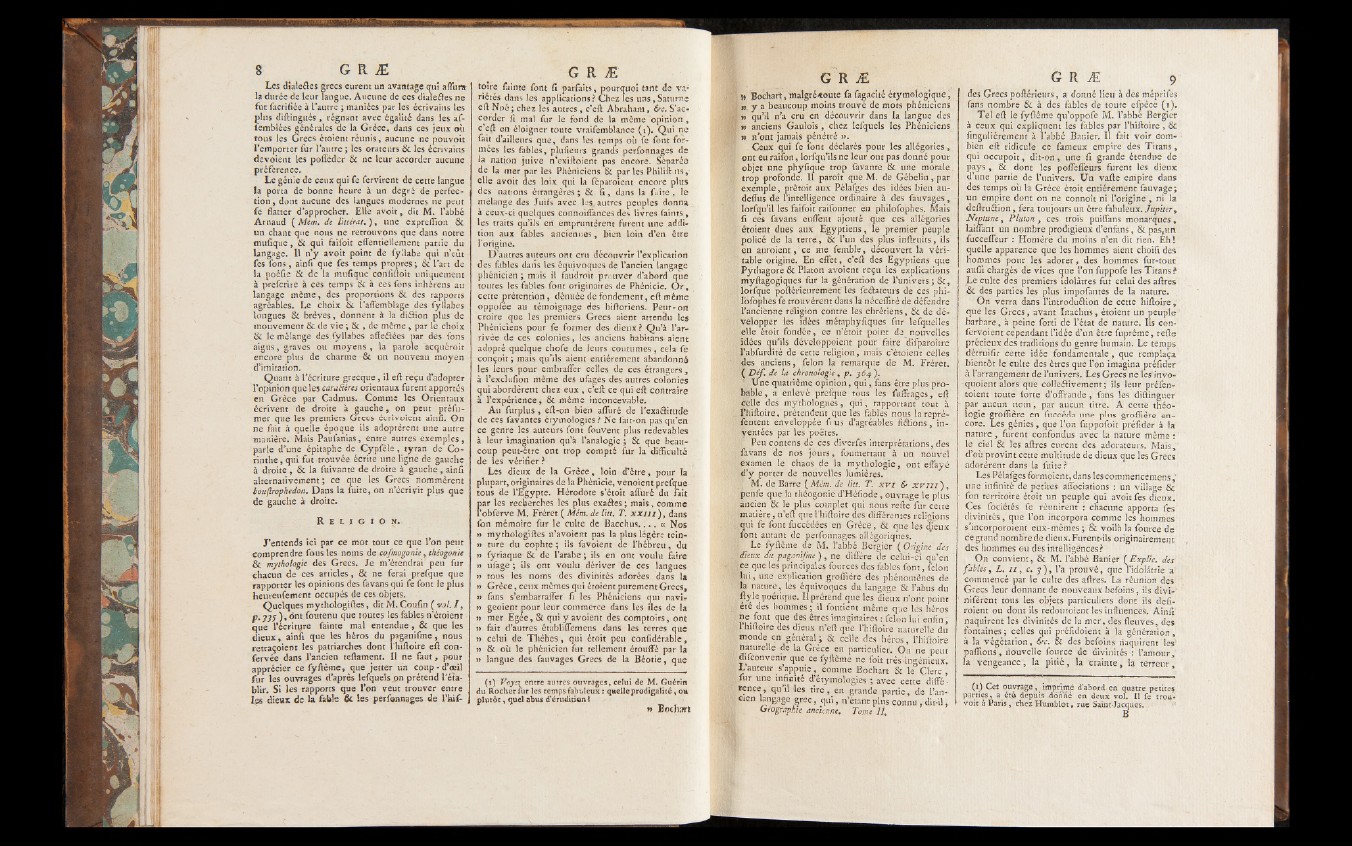
Les dîale&es grecs eurent un avantage qui afliift
la durée de leur langue. Aucune de ces dialeéfes ne
fur facrifiée à l’autre ; maniées par les écrivains les
plus diftingués , régnant avec égalité dans les af-
iemblées générales de la Grèce, dans ces jeux où
tous les Grecs étoient réunis, aucune ne pouvott
l’emporter fur l’autre ; les orateurs 8c les écrivains
dévoient les pofféder 8c ne leur accorder aucune
préférence.
Le génie de ceux qui fe fervirent de cette langue
la porta de bonne heure à un degré de perfection
, dont aucune des langues modernes ne peut
fe flatter d’approcher. Elle avoit, dit M. l’abbé
Arnaud ( Mém. de littéral. ) , une expreflton &
un chant que nous ne retrouvons que dans notre
mufique, & qui faifoit effentiellement partie du
langage. Il n’y avoit point de fyilabe qui n’eût
fes fons, ainfl que fes temps propres; 8c l’art de
la poéfie 8t de la mufique confiftoit uniquement
à préfcrire à ces temps & à ces fons whérens au
langage même, des proportions & des rapports
agréables. Le choix 6c l ’aflemblage des fyllabes
longues 8c brèves, donnent à la diélion plus de
mouvement & de vie ; & , de même, par le choix
6c le mélange des fyllabes affeftées par des fons
aigus, graves ou moyens , la parole àcquéroit
encore plus de charme & un nouveau moyen
d’imitation.
Quant à l’écriture grecque , il eft reçu d’adopter
l’opinion que les caractères orientaux furent apportés
en Grèce par Cadmus. Comme les Orientaux
écrivent de droite à gauche, on peut préfu-
mer que les premiers Grecs écrivoient ainfl. On
ne fait à quelle époque ils adoptèrent une autre
manière. Mais Paufanias, entre autres exemples,
parle d’une épitaphe de C yp fè le , tyran de Corinthe
, qui fut trouvée écrite une ligne de gauche
à droite, & la fuivante de droite à gauche, ainfl
alternativement ; ce que les Grecs nommèrent
iouftrophedon. Dans la fuite, on n’écrivit plus que
de gauche à droite.
R e l i g i o n .
J’entends ici par ce mot tout ce que l’on peut
comprendre fous les noms de cofmogonie, théogonie
& mythologie des Grecs. Je m’étendrai peu fur
chacun de ces articles, & ne ferai prefque que
rapporter les opinions des favans qui fé font le plus
heurenfement occupés de ces objets.
Quelques mythologiftes, dit M. Coufin ( vol. 1,
P* 335 )*^nt Soutenu que toutes les fables n’éroient
que l'écriture fainte mal entendue, 8c que les
dieux, ainfl que les héros du paganifme, nous
retraçoient les patriarches dont l’hiftoire eft con-
fervée dans l’ancien teflament. Il ne faut, pour
apprécier ce fyftême, que jetter un coup-d’oeil
fur les ouvrages d’après lefquels on prétend l’établir.
Si les rapports que l’on veut trouver entre
Içs dieux de la fable & les perfonnages de l'biftoire
fainte font fi parfaits, pourquoi tant de va*
nétés dans les applications ? Chez les uns, Saturne
eft Noé; chez les autres, c’eft Abraham, &c. S’accorder
fl mal fur le fond de la même opinion,
c’eft en éloigner toute vraifemblance ( i) . Qui ne
fait d’ailleurs que, dans les temps où fe font formées
les fables, plufieurs grands perfonnages de
la nation juive n’exiftoient pas èncorë. Séparée
de la mer par les Phéniciens 8c par les Philift.ns,
elle avoit des loix qui la féparoient encore plus
des nations étrangères ; 8c f l , dans la fuite , le
mélange des juifs avec les, autres peuples donna
à ceux-ci quelques connoiffances des livres faints ,
les traits qu’ils en empruntèrent furent une addition
aux fables anciennes, bien loin d’en être
l’origine.
D ’autres auteurs ont cru découvrir l’explication
des fables dans les équivoques de l’ancien langage
phénicien ; mais il faudroit prouver d’abord que
toutes les fables font originaires de Phénicie. O r ,
cette prétention , dénuée de fondement, eft même
oppofée au témoignage des hiftoriens. Petit-on
croire que les premiers Grecs aient attendu les
Phéniciens pour fe former des dieux? Qu’à 'l’arrivée
de ces colonies, les anciens habitans aient
adopté quelque chofe de leurs coutumes, cela fe
conçoit ; mais qu’ils aient entièrement abandonné
les leurs pour embraffer celles de ces étrangers,
à l’excluflon même des ufages des autres colonies
qui abordèrent chez eux , c’eft ce qui eft contraire
à l’expérience j & même inconcevable.
Au furplus , eft-on bien afliiré de l'exactitude
de ces favantes érymologiés ? Ne fait-on pas qu’en
ce genre les auteurs font fouvent plus redevables
à leur imagination qu’à l’analogie ; 8c que beaucoup
peut-être ont trop compté fur la difficulté
de les vérifier ?
Les dieux de la Grèce, loin d’être, pour la
plupart, originaires de la Phénicie, venoient prefque
tous de l’Egypte. Hérodote s’étoit alluré du fait
far les recherches les plus exaftes; mais, comme
obferve M. Fréret ( Mém. de litt. T. x x m ) , dans
Ion mémoire fur le culte de Bacchus.. . . « Nos
» mythologiftes n’avoient pas la plus légère tein-
n ture du cophte ; ils favoient de l’hébreu, du
ii fyriaque 8c de l’arabe ; ils en ont voulu faire
n ufage ; ils ont voulu dériver de ces langues
» tous les noms -des divinités adorées dans la
» Grèce, ceux mêmes qui étoient purement Grecs,
» fans s’embarraffer fl les Phéniciens qui navi»
a geoient pour leur commerce dans les îles de la
a mer Egee, 8c qui y avoient des comptoirs, ont
» fait d’autres établiffemens dans les terres que
n celui de Thèbes, qui étoit peu confidérable,
a 8c où le phénicien fut tellement étouffé par la
» langue des fauvages Grecs de la Béotie, que
entre autres ouvrages, celui de M. Guérin
du Rocher fur les temps fabuleux : quelle prodigalité, ou
plutôt, quel abus d’érudition {
n Bochart
Bocliart, malgré<oute fa fagacité étymologique,
n y a beaucoup moins trouvé de mots phéniciens
$ v qu’il n’a cru en découvrir dans la langue des
j; n anciens Gaulois, chez lefquels les Phéniciens
| n n’ont jamais pénétré ».
Ceux qui fe font déclarés pour les allégories ,
f ont eu railon, lorfqu’ils ne leur ont pas donné pour
1' objet une phyfique trop favante 8c une morale
f trop profonde. Il paroît que M. de Gébelin, par
1 exemple, prêtait aux Pélafges des idées bien au-
deflùs de l'intelligence ordinaire à des fauvages,
lorfqu’il les faifoit raifonner en philofophes. Mais
fi ces favans enflent ajouté que ces allégories
étoient dues aux Egyptiens, le premier peuple
policé de la terre, 8c l’un des plus inftruits, ils
en auroient, ce me femble, découvert la véritable
origine. En effet, c’eft des Egyptiens que
Pythagore 8c Platon avoient reçu les explications
myftagogiques fur la génération de l’uni vers ; & ,
lorfque poftérieuremënt'les feâateurs de ces phi-
îbfophes fe trouvèrent dans la néceffité de défendre
l’anciènne religion contre les chrétiens, 8c de développer
les idées métaphyfiques fur lefquelles
elle étoit fondée, ce n’étoit point de nouvelles
idées qu’ils déveïoppoient pour faire difparoître
l’abfurdité de cette religion, mais c’étoient celles
des anciens, félon la remarque de M. Fréret.
( D é f de la chronologie , p. 364 ).
Une quatrième opinion, qui, fans être plus probable
, a enlevé prefque tous les fuffrages, eft
celle des mythologues, qui * rapportant tout à
l’hiftoire, prétendent que les fables nous la repr.é-
fentent enveloppée feus d’agréables fiâions, inventées
par les poëtes.
Peu contens de ces diverfes interprétations, des
favans de nos jours, foumettant à un nouvel
examen le chaos de la mythologie, ont effayé
d’y porter de nouvelles lumières.
! M. de Barre ( Mém. de litt. T. XVl & x v m ) ,
penfe que la théogonie d’Héfiode, ouvrage le plus
ancien 8c le plus complet qui nous refte fur cette
matière, n’eft que lliiftoire des différentes religions
qui fë font fuccédées en Grèce, 8c que les ffiéùlx
font alitant de perfonnages. allégoriques.
_ Le fyftême de M. l’abbé Bergier ( Origine des
dieux du paganifme ) , ne diffère de celui-ci qu’en
; ce que les principales fources des fables font, félon
lu i, une explication groffière des phénomènes de
la nature, les équivoques du langage 8c l’abus du
ftyle poétique. Il prétend que les dieux n’ont point
été des hommes ; il fondent même que lés héros
ne font que des êtres imaginaires : félon lui enfin,
l’hiftoire des dieux n’ eft que Thiftotré naturelle du
inonde en général; 8c celle des héros, l’hiftoire
naturelle de la Grèce en particulier. On ne peut
difeonvenir que ce fyftême ne foit très-ingénieux.
L auteur s’appuie, comme Bochart 8c le Clerc,
fur une infinité d’étymologies ; avec cette différence,
qu il'les tire, en grande partie, de l’ancien
langage grec, q u i, n’étant plus connu, dit-il,
Géographie ancienne. Tome I f
des Grecs poftérieurs, a donné lieu à des méprifes
fans nombre 8c à des fables de toute efpèce (1 ).
Te l eft le fyftême qu’oppofe M. l’abbé Bergier
à ceux qui expliquent les fables par l’hiftoire, 8c
finguliérement à l ’abbé Banier. Il fait voir combien
eft ridicule ce fameux empire des Titans,
qui occupoit, dit-on, une fl grande étendue de
pay s , 8c dont les poffeffeurs furent les dieux
d’une partie de l’uniVers. Un vafte empire dans
des temps où la Grèce étoit entièrement fauvage;
un empire dont on ne connoît ni l’origine, ni la
deftruâion, fera toujours un être fabuleux. Jupiter >
Neptune, Pluton, ces trois puiffans monarques,
laiffant un nombre prodigieux d’enfans, 8c pasfun
fucceffeur : Homère du moins n’en dit rien. Eh !
quelle apparence que les hommes aient choifi des
hommes pour les adorer, des hommes fur-tout
auffi chargés de vices que l’on ftippofe les Titans?
Le culte des premiers idolâtres fut celui des aftres
8c des parties les plus impofantes de la nature.
On verra dans l’introduéHon de cette hiftoire,'
que les Grecs, avant Inachns, étoient un peuple
barbare, à peine forti de l’état de nature. Ils con-
fervoient cependant l’idée d’un être fuprême, refte
précieux des traditions du genre humain. Le temps
détruifir cétte idée fondamentale, que remplaça
bientôt le culte des êtres que l’on imagina préfider
à l’arrangement de l’univers. Les Grecs ne les invo-
quoient alors que collectivement; ils leur préfen-
toient toute forte d’offrande, fans les diftinguer
par aucun nom , par aucun titre. A cette théologie
groffière en fuccéda une plus groffière encore.
Les génies, que l’on fuppofoit préfider à la
nature, furent confondus avec la nature même:'
le ciel 8c les aftres eurent des adorateurs. Mais,
d’où provint cette multitude de dieux que les Grecs
adorèrent dans la fuite ?
Les Pélafges formoient, dans les-commencemens
une infinité de petites affociations : un village 8ç
fon territoire étoit un peuple qui avoit fes dieux.
Ces fociétés fe réunirent : chacune apporta fçs
divinités, que l’on incorpora comme les hommes
s’incorporoient eux-mêmes ; 8c voilà la fource de
ce grand nombre de dieux. Furent-ils originairement
des hommes ou des intelligences?
On convient, 8c M. l’abbé Banier ( Explic. des
fables, L. 1 1 , c. 3 ) , l’a prouvé, que l'idolâtrie a
commencé par le culte des aftres. La réunion des
Grecs leur donnant de nouveaux befpins, ils divi-
nifèrènt tous les objets particuliers dont ils defi-
roient ou dont ils redoùtoient les influencés. Ainft
naquirent les divinités de la mer, des fleuves, des
fontaines; celles qui préfidoient à la génération,
à la végétation, &c. 8ç des befoins naquirent les'
paffions, Nouvelle fource de divinités’: l’amour,
la vengeance; la pitié, la crainte, 1^ terreur ,
(1) Cet ouvrage, imprimé d’abord en quatre petites
parties, a été depuis donné en deux vol. Il fe trou*
voit à Paris, chez Humblot, rue Saint-Jacques,
B