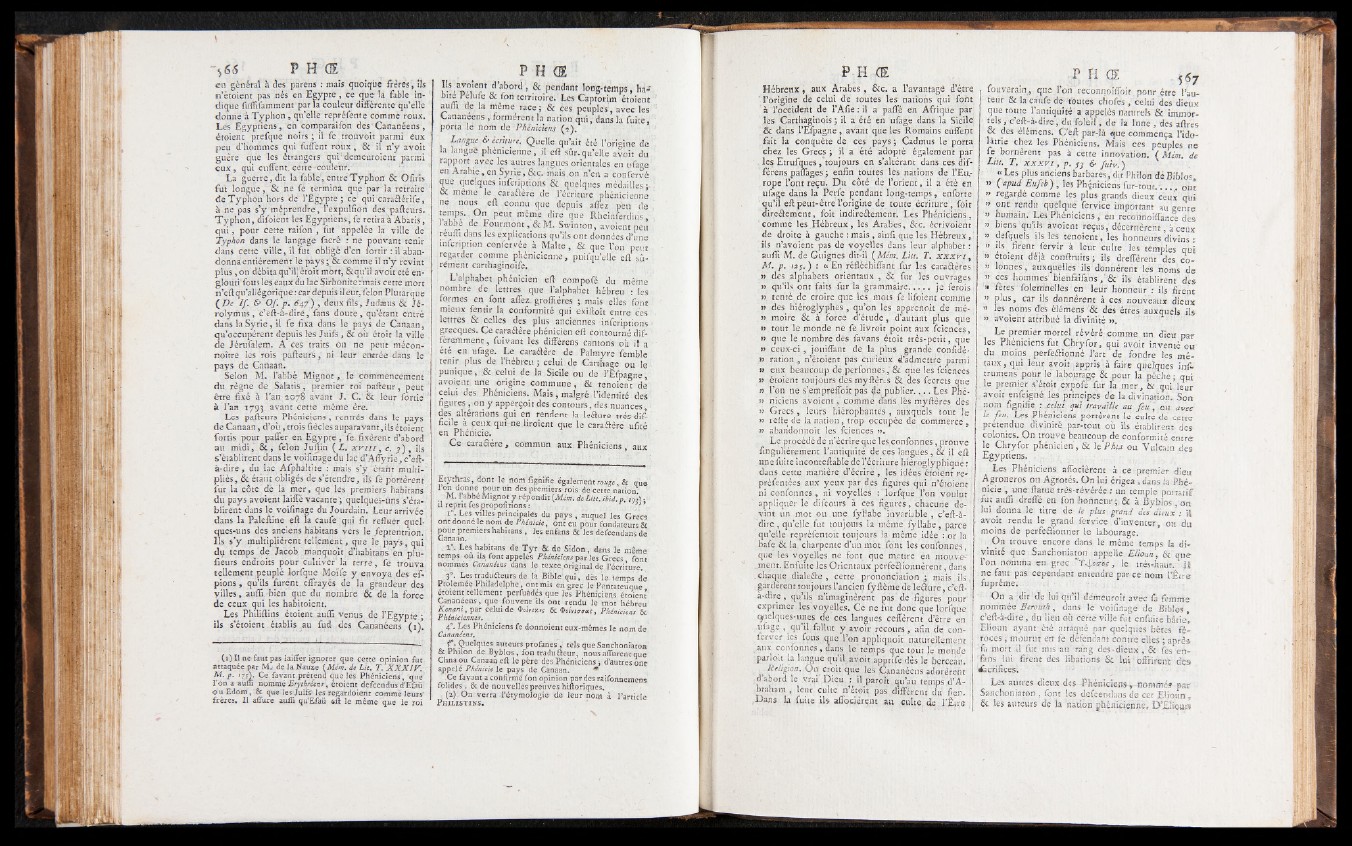
en général a des parens : mais quoique frères, ils
n’étoient pas nés en Egypte, ce que la fable indique
fuffifamment par la couleur différente qu’elle
donne à Typhon, qu’elle repréfente comme roux.
Les Egyptiens , eh comparaifon dés'Cananéens,
•étoient prefque noirs ; il fe trouvoit parmi eux
peu d’hommes qui fuffent rou x , & il n’y avoit
guère que les étrangers qui: demeuraient parmi
eu x , qui euffent, cette côiïlë'ùri
La guerre, dit la fable, entre Typhon: & Offris
fut longue, & ne fé termina que par la retraite
de Typhon hors de l’Égypte; ce qui caraClérife,
à ne pas s’y méprendre, l’expulfion des pafteurs.
Typ hon, difoiènt les Egyptiens, fe retira à Abaris,
q u i, pour cette raifon , fut appelée la ville de
Typhon dans le langage facré : ne pouvant tenir
dans cette ville, il fut obligé d’en fortir : il abandonna
entièrement le pays; & comme il n’y revint
plus , on débita qu’il] étoit mort, i&qu’il avoit été englouti
fous les eaüx du lac Sirbonrtermais cette mort
n’eft qu’allégorique : car depuis il eût, félon Plutarque
(D e If. & O f p. 6 4 7 ) , deux fils, Judæus & Jé-
rolymus , c’ eft-à-diré, fans doute, qu’étant entré
dans la S y r ie , il fe fixa dans le pays de Canaan,
qu’occupèrent depuis les Juifs, & où étoit la ville
de Jérufalem. A ces traits on ne peut mécon-
noître les rois pafteurs, ni leur entrée dans le
pays de Canaan.
Selon M. l’abbé Mignot, le commencement
du règne de Salatis / premier roi pafteur, peut
être fixé à l ’an 2078 avant J. C. & leur fortié
à l ’an 1793 avant cette même ère.
Les pafteurs Phéniciens , rentrés dans le pays
de Canaan, d’o ù , trois fiècles auparavant, ils étoient
fortis pour paffer en Egypte, fe, fixèrent d’abord
au midi, & , félon Juftin (Z . x v i h , c. y ) , ils
s’établirent dans le voifinage du lac d’A ffyrië, c’eft-
à-dire, du lac Afphâltite : mais s’y .‘étant multi-'
pliés, & étant obligés de s’étendre, ils fe portèrent
fur la côte dè la mer, que les premiers hâbitans
du pays avoient laiffé vacante ; quelques-uns s’établirent
dans le voifinage du Jourdain. Leur arrivée
dans la Paleftine eft la caufe qui fit refluer quelques
uns des anciens hâbitans vers le feptentrion.
Ils s’y multiplièrent tellement, que le pay s , qui
dq temps de Jacob manquqit d’habitans en plu-
fieurs endroits pour cultivér‘ la terre , fe trouva,
tellement peuplé lorfque Moïfe y envoya des ef«
pions , qu’ils furent effrayés de la grandeur des
yilles, auffi. bien que du nombre & de la force
de ceux qui les habitoient.
Les Philiftins étoient auffi venus de l’Egypte ;
ils s’étoient établis au fud des Cananéens (1).
(1) Il ne faut pas laifïer ignorer que çette opinion fut
attaquée par M. de la Natfze ( Mém. de Lit. T. X X X IV .
M-p. 17J). Ce favant prétend que les P héniciensqu e’
l’on a auffi nommé Erythréens, etoient deféendus d’Eûm!
ou Edom, & que les julfs' les regardoient comme leurs'
frères. Il allure auffi qu’Efaü eft le même que le roi
> & pendant long-temps, ha-î
8c fon territoire. Les Captorim étoient
aiim dé la même race ; & ces peuples, avec les
Cananéens, formèrent la nation qui, dans la fuite,
porta le nom de Phéniciens (a).
Langue & écriture. Quelle qu’ait été ^origine de
la langue phénicienne, il eft sûr.qu’elle avoit du
rapport avec les autres langues orientales en ufage
en Arabie, en Syrip, &c. mais.on n’en a confervé
que quelques inferiptions & quelques médailles
& même le caractère de l’écriture phénicienne
ne nous eft connu que depuis allez peu de
° n Pe>«. même dire que Rheinferdins,
1 abbe de Fourmont, & M. Swruton, avoïent peu
réuflî dans les explications qu’ils ont données d’une
infeription conservée à Malte, & que l’on peut
regarder comme phénicienne, puifqu’elle eft sûrement
carthaginoife.
L’alphabet phénicien eft compofé du même
nombre de lettres, que l’alphabet hébreu : les
formes en font aftez. groffières ; mais elles font
mieux fentir la conformité qui exiftoit entre ces
lettres & celles des plus anciennes inferiptions
grecques. Ce caraélère phénicien eft contourné différemment
, fuivant les différens cantons où il a
été en ufage. Le carajftère de Palmyre femble
tenir plus de l’hébreu; celui de Carthage ou le
punique, & celui de la Sicile ou de l’Efpagne,
avoient une origine commune, & tenoient dé
celui des Phéniciens. .Mais , malgré,l’identité des
figures , on y apperçoit des contours, des nuances,
des altérations qui en rendent la leâure très-dif’ -'
ficile à ceux qui-ne liroient que le caraélère ufitp
en Phénicie.
Ce caraélère , commun aux: Phéniciens, aux
Etythras, dont le nom fighifie également rouge, & qUÔ
l’on donne pour un des premiers-rois de cette nation/ '
M. l’abbé Mignot y répondit {Mém. de Lin. ïbid. p. /9?V
il reprit fes propositions : c ■ /*
I". Les villes principales du pays , auquel les Grées
ont donne le nom de Phénicie, ont eu pour fondateurs &
pour premiers habitans , les enfans & les defeendans de
Canaan.
Les habitans de T y r & de Sidon, dans le même
temps ou ils font appelés Phéniciens par les Grecs font
nommés Cananéens dans le texte .original de l’écriture.
3°- Lestraducteurs de la Bible'qui, dès le temps de
Ptolemée Philadelphe, ont mis en grec le Pentateuque
étoient tellement perfuàdés que les Phéniciens étoient
Cananéens, que fou vent ils ont rendu le mot hébreu
Kenani, par celui de $oiWsf & $oivi<r<r«ts, Phéniciens &
Phéniciennes.
4°. Les Phéniciens fe donnoient eux-mêmes le nom de
Cananéens.
& Quelques auteurs profanes , tels queSanchoniaton
& Philon de Byblos , fén traducteur, nous aflùrent que
Chna ou Canaan eft le père des Phéniciens ; d’autres ont
appelé Phénicie le pays de Canaan. m-
Ce fayant a cohfirmé fon opinion par des raifonnernens
félidés . & de nouvelles preuves hiftoriques.
; (2) On verra l'étymologie de leur nom à l ’article Philistins.
Hébreux, aux Arabes , &c. a l’avantagé d’être
‘ l’origine de celui de toutes les nations qui font
à l’occident de l’Afie : il a paffé en Afrique par
lès Carthaginois ; il a été en ufage dans la Sicile
& dans l’Efpagne , avant que les Romains euffent
fait la conquête de ces pays ; Cadmus le porta
chez les Grecs ; il a été adopté également par
les Etrufques/toujours en s’altérant dans ces différens
paffages ; enfin toutes lès nations de l'Europe
l’ont reçu. Du côté de l’orient, il a été en
ufage dans la Perfe pendant long-temps, enforte
qu’il eft peut-être l’origine de toute écriture, foit
directement, foit indireCtemenr. Les Phéniciens,
comme les Hébreux, les Arabes, &c. écrivoiént
de droite à gauche : mais , ainfi que les Hébreux,
ils n’avoient pas de voyelles dans leur alphabet :
aufii M. de Guignes dit-il (Mém. Lut. T. x X x v i ,
M. p. 127. ) : u En réflèchiffant fur Iss caractères i
V des alphabets orientaux , & fur les ouvrages
» qu’ils, ont faits fur la grammaire..... je ferais
». tenté de croire que les mots fe lifoient comme
» des Hiéroglyphes, qu’on les apprenoit de më-
» moire & à force d’étude, d’autant plus que
»> tout le monde ne fe livroit point aux fciences,
»> que le nombre des favans étoit très-petit, que
» ceux-ci, jouiffant de la plus grande confidé-
» ration , n’étoient pas curieux d’admettre parmi
» eux beaucoup de perfonnes , & que les fciences
» étoient toujours des myftèfcs & des fecrets que
n l’on ne s’empreffoit pas de, publier.. . . Les Phé-
» niciens avoient, comme dans lès myftères des
» Grecs, leurs hiérophantes , auxquels tout le
« refte de la nation, trop occupée de commerce ,
» abandonnoit les fciences ».
Le procédé de n’écrire que les confonnes, prouve !
finguliérement l’antiquité de ces langues, & il eft
une fuite inconteftable de l’écriture hiéroglyphique : I
dans cette manière d’écrire , les idées étoient re-
préfentées aux yeux par des figures qui n’étoient
ni confonnes , ni voyelles : lorfque Ton voulut
appliquer le difeours à ces figures, chacune devint
un mot ou une fyfiabe invariable , c’eft-à-
dire, qu’elle fut toujours la même fyllabe, parce
qu’elle repréfentoit toujours la même idée : or la
bafe & la charpente d’un mot font les confonnes,
que les voyelles ne font que mettre en mouvement.
Enfuite les Orientaux perfectionnèrent, dans j
.chaque diale été , cette prononciation mais ils,:
gardèrent toujours l’ancien fyftême de leÇïure, c’eft-
à-clire, qu’ils n’imaginèrent pas de figures pour
exprimer les voyelles. Ce ne fut donc que lorfque
quelques-unes de ces langues ceffèrent d’être en
ufage , qu il fallut y avoir recours, afin de con-
ferver les fons que l’on appliquoit naturellement
aux confonnes, dans le temps que tout Je monde
parloit la langue qu’il,avoit .apprife dès le berceau.
■ O li croit que leS Cananéens adorèrent
d’abord le vrai’ Dieu : il paroît qu’au temps d’A- I
braham , leur culte n’étoit pas différent du fien. ;
(Dans la fuite ils- affocièrçnt au culte de l'Être
■ fouverain,, que.l’on reconnoiffoit. pour .être l’auteur
& la caufe de toutes chofes / celui des dieux
que toute l’antiquité a appelés naturels & immor-
' J l s , c’eft-à-dire, du folèil, de la lune, des aftres
& des élémens. C'èft par-là que commença l’idolâtrie
chez les Phéniciens. Mais ces peuples ne
fe bornèrent pas à cette innovation. { Mém. de
Lut. T. x x x v i , p. yy & fuiv. )
« Les plus anciens barbares, dit Philon dê Biblos
» ( apud Eufeb ) , les Phéniciens fur-tout.. . . . onr
» regardé comme Içs plus grands dieux ceux qui
» ont rendu quelque fervice important au genre
» humain. Les Phéniciensen reconnoiflance des-
” biens qu’ils avoient reçus, décernèrent, à ceux
» dsfquels ils les tenoient, les honneurs divins r
» ils firent fervir à leur culte les temples qui
” etoient déjà conftruits ; ils dreffèrent des co-
>) lonnesauxquelles ils donnèrent les noms de
” ces hommes', bienfaifans , ils établirent des
» fêtes ■ folemnelles en leur hômieur : ils firent
” plus, car ils donnèrent à ces nouveaux dieux
» les noms des élémens & des êtres auxquels ils
» àvoient attribué la divinité ».
Le premier mortel révéré, comme un dieu par
les Phéniciens fut Chryfor, qui avoit inventé oa
du moins perfectionné Part de fondre les métaux
, qui leur avoit appris -à faire quelques infi.
trumens poür le labourage & pour la pêche ; qui
le premier s’ètoit expofé. fur la mer, qui, leur
avoit enfeigné les principes de la divination. Sort
nom fignifie : .celyi qui travaille au f e u , ou avec
le feu. Les Phéniciens portèrent le culte de cette
prétendue divinité par-tout où ils établirent des
colonies. On trouve beaucoup de conformité entre
le Chryfor phénicien, & le Phta ou Vulcain des
Egyptiens.
Les Phéniciens affocièrent à . ce premier dieu
Agroneros ou Agrotès. On lui érigea -, dans la Phénicie
, uné.ftatue très-révérée: un temple portatif
fut auffi dreffé en fon honneur;: & à Byblos , ou
lui donna le titre de- le p lu s - grand des dieux : il
avoit rendu le grand fervice d’inventer, ou du
moins de perfectionner le labourage.
On trouve encore dans le même temps la divinité
que San ch onia ton appelle Elioun, & que
l’on nomma en grec/Y^ocros-, le très-haut. Il
ne faut pas cependant entendre par ce nom l’Être
fuprême.
On a ;dit 'de lui qu’il demeuroif avec fa femme
nommée Beroiith, dans le voifinage de Bibles,
c’eft-à-dire , du lieu où cette ville fut enfuite bâtie,
Elioun ayant été attaqué par quelques bêtes féroces
/mourut en fe défendant contre elles ; après-
fa mort il fut mis au 'rang des‘ dieux , & fes en-
fans lui firent des libations & lui ' offrirent des
Sacrifices';
Les autres dieux des Phéniciens,, nommés par
Sanchoniaton , font les defeendans de cef .Eljoun y
& les auteurs de la nation phénicienne, D ’Eliouni