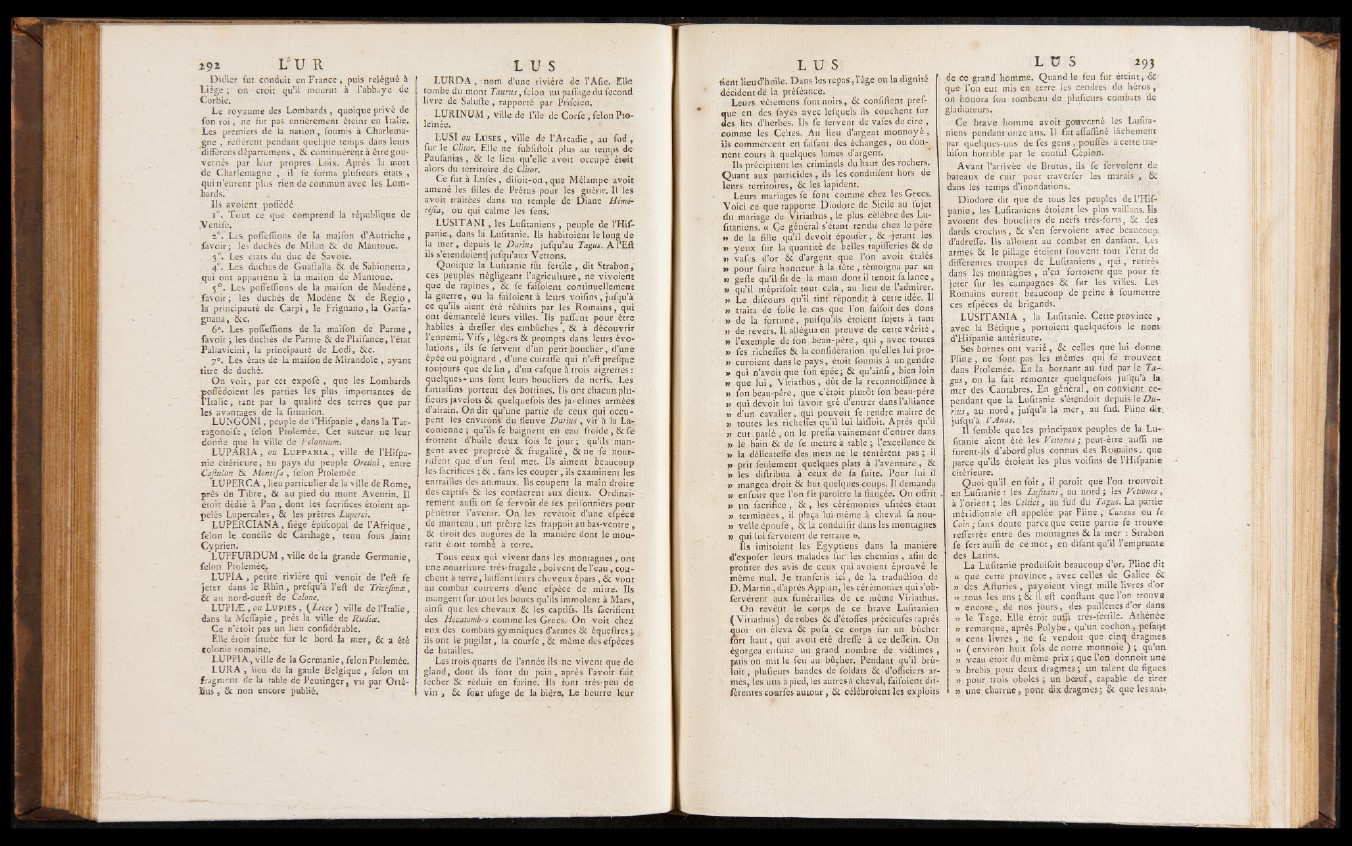
191 L'U R Didier fut conduit en France, puis relégué à
Liège ; on croit qu’il mourut à l’abbaye de
Corbie.
Le royaume des Lombards, quoique privé de
l'on ro i, ne fut pas entièrement éteint en Italie.
Les premiers de la nation, fournis à Charlemagne
, relièrent pendant quelque temps dans leurs
ciifférens départemens , 8c continuèrent à être gouvernés
par leur propres Loix. Après la mort
de Charlemagne , il fe forma plufieurs états ,
qui n’eurent plus rien de commun avec les Lombards.'
Ils avoient poffédé
i° . Tout ce que comprend la république de
,Venife.
a°. Les poffefiions de la maifon d’Autriche ,
favoir; les duchés de Milan 8c de Mantoue.
30. Les états du duc de Savoie.
4°. Les duchés de Guaftalla 8c de Sabionetta,
qui ont appartenu à la maifon de Mantoue.
5°. Les poffeffions de la maifon de Modène,
favoir ; les duchés de Modène 8c de Regio,
la principauté de Carpi, le Frignano, la Garfa-
gnanà, &c.
6°. Les poffeffions de la maifon de Parme,
favoir ; les duchés de Parme 8c de Plaifance , l’état
Pallavicini, la principauté de Lodi, &c.
7°. Les états de la maifon de Mirandole , ayant
titre de duché.
On voit, par cet expofé , que les Lombards
poffédoient les parties les plus importantes de
l ’Italie, tant par la qualité des terres que par
les avantages de la fituation.
LUNGONI, peuple de l’Hifpanie , dans la Tar-
ragonoife, félon Ptolemée. Cet auteur ne leur
donne que la ville de Pelontium.
LU PAR IA, ou Lupparia , ville de l’Hifpa-
nie citérieure, au pays du peuple Oieùni, entré
Ca (lu Ion 8c Menti fa , félon Ptolemée.
LUPERCA ,lieu particulier de la ville de Rome,
près do Tibre, & au pied du mont Aventin. 11
étoit dédié à Pan , dont les facrifices étoient appelés
Lupercales , & les prêtres Lupercï.
LUPERCIANA, fiège épifcopal de l’Afrique,
félon le concile de Carthage, tenu fous iaint
Cyprien.
LUPFURDUM , ville de la grande Germanie,
félon Ptolemée^
LU P IA , petite rivière qui venoit de l’eft fe
jeter dans le Rhin, prefqu’à l’eft de Tricefima,
6c an nord-oueft de Calone.
LUPIÆ , ou Lupies , ( Lecce ) ville de l’Italie,
dans la Meffapie, près la ville de Rudia.
Ce n’étoit pas un lieu confidérable.
Elle étoit fituée fur le bord la mer, & a été
colonie romaine.
LUPPIA, ville de la Germanie, félon Ptolemée.
L U R A , lieu de la gaule Belgique, félon un
fragment de la table de Peutinger, vu par Orté-
Üus, 8c non encore publié.
L U S
L U R D A , nom d’une rivière de l’Afie. Elle
tombe du mont Taurus, félon lin paffage du fécond
livre de Salufte , rapporté par Prifcien.
LURINUM , ville de l’ile de C orfe, félon Ptolemée.
LUSIow Lu se s , ville de l’Arcadie, au fud ,
fur le Clitor. Elle ne fubfiftoit plus au temps de
Paufanias,. & le lieu qu’elle avoit occupe étoit
alors du territoire de Clitor.
Ce fut à Lufes, difoit-on , que Mélampe avoit
amené les filles- de Prétus pour les guérir. Il les
avoit traitées dans un temple de Diane tiémè-
réfia, ou qui calme les fens.
LU SITAN I, les Lufitaniens , peuple de l’Hifpanie
, dans la Lufitanie. Ils habitoient le long de
la mer, depuis le Durius jufqu’au Tagus. A l ’Efl
ils s’étendoient} jufqu’aux Vettons.
Quoique la Lufitanie fût fertile , dit Strabon ,'
ces peuples négligeant l’agriculture, ne vivoient
que^de rapines, & fe faifoient continuellement
la guerre, ou la faifoient à leurs voifins, jufqu’à
ce qu’ils aient été réduits par les Romains, qui
ont démantelé leurs villes. Ils paffcnt pour être
habiles à dreffer des embûches , & à découvrir
l’ennemi. Vifs , légers & prompts dans leurs évolutions,
ils fe fervent d’un petit bouclier, d’une
épée ou poignard , d’une cuiraffe qui n’eft préfque
toujours que de lin , d’un cafque à trois aigrettes :
quelques - uns font leurs boucliers de nerfs. Les
fantaifins portent des bottines. Us ont .chacun.plufieurs
javelots & quelquefois des javelines armées
d’airain. On dit qu’une partie de ceux qui occupent
les environs du fleuve Durius, vit à la La-
conienne ; qu’ils fe baignent en éau froide , & fe
frottent d’huile deux fois lë jpur ; qu’ils mangent
avec propreté^ & frugalité, & ne fe nourrirent
que, d’un feul met. Ils aiment beaucoup
les facrifices ; 8c, fans les couper, ils examinent les
entrailles des animaux. Us coupent la main droite
des captifs & les confacrent aux dieux. Ordinairement
-auffi on fe fervoit de lès prifonniers pour
pénétrer l’avenir. On. les revêtoit d’uné efpèce
de manteau , un prêtre les frappoit au bas-ventre,
8c droit des augures de la manière dont le mourant
éioit tombé à terre.
Tous ceux qui vivent dans les montagnes, ont
une nourriture très-frugale, boivent de l’eau, couchent
à terre, laiffent leurs cheveux épars , & vont
au combat couverts d’-une efpèce de mitre. Ils
mangent fur tout les boucs qu’ils immolent à Mars,
ainfi que les chevaux & les captifs. Ils facrifient
des Hécatombes comme les Grecs.- On voit chez
eux des combats gymniques d’armes & équeftresy
ils ont le pugilat, la courfe , 8c même des efpèces
de batailles.
Les trois quarts de l’année ils ne vivent que de
gland, dont ils font du pain, après l’avoir fait
lécher & réduit en farine. Ils font très-peu de
vin , 6c font ufage de la bière. Le beurre leur
L U S rient lieu d’huile. Dans les repas, l’âge ou la dignité I
décident dë la préféance.
Leurs, vêtemens font noirs, 8c confident presque
en des fayes avec lefquels ils couchent fur
des lits d’herbes. Ils fe fervent de vafes de cire ,
comme les Celtes. Au lieu d’argent monnoyé,
ils commercent en faifant des échanges, ou don-^
nent cours à quelques lames d’argent.
Ils précipitent les criminels du haut des rochers.
Quant aux parricides , ils les conduifent hors de
leurs territoires, & lés lapident.
Leurs mariages fe font comme chez les Grecs.
Voici ce que rapporte Diodore de Sicile au fujet
du mariage de Viriathus, le plus célébré des Lufitaniens.
« Ce général s’étant rendu chez le père
» de la fille qu’il devoit époufer, & -jetant les
» yeux fur la quantité de belles tapifferies & de
vafes, d’or 8c d’argent que l’on avoit étalés
w pour faire honneur à la-fête , témoigna par un
m gefie qu’il fit de la main dont il tenoit fa lance,
» qu’il méprifoit tout cela, au lieu de l’admirer.
» Le difeours qu’il tint répondit à cette idée. Il
» traita de folie, le cas. que l’on faifoit des dons
» de la fortuné, puifqu’ils. étoient fujets à tant
v de revers. Il allégua en preuve de cette vérité ,
» l’exemple de fon beau-père, qui , avec toutes
» fes richefles & la confidération. qu’elles lui pro-
» curoient dans le pays, étoit fournis a un gendre
v qui n’avoit que fon épée & qu’ainfi , bien loin
w que lu i, Viriathus, dût de la reconnoiflance à
» fon beau-père, que c’étoit plutôt fon beau-père
» qui devoit lui favoir gré d’entrer dans l’alliance
» d’un cavalier, qui pouvoit fe rendre maître de
» toutes les richefles qu’il lui laiffoit. Après qu’il
» eut parlé , on le preffa vainemenr d’entrer dans
» le bain 8c de fe mettre à table ; l’excellence Ôc
w la délicateffe des mets ne le tentèrent pas ; il
» prit feulement quelques plats à l ’aventure, &
» les diftribua à ceux de fa fuite. Pour lui il
v mangea droit 8c but quelques coups. Il demanda
m enfuite que l’on fît paroître la fiangée. On offrit
» un facrifice , 8c, les cérémonies ufitées étant
» terminées, il plaça lui-même à cheval fa nou-
» velle époufe , 8c la conduifit dans les montagnes
» qui lui fervoient de retraite n.
Ils imitoient les Egyptiens dans la manière
d’expofer leurs malades fur les chemins, afin de
profiter des avis de ceux qui avoient éprouvé le
même mal. Je tranferis i c i , de la traduélion de
D. Martin, d’après Appian, les cérémonies quis’ob-
fervèrent aux funérailles de ce même Viriathus.
On revêtit le corps de ce brave Lufitanien
( Viriathus) de robes 8c d’étoffes préeieufes : après
quoi on éleva 8c pofa ce corps fur un bûcher
fort haut, qui avoit été drefle à ce deffein. On
égorgea enfuite un grand nombre de viétimes ,
puis on mit le feu au bûcher. Pendant qu’il brû-
lo i t , plufieurs bandes de foldats 8c d’officiers armés,
les uns à pied, les autres à cheval, faifoient différentes
coi&rfes autour, 6c célébroient les exploits
L U S 1 9 ?
de ce grand homme. Quand le feu fut éteint, 8c
que l’on eut mis en terre les cendres du héros,
on honora fon tombeau de plufieurs combats de
gladiateurs.
Ce brave homme avoit gouverné les Lufitaniens
pendant onze ans. Il fut affafllné lâchement
par quelques-uns de fes gens, pouffes à cette tra-
hifon horrible par le conful Cép-iôn.
Avant l’arrivée de Brutus, ils fe fervoient de
bateaux de cuir pour traverfer les marais , 6c
dans les temps d’inondations.
Diodore dit que de tous les peuples de l’Hif-
panie, les Lufitaniens étoient les plus vaillans. Iis
avoient des boucliers de nerfs très-forts, & des
dards crochus, & s’en fervoient avec beaucoup,
d’adreffe. Ils alloient au combat en danfant. Les
armes 8c le pillage étoi,ent fouvent tout l’état de
différentes troupes de Lufitaniens , qui, retirés *
dans les montagnes, n’en Tortoienr que pour fe
jeter fur lès campagnes 8c fur les villes. Les
Romains eurent beaucoup de peine à foumettre
ces efpèces de brigands.
LUSITANIA , la Lufitanie. Cette province ,
avec la Bétique , portoient quelquefois le nom
d’Hifpanie antérieure, t. .
Ses bornes ont varié , & celles que lui donne
Pline, ne font pas les mêmes qui fe trouvent
dans Ptolemée. En la bornant au fud parTe Ta-
gus, on la fait remonter quelquefois jufqu’à la
mer des Cantabres. En général, on convient ce-,
pendant que la Lufitanie s’étendoit depuis le Du-
rius9 au nord, jufqu’à la mer, au fud. Pline dit:
jufqu’à /’Anas. ; . ,
Il femble que les principaux peuples de la Lu- ,
fitanie aient été les Vettones peut-être aufli ne
furent-ils d’abord plus connus des Romains j que
parce qu’ils étoient les plus voifins de l’Hifpanie
citérieure.
Quoi qu’il en fo it, il paroît que l’on tronvoit
en Lufitanie : les Lufitani, au nord ; les Vettones^,
à l’orient ; les Celtici, au fud du Tagus. La partie
; méridionale eft appelée par Pline , Cuneus ou le
• Coin ; fans doute parce que cette partie fe trouve
; refferrée entre des montagnes 8c la mer : Strabon
‘ fe fert aufli de ce mot, en difant qu’il l’emprunte
■ des Latins.
La Lufitanie produirait beaucoup d’or. Pline dit
u que cette province, avec celles de Galice &
» des Afturies , payoient vingt mille livres d’or
» .tous les ans ; & il eft confiant que l’on trouve
î> encore, de nos jours, des paillettes d’or dans
» le Tage. Elle étoit aufli très-fertile. Athenée
» remarque, après Polybe, qu’un cochon., pefai^t
» cent livres , ne fe vendoit que cinq dragmes
» ( environ huit fols de notre monnoie ) ; qu’un
» veau étoit du même prix ; que l’on donnoit une
» brebis pour deux dragmes j un talent de figues
n pour trois oboles ; un boeuf, capable de tirer
» une . charrue, pour dix dragmes j 8c que les ain-»