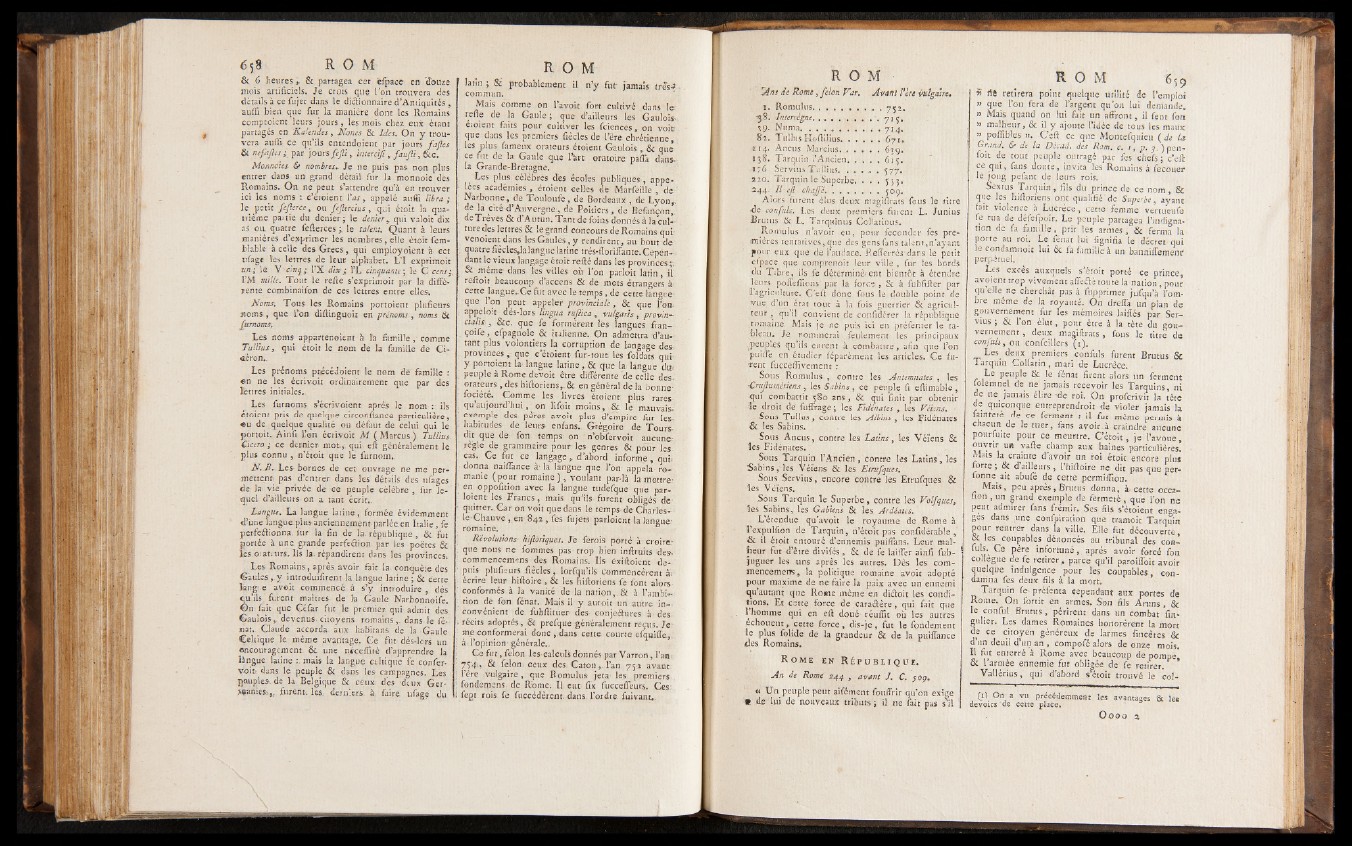
& 6 heures ~y & partagea cet èipace en douze
mois artificiels. Je crois quç Von trouvera des
détails à ce fujet dans le dictionnaire d’Antiquités ,
aufli bien que fur la manière dont les Romains
comptoient leurs jours, les mois chez eux étant
partagés en 'Kalend.es, Noues & Ides. On y trouvera
aufli- ce qu’ils entendoient par jours fafles
Si nefajles ; par jours fe fliinte ràfi y faufli, &c.
Monnoies & nombres- Je ne puis pas non plus
entrer dans un grand détail fur la monnoie des
Romains. On ne peut s’attendre qu’à en trouver
ici les noms : c’étoient lW r appelé aufli libra ;
le petit feflerce, ou fefltrdus , q.ui étoit la quatrième
partie du denier; le denierr qui valoir dix
nè oit quatre feflerces le talent. Quant à leurs
manières d’exprimer les nombres, elle étoit fem-
blable à celle des Grecs, qui employoient à cet
ufagc les lettres de leur alphabet. L’I exprimoit
un; le Y 'cinq; VX dix; YL cinquante ; le C cent;..
l’M mille. Tout le refie s’exprimoit par la différente
combinaifon de ces lettres entre elles*
Noms. Tous les Romains portoient plufieurs
noms, que l’on difiinguoit en prénoms, noms Si
. furnoms.
Les noms appartenoient à la famille,* comme
Tullius y qui étoit le nom de. la famille de C i- ,
eéron..
Les prénoms pricédoient le nom de famille :
©n ne les écrivoit ordinairement que par des
lfettres initiales...
Les fürnoms s’écrivoîent après le nom : ils
étoient pris de quelque circonftance particulière,
©u de quelque qualité ou défaut de celui, qui le
portoit. Àinfi L’on écrivoit M ( Marcus,) Tullius.
Cicero. ; c.e dernier mot,-, qui eft généralement, le
plus connu , n’étoit que le furnom..
N.B.. Les- bornes de cet? ouvrage ne me permettent
pas d’entrer dans les détails des ufages
de la vie privée de ce peuple célèbre , fur. lequel.
d’ailleurs on a. tant écrit.,
Langue. La langue latine, formée évidemment
«Lune langue plus-anciennement .parlée, en Italie, fe
perfectionna, fur la. fin de la. république , & fut
portée à une grande perfeâion par les poètes &
lès. O! au tirs. Ils la. répandirent dans les provinces.
Les Romains, après avoir fait la conquête des
Gaules,.y introduifirent la langue latine; & cette
langue avoit commencé: à s’y. introduire dès
qu’ils furent maîtres de la Gaule Narbonnoife.
<Dn fait que Géfar fut le premier qui admit des
Gaulois, devenus, citoyens romains,, dans le fé-
nat. Claude accorda aux habirans de la Gaule
Celtique le même avantage. Ce fut- dès-lors un
encouragement. & une ncceflité d’apprendre la
lingue latine :. mais la langue celtique fe confer-
voitr dans le peuple & dans les* campagnes. Les
pnuples. de la. Belgique &. ceux; des 'deux Ger-
jjganiesig, furent. les; derniers à. faire ufage du
latin ; 8ï probablement il n’y fut- jamais très'J
commun.
Mais comme on l’avoit fort cultivé dans le-
refte de la Gaule ; que d’ailleurs les Gaulois-
étoient faits pour cultiver les fciences,. on voit
que dans les premiers fie clés de l’ère chrétienne,
les plus fameux orateurs étoient. Gaulois , & que
ce fut de la Gaule que J M oratoire paffa dans-
la Grande-Bretagne.
Les plus célèbres des écoles publiques-, appelées
académies, étoient celles de Marfeille , de.
Narbonne, de Touloufe, de Bordeaux , de Lyon,,
de la cite d’Auvergne, de Poitiers, de Befaiïçon,
deTreves & d Autun. Tant de foins donnés à la culture
des lettres & le grand concours de Romains qui
venoient dans les Gaules, y rendirent, au bout de
quatre fièclesjalangue latine très-floriffante. Cependant
le vieux lançage étoit refté dans les provinces|
& meme dans les villes où l’on par-loit latin, il
refioit beaucoup d àccens & de mots étrangers à'
cette langue„.Ce fut avec le temps, de cette langue*
que l’on peut appeler provinciale, & que Lon-
appeloit dès-lors lingua ruflica, vulgaris, provins
cialis-, &c. que fe formèrent lès langues fran-
çoife, efpagnole & italienne.. On admettra d’autant
plus volontiers la corruption de langage des-
provinces ; que c etoient fur-tout les foîdats qui
y portoient 1* langue latine, & que la langue du.*
; peuple à Rome devoir être difleren te/de celle des.
orateurs ,.des hiftoriens,. & en générai de la bonne
fociété. Gomme les livres étoient plus rares*
. qu’aujourd’h ui, on lifoir moins, & le mauvaise
exemple des. pères avoit plus d’empire fur les.
: habitudes- de leurs enfans.. Grégoire de Tours*
dit que de. fon temps on n’obfervoit aucune*
' règle dè grammaire pour les genres & pour les
cas.. Ce fut ce langage,, d’abord informe, qui
■ donna naiffance à* la langue que l’on appela ro-
manie (pour romaine), voulant parla la mettre-
• en oppofirion avec la langue tudefque que par-
- loient les Francs, mais qu ils- furent- obligés de*
quitter. Car on voit que dans le temps de Charles-
le-Chauve, en-842 ,.fes fujets parloient la langue-
romaine.
Révolutions hiflbriques. Je fe rois porté à- croire.*
que nous ne fommes pas-trop bien inflruits des>
’ commencemens des Romains; Ils éx-iftoient depuis
plufieurs flêcles, lorfqu’ils commencèrent àï
écrire leur* hifloire, & lès hiftoriens fe font alors
conformés à la vanité de la nation,. & à l’ambi-
tion dè fon fénat.. Mais il y auroit un autre in—
; convénient de. fubftituer des- conjectures à* des
; récits adoptés, & prefque généralement reçus. Je:
■ aie conformerai donc ,.dans cette courte efquifle.,,
; à: l’opinion - générale..
j Ge fut, félon les-calcuRdonnés par Varron, l’an:
: 754., & fclom ceux des Caton, Lan. 75a avant
i l’ère vulgaire,. que Romulus jeta les premiers
| fondemsns. de Rome; I l eut ft'x fuccefleurs. Ces:
i fept rois fe fuccédèrent. dans. Lordre. fuivant».
■
R O M
VA ns de Rome, jeton Far. Avant Vire vulgaire*
1. Romulus. . .
-58. Interrègne. ... ,
rp. N u ma. . . . ,
82. Tiillus Hoftilius.
114. Ancus Marcius.
138. Tarquin l’Ancien.
176 Servius Tull-iu
a 20. Tarquin le Superbe
-244. Il efl chaffé.
Alors furent élus deu
• 7 5 2 *
715.
lisi
•671.
639.
61^.
577»
533*
. 5°9- ^
eux magiflrats fous le titre
^e co n fuis. Les deux premiers furent L. Junius
Brunis & L. Tarquinus Collatinus.
Romulus n’avoir eu, pour féconder fes premières
tentatives, que des gens fans talent,n’ayant
pour eux que de l’audace. Reffer.rcs- dans le petit
efpace que comprenoit leur ville , fur les bords
du Tibre, ils fe déterminèient bientôt à étendre
leurs poflefiions par la force , & à fubfifler par
l’agriculture. C ’eft donc fous le double point de
vue d’un état tour à la fois guerrier & agricul-
tenr , qu’il convient de confidérer la république
romaine. Mais je ne puis ici en préfenrer le tableau.
Je nommerai feulement les' principaux
..peuples qu’ils eurent à combattre, afin que l’on
puifle en étudier féparément les articles. Ce furent
fuccéfîivement :
Sous Romulus , contre les Antemnates , les
■ Cruflumeriens , les Sabins, ce peuple fi eftimable ,
<jui combattit 580 ans, & qui finit par obtenir
le droit de fuffràge ; les Fidénates , les Vèhns. *
Sous Tullus, contre les Albins, les Fidénates
Si les Sabins.
Sous Ancus, contre les Latins, les Véïens &
les Fidéqates.
Sous Tarquin l’Ancien, contre les Latins, les
Sabins,*les Véïens & les Etrufques. .
Sous Servius, encore contre les Etrufques &
les Véïens.
Sous Tarquin le Superbe, contre les Voljques,
les Sabins, les Gabiens & les Ardéates.
L'étendue qu’avoit le royaume de Rome à
l’expulfion de Tarquin, n’étoit pas confidérable ,
& il étoit entouré d’ennemis pùiffans. Leur malheur
fut d’être divifés, & de fe laifler ainfi fub-
juguer les uns après les autres. Dès les com-
mencemenrs, la politique romaine avoit adopté
pour maxime de ne faire la paix avec un ennemi
qu’autant que Rome même en diéloit les conditions.
Et cette force de caraftère, qui fait que
1 homme qui en eft doué réuflit où les autres
echouent, cette force, dis-je, fut le fondement
le plus folide de la grandeur & de la puiffance
«les Romains.
R o m e e n R é p u b l i q u e .
An de Rome 244 , avant J. C. /op.
« Un peuple peut aifément fouffrir qu’on exige
* de lui de nouveaux tributs ; il ne fait pas s’il
R O M
v> lie retirera point quelque utilité de l’emploi
» que l’on fera de l’argent qu’on lui demande.
» Mais quand on lui fait un affront, il fent fon
» malheur, & il y ajoute l’idée de tous les maux
» poflibles ». Ceft ce que Montefquieu (de la
Grand. & de la Dècad. des Rom. c. 1 , p. ) peu-
foit de tout peuple outragé par fes chefs ; c’eR
ce qui, fans doute, invita les Romains à fecouer
; le joug pefant de leurs rois.
Sexrus Tarquin, fils du prince de ce nom, &
que les hifioriens ont qualifié' de Superbe, ayant
fait violence à Lucrèce, cette femme vertueufe
fe tua de défefpoir. Le peuple partagea l’indignation
de fa famille, prit les armes, & ferma la
porte au roi. Le fénat lui fignifia le décret-qui
le condamnoit lui & fa famille à un banniflemenr
perpétuel.
Les excès auxquels s’éroit porté ce prince,
avoient trop vivement affe&é toute la nation, pour
qu’elle ne cherchât pas à fupprimer jufqu’à l’ombre
même de la royauté. On dreffa un plan de
gouvernement fur les mémoires laiflés par Servius
; & l’on élut, pour être à la tête du gouvernement
, deux magiflrats , fous le titre de
confuls, ou confeillers (1).
Les_ deux premiers confuls furent Brutus &
Tarquin Collatin, mari de Lucrèce.
Le peuple & le fénat firent alors un ferment
folemnel de ne jamais recevoir les Tarquins, ni
de ne jamais élire -de roi. On proferivit la tête
de quiconque entreprendroit de violer jamais la
lainteté de ce ferment : il fut même permis à
chacun de le tuer, fans avoir.à craindre aucune
pourfuite pour ce meurtre. C’étoit, je l’avoue,
ouvrir un vafte champ aux haines particulières.
Mais la crainte d avoir un foi étoic encore plus
forte j & d ailleurs , 1 hifioire ne dit pas que per-
fonne ait abufé de cette permifiion.
Mais, peu après , Brutus donna, à-cette occa-
fion, un grand exemple de fermeté, que l’on ne
peut admirer fans frémir. Ses fils s’étoient engages
dans qne confpiration que tramoit Tarquin
pour rentrer dans la ville. Elle fut découverte
& les coupables dénoncés au tribunal des coh-
fuls._ Ce père infortuné,. après avoir forcé fon
collègue de fe retirer, parce qu’il paroiiToit avoir
quelque indulgence pour les coupables, cou-
damna fes deux fils à la mort.
Tarquin fe- préfenta cependant aux portes de
Rome. On fortit en armes. Son fils Aruns, &
le conful Brutus , périrent dans un combat fin-
gulier. Les dames Romaines honorèrent la mort
de ce citoyen généreux de larmes fincères &
d’un deuil d’un an , compofé alors de onze mois.
Il fur enterré à Rome avec beaucoup de pompe,
& l'armée ennemie fut obligée de fe retirer. "
Vallérius, qui d’abord. s’étoit trouvé le col-
■
(i\ On a vu précédemment les avantages & le*
devoirs de cette place.
O ©O O 2