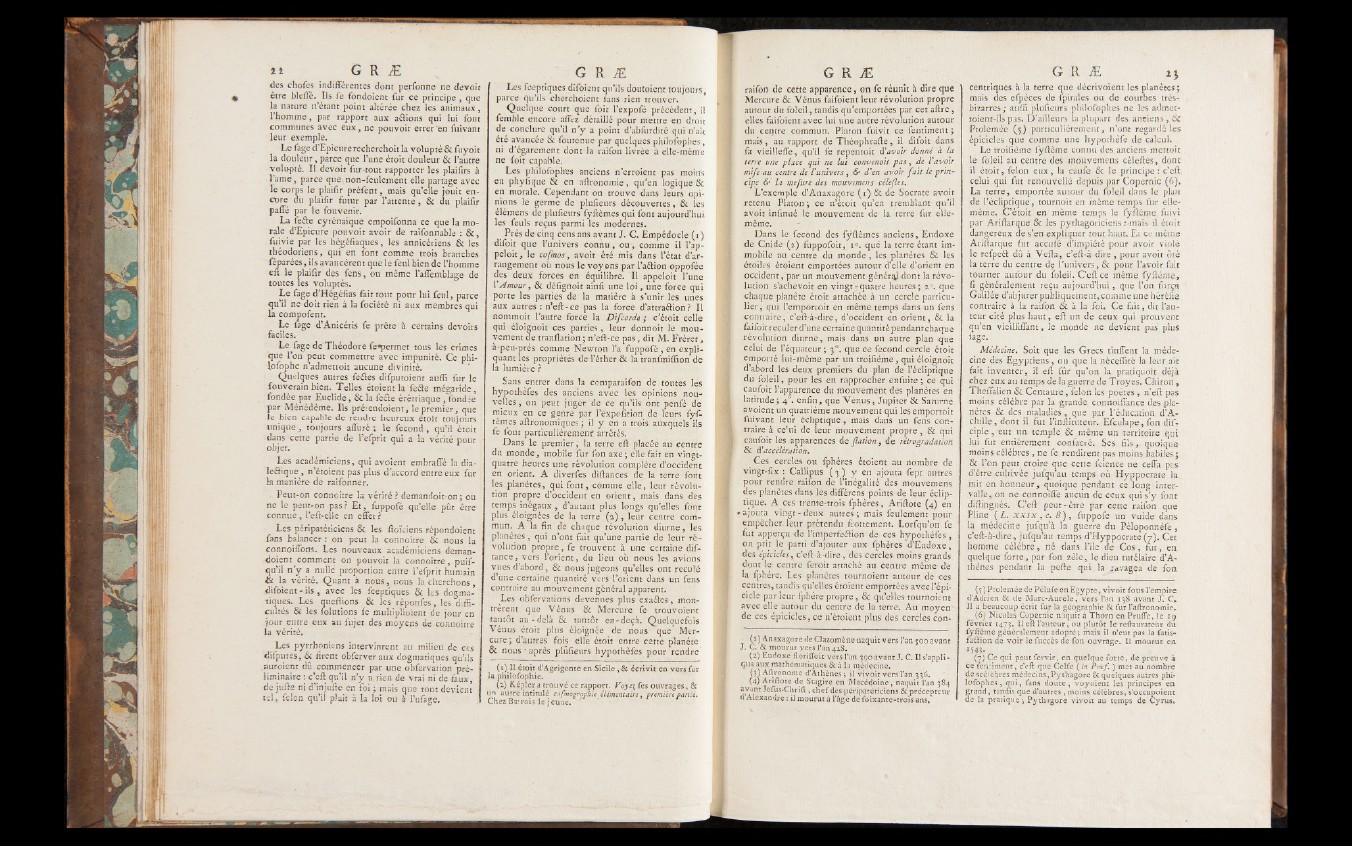
des chofes indifférentes dont perfonne ne devoit
être bleffé. Ils fe fondoient fur ce principe, que
h nature n’étant point altérée chez les animaux,
l’homme, par rapport aux avions qui lui font
communes avec eux, ne pouvoit errer‘en fuivant
leur exemple.
Le fage d’Epicure recherchoit la volupté & fuyoit
la douleur, parce que l’une étoit douleur 8c l’autre
volupté. Il devoit fur-tout rappoiter les plaifirs à
l’ame, parce que non-feulement elle partage avec
le corps le plaifir préfent, mais qu’elle jouit encore
au plaifir futur par l’attente, 8c du plaifir
pafîe par le fouvenir.
La fefte Cyrénaïque empoifonna ce que la morale
d’Epicure pouvoit avoir de raifonnable : & ,
fuivie par les hégéfiaques, les annicériens & les
théodoriens, qui en font comme trois branches
féparées, ils avancèrent que le feulhien de l’homme
efi le plaifir des fens, ou même l’affemblage de
toutes les voluptés.
Le fage d’Hégéfias fait tout pour lui feul, parce
qu’il ne doit rien à la fociété ni aux membres qui
la compofent.
Le fage d’Anicéris fe prête à certains devoirs
faciles.
Le fage de Théodore fe«permet tous les crimes
que l’on peut commettre avec impunité. Ce phi-
lofophe n’admettoit aucune divinité.
Quelques autres fe&es difputoient auffi fur le
fouvcrain bien. Telles étoient la fe&e mégaride,
fondée par Euclide, & la feéle érérriaque , fondée
par Ménédème. Ils prétendoient, le premier, que
le bien capable de rendre heureux étoit toujours
unique, toujours alluré ; le. fécond, qu’il étoit
dans cette partie de l’efprit qui a la vérité pour
objet.
Les académiciens, qui avoient embraffé la dia-
leâique , n’étoient pas plus d’accord entre eux fur
la manière- de raifonner.
- Peut-on connoître la vérité ? demandoit-on; ou
ne le peut-on pas? E t, fuppofé qu’elle pût être
connue, l’eft-elle en effet ?
Les péripatéticiens & les fioïciens répondoient
fans balancer : on peut la corincître & nous la
cônnoiffons. Les nouveaux académiciens deman-
doient comment on pouvoit la connoître, puisqu'il
n’y a nulle proportion entre l’efprit humain
& la vérité. Quant à nous, nous la cherchons,
difoient-.ils, avec les Sceptiques & les dogmatiques.
Les queftions & les réponfes, les difficultés
8c les Solutions fe muîriplioient de jour en
jour entre eux au Sujet des moyens de connoître
la vérité.
Les pyrrhoniens intervinrent au milieu de ces
difputes, & firent obferveraux dogmatiques qu’ils
auroient dû commencer par une obfervation préliminaire
: ç’eft qu’il n’y a rien de vrai ni de faux,
de jufie ni d’injufie en foi ; mais que tout devient
te l, félon qu’il plaît à la loi ou à l’ufage.
Les fceptiques difoient qu’ils doutoient toujours;
parce qu’ils cherchoient fans rien trouver.
Quelque court que foit l’expofé précédent, il
femble encore affez détaillé pour mettre en droit
de conclure qu’il n’y a point d’abfurdité qui n’ait
été avancée 8c foutenue par quelques philofophes,
ni d’égarement dont la raifon livrée à elle-même
ne foit capable.
Les philofoplms anciens n’erroient pas moins
en phyfique & en aftronomie, qu’en logique 8c
en morale. Cependant on trouve dans leurs opinions
le germe de plufieurs découvertes, & les
élémens de plufieurs fyfiêmes qui font aujourd’hui
les feuls reçus parmi les modernes.
Près de cinq cens ans ayant J. C. Empédocle ( i)
difoit que l’univers connu, o u , comme il l’ap-
peloit, le cofmos, avoit été mis dans l’état d’arrangement
où nous le voyons par l’a&ion oppofée
des deux forces en équilibre. Il appeloit l ’une
y Amour, 8c défignoit ainfi une lo i, une force qui
porte les parties de la matière à s’unir les unes
aux autres : n’eft-ce pas la force d’attraéiion ? Il
nommoit l’autre force la Difcorde ,* c’étoit celle
qui éloignoit ces parties , leur donnoit le mouvement
de tranflation; n’eft-ce pas, dit M. Fréret,
à-peu-près comme Newton l’a fuppofé , en expliquant
les propriétés de l’éther 8c la tranfmiffion de
la lumière ?
Sans entrer dans la comparaifon de toutes les
hypothèfes des anciens avec les opinions nouvelles,
on peut juger de ce qu’ils ont penfé de
mieux en ce genre par l’expofition de leurs fyfi
têmes aftronomiques ; il y en a trois auxquels ils
fe font particuliéremenf arrêtés.
Dans le premier, la terre efi placée au centre
du monde, mobile fur fon axe ; elle fait en vingt-
quatre heures une révolution complète d’occident
en orient. A diverfes diftances de la terre font
les planètes, qui font, comme elle, leur révolution
propre d’occident en orient, mais dans des
temps inégaux, d’autant plus longs qu’elles font
plus éloignées de la terre (2) , leur centre commun.
A la fin de chaque révolution diurne, les
planètes , qui n’ont fait qu’une partie de leur révolution
propre, fe trouvent à une certaine difi-
tance, vers l’orient, du lieu où nous les avions
vues d’abord , & nous jugeons qu’elles ont reculé
d une ^certainequantité vers- l’orient dans un fens
contraire au mouvement général apparent.
Les obfervations devenues plus exa&es, montrèrent
que Vénus & Mercure fe trou voient
tantôt au-delà 8c tantôt en-deçà. Quelquefois
Vénus étoit plus éloignée de nous que Mercure;
d’autres fois elle étoit entre cette planète
8c nous • après plufieurs hypothèfes pour rendre
(1) Il étoit d’Agrigente en S icile, & écrivit en vers fur
la philofophie.
(2) K.éjDler a trouvé ce rapport. Voye\ fes ouvrages, &
un autre intitulé cofmo graphie élémentaire, première partie.
Chez Ba:rois le jeune. '
raifon de cette apparence, pn fe réunit à dire que
Mercure 8c Vénus faifoient leur révolution propre
autour du foleil, tandis qu’emportées par cet aftre,
elles faifoient avec lui une autre révolution autour
du centre' commun. Platon fuivit ce fentiment ;
mais, au rapport de Théophrafie, il difoit dans
fir vieilleffe, qu’il le repentoit d’avoir donné à la
terre une place qui ne lui convenoit pas, de l’avoir
mife au centre de Vunivers, & d’en avoir fait le principe
& la mefure des mouvemens cèlejles.
L’exemple d’Anaxagore (1) 8c de Socrate avoit
retenu Platon ; ce n’étoit qu’en tremblant qu’il
avoit infinué le mouvement de la terre fur elle-
même.
Dans le fécond des fyfiêmes anciens, Eudoxe
de Cnide (2) fuppofoit, i°. que la terre étant immobile
au centre du monde, les planètes 8c les
étoiles étoient emportées autour d’elle d’orient en
occident, par un mouvement général dont la révolution
s’achevoit en vingt-quatre heures; 20. que
chaque planète étoit attachée à un cercle particulier
, qui l’emportoit en même temps dans un fens
contraire, c’eft-à-dire, d’occident en orient, 8c la
faifoit reculer d’une certaine quantité pendant chaque
révolution diurne, mais dans un autre plan -que
celui de l’équateur; 30. que ce fécond cercle étoit
emporté lui-même par un troifième, qui éloignoit
d’abord les deux premiers du plan de l’écliptique
du foleil, pour les en rapprocher enfuite ; ce qui
caufoit l’apparence du mouvement des planètes en
latitude; 4°. enfin, que Vér\us, Jupiter 8c Saturne
avoient un quatrième mouvement qui les emportoit
fuivant leur écliptique, mais dans un fens contraire
à ce’ ni de leur mouvement propre, 8c qui
caufoit les apparences de jlation, de rétrogradation
8c d’accélération.
Ces cercles ou fphères étoient au nombre de
vingt-fix : Callipus ( 3 ) y en ajouta fept autres
pour rendre raifon de. l’inégalité des mouvemens
des planètes dans les différens points de leur écliptique.
A ces trente-trois fphères, Ariftote (4) en
♦ ajouta vingt-deux autres; mais feulement pour
empêcher, leur prétendu frottement. Lorfqu’on fe
fut apperçu de l’imperfeéfion de ces hypothèfes,
on prit le parti d’ajouter aux fphères d’Eudoxe,
des épicicles, c’eft-à-dire, des cercles moins grands
dont le centre feroit attaché au centre même de
la fphère. Les planètes tournoient autour de ces
centres, tandis qu’elles étoient emportées avec L’épi-
cicle par leur fphère propre, 8c qu’elles tournoient
avec elle autour du centre de la terre. Au moyens
de ces épicicles, ce n’étoient plus des cercles con•
C* 2 3 4 *1 ) Anaxagore de Clazomène naquit v ers l’an 500 avant
J. C. & mourut yers l’an 428.
(2) Eudoxe floriffoit vers l’an 390 avant J. C. Il s’appliqua
aux mathématiques & à la médecine.
(3) Aflronome d’Athènes -, il vivoit vers l’an 336.
(4) Ariftote de Stagire en Macédoine, naquit l’an 384
avant Jefus-Chrift, chef des péripatéticiens & précepteur
d Alexandre : il mourut à l’âge de foixante-trois ans.
centriques à la terre que décrivoient les planètes ;
mais des efpèces de fpirales ou de courbes très-
bizarres ; auffi plufieurs philofophes ne les admet-
toient-ils pas. D’ailleurs la plupart des anciens , 6c
Ptolemée (5) particuliérement, n’ont regardé les
épicicles que comme une hypothèfe de calcul.
Le troifième fyfiême connu des anciens mettoit
le foleil au centre des mouvemens célefies, dont
il étoit, félon eux , la caufe 8c le principe : c’eft
celui qui fut renouvellé depuis par Copernic (6).
La terre, emportée autour du foleil dans le plan
de l’écliptique, tournoit en même temps fur elle-
même. C ’étoit en même temps le fyfiême fuivi
par Ariftarque & les pythagoriciens Muais il étoit
dangereux de s’en expliquer tout haut. Et ce même
Arifiarque fut accufé d’impiété pour avoir violé
le refpeâ dû à Vefia, c’eft-à-dire, pour avoir ôté
la terre du centre de l’univers, 8c pour l ’avoir fait
tourner autour du foleil. C’eft ce même fyfiême,
fi généralement reçu aujourd’hui, que l’on força
Galilée d’abjurer publiquement, comme une héréfie
contraire à la raifon 8c à la foi. Ce fait, dit l’auteur
cité plus haut, efi un de ceux qui prouvent
qu’en vieilliffant, le monde ne devient pas plus
fage.
Médecine. Soit que les Grecs tinffent la médecine
des Egyptiens, ou que la néceffité la leur ait
fait inventer, il efi fur qu’on la pratiquoit déjà
chez eux au temps de la guerre de Troyes. Chiron ,
Theffalien 8c Centaure, félon les poètes , n’eft pas
moins célèbre par la grande connoiffance des planètes
8c des maladies, que par l’éducation. d’A chille,
dont il fut l’infiituteur. Efculape, fon dif-
ciple, eut un temple 8c même un territoire qui
lui fut entièrement confacré. Ses . fils, quoique
moins célèbres, ne fe rendirent pas moins habiles;
8c l’on peut croire que cette feience ne ceffa pas
d’être cultivée jufqu’au temps où Hyppocrate la.
mit en honneur, quoique pendant ce long intervalle,
on ne connoiffe aucun de ceux qui s’y font
diftingués. C ’eft peut-être par cette raifon que
Pline ( L. x x i x , c. 8 ) , fuppofé un vuide dans
la médecine jufqu’à la guerre du Péloponnèfe ,
c’eft-à-dire, jufqu’au temps d’Hyppocrate (7). Cet
homme célèbre, né dans l’ile de C o s , fut, en
quelque forte, par fon zèle, le dieu tutélaire d’A thènes
pendant la pefte qui la .ravagea de fon
(5) Ptolemée de Pélufe en Egypte, vivoit fous l’empire
d'Adrien & de Marc-Aurèle, vers l’an 13S avant J. C.
Il a beaucoup écrit fur la géographie & fur l’aftronomie.
(6) Nicolas Copernic mquit à Thorn en Pruffe, le 19
février 1473. 11 eft l’auteur, ou plutôt le reftaurateur du
fyftême généralement adopté -, mais il n’eut pas la fatis-
fafiion de voir le fuccès de fon ouvrage. Il mourut en
I543»
(7} Ce qui peut fervir, en quelque forte, de preuve à
ce fenàment, c’eft que Celfe (zn Praf. ) met au nombre
de scéîëljres médecins,Pythagore & quelques autres philofophes
, qui, fans doute, voyoient les principes en
grand, tandis que d’autres, moins célèbres, s’occupoient
de la pratique ; Pythagore vivoit au temps de Cyrus.