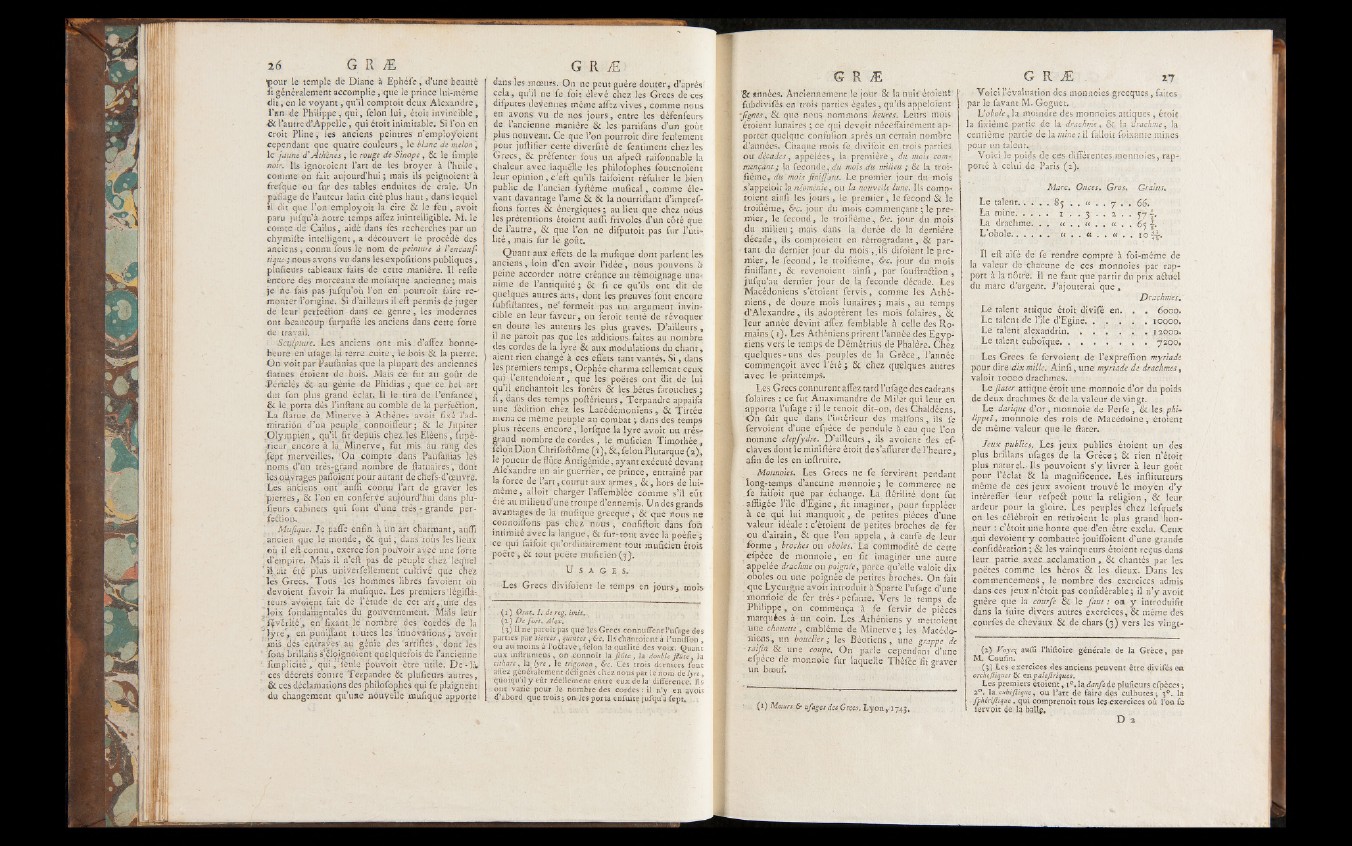
x6 G R Æ
'pour le temple de Diane à Ephèfe, d’une beauté
fi généralement accomplie, que le prince lui-même
d it , en le voyant, qu’il comptoit deux Alexandre,
l ’nn de Philippe, qui , félon lu i, étoit invincible,
& l’autre d’Appelle, qui étoit inimitable. Si l’on en
croit Pline, les anciens peintres n’employoient
cependant que quatre couleurs , le blanc de melon ,
le jaune d'Athènes, le rouge de Sinope , & le (impie
noir. Ils ignoroient l’art de les broyer à l’huile,
comme on fait aujourd’hui; mais ils peignoient à
frefque ou fur des- tables enduites de craie. Un
pàffage de Fauteur latin cité plus haut, dans:lequel
il dit que l’on employoit la cire & le feu , .avoit
paru jufqu’à notre temps affez. inintelligible. M. le
comte de Cailus, aidé dans fies recherches par un
chymiffe intelligent, a découvert le procédé des
anciens, connu fous.le nom de peinture à l’encaufi
tiquer nous avons vu dans les.expofitions publiques,
pïufieurs tableaux faits de cette manière. Il réfie
èncore des morceaux de mofaïque ancienne; mais
je 6e. fais pas jufqu’où l’on en pourroit faire re-'
monter l ’origine. Si d’ailleurs il :elt permis-de juger
de leur perfeélion dans ce. genre, les modernes
ont -beaucoup furpaffé les anciens dans cette forte
de travail.
< Sculpture. Les anciens ont mis. d’affez bonne-
heure en ulage; là terre, cuite, le bois & la pierre.
On Voit parPatffiuïias qué la plupart des anciennes
ffatues étoient de bois. Mais ce fut au goût de
-Périclès & au génie de Phidias , que ce: bel art
dut fon plus grand éclat. Il le. tira de l’enfance ;
& le. porta dès l’inftant au comble de la perfe&ion.
La ffàtue de Minerve .à Athènes avoit fixé l’ad-
miratiôn d’un peuplql çonnoiffeur ; & le Jupiter
.Olympien , qu’ il fit depuis chez, les Eléeiis, fupé-
-rièur'encore à la Minerve, fut mis. au rang des
,fept meryèilles. 1 On compte .dans Paufariias les
noms, d’un très-grand nombre de ffatüaires , dont
les qûvrages paffoien't pour autant de chefs-d’oeuvre.
. Lès anfciens . ont aufli connu l’ârt dé gravier les
pierres, & l’on en confier ve' aujourd’hui dans plusieurs
cabinets qui font d’une très - grande per-
‘ fecHon. \ "
Mufique. Je paffe enfin a un art charmant, aufli
' ancien que le monde, & qui , dans 'tous les lieux
©u il eft-connu, exercé fon pourvoir avec une forte
d’empire. Mais ïl ’n’efi pas de peuple chez ’leq'liel
S ’ait été plus univérfellémént cultivé que chez
. les Grecs. Tous * les' hommes librés favoient ou
dévoient (avoir la mufique.. Les premiers iégifià-.„
* teurs a voient fait de l’ étude de cet aVt,tü"rïe' des .
loix fo'ndatnèntaîés du 'gouvernement. Mais leur 1
^ffvérlté',, en fixant lie Uonibre des' iordès de la
v]yré y en puniffaut toutes les ' innovations ; 'avoit ;
' mis dés entraves' au génie des 'aftiflés-, dont lès !
fpns.briïlaris séloig.nqiéht quelquefois dé l’ancielirie1
fimplicite , 'quiVfeule pouvoir être utile. De-làr
ces décrets contre Terpandre & pliifietïrs autres,
& ces déclamations des philofophes qui fe plaignent
du changement qu’une nouvelle mufiqué apporte ;
G R Æ
dans les moeurs. On ne peut guère douter, d’après
cela, qu’il ne fe foit élevé chez les Grecs de ces
difputes devenues même a fiez vives, comme nous
en avons vu de nos jours, entre les défenfeurs
de l’ancienne manière 8c les partifans d’un goût
plus nouveau. Ce que l’on pourroit dire feulement
pour juffifier cette diverfité de fentiment chez les
Grecs, 8c préfenter fous un afpeét raifonnable la
chaleur avec laquelle les philofophes foutenoient
leur opinion, c ’eft qu’ils faifoient réfulter le bien
public de l’ancien fyftême mufical, comme élevant
davantage l’ame & & la nourriffant d’impref-
fions fortes 8c énergiques ; au lieu que chez nous
les prétentions étoient aufli frivoles d’un côté que
de l’autre, 8c que l’on ne difputoit pas fur l’utilité
, mais fur le goût.
Quant aux effets de la mufique dont parlent les
anciens, loin d’en avoir l’idée, nous pouvons à
peine accorder notre créance au témoignage unanime
de l’antiquité ; & fi ce qu’ils ont dit de
quelques autres arts, dont les preuves font encore
fubfiftantes., ne* for moi t pas un, argument invincible
en leur faveur, on feroit tenté de révoquer
en doute les auteurs les plus graves. D ’ailleiirs ,
il ne paroît pas que les additions, faites au nombre
des cordes de la lyre & aux modulations du chant,
aient rien changé à ces effets tant vantés. S i , clans
les premiers temps r Orphée charma tellement ceux
qui Tenténdoient, que les poètes ont dit de lui
qu’il enchantoit les forêts & les bêtes farouches ;
f i , dans des temps poftérieurs , Terpandre appaifa
une fédition chez les Lacédémoniens, 8c Tirtée
mena ce même peuple au combat y dans des temps
plus recens encore , lorfque la lyre avoit un très?
grand nombre de cordes., le muficien Timothée ,
félon Dion Chrifoflôme ( î) , & , félon Plutarque (a),
le joueur de flûte Antigénide, ayant exécuté devant
Alexandre un air guerrier, ce prince, entraîné par
la force de l’art,courut aux armes,, 8c, hors de lui-
même, alloit charger l’affemblée comme s’il eut
été au milieu d’une troupe d’ennemis. Un des grands
avantagés de la mufique grecque * ôrque nous ne
connoiflons pas chez nous , confiftoit dans fon
intimité avec la langue, & fur-tout avec la poéfiej;
;ce qui faifoit qu’orclinairement tout muficien étoit
poète , 8c tout ■ poèté muficien^).
U s A g e . sr
Les Grecs drvifoient le temps en jours, mors
. ( i) O.rat. I. de reg. imit..t
(a) Ùe fort. Alex.
(3.) b ne paroît fias que les Grecs connuflenr l’ufage des
parties par 'tierces, quintes ,&c. Ils chantoient à l’uniffon ,
ou au moins àTo.&ave, félon, la qualité des voix. Quant
aux inftrumenson „connoît la fûte , la double f l û t e la
cithare, la dyre , le trigonoji, &c. Ces trois derniers font
affez généralement défignés théznous par le nom de lyre,
quoiqu’il y eût réellement entre eux de la différence. Fis
ont varié pour le nombre des cordes: il nvy en avdis
d’abord que trois ; on-les porta enfuite jufqu’â fept» . i
& années. Anciennement le jour & la nuit étoient
fubdivifés en trois parties égales, qu’ils appeloient
'Jtgnes., 8c que nous nommons heures. Leurs mois
étoient lunaires ; ce qui devoit néceflairement apporter
quelque confufion après un certain nombre
d’années. Chaque mois fe. divifoit en.trois parties
o\i décades;, appelées-, la première , du mois commençant;
la fécondé, du mois du milieu ; & la troi-,
fième, du 'mois finiJJjnt. Le premier jour du'-mois
.s’appeloit la néoménie, ou la nouvelle-lune. Ils coinp-
toient ainfi les jours, le premier, le fécond & le
troifième, &c. jour du mois commençant ;Te premier,
le fécond, le troifième, ^ . jour du mois
du milieu ; niais dans la durée de la dernière
décade , ils çomptoient en rétrogradant, & partant
du dernier jour du mois , .ils difoient le premier,
le fécond, le troifième, &c. jour du mois
fini fiant, & revenaient ainfi, par fouftraélion ,
jufqu’au dernier jour de la fécondé décade. Les
Macédoniens s’étoienf fervis, comme les Athéniens,
de douze mois lunaires ; mais , au temps
d’Alexandre, ils.adoptèrent les mois folaires, &
leur année devint affez femblable à celle des Romains
( i) . Les Athéniens prirent l’année des Egyptiens
vers le tèifips-de Démétrius de Phalère. Chez
quelques - uns des ' peuples de la Grèce., l’année
commençoit avec 1 été ; & chez quelques autres
avec le printemps. •
Les Grecs connurent affez tard l’ufage des cadrans
folaires : ce fut Anaximandre de Mil et qui leur en
apporta t’ufage : il le tenoit dit-on, des Chaldéens.
On fait que dans l’intérieur des maifons, ils fe
(ervoient d’une efpèce de pendule à eau que l’on
nomme clepfydre. D ’ailleurs , ils avoient des ef-
claves dont le miniftère étoit de s’affurer de l ’heure,
afin de les en inftruire.
Monnoies. Les Grecs ne fe fervirent pendant
long-temps d’aucune monnoie; le commerce ne
.fe faifoit que par échange. La fférilité dont fut
. affligée l’îie d’Egine, fit imaginer, pour fuppléer
à ce qui lui manquoit, de petites pièces d’une
valeur idéale : c’étoient de petites broches de fer
ou d’airain, 8i que l’on appela, à caufe de leur
forme, broches ou oboles.'L?l commodité de cette
efpèce de monnoie, en fit imaginer une autre
appelée drachme ou poignée, parce qu’elle valoit dix
oboles ou une, poignée de petites broches. On fait
que Lycqrgue avoir introduit à Spartè l’ufage d’une
monnoie de fer très •= pèfante. Vers le temps de
Philippe, on commença à fe fervir de pièces
marquées à- un coin. Les Athéniens y mettoient
une chouette, emblème de Minerve; les Macédoniens,
un bouclier; les Béotiens, une grappe de
rat-fin & une coupe. On parle cependant d’une
efpece de monnoie fur laquelle Théfée fit graver
lin boeuf.
( i) Moeurs. & ufages des Grecs, Lyon ,1743,
Voici dévaluation des monnoies grecques, faites
par le favant M. Goguet.
Uobole, la moindre des monnoies attiques , étoit
la fixième partie de la drachme, la. drachme, la
centième partie de la mine : il falioit foixante mines
pour un talentV' ::
Voici le poids de ces différentes monnoies , rapporté
à celui de Paris (2).
Marc. Onces. Gros. Grains«
Le talent.. . . . 85 a . . 7 . . 66.
La mine; . . . . 1 . . 3 . . 2 . . 57
La drachme. . . « . . « . . « . . 65 f.
L’obole.. . . à « 10
Il efl aifé de fe fendre compte à foi-même de
la valeur de chacune de ces monnoies par rapport
à la nôtre; Il ne faut que partir du prix aftùel
du marc d’argent. J’ajouterai que ,
Drachmes•
Le talent attîque étoit divifé en. . . 6000.
Le talent de l’île d’Eginé. . . . . 10006.
Lé talènt. alexandrin. . . . . 12000.
Le talent euboïque............................... ' 7200.
g Les Grecs fe fervoient de l’expreflion myriade
pour dire -dix mille. Ainfi , une myriade de drachmes,
valoit 10000 drachmes.
I .e flater attîque étoit une monnoie d’or du poids
de deux drachmes & de la valeur de vingt.
Le darique d’o r , monnoie de Perfe, 8c les phi-
lippeîy monnoie des rois de Macédoine, étoient
de même valeur que le dater.
Jeux publics. Les jeux publics étoient un des
plus br'illans ufages de la Grèce; & rien n’étoit
plus naturel.-Ils pouvoient s’y livrer à leur goût
pour l’éclat & la magnificence. Les inflituteurs
même de ces jeux avoient trouvé le moyen d’y
intérefler -leur refpeél pour la religion , & leur
ardeur pour la gloire. Les peuples chez lefquels
on les célébroit en retiraient le plus grand lion-
.neur : c’étoit une honte que d’en être exclu. Ceux
qui devoienry combattre jouiffoient d’une grande
confidération ; & les vainqueurs étoient reçus dans
leur patrie avec^acclamation , 8c chantés par les
poètes comme les héros & les dieux. Dans les
commencemens, le nombre des exercices admis
dans ces jeux i f étoit pas confidérable ; il n’y avoit
guère que la courfe 8c le faut : oa y introduifit
dans la fuite divers autres exercices, & même des
courfes de chevaux & de chars (3) vers les vingt-
(2) Voyc\ aufli l’hifloire générale de la Grèce, par
M» Coufin.
(3) Les exercices des anciens peuvent être divifés ea
orchejliques .& en palejlriqu.es.
Les premiers etoient, i ° . la danfe de pïufieurs efpèces ;
2°. la.cubifiique, ou l ’art de faire des culbutes-, 30. la
fphériftique, qui comprenoit tous les exercices où l’on fc
fer voit de la ballp,
D z