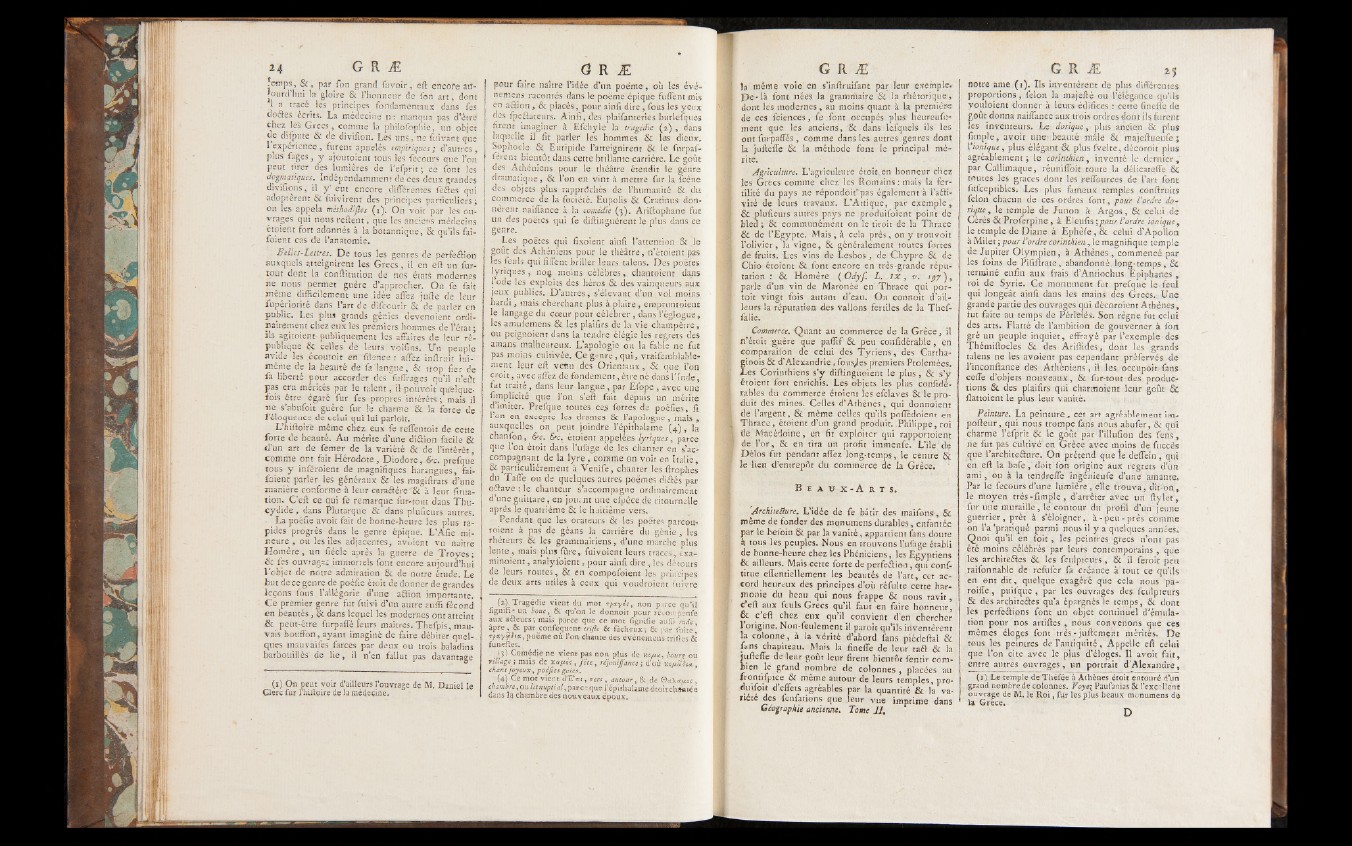
.etnps, 8c, par Ton grand fa v o ir , eft encore aujourd'hui
la gloire & l’honneur de fon art, dont
1 a tracé^ les principes fondamentaux dans fes
cio&es écrits. La médecine ne manqua pas d’être
chez lès Grecs, comme la philofophie, un objet
de difpute & de divifion. Les uns, ne fuivant que
l ’expérience, furent appelés empiriques; d’autres,
plus fages, y ajoutaient tous les fecours que l’on
peut tirer des lumières de l’efprit; ce font les
dogmatiques. Indépendamment de ces deux grandes
divifions, il y ' eut encore différentes fedes qui
adoptèrent 8c fuivirent des principes particuliers ;
on les appela mèthodifies ( i) . On voit par les Ouvrages
qui nous retient, que les anciens médecins
étoient fort adonnés à la botannique, & qu’ils fai-
loient cas de l’anatomie.
Belles-Lettres. De tous les genres de perfe&ion
auxquels atteignirent les Grecs, il en eft un fur-
tout dont la conftitution de nos états modernes
he nous permet guère d’approcher. On fe fait
même difficilement une idée affez jufte de leur
fupériorité dans l’art de difeourir & de parler en
public. Les plus grands génies devenoient ordinairement
chez eux les premiers hommes de l’état ;
ils agitoient- publiquement les affaires de leur république
& celles de leurs voHins. Un peuple
avide les .écoutoit en filence : affez inftruit lui-
même de la beauté de fa langue, 8c trop fier de
fa liberté pour accorder des fiiffrages qu’il n’eût
pas cru mérités par le talent, ihpouvoît quelquefois
être égaré fur fes-propres intérêts; mais il
ne s’abufoit guère fur le charme 8c la force de
l ’éloquence de celui qui lui parloit.
L’hiftoire même chez eux fe reffentoit de cette
forte de beauté. Au mérite d’une diâion facile &
cl’un art de femer de la variété 8c de l’intérêt,
comme ont fait Hérodote, Diodore, &c. prefque
tous y inféroient de magnifiques harangues, faisaient
parler les généraux & les magiftrats d’une
manière conforme à leur caraâère''8c à leur fitua-
tion. C ’eft ce qui fe remarque fur-tout dans Thucydide
, dans Plutarque & dans plufieurs autres.
La poéfie avoit fait de bonne-heure les plus rapides
progrès dans le genre épique. L’Afie mineure
, ou les îles adjacentes, avaient vu naître
Homère, un fiècle après la guerre de Troyes ;
& fes ouvrage* immortels font encore aujourd’hui
l ’objet de notre admiration 8c de notre étude. Le
but de ce genre de poéfie étoit de donner de grandes
leçons fous l’allégorie d’une a&ion importante.
C e premier genre fut fuivi d’un autre auffi fécond
en beautés, 8c dans lequel les modernes ont atteint
& peut-être furpaffé leurs maîtres. Thefpis, mauvais
bouffon, ayant imaginé de faire débiter quel-.
ques mauvaises farces par deux ou trois baladins
barbouillés de lie , il n’en fallut pas davantage
(x) On peut voir d’ailleurs l’ouvrage de M. Daniel le
Clerc fur l’hiltoire de la médecine.
pour faire naître l’idée d’un poëme, ou les évé-
nemens racontés dans le poëme épique fuffent mis
en aâion, 8c placés, pour ainfi dire , fous les yeux
des fpeâateurs. Ainfi,des plaifanteries burlefques
firent imaginer à Efchyle la tragédie (2) , dans
laquelle il fit parler les hommes Sc les dieux.
Sophocle & Euripide l’atteignirent & le furpaf-
fèrent bientôt dans cette brillante carrière. Le goût
des Athéniens pour le théâtre étendit le genre
dramatique, Sc l’on en vint à mettre fur la fcène
des objets plus rapprochés de l’humanité & du
commerce de la fociété. Eu polis- & Cratinus donnèrent
naifîànce à la comédie (3). Ariftophane fut
un des poëtes qui fe diftinguèrent le plus dans ce
genre.
Les poëtes qui fixoient ainfi l ’attention 8c ,1e
goût des Athéniens pour le théâtre, n’étoient pas
les feuts qui fiffent briller leurs talens. Des poëtes
lyriques , nog moins célèbres, chantoient dans
l’ode les exploits des héros 8c des vainqueurs aux
jeux publics. D ’autres, s’élevant d’un vol moins
hardi, mais cherchant plus à plaire, emprunt oient
le langage du coeur pour célébrer , dans l’églogue,
les amufemens 8c les plaifirs de la vie champêtre,
ou peignoient dans la tendre élégie les regrets des
amans malheureux. L’apologie ou la fable ne fut
pas moins cultivée. Ce genre,qui, vraifemblable-
ment leur eft venu des Orientaux, Sc que l’on
croit, avec affez de fondement, être né dans l’ fnde,
fut traité, dans leur langue, par Efope , avec une
Ibnphcité que l’on s’eft fait depuis un mérite
d’imiter. Prefque toutes ce^ fortes de poéfies ,fi
l’on ea excepte les drames & l’apologue, mais ,
auxquelles on peut joindre l’épithalame (4 ) , la
chanfon, &c. &c. étoient appelées lyriques, parce
que l’on étoit dans l’ufage de les chanter en s’accompagnant
de la lyre , comme on voit en Italie,
& particuliérement à Venife , chanter les ftropkes
du Taffe ou de quelques autres poëmes diétés par
oélave : le chanteur s’accompagne ordinairement
d’uneguittare, en journt une efpèce de ritournelle
après le quatrième & le huitième vers.
Pendant que les orateurs & les poëtes parcou-
roient à pas de géans la carrière du génie, les
rhéteurs 8c les grammairiens, d’une marche plus
lente, mais plus fûre, fuivoient leurs traces, exa-
minoient, analyfoient. pour ainfi dire , les détours
de leurs routes, & en compofoient les principes
de deux arts utiles à ceux qui voudroient Cuivre 2 3
(2) Tragéd ie vient du mot non parce qu’il
lignifia un bçue, & qu’on le donnoit pour rcto;T>penfe
aux aâeurs-, mais parce que ce mot lignifie auffi rude,
âpre, & par conféqucnt trifle & fâcheux-, & par fuite\
rpA-ySSui, poëme où l’on chante des événemens trifies &
funeftes.
(3) Comédie ne vient pas non plus de xo<mk , bourg ou
village ; mais de xu'/xos , fête , réjouijfance ; d’où xo/uiïfia.,
chant joyeux, poéfies gaies.
(-4) Ce mot vient d’E V i, vers , autour, & de ©ctka^oc ,
chambre, ou lit nuptial, parce que l’épiehalame étoit cUaatée
dans la chambre des nouveaux époux.
la même voie en s’inftruifant par leur exemple.
De -là font nées la grammaire 8c la rhétorique,
dont lès modernes, au moins quant à la première
de ces fciences, fe font occupés plus heureufn-
ment que les anciens, & dans :lesquels ils les
ont furpaffés , comme dans les autres genres dont
la jufteffe 8c la méthode font le principal mé-
rite.
Agriculture. L’agriculture étoit,en honneur chez
les Grecs comme chez les Romains : mais la fertilité
du pays ne répondoit*'pas également à l’afti-
vité de leurs travaux. L’Attique, par exemple,
& .plufieurs autres pays ne produifoient point de
bled ; & communément on le tiroit de la Thrace
& de l’Egypte. Mais, à cela près’, on y trouvpit
l’olivier, la vigne, 8c généralement toutes fortes
de fruits. Les vins de Lesbos , de Chypre & de
Chio étoient & font encore en très-grande réputation
: 8c Homère ( Odyf. L. i x , v. 19 7),
parle d’un vin de Maronée en Thrace qui por-
toit vingt fois autant d’eau. On connoît d’ailleurs
la réputation des vallons fertiles de la Thef-
falie.
Commerce. Quant au commerce de la Grèce, il
n’étoit guère que paffif 8c peu confidérable, en
comparaifon de celui des Tyriens, des Carthaginois
8c d’Alexandrie, fous^es premiers Ptolémées.
Les Corinthiens s’y diftinguoient le plus, 8ç s’y
étoient fort enrichis. Les objets les plus confidé-
rables du commerce étoient les efclaves 8c le produit
des mines. Celles d’Athènes, qui donnaient
de l’argent, 8c même celles qu’ils, poffédoient en
Thrace, étoient d’un grand produit. Philippe, roi
de Macédoine, en fit exploiter qui rapportaient
de l’or , 8c en tira un profit immenfe. L’île ;dé
Délos fut pendant affez long-temps, le centre 8c
le lie» d’entrepôt du commerce de la Grèce.
B e a u x - A r t s ,
Architecture. L’idée de fe bâtir des maifons1', &
même de fonder des memumens durables, enfantée
par le betoin 8c par la vanité, appartient fans doute
à tous les peuples. Nous en trouvons l’ufage établi
de bonne-heure chez les Phéniciens, les Egyptiens
8c ailleurs. Mais cette forte de perfeâion , qui conf-
titue effentiellement les beautés de l’art, cet accord
heureux des principes d’où réfulte cette harmonie
dit beau qui nous frappe 8c nous ravit,
c’eft aux feuls Grecs qu’il faut en faire honneur,
6c c’eft chez eux qu’il convient d’en chercher
l ’origine. Non-feulement il paroît qu’ils inventèrent
la colonne, à la vérité d’abord fans pié.deftai 8c
fans chapiteau. Mais la fineffe de leur taâ 8c la
jufteffe de leur goût leur firent bientôt fentir combien
le gfand nombre de colonnes , placées ail
Irontifpice 8c même autour de leurs temples, pro-
duifoit d’effets agréables par la quantité & îa variété
des fenfations que leur vue imprime dans
Géographie ancienne. Tome Jl,
notre ame (1). Ils inventèrent de plus différentes
proportions, félon la majefté ou l’élégance qu’ils
yotiloient donner à leurs édifices : cette finefl'e de
goût donna naiffance aux trois ordres dont ils.furent
les inventeurs. Le, d o r iqueplus ancien 8c plus
fimple, avoit une- beauté mâle 8c majeftueufe ;
'Cionique, plus élégant 8c plus fveltc, décoroit plus
agréablement ; le corinthien , inventé le dernier ,
par Callimaque, réuniffoit toute la délicateffe 8c
toutes les grâces dont les ireffources de l’art font
fiifceptibles. Les plus fameux temples conftruits
félon chacun de ces ordres font, pour Tordre do-
rime, le temple de Junon à Argos, 8c celui de
Cér’ès 8c Proferpi ne , à Eleufis ; pour Tordre ionique,
le temple de Diane à Eplïèfe, 8c celui d'Apollon
à Milet ; pour Tordre corinthien, le magnifique temple
de Jupiter Olympien, à Athènes , commencé par
les foins de Pififtrate, abandonné long-temps, <3c
terminé enfin aux frais d’Antiochus Epiphanes ,
roi de Syrie. Ce monument fut prefque le feuî
qui longeât ainfi dans les mains des Grecs. Une
grande partie des ouvrages qui décoroient Athènes,
fut faite au temps de PérMès. Son règne fut celui
des arts. Flatté de l’ambition de gouverner à forî
gré un peuple inquiet, effrayé par l’exemple des
Thémiftocles 8c des Ariftides, dont les grands
talens ne les avoient pas cependant préfervés de
l’inconftance des Athéniens, il les ©ccupôit fans
ceffe d’objets nouveaux, Sc fur-tout des, productions
8c des plaifirs qui charmoient leur goût ÔC
flattoient le plus leur vanité.
Peinture. La peinture, cet art agréablement im-
pofteur, qui nous trompe fans nous abufer, 8c qui
charme l’efprit 8c le goût par Tillufion des fens,
ne fut pas cultivé en Grèce avec moins de fuccès
que l’archite&ure. On prétend qùe ie deffein, qui
en eft la bafe , doit fon origine aux regrets d’un
ami, ou à la tendreffe ingénieufe d’une amante.
Par le fecours d’une lumière, elle trouva,’ dit-oft,
le moyen très-fimple, d’arrêter avec un ftyle t,
fur une muraille, lé contour du profil d’un jeune
guerrier, prêt à s’éloigner,, à - peu - près comme
on l’a 'pratiqué parmi nous il y a quelques années.
Quoi qu’il- e n . fo it , les peintres grecs n’onr pas
été moins célébrés par leurs contemporains , que
les archite&es 8c les fculp teiirs8c il feroit peu
raifonnable de refufer fa créance à tout ce qu’ils
en ont dit, quelque exagéré que cela nous pa-
roiffe, puifque , par les ouvragés des fculpreurs
8c des architeéles qu’a épargnés le temps, 8c dont
les perfe&ipns font un objet continuel d’émulation
pour nos artiftes , nous convenons que ces
mêmes éloges font très-juftemeht mérités. De
tous les peintres de l’antiquité, Appelle eft celui
que l’on cite avec le plus d’éloges. Il avoit fait,
entre autres ouvrages, un portrait d’Alexandre,
(1) Le temple de Théfée à Athènes étoit entouré d'un
grand nombre de colonnes. Voye\ Paufanias & l’excellent
ouvrage de M. le R o i, fur les plus beaux menumens d$
la Grèce.
D