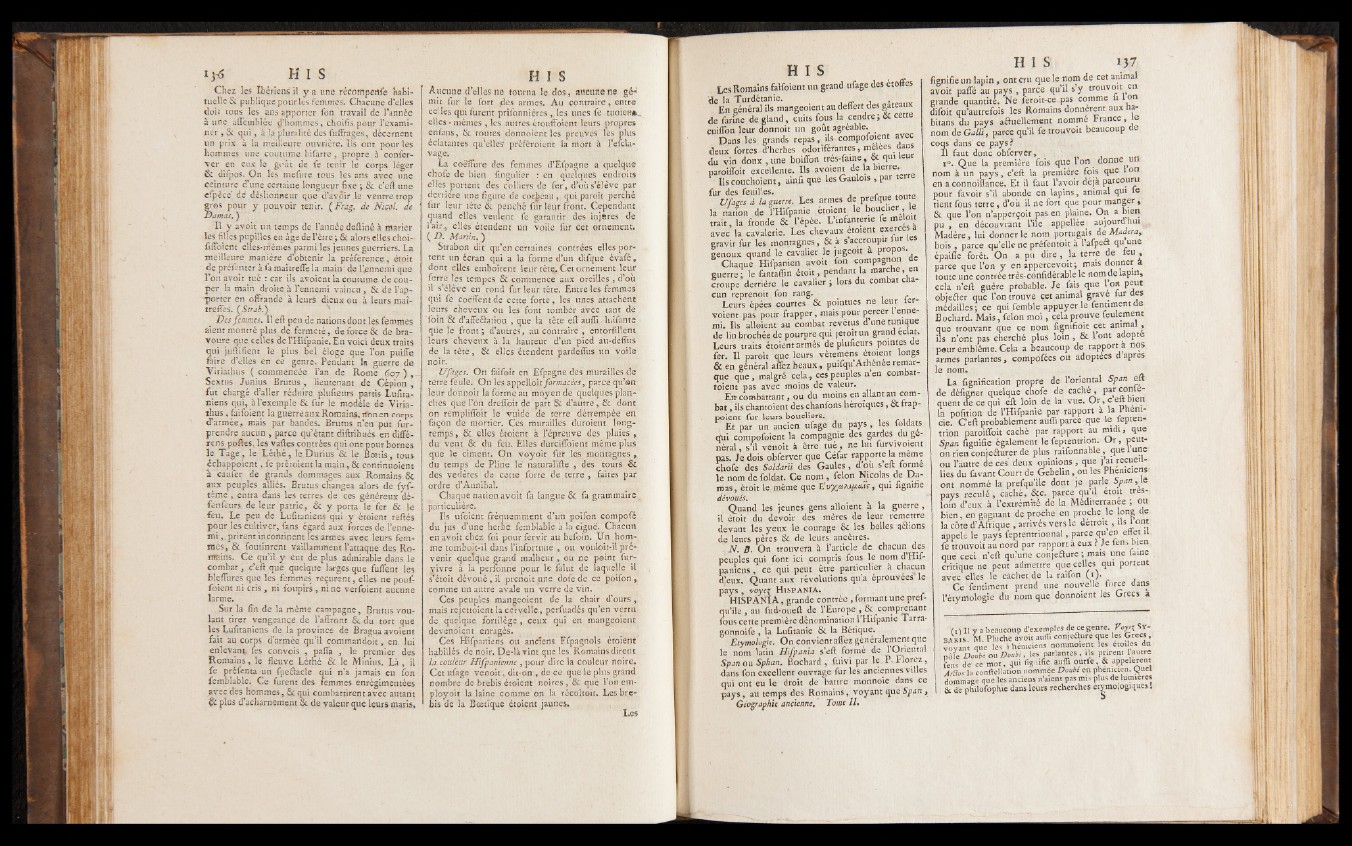
ij-6 H I S
Chez les Ihériens'il y a une récompense habituelle
& publique pour les femmes. Chacune d’elles
doit tous les ans apporter fon travail de l’année
à une alîembîçe d’hoir.mes, choifis pour l’examiner
, & q u i, à la pluralité des Suffrages, décernent
un prix à la meilleure ouvrière. Iis ont pour les
hommes une coutume biSarre, propre à confer-
v er en eux le goût de Se tenir le corps léger
& diSpos. On les meSure tous les ans avec une
ceinture d’une certaine longueur fixe ; & c’eft une
efpèce' dé déshonneur que d’avoir le ventre trop
Sres pour y pouvoir tenir. ( Frag. de Nicol. de
fem'as.')
Il y avoir un temps de l’année deftiné à marier
les filles pupilles en âge de l’être ; & alors elles choi-
fiffoient elles-mêmes parmi les jeunes guerriers. La
meilleure manière d’obtenir la préférence, étoit
de prèSenter à Sa maîtreffe la main de l’,ennemi que
l ’on avoit tué : car ils avoient la coutume de couper
la main droite à l'ennemi vaincu , & de l’apporter
en offrande à leurs dieux ou à leurs maî-
îreffes. (Strab.)
^ Des femmes. Il eft peu de nations dont les femmes
aient montré plus de fermeté, de force & de bravoure
que celles de l’Hifpanie. En voici deux traits
qui jufiifient le plus bel éloge que l’on puiffe
faire d’elles en ce genre. Pendant la guerre de
Viriathus ( commencée l’an de Rome 607 ) , .
Sextus Junius Brutus , lieutenant de Cépion,
fut chargé d’aller réduire plufieurs partis Lufita-
niens qui, à l’exemple & fur le modèle de Viria-
ihus , faifoient la guerre aux Romain#, rïon en corps
d’armée, mais par bandes. Brufus n’en put Surprendre
aucun , parce qu’étant diftribués en diffé-
rens poftes, les vaftes contrées qui ont pour bornes
le T a g e , le Léthé, le Durius & le Boetis, tous
échappaient, Se prètoient la main, & continuoient
à cauler de grands dommages aux Romains &
aux peuples alliés. Brutus changea alors de fyf-
tême, entra dans les terres de ces généreux dé-
fenfeurs de leur patrie, & y porta le fer & le
feu. Le peu de Lufîtaniens qui y étoient reliés
pour les cultiver, Sans égard aux forces de l’ennemi
prirent incontinent les armes avec leurs femmes
, & Soutinrent vaillamment l’attaque des Romains.
Ce qu’il y eut de plus admirable dans le
combat, c’eft qué quelque larges que fuffent les
blefïures que les femmes reçurent, elles ne pouf-
foient ni cris, ni Soupirs, ni ne verfoient aucune
larme.
Sur la fin de la même campagne, Brutus voulant
tirer vengeance de l’affront & du tort que
les Lufîtaniens de la province de Bragua avoient
fait au corps d’armée qu’il commandoit, en lui
enlevant, les convois , pafla , le premier des
Romains, le fleuve Léthé & le Minius. L à , il
fe préfenta un fpeéfacie qui n’a jamais eu Son
Semblable. Ce furent des femmes enrégimentées
avec des hommes, & qui combattirent avec autant
& plus d’acharnement 6c de valeur que leurs maris,
H I S
Aucune d elles 11e tourna le dos, aucune ne gé*»
mit Sur le fort ,des armes. Au contraire, entre
celles qui Surent prifonnières les unes Se tuoieiMk,
elles - mêmes , les autres étouffoient leurs propres
en fans, 8t toutes donnoient les preuves lès plus
éclatantes qu’elles pr-èféroient la mort à l’efcla-
vage.
La coëffure des femmes d’ESpagne a quelque
chofe de bien fingulier : en quelques endroits
elles portent des colliers de fer , d’où s’élève par
derrière une figure de corbeau, qui paroît perché
fur leur tête & penché fur leur front. Cependant
quand elles veulent Se garantir des injftres de
l’air, elles étendent un voile fur cet ornement.
( D. Martin. )
Strabon dit qu’en certaines contrées elles portent
un écran qui a la forme d’un difque évafé,
dont elles emboîtent leur tête. Cet ornement leur
ferre les tempes & commence aux oreilles , d’où
il s’élève en rond fur leur tête. Entre les femmes
qui fe coëffent de cette forte, les unes attachent
leurs cheveux ou les font tomber avec tant de
loin & d’affeélation , que la tête eff auflvluifante
que le front; d’autres, au contraire , entortillent
leurs cheveux à la hauteur d’un pied aü-deffus
de la tête, 6c elles étendent pardeffus un voile
noir.
Ufages. On fâifoit en Efpagne des murailles de
terre feule. On les appelloitformacées, parce qu’®n
leur donnoir la forme au moyen de quelques planches
que l’on dreffoit de part 6c d’autre, & dont
on remplifloit le vuide de terre détrempée en
façon de mortier. Ces murailles duroient longtemps
, 8t. elles étoient à l’épreuve des pluies ,
du vent 6c du feu. Elles durciffoient même plus
que le ciment. On voyoit fur les montagnes ,
du temps de Pline lé naturalifte , des tours %L
des vedères de cette forte de terre , faites par
Ordre d’Annibal.
Chaque nation avoit fa langue 8c fa grammaire ,f
particulière.
Ils ufoient fréquemment d’un poifon compofé
du jus d’une herbe femblable à la ciguë. Chacun
en avoit chez foi pour fervir au befoin. Un homme
tomboit-il dans l'infortune , ou vouloit-il prévenir
quelque grand malheur, où ne point fur-
vivre à la perfonne pour le falut de laquelle il
s’étoit dévoué, il prenoit une dofe de ce poifon,
comme un autre avale un verre de vin.
Ces peuples mangeoient de la chair d’ours,
mais rejettoient la ceryelle, perfuadés qu’en vertu
de quelque fortilège, ceux qui en mangeoient
devenaient enragés.
Ces Hîfpaniens ou anciens Efpagnols étoient
habillés de noir. De-là vint que les Romains dirent
la couleur HiÇp antenne , pour dire la couleur noire.
Cet ufage venoit, dit-on de ce que le plus grand
nombre de brebis étoient noires, 8c que l’on em-
ployoit la laine comme on la récoltoit. Les brebis
de la Boetique étoient jaunes.
H 1 s
Les Romains faifoient un grand ufage des étoffes
de la Turdètanie. _ , , „
En général ils mangeoient au deffert des gateaux
de farine de gland, cuits fous la cendre ; & cette
cuiffon leur donnoir un goût agréable.
Dans les grands repas, ils compofoient avec
deux fortes-d’herbes odoriférantes, melèes dans
du vin doux , une boiffon très-faine, & qui leur
paroiffoit excellente. Ils avoient de la b'erre;
Us couchoient, ainii que les Gaulois , par
fur des feuilles. .
Ufages à la guerre. Les armes de prefque toute
la nation de l’Hifpanie .étoient le bouclier, le
trait, la fronde & l’épée. L’infanterie fe meloit
avec la cavalerie. Les chevaux etoient exerces a
gravir fur les montagnes, & à s’accroupir lur les
genoux quand le cavalier le jugeoit a propos.
Chaque Hifpanien avoit fon compagnon de
guerre ; le fantaffin étoit, pendant la marche, en
croupe derrière le cavalier ; lors du combat cba-
cun reprenoit fon rang.
Leurs épées courtes 8c pointues ne leur îer-
voient pas pour frapper, mais pour percer 1 ennemi.
Ils alloient au combat revêtus d’une tunique
de lin brochée de pourpre qui jetoitun grand éclat.
Leurs traits étoient armés de plufieurs pointes de
fer. Il paroît que leurs vêtemens étoient longs
& en général allez beaux, puifqpAthénée remarque
que, malgré cela, ces peuples n en combat-
toient pas avec moins de valeur.
Eir combattant, ou du moins en allant au combat
, ils chantoient des chanfons héroïques, 6c frap-
poient fur leurs boucliers,
Et par un ancien ufage du pays, les foldats
dui compofoient la compagnie des gardes du général
, s’il venoit à être tu é , ne lui furvivoient
nas. Je dois obferver que Céfar rapporte la meme
chofe des Soldant des Gaules, d’ou s eft forme
le nom de foldat. Ce nom, félon Nicolas de Damas
, étoit le même que E'v’XjùKipctAÇ, qui lignine
dévoués.
Quand les jeunes gens alloient à la guerre,
il étoit du devoir des mères de leur remettre
devant les yeux le courage 8c les belles aâions
de leurs pères 8c de leurs ancêtres.
. N. B. On trouvera à l’article de chacun des
peuples qui font ici compris fous le nom d Hif-
paniens, ce qui peut être particulier a chacun
d’eux. Quant aux révolutions qu’.a éprouvées le
pays , voye{ Hispania.
HISPANIA, grande contrée , formant une pref-
qu’ile , au fud-oueft de l’Europe , 8c comprenant
lous cette première dénomination l’Hifpanie Tarra-
gonnoife , la Lufitanie 8c la Bétique.
Etymologie. On convient affez généralement que
le nom latin Hifpania s’eft forme de 1 Oriental
Span ou Sphan. Bochard , fuivi par le, P. Florez,
dans fon excellent ouvrage fur les anciennes villes
qui ont eu le droit de battre monnoie dans ce
pays, au temps des Romains, voyant que Span>
Géographie ancienne. Tome II»
H I S 137
fignlfie un lapin, ont cru que le nom de cet animal
avoit paffé au pays , parce qu’il s’y trouvait en
grande quantité. Ne ieroit-ce pas comme il Ion
difoit qu’autrefois les Romains donnèrent aux na-
bilans du pays a&uellement nomme France, e
nom de Galle, parce qu’il fe trouvoit beaucoup de
coqs dans ce pays ?
Il faut donc obferver, '
i° . Que La première fois que l’on donne un
nom à un pays, c’eft la première fois que 1 on
en a connoiffance. Et il faut l’avoir déjà parcouru
pour favoir s’il abonde en lapins, animal qui le
tient fous terre, d’où il ne fort que pour manger »
8c que l’on n’apperçoit pas en plaine. On a bieft
pu , en découvrant l’île appellée^ aujourd hui
Madère, lui donner le nom portugais de Madera,
bois , parce qu’elle ne préfentoit à l’afpeât qu une
j épaifle forêt. On a pu dire , la terre de teu ,
parce que l’on y en appercevoit ; mais donner a
toute une contrée très-confidérable le nom de lapin,
cela n’eft guère probable. Je fais que I on peut
objeéler que l’on trouve cet animal grave fur des
médailles; ce qui femble appuyer le fentimentde
Bochard. Mais, félon m oi, cela prouve feulement
que trouvant que ce nom fignifioit cet animal,
ils n’ont pas cherché plus lo in , 8c l ’ont adopte
pour emblème. Cela a beaucoup de rapport a nos
armes parlantes, compdfées ou adoptées d apres
le nom.
La Lignification propre de l’oriental Span eft
de défigner quelque chofe de caché, par conle-
quent de ce qui eft loin de la vue. O r , c eft bien
la pofition de l’Hifpanie par rapport à la Pheni-
cie. C ’eft probablement auffi parce que le lepten-
trion paroiffoit caché par rapport au midi, que
Span fignifie également le feptentrion. O r , Peut"
on rien conjeêlurer de plus raifonnable, que I une
ou l’autre de ces deux opinions , que j’ai recueillies
du favant Court de Gebelin, ou les Phéniciens
ont nommé la prefqu’île dont je parle Span, le
pays reculé, caché, &c. parce qu’il etoit très-
loin d’eux à l’extrémité de la Méditerranée ; ou
bien, en gagnant de proche en proche le long de
la côte d’Afrique , arrivés vers le détroit, ils 1 ont
appelé le pays feptentrionnal, parce qu’en effet il
fe trouvoit au nord par rapport à eux ? Je fens bien
que ceci n’eft qu’une conje&ure ; mais une faine
critique ne peut admettre que celles qui portent
avec elles le cachet de la raifon (0*
Ce fentiment prend une nouvelle force dans
l’étymologie du nom que donnoient les Grecs à
(1) Il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Voyt\ Sy -
b a r i s . M . Pluche avoit auffi conjeaure que les Grecs,
voyant que les Ihéniciens nommoiem les etoi es du
pôle Doubè ou Doubi, les parlantes , ils prirent 1 autre
fens de ce mot, qui fignifie auffi ourle, & appelèrent
Arclos la conft'ellation nommée Doabe en phemcien. ^rnei
dommage que les anciens n’aient pas mis plus de lumières
1. & de philofophie dans leurs recherches étymologiques.