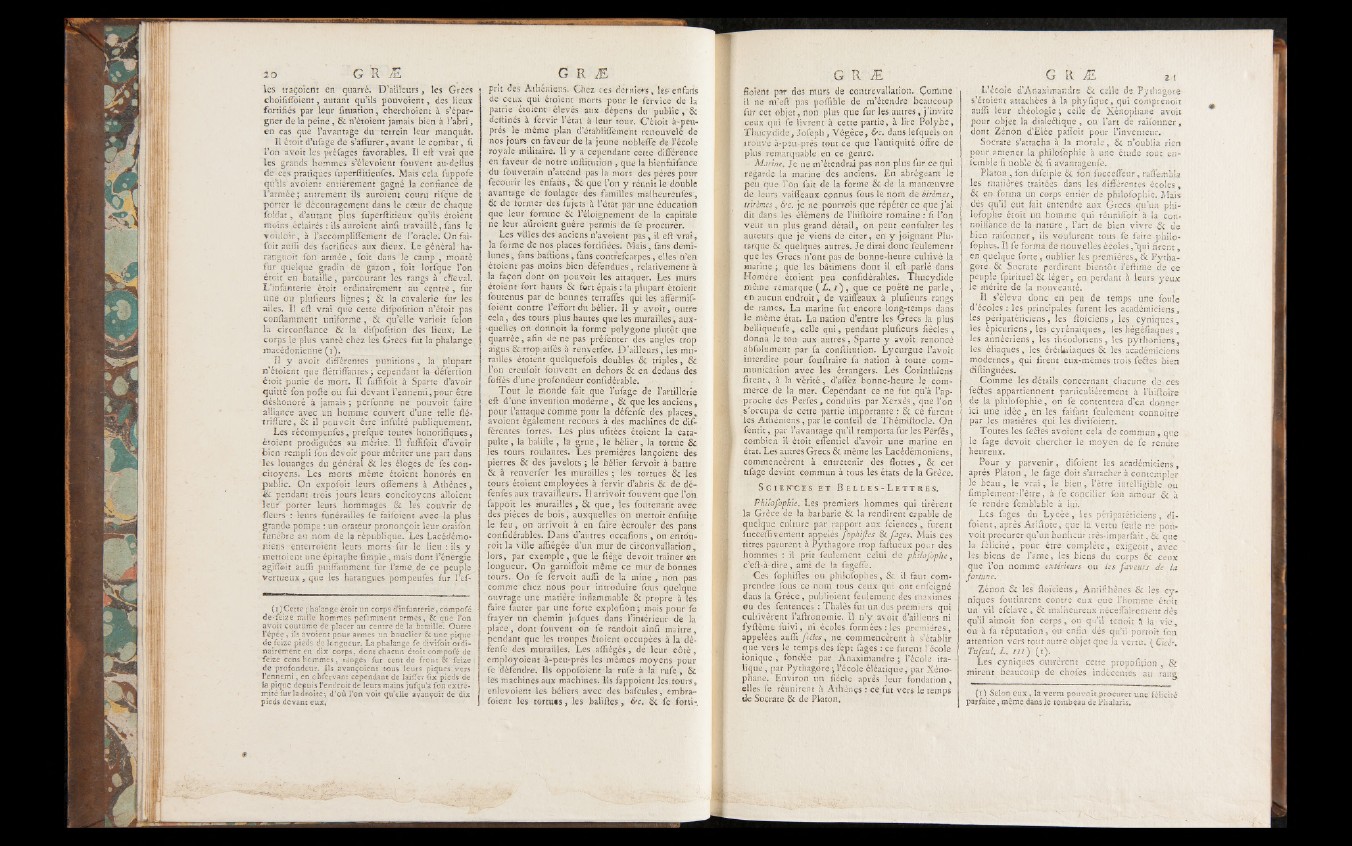
les traçoient en quarré. D ’ailleurs, les Grecs
choififfoient, autant qu’ils pouvoient, des lieux
fortifiés par leur fituation, cherchoient à s’épargner
de la peine, & n’étoient jamais bien à l’abri,
en cas que l’avantage du terrein leur manquât.
Il étoit d’ufage de s’affurer, avant le combat, fi
l’on avoit les préfages favorables. Il eft vrai que
les grands hommes s’élevoient fouvent au-delius
de ces pratiques luperftitieufes. Mais cela fuppofe
qu’ils avoient entièrement gagné la confiance de
l ’armée; autrement ils auroient couru rifque de
porter le découragement dans le coeur de chaque
foîdat, d’autant plus fuperftitieux qu’ils étoient
moins éclairés : ils auroient ainfi travaillé , fans le
vouloir, à l’acçoinpliffement de l’oracle. On fai*
foit auffi des facrifices aux dieux. Le général ha-
ratiguoit fon armée , foit dans le camp , monté
fur quelque gradin de gazon, foit lorfque l’on
étcit en bataille, parcourant les rangs à cheval.
L’infanterie étoit ordinairement au centre , fur
une ou plufieurs lignes ; 8c la cavalerie fur les
ailes. Il eft vrai que cette difpofition n’étoit pas
conftamment uniforme , 8c qu’elle varioit félon
la circonftance 8c la difpofition des lieuxi Le
corps le plus vanté chez les Grecs fut la phalange
macédonienne ( i) .
Il y avoit différentes punitions , la plupart
n’étoient que flétriffantes ; cependant la délertion
étoit punie de mort. Il fuffifoit à Sparte d’avoir
quitté fon pofte ou fui devant l’ennemi,pour être
déshonoré à jamais; perfonne ne pouvoit faire
alliance avec un homme couvert d’une telle flé-
triflüre, 8c il pcuvcit être infulté publiquement.
Les récompenfes, prefque toutes honorifiques,
étoient prodiguées au mérite. Il fuffifoit d’avoir
bien rempli fon devoir pour mériter une part dans
les louanges du général 8c les éloges de fes concitoyens.
Les morts même étoient honorés en
public. On expofoir leurs offemens à Athènes,
& pendant trois jours leurs concitoyens alloient
leur' porter leuis hommages & les couvrir de
fleurs : leurs funérailles fe faifoient avec la plus
grande pompe : un orateur prononçoit leur oraifon
funèbre an nom de la république. Les Lacédémoniens
enterroient leurs morts-fur le. lieu : ils y
mettoient une épitaphe fimple, mais dont l’énergie
agifteit auffi puiffamment fur i’ame de ce peuple,
vertueux, que les harangues pompeufes fur l’ef-
(i)Cette phalange étoit un corps d’infanterie', compofé
de-feize mille hommes pefamment armés, & que l’on
avoit coutume de placer au centre de la bataille*. Outre
l’épée, ils avoient pour armes un bouclier & une pique
de feize pieds de longueur. La phalange fe divifoit ordinairement
en dix corps, dont chacun étoit compofé de
feize cens hommes, rangés fur cent de front & feize
de profondeur. Ils avançoienr tous leurs piques vers
l’ennemi, en cbfervant cependant de laifîer fix pieds de .
la pique depuis l’endroit de leurs mains jufqu’â fon extrémité
fur la droite-, d’où l’on voit qu’elle ayançoit de dix
pieds devant eux.
prit des Athéniens. Chez ces derniers, les-enfaris
cie ceux qui étoient morts pour le fervice de la
patrie étoient élevés aux dépens du public, &
deftinés à fervir l’état à leur tour. C ’était à-peu-
près le même plan d’établiffement renouvelé de
nos jours en faveur de la jeune nobleffè de l’école
royale militaire. 11 y a cependant cette différence
en faveur cle notre inftitution , que la bienfaifance
du fouverain n’attend pas la mort des pères pour
fecoiirir les enfans, 8c~ que l’on y réunit le double
avantage de foulager des familles malheureufesg
& de former des fujets à l’état par une éducation
que leur fortune 8c l’éloignement de la capitale
ne leur auroient guère permis de fe procurer.
Les Villes des anciens n’avoient pas, il eft vrai,
la forme de nos places fortifiées. Mais, fans demi-
lunes, fans baftions , fans contrefcarpes, elles n’en
étoient pas moins bien défendues, relativement à
la façon dont on pouvoit les attaquer. Les murs
étoient fort hauts & fort épais : la plupart étoient
foutenus par de bonnes terraffes qui les affermif-
foient contre l’effort du bélier. Il y avoit, outre
cela, des tours plus hautes que les murailles, auxquelles
on dorinoit la forme polygone plutôt que
quarrée, afin de ne pas préfenter des angles trop
aigus & trop aifés à renverfer. D ’ailleurs, les m u railles
étoient quelquefois doubles 8c triples, &
l’on creufoit fouvent en dehors & en dedans des
foffés d’une profondeur confidérable.
Tout le monde fait que l’ufage de l’artillerie
eft d'une invention moderne, 8c que les anciens ,
pour l’attaque comme pour la défenfe des places ,
avoient également recours à des machines de différentes
fortes. Les plus ufitées étoient la catapulte
, la balifte, la grue, le bélier, la tortue &
les tours roulantes. Les premières lançoiemt des
pierres 8c des javelots ; le bélier fervoit à battre
8c à renverfer les murailles ; les tortues 8c les
tours étoient employées à fervir d’abris & de dé-
fenfes aux travailleurs. Il arrivoit fouvent que l’on
fappoit les murailles, & que, les foutenarït avec
des pièces de bois, auxquelles on mettoit enfuite
le feu, on arrivoit à en faire écrouler des pans
confidérables. Dans d’autres occafions, on entôu-
roit la ville affiégée d’un mur de circonvallation,
lors, par exemple , que le fiègè de voit traîner en
longueur. On garniffoit même ce mur de bonnes
tours. On fe fervoit auffi de la mine , non pas
comme chez nous pour introduire fcms quelque
ouvrage une matière inflammable 8c propre à les
faire fauter par une forte explofion ; mais pour fe
frayer un chemin jiifques clans l’ihiérieur de la
place, dont fouvent on fe rendoit ainfi maître,
pendant que les troupes étoient occupées à la défenfe
des murailles. Les affiégés, de leur côté,
employoient à-peu-près les mêmes moyens pour
fe défendre. Ils oppofoient la rufe à la rufe, 8c
les machines aux machines. Ils fappoient les.tours,
enlevoient les béliers avec des bafcules, embra-
foient les tortu*s, les baliftes, &c. & fe forù-.
fioletit pa*r des murs de contrevallation. Çomme
il ne m’eft pas poffible de m’étendre beaucoup
fur cet objet, non plus que fur les autres, j ’invite
ceux qui fe livrent à cette partie, à lire Polybe,
Thucydide, Jofeph, Végèce, &c. dans lefqueis.ôn
trouve à-peu-près tout ce que l’antiquité offre de
plus remarquable en ce genre.
Alarme. Je ne m’étendrai pas non plus fur ce qui
regarde la marine des anciens. En abrégeant le
peu que l’on fait de la forme & de la manoeuvre
de leurs vaiffeaux connus fous le nom de birèmes,
trirèmes, &c. je ne pourrois que répéter ce que j’ai
dit dans les élémens cle l’hiftoire romaine : fi l’on
veut un plus grand détail, on peut confulter les
auteurs que je viens de citer, en y joignant Plutarque
8c quelques autres. Je dirai donc feulement
que les Grecs n’ont pas de bonne-heure cultivé la
marine ; que les bâtimens dont il eft parlé dans
Homère étoient peu confidérables. Thucydide
même remarque ( L. i ) , que ce poète ne parle,
en aucun endroit, de vaiffeaux à plufieurs rangs
de rames. La marine fut encore long-temps dans
le même état. La nation d’entre les Grecs la plus
belliqueufe, celle qui, pendant plufieurs fiècles ,
donna le ton aux autres, Sparte y avoit renoncé
abfolument par fa conftimtion. Lycurgue l’avoit
interdite pour fopftraire fa nation à toute com-
mu m'câtion avec les étrangers. Les Corinthiens
firent, à la vérité, d’affez bonne-heure le commerce
de la mer. Cependant ce ne fut qu’à l’approche
des Perfes, conduits par Xerxès, que l’on
s’occupa de cette partie importante : & ce furent
les Athéniens, par le confeil de Thémiftocle. On
fentit, par l’avantage qu’il remporta fur les Peffês,
combien il étoit effentiel d’avoir une marine en
état. Les autres Grecs & même les Lacédémoniens,
commencèrent à entretenir des flottes , 8c cet
ufage devint commun à tous les états de la Grèce,
S c i e n x e s e t B e l l e s - L e t t r e s .
Philofophie. Les premiers hommes qui tirèrent
la Grèce de la barbarie & la rendirent capable de
quelque culture par rapport aux fciences, furent
fucceffivenient appelés fophijles & figes. Mais ces
titres parurent à Pythagore trop faftueux pour des
hommes : il prit feulement celui de philofophe,
ç’eft-à-dire, ami de la fageffe.
Ces fophiftes ou philofophes, & il faut comprendre
fous ce nom tous ceux qui ont enfeigné
dans la Grèce, pub'ioient feulement des maximes
Ou des fentences : Thaïes fut un des premiers qui
cultivèrent l’aftronomie. Il n’y avoit d’ailleurs ni
fyftême fuivi, ni écoles formées : les premières,
appelées auffi f i l e s , ne commencèrent à s’établir
que vers le temps des fept fages : ce furent l’école
ionique, fondée par Anaximanclre ; l’école italique
, par Pythagore ; l’école éléatique, par Xéno-
phane. Environ un fiècle après, leur fondation ,
elles fe réunirent à Athènçs : ce fut vers le temps
de Socrate 8c de Pkton.
L’école d’Anaximandre 8c celle, de Pythagore
s’étoient attachées à la phyfique, qui coniprenoit
auffi leur théologie ; celle de Xénophane avoit
pour objet la dialeétique , ou l’art de raifonner,
dont Zénon d’Elée paffoit pour l’inventeur.
Sotrate s’attacha à la morale, 6c n’oublia rien
I pour amener la philofophie à une étude tout en-
iemble fi noble 6c fi avantageufe.
Platon , fon difciple Sc fon fucceffeur, raffembja
les matières traitées dans les différentes écoles,
6c en forma un corps entier de philofophie. Mais
dès qu’il eut fait entendre aux Grecs qu’un philofophe
étoit un homme qui réuniffoit à la çon*
noiffance de la nature, l’art de bien vivre 6c de
bien raifonner, ils voulurent tous fe faire philofophes.
Il fe forma de nouvelles écoles »'qui firent,
en quelque forte, oublier les premières, 6c Pythagore.
6c Socrate perdirent bientôt Teftime de ce
peuple lpirituel 6c léger, en perdant à leurs yeux
le mérite de la nouveauté.
Il s’éleva donc en peu de temps une foule
cl’écoles: les principales furent les académiciens,
les péripatériciens, les ftoïciens, les cyniques.,
les épicuriens, les cyrénaïques, les hégéfiaques ,
les annéeriens, les théodoriens , les pyrhomens.,
les éiiaques, les érétbriaques 6c les académiciens
modernes, qui firent eux-mêmes trois feéles bien
diftinguées.
Comme les détails concernant chacune de ces
fe&es appartiennent particuliérement à l’hiftoire
de la philofophie, on fe contentera d’en donner
ici une idée , en les faifaht feulement connoîtré'
| par les matières qui les divifoient.
Toutes les fe&ès avoient cela de commun , que
le fage devoir chercher le moyen de fe rendre
heureux.
Pour y parvenir, difoiènt les académiciens,
après Platon , Je fage doit s’attacher à contempler
Je beau, le v rai, le bien, l’être intelligible ou
finalement l’être, à fe concilier fon amour 6c à
fe rendre femblable à lui.
Les fages du L y cé e , les péripatériciens, dî-
foient, après Ariftote, que la vertu feule ne pouvoir
procurer qu’un bonheur très-imparfait, 6c que
la félicité, pour être complète, exigeoit, avec
les biens de l’ame, les biens du corps 6c ceux
que l’on nomme extérieurs ou les faveurs de la
fortune.
Zénon 6c les ftoïciens , Antifihènes 6c les cyniques
fournirent contre eux que l’homme étoit
un vil efclave , 8c malheureux néceffairement dès
qu’il aimoit fon corps, ou qu’il tenoit à la v ie ,
ou à fa réputation, ou enfin dés qu’il portoit fon
attention vers tout autre objet que la venu. ( Cicér.
Tufcul. L. n i ) (i).
Les cyniques outrèrent cette propofition , 6c
mirent beaucoup de chofes indécentes au ram*
( i ) Selon e u x , la vertu pouvoit.procurer une félicité
parfaite, même dans le tombeau de Phalaris.