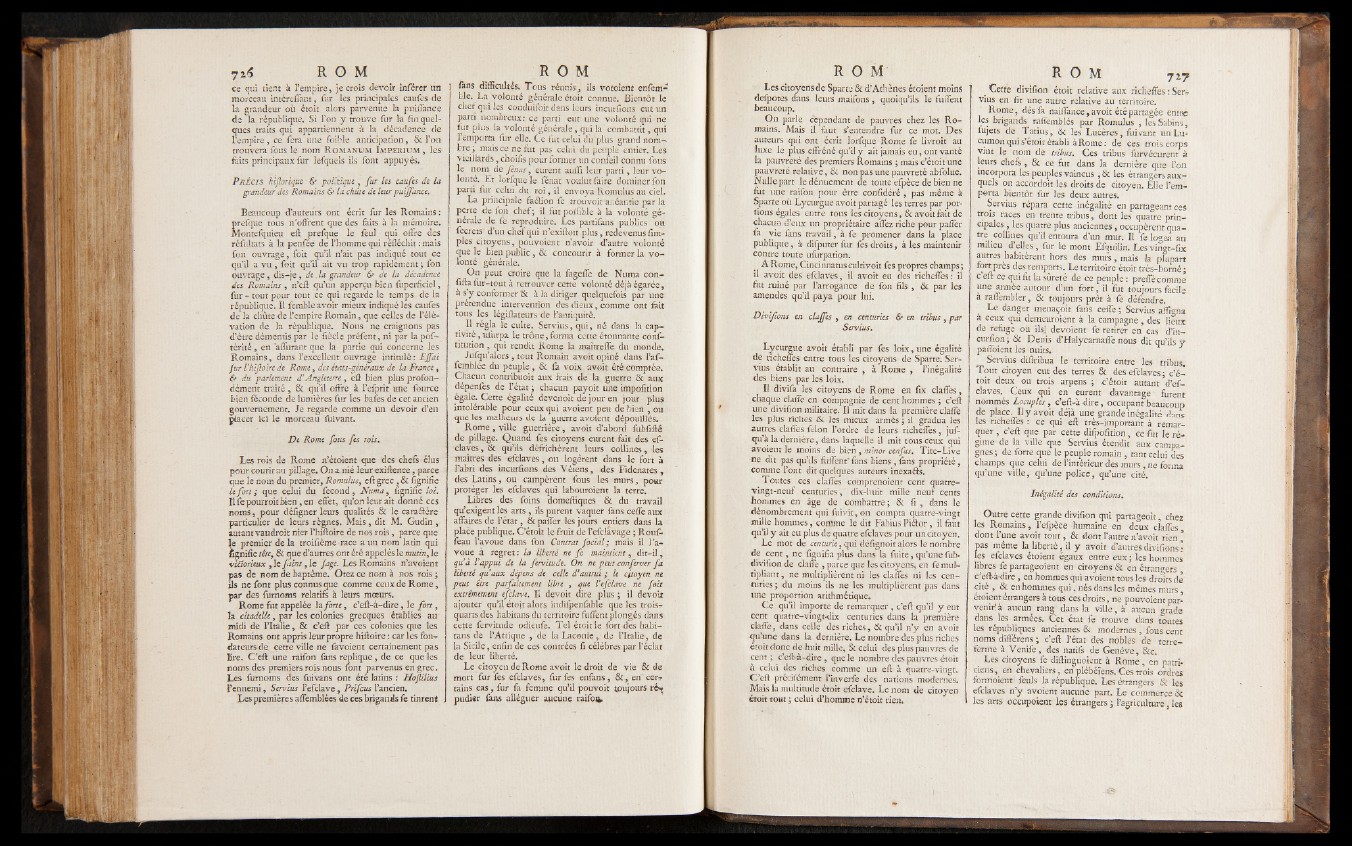
ce qui tient à l’empire, je crois devoir inférer lin
morceau intéreffant, fur les principales caiifes de
la grandeur où étoit alors parvenue la puiffance
de la république. Si l’on y trouve fur la fin quelques
traits qui appartiennent à la décadence de
l ’empire, ce fera une foible anticipation, & l’on
trouvera fous le nom R om an um Im p erium , les
faits principaux fur lefquels ils font appuyés.
P r é c i s hijlorique & politique, fur les caufes de la
grandeur des Romains & la chûte de leur puijfance.
Beaucoup d’auteurs ont écrit fur les Romains:
prefque tous n’offrent que des faits à la mémoire.
Montefquieu eft prefque le feul qui offre des
réfultats à la penfée de l’homme qui réfléchit : mais
l'on ouvrage, foit qu’il n’ait pas indiqué tout ce
qu’il a vu , foit qu’il ait vu trop rapidement ; fon
ouvrage, dis-je, de la grandeur & de la décadence
des Romains , n’eft qu’un apperçu bien fuperficiel,
fur - tout pour tout ce qui regarde le temps de la
république. Il femble avoir mieux indiqué les caufes
de la chûte de l’empire Romain, que celles de l’élévation
de la république. Nous ne craignons pas
d’être démentis par le fiècle préfent, ni par la pof-
térité, en affurant que la partie qui concerne les
Romains, dans l’excellent ouvrage intitulé: Effai
fur l-hifloire de Rome, des états-généraux de la France,
& du parlement d’Angleterre, eft bien plus profondément
traité, & qu’il offre à l’efprit une fource
bien féconde de lumières fur les bafès de cet ancien
gouvernement. Je regarde comme un devoir d’en
placer ici le morceau fuivant.
De Rome fous fes rois.
Les rois de Rome n’étoient que des chefs élus
pour courir au pillage. On a nié leur exiftence, parce
que le nom du premier, Romulus, eft grec, & figriifie
le fon ; que celui du fécond , Numa, fignifie loi.
Il fe pourroit bien, en effet, qu’on leur ait donné ces
noms, pour défigner leurs qualités & le caractère
particulier de leurs règnes. Mais, dit M. Gudin,
autant vaudroit nier Phiftoire de nos rois, parce que
le premier delà troifième race a un nom latin qui
lignifie tête, & que d’autres ont été appelés le mutin, le
Viêîorieux , le faint, le fage. Les Romains n’avoient
pas de nom de baptême. Otez ce nom à nos rois ;
ils ne font plus connus que comme ceux de Rome,
par des furnoms relatifs à leurs moeurs.
Rome fut appelée la forte, c’eft-à-dire, le fort,
la citadelle, par les colonies grecques établies au
midi de l’Italie, & c’eft par ces colonies que les
Romains ont appris leur propre hiftoire : car les fon-r
dateurs de cette ville ne favoient certainement pas
lire. C ’eft une raifon fans répliqué, de ce que les
noms des premiers rois nous font parvenus en grec.
Les furnoms des fuivans ont été latins : Hofiilius
l’ennemi, Servius l’efclave, Prifcus l’ancien.
Les premières affemblécs de ces brigands fe tinrent
fans difficultés. Tous réunis, ils votoient enfem-
kje. La volonté générale étoit connue. Bientôt le
chef qui les conduifoit dans leurs incurfions eut un
parti nombreux: ce parti eut une volonté qui ne
fut plus la volonté générale , qui la combattit, qui
l’emporta fur elle. Ce fut celui du'plus grand nom--
i mais ce ne fut pas celui du peuple entier. Les
vieillards, choifis pour former lin conleil connu fous
le nom de fénat, eurent auffi leur parti, leur volonté.
Et lorfque le fénat voulut faire dominer fon
parti fur celui du roi, il envoya Romulus au ciel.
La principale fadion fe trouvoitanéantie parla
perte de fon chef; il fut pofîible à la volonté générale
de fe reproduire. Les partifans publics ou
fecrets d’un chef qui n’exiftoit plus, redevenus (impies
citoyens, pouvoient n’avoir d’autre volonté
que le bien public, & concourir à former la volonté
générale.
On peut croire que la fageffe de Numa con-
fifta fur-tout à retrouver cette volonté déjà égarée,
à s’y conformer & à la diriger quelquefois par une
prétendue intervention des dieux, comme ont fait
tous les légiflateurs de l’antiquité.
Il régla le culte. Servius, qui, né dans la captivité,
ufurpa le trône,forma cette étonnante cônf-
titution, qui rendit Rome la maîtreffe du monde.
Jufqu’alors , tout Romain avoit opiné dans l’af-
femblée du peuple, & fa voix avoit été comptée.
Chacun contribuoit aux frais de la guerre & aux
dépenfes de l’état ; chacun payoit une impofition
égale. Cette égalité devenoit de jour en jour plus
intolérable pour ceux qui avoient peu de bien , ou
que les malheurs de la guerre avoient dépouillés. '
Rome , ville guerrière , avoit d’abord fubfifté
de pillage. Quand fes citoyens eurent fait des ef-
claves, & qu’ils défrichèrent. leurs collines , les
maîtres des efclaves, ou logèrent dans le fort à l’abri des incurfions des Yéïens, des Fidenates,
des Latins, ou campèrent fous les murs, pour
protéger les efclaves qui labouroient la terre.
Libres des foins domeftiques & du travail
qu’exigent les arts , ils purent vaquer fans ceffe aux
affaires de l’é tat, & paffer les jours entiers dans la
place publique. C ’étolt le fruit de l’efclavage ; Rouf-
feau l’avoue dans fon Contrat fociâl,* mais il l’avoue
à regret : la liberté ne fe maintient, dit-il,
quà l’appui de la fervitude. On ne peut conferver fa
liberté qu’aux dépens de celle dlautrui ; le citoyen ne
peut être parfaitement libre , que l’efclave ne foit
extrêmement efclave. Il devoit aire plus ; il devoir
ajouter qu’il étoit alors indifpenfable que les trois-?
quarts des habitans du territoire fuffent plongés dans
cette fervitude odieufe. Tel étoit le fort des habitans
de l’Attique , de la Laconie, de l’Italie, de
la Sicile, enfin de ces contrées fi célèbres par l’éclat
de leur liberté.
Le citoyen de Rome avoit le droit de vie & de
mort fur fes efclaves, fur fes enfans, & , en' cer-r
tains cas, fur fa femme qu’il pouvoit toujours ré*
pudier fans alléguer aucune raifon»
Les citoyens de Sparte & d’Athènes étoiertt moins
defpotes dans leurs maifons, quoiqu’ils le fuffent
beaucoup.
On parle cependant de pauvres chez les Romains.
Mais il faut s’entendre fur ce mot. Des
auteurs qui ont écrit lorfque Rome fe livroit au
luxe le plus effréné qu’il y ait jamais eu, ont vanté
la pauvreté des premiers Romains ; mais c’étoit une
pauvreté relative, & non pas une pauvreté abfolue.
Nulle part ie dénuement de toute efpèce de bien ne
fot une raifon pour être confidéré , pas même à
Sparte où Lycurgue avoit partagé les terres par portions
égales entre tous les citoyens, 8c avoit fait de
chacun d’eux un propriétaire affez riche pour paffer
fa vie fans travail, à fe promener dans la place
publique, à difputer fur fes droits , à les maintenir
contre toute ufurpation.
A Rome, Cincinnatuscultivoit fes propres champs ;
il avoit des efclaves , il avoit eu des richeffes: il
fut ruiné par l’arrogance de fon fils , & par les
amendes qii’il paya pour lui.
Divifons en clajfes , en centuries & en tribus, par
Servius.
Lycurgue avoit établi par fes loix, une égalité
de richeffes entre tous les citoyens de Sparte. Servius
établit au contraire , à Rome , l’inégalité
des biens par les loix.
Il divifa les citoyens de Rome en fix claffes,
chaque claffe en compagnie de cent hommes ; c’eft
une divifion militaire. Il mit dans la première claffe
les plus riches & les mieux armés ; il gradua les
autres claffes félon l’ordre de leurs richeffes, juf-
qu’à la dernière, dans laquelle il mit tous Ceux qui
avoient le moins de bien , minor cenfus. Tite-Live
ne dit pas qu’ils fuffent* fans biens , fans propriété,
comme l’ont dit quelques auteurs inexads.
Toutes ces claffes comprenoient cent quatre-
vingt-neuf centuries, dix-huit mille neuf cents
hommes en âge de combattre ; & fi , dans le
dénombrement qui fuivit, on compta quatre-vingt
mille hommes, comme le dit Fabius Piftor, il faut
qu’il y ait eu plus de quatre efclaves pour un citoyen.
Le mot de centurie, qui défignoit alors le nombre
de cent, ne fignifia plus dans la fuite, qu’une fub-
divifion de claffe , parce que les citoyens, en fe multipliant
, ne multiplièrent ni les claffes ni les centuries
; du moins ils ne les multiplièrent pas dans
une proportion arithmétique.
Ce qu’il importe de remarquer , c’eft qu’il y eut
cent quatre-vingt-dix centuries dans la première
claffe, dans celle des riches, & qu’il n’y en avoit
qu’une dans la dernière. Le nombre des plus riches
étoit donc de huit mille, & celui des plus pauvres de
cent; c’eft-à-dire, que le nombre des pauvres étoit
a celui des riches comme un eft à quatre-vingt.
C ’eft précifément l’inverfe des nations modernes.
Mais la multitude étoit efclave. Le nom de citoyen
étoit tout ; celui d’homme n’étoit rien.
ROM 7 * 7
Cette divifion étoit relative aux richeffes : Ser*
vius en fit une autre relative au territoire.
Rome, dès fa naiffance, avoit été partagée entre
les brigands raffemblés par Romulus , lesSabins,
fujets de Tatius, & les Lucères, fuivant unLu-
cumon qui s etoit établi à Rome : de ces trois corps
vint le nom de tribus. Ces tribus Turvécurent à
leurs chefs, & ce fut dans la dernière que l’on
incorpora les peuples vaincus ,& les étrangers auxquels
on accordoit les droits de citoyen. Elle l’emporta
bientôt fur les deux autres.
Servius répara cette inégalité en partageant ces
trois races en trente tribus, dont les quatre principales
, les quatre plus anciennes, occupèrent qua-,
tre collines qu’il entoura d’un mur. Il fe lo^ea au
milieu d’elles, fur le mont Efquifin. Les vingt-fix
autres habitèrent hors des murs, mais la plupart
fort près des remparts. Le territoire étoit très-borné;
c eft ce qui fit la sûreté de ce peuple : preffé comme
une armée autour d’un fort, il fut toujours facile
à raffembler, & toujours prêt à fe défendre.
, Le danger menaçoit fans ceffe ; Servius aflîgna
a ceux qui demeuraient à la campagne , des lieux
de refiige où ils,’ dévoient fe retirer en cas d’iu-
curiion ; 8c Denis d’Halycarnaffe nous dit qu’ils y
pafîbient les nuits.. J
Servius diftribua le territoire entre les tribus.
Tout citoyen eut des terres & des efclaves; c’étoit
deux ou trois arpens ; c ’étoir autant d’e f-
claves. Ceux qui en eurent davantage furent
nommés Locuplcs, c’eft-à dire, occupant beaucoup
de place. Il y avoit déjà une grande inégalité dans
les richeffes : ce qui eft très-important à remarquer
, c’eft que par cette difpofition, ce fut le régime
de la ville que Servius étendit aux campagnes
; de forte que le peuple romain , tant celui des
champs que celui de l’intérieur des murs, ne forma
qu’une ville, qu’une police, qu’une cité.
Inégalité des conditions.
Outre cette grande divifion qui partageoit, chez
les Romains, l’efpèce humaine en deux claffes
dont l’une avoit tout, & dont l’autre n’avoit rien )
pas même h. liberté, il y avoit d’autres divifions :
les efclaves étoient égaux entre eux ; les hommes
libres fe partageoient en citoyens & en étrangers
c’eft-à-dire, en hommes qui avoient tous les droits dé
cité , & en hommes qui, nés dans les mêmes murs
étoient étrangers à tous ces droits, ne pouvoient parvenir!
à aucun rang dans la ville, à aucun grade
dans les armees. Cet état fe trouve dans toutes
les républiques anciennes & modernes, fous cent
noms différens ; c’eft l’état des nobles de terre-
ferme à Venife, des natifs de Genève, &c.
Les citoyens fe diftinguoient à Rome, en patriciens,
en chevaliers, en plébéiens. Ces trois ordres
formoient feuls la république. Les étrangers & les
efclaves n’y avoient aucune part. Le commerce &
les arts occupoient les étrangers ; l’agriculture, les