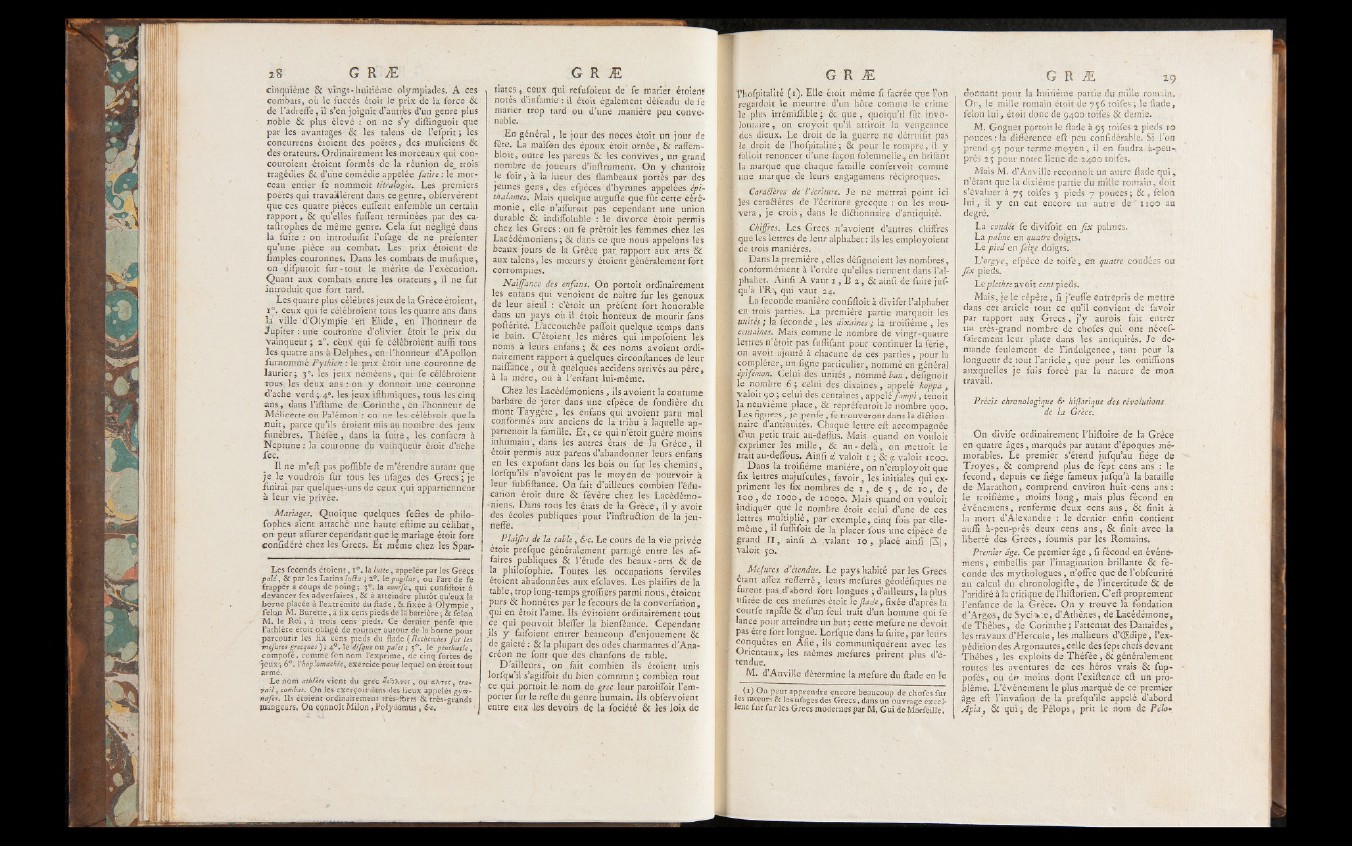
i8 G R Æ
cinquième 8c vingt-huitième olympiades. A ces
combats, où le fuccès étoit le prix de la force &
de l ’adreffe, il s’en joignit d’autres d’un genre plus
noble & plus élevé : on ne s y diftinguoit que
par les avantages & les talens de l’elprit ; les
concurrens étoient des poètes, des muficiens &
des orateurs. Ordinairement les morceaux qui con-
couroient étoient formés de la réunion de^ trois
tragédies & d’une comédie appelée fatire : le morceau
entier fe nommoit tétralogie. Les premiers
poètes qui travaillèrent dans ce genre, obferyèrent
que ces quatre pièces euffent ensemble un certaiii
rapport, & qii’elles fuffent terminées par des ca-
taflrophes de même genre. Cela fut négligé dans
la fuite : on introduit l’ufage dé ne préfenter
qu’une pièce au combat. Les prix étoient de
fimples couronnes. Dans les combats de mufique,
on difputoit fur-tout le mérite de l’exécution.
Quant aux combats entre les orateurs, il ne fut
introduit que fort tard.
Les quatre plus célèbres jeux de la Grèce étoient,
i° . ceux qui fe célébroient tous les quatre ans dans
la v ille 'd ’OIympie ’ en Elide, en l’honneur de
Jupiter : une couronne d’olivier étoit le prix du
vainqueur ; 2°. ceux qui fe célébroient aufli tous
les quatre ans à-Delphes, en l’honneur d’Apollon
iurnommé Pythien : le prix étoit une couronne de
laurier; 30. les jeux néméens, qui fe célébroient
tous les deux ans : on y donnoit une couronne
d’ache verd ;4 ° . les. jeux ifthmiques, tous les cinq
ans, dans l’iflhme de .Corinthe, en l’honneur de
Mélicerte ou Palémon : on ne les célébroit que la
nuit,' parce qu’ils étoient mis au nombre des jeux
funèbres. Thé fé e , dans la fuite, les confacra à
Neptune : la couronne du vainqueur étoit d’ache
fec.
Il ne m’eft pas poflible de m’étendre autant que
je le voudrois fuir tous les ufages des Grecs ; je
finirai par quelques-uns de ceux qui appartiennent
à leur vie privée.
Mariages. Quoique quelques feôes de philo-
fophes aient attaché une haute eftime au célibat,
on- peut affurer cependant que le mariage étoit fort
confidéré chez les Grecs. Et meme chez les Spar-
Les féconds étoient, i 9. la lutte, appelée par les Grecs
paie, & par les Latins lucla -, a9. le pugilat\ ou l’art de fe
frapper à coups de poing; 30. la courfe, qui confiftoit à
devancer fes adversaires, & à atteindre plutôt qu’eux la
borne placée à l’extrémité du ftade, & fixée à Olympie ,
félon M. Burette, à fix cens pieds de la barrière ; & félon
M. le Roi, à trois cens pieds. Ce dernier penfe que
l ’athlète étoit obligé de tourner autour de la borne pour
parcourir les fix cens pieds du ftade (Recherches fur les
mefures grecques ) y 4°. le difque ou palet ; 50. le peuthatle ,
compofé, commefonnom l’exprime, de cinq fortes de
jeux ; 6°. Yhop!ômackie> exercice pour lequel on étoit tout
armé.
Le nom athlète vient du grec «sâ'Vrsf, ou «Xtoc , travail,
combat. On les exerçoit’dans des lieux appelés gym-
nafesi Ils étoient ordinairement très-ft>rts & très-grands
mangeurs, On connaît Milon, Polydamus, &c.
G R Æ
tiates, ceux qui refufôient de fe marier étoient
notés d’infamie' : il étoit également défendu de fe
marier trop tard ou d’une manière peu convenable.
.En général, le jour des noces étoit un jour de
fête. La maifon des époux étoit ornée, & raffem-
bloit, outre les parens 8c les convives, un grand
nombre de joueurs d’inftrument. On y chantoit
le fo ir , à la lueur des flambeaux portés par des
jeunes gens, des efpèces d’hymnes appelées êpi-
thaiames. Mais quelque augufte que fût cette cérémonie
, elle n’affuroit pas cependant une union
durable & indiffoluble : le divorce étoit permis
chez les Grecs: on fe prêtoit les femmes chez les
Lacédémoniens ; & dans ce que nous appelons les
beaux jours de la Grèce par rapport aux arts &
aux talens, les moeurs y étoient généralement fort
corrompues.
Naiffance des en fans. On portoit ordinairement
les enfans qui venoient de naître fur les genoux
de leur aïeul : c’étoit un préfent fort honorable
dans un pays ou il étoit honteux de mourir fans
poftérité. L’accouchée paffoit quelque temps dans
le bain. C ’étoienty les mères qui impofoient les
noms à leurs enfans ; 8c ces noms a voient ordinairement
rapport à quelques circonftances de leur
naiffance, oiï à quelques accidens arrivés au père,
à la mère, ou à l'enfant lui-même.
Chez les Lacédémoniens, ils avoient la coutume
barbare de jeter dans une efpèce de fondière du
mont Tay gè te , les enfans qui avoient paru mal
conformés aux anciens de la tribu à laquelle ap-
partenoit la famille. E t, ce qui n’étoit guère moins
inhumain, dans les autres états dé la Grèce, il
étoit -permis aux parens d’abandonner leurs enfans
en les expofant dans les bois ou fur les chemins ,
lorfqu’ils n’avoient pas le moyen de pourvoir à
leur fubfiftance. On fait d’ailleurs combien l’éducation
étoit dure & févère chez les Lacédémoniens.
Dans tous les états dé la Grèce, il y avoit
des écoles publiques pour l’inftruéHon de la jeu-
neffe.
Plaijirs de la table, &c. Le cours de la vie privée
étoit prefque généralement partagé entre les affaires
publiques & l’étude des beaux-arts & de
la philofophie. Toutes les occupations ferviles
étoient abadonnées aux efclaves. Les plaifirs de la
table, trop long-temps grofii.ers parmi nous, étoient
purs & honnêtes par le fecours de la converfation,
qui ea étoit l’ame. Ils évitoient ordinairement tout
ce qui pouvoit bleïfer la bienféance. Cependant
ils y faifoient entrer beaucoup d’enjouement &
de gaieté : & la plupart des odes charmantes d’Anacréon
ne font que des chanfons de table.
D ’ailleurs, on fait combien ils étoient unis
lorfqw’il s’agiffoit du bien commun; combien toiit
ce qui portoit le nom de grec leur parpiffoit l’emporter
fur le refte du genre humain. Ils obfervoient
entre eux les devoirs de la fociété & les loix de
G R Æ
Thofpitalîté (1). Elle étoit même fi facrée que l’on
1 1 regardoit le meurtre d’un hôte comme le crime
I le plus irrémifliblë : & que , quoiqu’il fût invo-
I [ lontaïre, on croyoit qu’il attiroit la vengeance
I | des dieux. Le droit de la guerre ne détruifit pas
1 ; le droit de l’hofpitalité; & pour le rompre, il y
I I falloit renoncer d’une façon folenrnelle,, en brifant
I la marque que chaque famille confervoit comme
■ lune marquer de leurs engagemens réciproques.
■ Caraft'eres de Vécriture. Je ne mettrai point ici
1 • les caractères de l’écriture grecque : on les trou-
vera, je crois, dans le diélionnaire d’antiquité.
! Chiffres. Les Grecs n’avoient d’autres chiffres
il que lés lettres de leur alphabet : ils les employoient Jfl [ de trois manières.
J Dans la première , elles défignoient les nombres,
B conformément à l’ordre qu’elles tiennent dans l’al-
B phabet. Ainfi A vaut 1 , B 2 , & ainfi de fuite juf-
JB qu’à l’R\ qui vaut 2.4.
La fécondé manière confiftoit à dtvifer l’alphabet
-■■■■! en trois parties. La première partie marquoit les
■ unités ; la fécondé , les dixaines ; la troifième , les
J centaines. Mais, comme le nombre de vingt-quatre
! lettres n’étoit pas fuffifànt pour continuer la férié,
; avoit ajouté à chacune de ces parties, pour la
compléter, un ligne particulier, nommé en général
Mgcpifénion. Celui, des unités, nommé , défignoit
Ie nombre 6 ; celui des dixaines , appelé koppa ,
-if valoit 90 ; celui des centaines, appelé fatnpi, tenoit
jB l a neuvième place, & repréfenioit le nombre 900.
iEes figures , je penfe, fe trouveront dans le di&ion-
H n a ir e d’antiquités. Chaque lettre eft accompagnée
■ d ’un petit trait, au-deffus. Mais quand on vouloit
jBexprimer les mille * & au -d elà, on mettoit le
Jw trait au-deffous. Ainfi ci valoit 1 ; 8c et valoit 1000.
1 Dans la troifième manière, on n’employoit que B flX lettres majufcules, favoir, les initiales qui exi
l priment les fix nombres de 1 , de 5 , de 10, de
^ 100, de 1000, de 10000. Mais quand on vouloit
indiquer que le nombre étoit celui d’une de ces
lettres multiplié, par exemple, cinq fois par elle-
même , il fuffifoit de la placer fous une eïpèce de
grand FI, ainfi A ,valant 10 , placé ainfi |Â1,
i valoit $o.
MeJures d'étendue. Le pays habité par les Grecs
étant affez re(Terré , leurs'mefures géodéfiques ne
furent pas„d’abord fort longues ; d’ailleurs, la plus
tifitée de ces mefures étoit le flade, fixée d’après la
courfe rapfde 8c d’un feul trait d’un homme qui fe
m lance pour atteindre un but; cette mefure ne devoit
S pas être fort longue. Lorfque dans la fuite, par leurs
B conquêtes en A f ié , ils communiquèrent avec les
B Orientaux, les mêmes mefures prirent plus d’é- 1 ; tendue.
M. d’Anvilie détermine la mefure du ftade en le
I ï * C1) Dn peut apprendre encore beaucoup de chofes fur
| les moeurs & les ufages des G recs, dans un ouvrage excellent
fait fur les Grecs modernes par M, Gui de Marfeille,
G R Æ 29
donnant pour la huitième partie du mille romain.
O r , le mille romain étoit de 756 toifes ; le ftade,
félon lui, étoit donc de 9400 toifes & demie.
M. Goguet portoit le ftade à 95 toifes % pieds 10
pouces : la différence eft peu confidérable. Si l ’on,
prend 95 pour terme moyen ; il en faudra ^à-peu-
près 25 pour notre lieue de 2400 toifes.
Mais M. d’Anville reconnoît un autre ftade qui,
n’étant que la dixième partie du mille romain, doit
s’évaluer à 75 toifes 3 pieds 7 pouces ; & , félon
lu i, il y en eut encore un autre d e ''1100 au
degré.
La coudée fe divifoit en fix palmes.
La palme en quatre doigts.
Le pied en feiçe doigts.
L’orgye, efpèce de toile, en quatre coudées ou
fix pieds.
Leplethre avoit cent pieds.
Mais, je le répète, fi j’euffe entrepris de mettre
dans cet article tout ce qu’il 'convient de favoir
par rapport aux Grecs , j’y aurois fait entrer
jaa très-grand nombre de chofes qui ont nécef-
fàirement leur place dans les antiquités. Je demande
feulement de l’indulgence, tant pour la
longueur de tout l’article, que pour les omifiions
auxquelles je fuis forcé par la nature de mon
travail.
Précis chronologique & hifiorique des révolutions
de la Grèce.
On divife ordinairement l ’hiftoire de la Grèce
en quatre âges, marqués par autant d’époques mémorables.
Le premier s’étend jufqu’au fiège de
Troy e s, & comprend plus de fept cens ans : le
fécond, depuis ce fiège fameux jufqu’à la bataille
de Marathon, comprend environ huit-cens ans,:
le troifième, moins long, mais plus fécond en
événemens, renferme deux cens ans, & finit à
la mort d’Alexandre : le dernier enfin contient
aufii à-peu-près deux cens ans, & finit avec la
liberté des Grecs, fournis par les Romains.
Premier âge. Ce premier âge , fi fécond en évène-
mens, embellis par l’imagination brillante 8c féconde
des mythologues, n’offre que de l’obfcurité
au calcul du chronologifte, de l’incertitude & de
l’aridité à la critique de l’hiftorien. C ’eft proprement
l’enfance de la Grèce. On y trouve la fondation
d’Argos, de Syc? ^.:e, d’Athènes, de Lacédémone,
de Thèbes, de Corinthe ; l’attentat des Danaïdes ,
les travaux d’Hercule, lés malheurs d’QXaipe, l’expédition
des Argonautes, celle des fept chefs devant
Thèbes , les exploits de Théfée , & généralement
toutes les aventures de ces héros vrais & fup-
pofés, ou dit moins dont l’exiftence eft un problème.
L’événement le plus marqué de ce premier
âge eft Fmvafion de la prefqu’île appelé d’abord
Apia, & qui ; de Pélops, prit le nom de Pélo