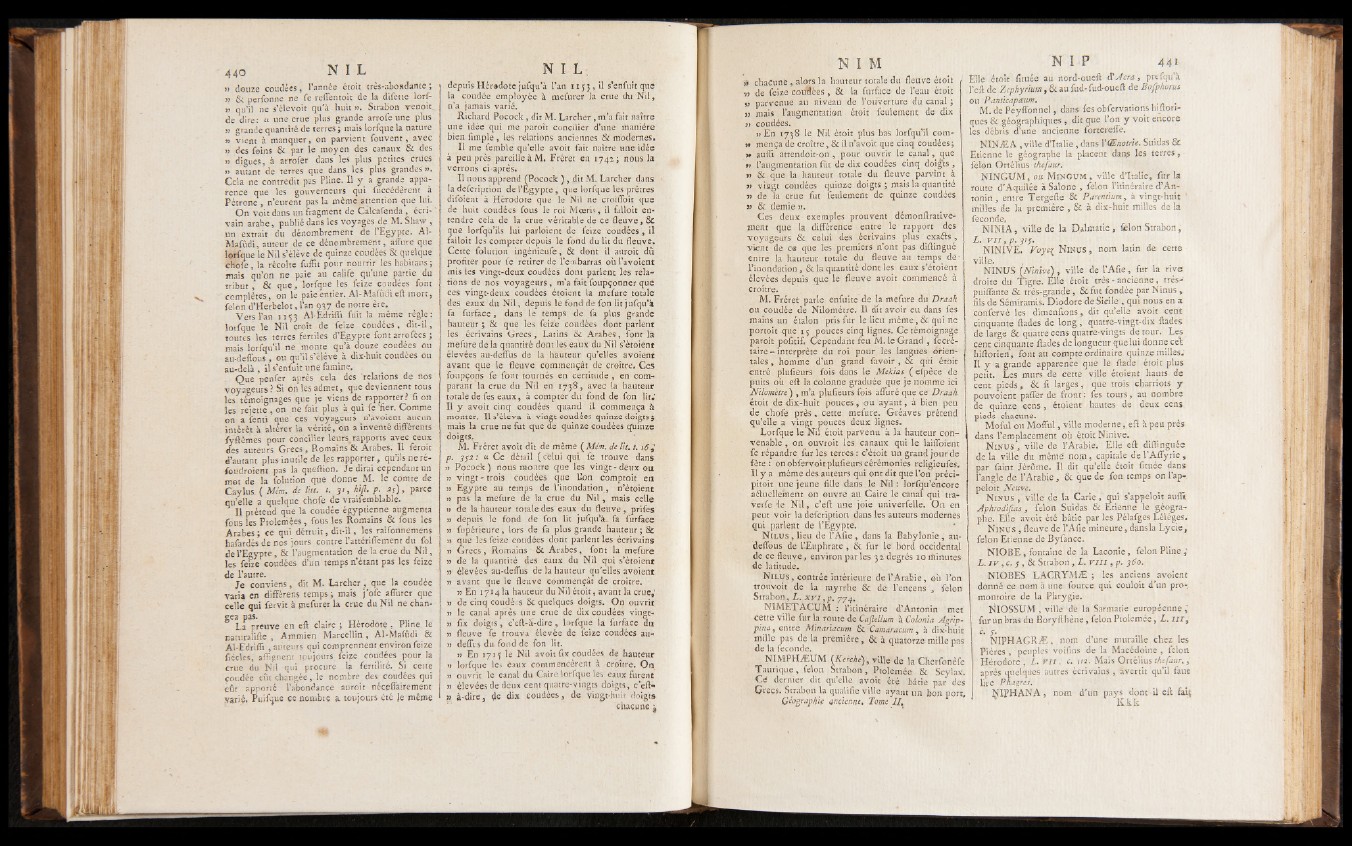
440 N I L
il douze coudées , l’îinnês etoit tres*3boBtl3Ste j
» & perforine ne fe reffentoit de la difette lorf-
» qu’il ne s’élevoit qu'à huit ». Strabon venoit_
de dire: « une crue plus grande arrofe une plus
» grande quantité de terres ; mais lorfque la nature
n vient à manquer, on parvient Couvent, avec
» des foins & par le moyen des canaux & des
» digues, à arrofer dans les plus petites crues
» autant de terres que dans les plus grandes ».
Cela ne contredit pas Pline. Il y a grande apparence
que les gouverneurs qui fuccèdèrent à
Pétrone , n’eurent pas la même attention que lui.
On voit dans un fragment de Calcafenda , écri- ‘
vain arabe, publié dans les voyages de M. Shatv ,
un extrait du dénombrement de l’Egypte. Al-
Mafùdi, auteur de ce dénombrement, affure que
lorfque le Nil s’élève de quinze coudées & quelque
chofe, la récolte fuffit pour nourrir les habitans ;
mais qu’on ne paie au calife qu’une partie du
tribut, & que, lorfque les feize coudées font
complètes, on le paieentier. Al-Mafûdieft mort,
félon d’Herbelot, l’an 937 de notre ère.
Vers l’an 1153 Al Edrifli fuit la même règle1:
lorfque le Nil croît de feize coudées, dit-il,
toutes les terres fertiles d’Egypte font arrofées ;
mais lorfqu’il ne monte qu’à douze coudées ou
au-deffons, ou qu’il s’élève à dix-huit coudées ou
au-delà , il s’enfuit une famine.
Que penfer après cela des relations de nos
voyageurs? Si on les admet, que deviennent tous
les témoignages que je viens de rapporter? fi on
les rejette , on ne fait plus à qui fe ‘fier. Comme
on a fend que ces voyageurs n’avoient aucun
intérêt à altérer la vérité, on a inventé différents
fyftêmes pour concilier leurs,rapports avec ceux
des auteurs Grecs, Romains 8t Arabes. Il feroit
d’autant plus inutile de les rapporter, qu’ils ne résoudraient
pas la queftion. Je dirai cependant un
mot de la folution que donne M. le comte de
Caylus. ( Mêm. dt lut. 1. 31, hift. p. * f ) , parce
qu’elle a quelque chofe de vraifemblable.
Il pi étend que la coudée égyptienne augmenta
fous les Ptolémées, fous les Romains & fous les
Arabes; ce qui détruit, dit-il, les raifonnemens
hafardés de nos jours contre l’attériffement du fol
de l’E gypte, & l’augmentation de la crue du N i l,
les feize coudées d’un temps n’étant pas les feize
de l’autre.
Je conviens, dit M. Larcher , que la coudee
varia en différens temps ; mais j’ofe affurer que
celle qui fervit à piefurer la crue du Nil ne changea
pas. t .
La preuve en eft claire ; Hérodote, Pline le
naturalifte , Ammien Marcellin, Al-Mafâdi &
Al-Edrifli, auteurs qui comprennent environ feize
fiècles, a {lignent toujours feize coudées pour la
crue du Nil qui procure la fertilité. Si celte
coudée eût changée, le nombre des coudées qui
eût apporté l’abondance auroit néceffairement
yarié* Puifque ce nombre a toujours été Je même
N I L
depuis Hérodote jufqu’à l’an 1153, il s’enfuit que
la coudée employée à mefurer la crue du Nil,
n’a jamais varié.
Richard Pocock, dit M. Larcher , m’a fait naître
une idée qui me paroît concilier d’une manière
bien fimple, les relations anciennes & modernes.
Il me femble qu’elle avoit fait naître une idée
à peu près pareille à M. Fréret en 1742; nous la
verrons ci-après.
Il nous apprend (Pocock ) , dit M. Larcher dans
la description de l’Egypte, que lorfque les prêtres
difôient à Hérodote que le Nil ne croifloit que
de huit coudées fous le roi Moeris, il fal.loit entendre
cela de la crue véritable de ce fleuve, &
que lorfqa’ils lui partaient de feize coudées , il
failoit les compter depuis le fond du lit du fleuve.
Cette folution ingénieufe, & dont il auroit dû
profiter pour fe retirer de l’embarras o iil’avoient
mis les vingt-deux coudées dont parlent les relations
de nos voyageurs, m’a fait foupçonner que
ces vingt-deux coudées étoient la mefure totale
des eaux du Nil, depuis le fond de fon lit jufqu’à
fa furface, dans le temps de fa plus grande
hauteur ; & que les feize coudées dont parlent
les écrivains Grecs, Latins & Arabes, font là
mefure de la quantité dont les eaux du Nil s’étoient
élevées au-deflùs de la hauteur qu’elles avoient
avant que le fleuve commençât de croître. Ces
foupçons fe font tournés en certitude , en comparant
la crue du Nil en 1738, avec la hauteur
totale de fes eaux, à compter du fond de fon lit.’
Il y avoit cinq coudées quand il commença à
monter. Il s’éleva à vingt coudées quinze doigts ÿ
mais la crue ne fut que de quinze coudées quinze
doigts.
M. Fréret ayoit dit de même (Méat. de lit t. 16*
p. 352 : u Ce détail ( celui qui fe trouve dans
jj Pocock ) nous montre que les vingt - deux pu
» vingt-trois coudées que lion comptoir eu
j> Egypte au temps de l’inondation, n’étoient
jj pas la mefure de la crue du N i l , mais celle
» ae la hauteur totale des eaux du fleuve, prifes
» depuis le fond de fon lit jufqu’à . fa furface
» fupérieure, lors de fa plus grande hauteur ; &
» que les feize coudées dont parlent les écrivains
» Grecs, Romains &. Arabes, font la mefure
» de la quantité des eaux du Nil qui s’étoient
» élevées au-deflùs de la hauteur qu’elles avoient
» avant que le fleuve commençât de croître.
» En 1714 la hauteur du Nil étoit, avant la crue,’
» de cinq coudées & quelques doigts. On ouvrit
n le canal après line crue de dix coudées vingt-
» fix doigts, c’eft-à-dire, lorfque la furface du
n fleuve fe trouva élevée de feize coudées ail-
jj defîtrs du. fond de fon lit.
jj En 1713 le Nil avoit fix coudées de hauteur
» lorfque les eaux commencèrent à croître. On
jj ouvrit le canal du Caire lorfque les eaux furent
jj élevées de deux cent quatre-vingts doigts., c ’eft»
v à'dire, de dix coudées, de vingt-huit doigts
chacune i
N I M
» chaCunè, alors la hauteur totale du fleuve étoit |
« de feize codSées, & la furface de l’eau étoit
» parvenue au niveau de l’ouverture du canal ;
» mais l’augmentation étoit feulement de dix
» coudées.
jj En 1738 le Nil étoit plus bas lorfqu’il com-
w meriça de croître, & iln’avoit que cinq coudées;
» aufli attendoit-on , pour ouvrir le canal, que
v l’augmentation fût de dix coudées cinq doigts ,
jj & que la hauteur totale du fleuve parvînt à
jj vingt coudées quinze doigts ; mais la quantité
jj de la crue fut feulement de quinze coudées
jj & demie jj.
Ces deux exemples prouvent démonflrative-
meiit que la différence entre le rapport des
voyageurs & celui des .écrivains plus exaâs ,
-vient de ce que les premiers n’ont pas diftingué
entre la hauteur totale du fleuve au temps de-
l’inondation, & la quantité dont les eaux s’étoient
élevées depuis que le fleuve avoit commencé à
croître. > ’ -
M. Fréret parle enfuite de la mefure du Draah
ou coudée de Nilomètre. Il dit avoir eu dans fes
mains un étalon pris fur le lien même, & qui ne
portoit que 1 ç pouces cinq lignes. Ce témoignage
paroît pofitifr Cependant feu M. le Grand , Secrétaire
- interprète du roi pour les langues orientales
, homme d’un grand favoir , & qiii étoit
entré plufieurs fois dans le Mekias ( efpèce de .
puits où eft la colonne graduée que je nomme ici
Nilomètre ) , m’a plufieurs fois aflùré que ce Draah
étoit de dix-huit pouces, ou ayant, à bien peu
de chofe près , cette mefure. Gréaves prétend
qu’elle a vingt pouces deux lignes.
Lorfque le Nil étoit parvenu à la hauteur con- ,
venable , on ouvroit les canaux qui le laiffoient
fe répandre furies terres: c’étoit un grand jour de
fête.: on obfervoit-plufieurs cérémonies religieufes.
Il y a même des-auteurs qui ont dit que l’on préci-
pitoit une jeune fille dans,le Nil: lorfqu’encore
aéluellement on ouvre au Caire le canal qui tra-
verfe de N il, c’eft une joie univerfelle. On en
peut voir la defeription dans les auteurs modernes
qui parlent de l’Egypte.
N ilu s , lieu de l’Afie , dans la Babylonie, au-
deflous de l’Euphrate , & fur le bord occidental
de ce fleuve, environ par les 32 degrés 10 minutes
de latitude.
N il u s , contrée intérieure de l’A rab ie , où l ’on
troùvoit de la myrrhe & de l’encens , félon
Strabon, L. x v i, p. 774.
NIMETACUM : l’ itinéraire d’Antonin met
cette ville fur la route de Cajlellum à Colonia dgrip-
pïna, entre Minariacum & Camaracum, à dix-huit
mille pas de la première, & à quatorze mille pas
de la fécondé.
NIMPHÆUM (Kerchè) , ville de la Cherfonèfe
Taurique, félon Strabon, Ptolemée & Scylax.
Cd dernier dit qu’elle avoit été bâtie par des
Grecs. Strabon la qualifie ville ayant un bon port.
Géographie ancienne. Tome IL
N I P 441
Elle étoit fl tuée au nord-oueft tfdcra, prefqu’à
l ’eft de Zephyrium, & au fud-fud-oueft de JBofphorus
ou Panticapaum. .
M. de Peyffonnel, dans fes obfervattans hiftori-
ques Sc géographiques , dit que l’on y voit encore
les débris d’une ancienne forterefle.
NINÆ A , ville d’Italie, dans Yfènotrie. Suidas &
Etienne le géographe la placent danp les terres,
félon Ortélius thefaur.
NINGUM, ou Min g um , ville d’Italie, fur la
route d’Aquilée à Salone , félon ritinéraire d’Antonin,
entre Tergefte & Parentium, à vingt-huit 1
milles de la première , & à dix-huit milles de la
fécondé.
NINIA, ville de la D.alinatie, félon Strabon ;
X. vu, p. 3>s- - , . ,
NINIVE. Voye^ Ninus , nom latin de cette
ville. ,
NINUS (.Ninive) , ville de l’A fie , fur la rive
droite du Tigre. Elle étoit très - ancienne, très-
puiflante & très-grande, & fu t fondée par Ninus ,
fils de Sémiramis. Diodore de Sicile , qui nous en a
confervé les dimenfioos, dit qu’elle avoit cent
cinquante ftades de lo n g , quatre-vingt-dix ftades
de large & quatre cens quatre-vingts de tour. Les
cent cinquante ftades de longueur que lui donne cet
hiftorien, font au compte ordinaire quinze milles.
Il y a grande apparence que le ftade étoit plus
petit. Les murs de cette ville étoient hauts de
cent pieds, & fi larges, que trois charriots y
pouvoient pafîer de front: fes tours, au nombre
de quinze cens , étoient hautes de deux cens
pieds chacune.
Mo fui ou Moflùl, ville moderne, eft à peu près
dans l’emplacement où étoit Ninive.
Nin u s , ville de l’Arabie. Elle eft diftinguée
de la ville du même' nom, capitale de l’Aflyrie ,
par faint Jérôme. Il dit qu’elle étoit fituée dans
l ’angle de l’Arabie, & que de fon temps on l’ap-,
peloit Neuve.
Ninus , ville de la Carie, qui s’appeloit aufli
Aphrodifias, felcm Suidas & Etienne le géographe.
Elle avoit été bâtie par les Pélafges Léléges.
Ninus , fleuve de l’Afie mineure, dans la L y cie,
félon Etienne de Byfance.
N IO B E , fontaine de la Laconie, félon Pline,’
L . i v , c. 7 , & Strabon , L. v i n , p. 360.
NIOBES LACRYMÆ ; les anciens avoient
donné ce nom à une foutee qui couloit d’un promontoire
de la Phrygie.
NIOSSUM , ville de la Sarmatie européenne^
fur un bras du Boryfthène, félon Ptolemée, L. 111,
c. S'
NIPHAGRÆ, nom d’une muraille chez les
Piéres , peuples voifins de la Macédoine, félon
Hérodote, L. v u , c. 112. Mais Ortélius thefaur. s
après quelques autres écrivains , avertit qu’il faut
lire P h agrès.
NIPHANA, nom d’un pays dont il eft fai$
K k k