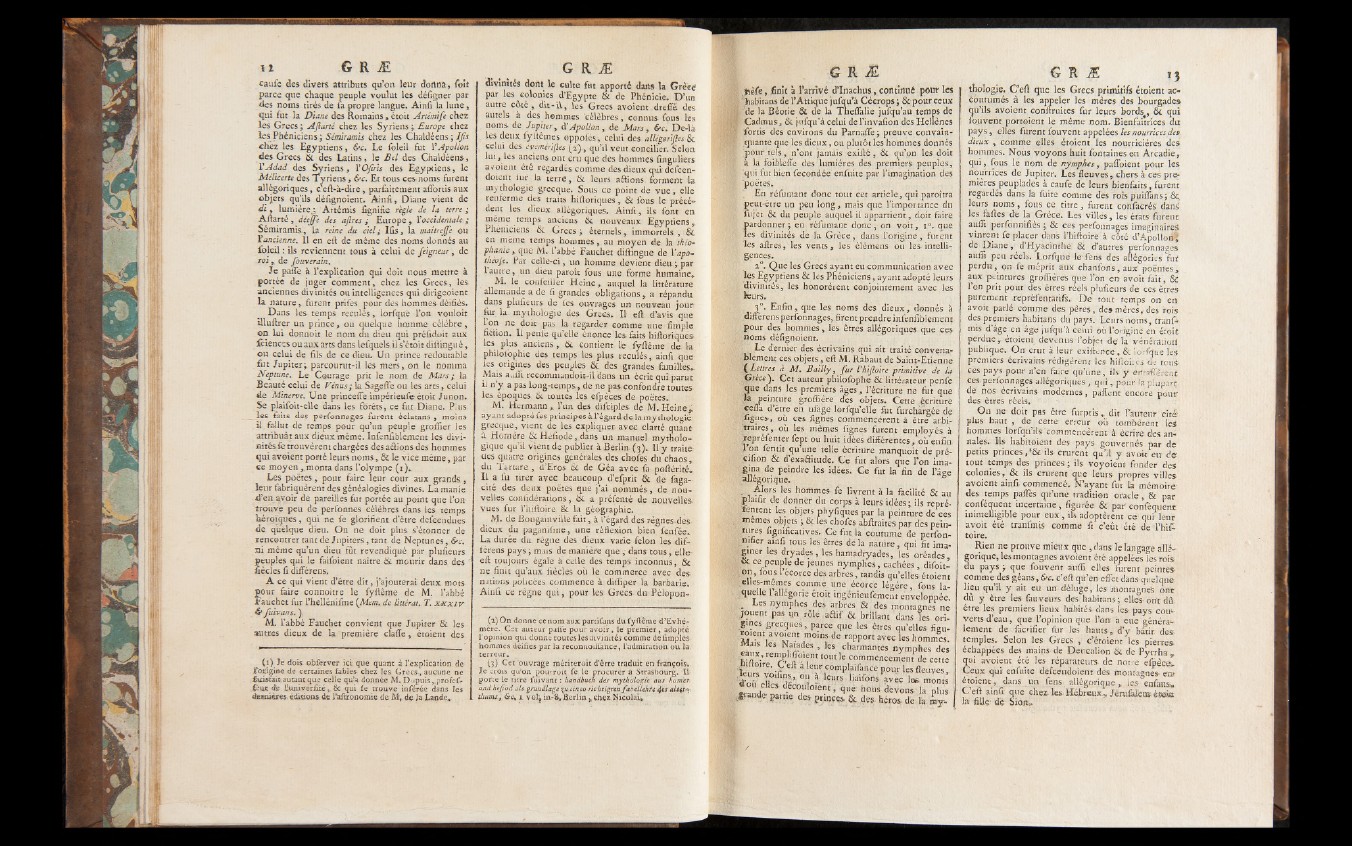
caufe des divers attributs qu’on leur dortnâ, (oit
parce que chaque peuple voulut les désigner par
des noms tirés de la propre langue. Ainfi la lune,
qui fut la Diane des Romains, étoit Artémife chez
les Grecs ; AJlarté chez les Syriens ;. Europe chez
les Phéniciens ; S émir amis chez les Chaldéens; Ifîs
chez les Egyptiens, &c. Le foleil fut l’Apollon
des Grecs & des Latins, le Bel des Chaldéens,
i Adad des Syriens, YOfîris des Egyptiens, le
Mélicerte des Tyriens , &c. Et tous ces noms furent
allégoriques, c’eft-à-direparfaitement affortis aux
objets qu’ils défignoient. Àinfi, Diane vient de
di y lumière,; Artémis lignifie règle de la terre ;
Aftart è 9 déejjè des autres; Europe, Y occidentale ;
Sémiramis., la reine du ciel; Iûs , la tnaîtrejje ou
Vancienne. 11 en eft de même des noms donnés au
foleil i ils reviennent tous à celui de feigneur, de
roi r de fouverai/i.
Je paffè à l’explication qui doit nous mettre à
portée de juger comment, chez les Grecs, les
anciennes divinités ou intelligences qui dirigeoient
la nature,. furent prifes pour des hommes déifiés.
Dans les temps reculés y lorfqué l’on vouloir
illullrer un prince , ou quelque homme célèbre,
on lui donnoit Le nom du dieu qui préfidoit aux
fcienccs ou aux arts dans lefquels.il s’étoit diftingué,.
ou celui de fils de ce dieu. Un prince redoutable
fut Jupiter; parcourut-il les mers,.on le nomma
Neptune. Le Courage prit le nom. de Mars7. la
Beauté celui de Vénus; la Sageffe ou les arts , celui
de Minerve. Une princeffe impérieufe étoit Junon.
Se plaifoit-elle dans Les forêts, ce fut Diane. Plus.
_ le s faits des perfonnages furent éclatans , moins
ü,fallut de temps pour qu’un peuple grofiier les
attribuât aux dieux même. Infenfiblement les divinités
fe trouvèrent chargées des actions des hommes
qui avoient porté, leurs noms, & le vice même ,.par
ce moyen , monta dans l’olympe (i) „
Les poètes, pour faire leur cour aux grands,,
leur fabriquèrent des généalogies divines. La manie
d’en avoir de pareilles fut portée au point que l’on
trouve peu de perfonnes célèbres dans les temps
héroïques, qui ne fe glorifient d’être defeendues
de. quelque dieu. On ne doit plus s’étonner de
rencontrer tant de Jupiters, tant de Neptunes,.6*t:.
ni même qu’un dieu fut revendiqué par plufieurs
peuples qui le faifbient naître & mourir dans des '
fiècles fi differens.
A ce qui vient d’être dit, j’ajouterai deux mots
pour faire connoitre le fyftême de M. l’abbé
Fauchet fur l’hellénifine (Mém. de littéral. T. x x x i v
& fulvans. );
M. l’abbé Fauchet convient que Jupiter & les
autres dieux de la première d a fle , étoient des 1
(1) Je dois obferver ici que quant à l’explication, de
jfocigine de certaines fables chez les Grecs.,, aucune ne
fetisfait autant que celle qu’a- donnée M, Dupuis ,.profe£-
feus dé i'univérlbé,. & qui £e trouve inférée dans les
deanières. éditions, de faftronomie de M , de la Lande,.
divinités dont le culte fut apporté dans la Grèce?
par les colonies d’Egypte & de Phénicie. D ’un
autre cô té , d it- il,.le s Grecs avaient drefîe des
autels à des hommes célèbres, connus fous lés
noms de Jupiter| à'Apollon , de Mars, &c. De-là
les deux fyftêmes oppofés, celui des allégorijles &
celui des evemériftes (2) , qu’il veut concilier. Selon
lu i, les anciens ont cru que des hommes finguliers
avoient été regardés comme des dieux qui defcen-
doieiii fur la terre, & leurs aétions forment lai
mythologie grecque. Sous ce point de v u e , elle
renferme des traits hiftoriques, 8c fous le précédent
les dieux allégoriques. Ainfi, ils font en
même temps anciens 8c nouveaux Egyptiens,.
Phéniciens 8c Grecs éternels, immortels , &
en même temps hommes, au moyen de la théo-
phanie y M.d’abbé Fauchet diftingué de Yapo-
t/iéoje. Par celle-ci, un homme devient dieu; par
I autre, un dieu paroît fous une forme humaine».
M. le confeiller Heine, auquel la littérature
allemande a de fi grandes obligations.,, a répandu
dans plufieurs de les. ouvrages un nouveau jour
fur la. mythologie des Grecs» 11 eft. d’avis que
Ion 11e doit pas la regarder comme une fimple
fiétion. Il penlè qu’elle énonce les faits hifioriques
les plus anciens, 8c contient le fyftême de. la
phiiolophie des temps les plus reculés, ainfi que
les origines des peuples & des grandes familles*.
Mais auiîi recommandoit-il dans un écrit qui-parut
il »n’y a pas long-temps., de ne pas confondre toutes
les époques. 6t toutes les efpèees de poètes.;
M. Hermann , l’un des difciples de M* Heine*
ayant adopté fes principes à l’égard de la mythologie
grecque, vient de les expliquer, avec clarté quant
à Homère &. Héfiode, dans un manuel mythologique
qu’il vient de publier à Berlin- (3).. Il y traite-
des quatre origines générales des chofes du chaos ,
du Tartare , d’Eros &. de Géa avec fa poftérité*.
II a lu tirer avec beaucoup d’efprit 8c de faga-
cité des deux poètes que j’ai nommés, de nouvelles
confidérations, 6c a préfenté de nouvelles,
vues fur l’hiftoire. 8c la géographie.
M. de Bougainville fait, à l’égard des règnes.des
dieux du paganifine, une réflexion bien fenfée*
La durée du, règne des dieux varie félon les différens
pays ; mais de maniéré que , dans- tous, elle-
eft toujours égale à celle, des temps inconnus, 8c
ne finit qu’aux fiècles où le commerce avec des.
nations policées commence à diffiper la barbarie.
Ainfi ce règne qui, pour les Grecs du Pélopon- 2 3
(2) On donne ce nom aux partifans du fyftême d’Evhé-
mère. Cet auteur pâlie pour avoir, le premier, adopté
l'opinion qui donne toutes les divinités comme defimplés
hommes déifies par. la reconnoilïance, l'admiration ou.la
terreur.
(3) Cet'ouvrage mériter.oit d’être traduit en françois..
le c rois qu’on pourroit fe le procurer a Strasbourg. IL
porte le titre fuivant : tiandbuch der mythologie dus nomer.
and.hefiod als grundlage yt cineo ricluigren fabellehis (jes altii-,
thums.y &cy. j. volj in-8, Berlin,, chezbficfilafi
jiè fe , finît à l’arrivé d’Inachus, continué pour les
':}<• 'habitans de l’Attique jufqu’à Cécrops ; &pour ceux
w :'de la Bêotie & de la Theflalie jufqu’au temps de
I f Cadmus, & jufqu’à celui de l’invafion des Hellènes
||f fortis des environs du Parnafte ; preuve convain-
cjuante que les dieux, ou plutôt les hommes donnés
?! pour tels , n’ont jamais' exifté, 8c qu’pn les doit
|| à la foiblefte des lumières des premiers peuples,
qui fut bien fécondée enfuite par l’imagination des
poètes.
' En réfumant donc tout cet article, qui paroîtra
.. . peut-être un peu long, mais que l’importance du
iujet & du peuple auquel il appartient, doit faire
pardonner ; en réfumant donc , on voit, i° . que
les divinités de la Grèce, daiis l’origine, furent
les aftres, les vents, les élémens ou les intelligences.
20. Que les Grecs ayant eu communication avec
les Egyptiens 8c les Phéniciens, ayant adopté leurs
divinités, les honorèrent conjointement avec les
leurs.
.oinerensperionnages, firent prendre infenfiblement
. pour des hommes , les êtres allégoriques que ces
noms défignoient.
. Ce dernier des écrivains qui. ait traité convenablement
ces objets, eft M. Rabaut de Saint-Etienne
^Lettres a M. Bailly, J\ir l’hijloire primitive de la
Grèce ). Cet auteur philofophe & littérateur penfe
que dans les premiers âges, l’écriture ne fut que
Ja peinture groflière des objets. Cette écriture
I jeflà d être en ufage lorfqu’elle fiit furchargée de
c;'i|“ §?es'» °h Ces fignes commencèrent à être arbitraires,
où les mêmes fignes furent employés à
xepréfenter fept ou huit idées différentes,.où enfin.
> fentit qu’une telle écriture manquoit de pré-
cifion & d exactitude. Ce fut alors que l’on imagina
de peindre les idées. Ce fut la fin de l’âee
Allégorique. °
r Alors les hommes fe livrent à la facilité & au
plaifir de donner du corps à leurs idées; ils représentent
les objets phyfiques par la peinture de ces
memes objets ;. 8c les chofes abftraites par des pein-
tures figmficatives. Ce fut la coutume de perfon-
mfier amfi tous les êtres delà nature, qui fit imaginer
les dryades , les hamadryades, les oréades
. ce ce peuple de jeunes nymphes, cachées, difoit-
§§£ » fous l’écorce des arbres, tandis qu’elles étoient
elles-memes comme une écorce légère, fous laquelle
l'allégorie étoit ingênieufemenf enveloppée,
i;., Les nymphes des arbres & des montagnes ne
jouent pas yn rôle,aCtif 8c brillant dans les ori-
gmes grecques,, parce que les êtres qu’elles figu-
roient avoient moins de rapport avec les hommes.
Mais les Naïades , les charmantes nymphes des
aux^remphffoienttoutle commencement de cette
M y i eft a ‘ C » ! pour 1« fleuves,.
fê m U liaifons ?vec les. monts
E S i p l que. nous' devons- la plus.
. g arnie-parrre des prmeqs. & des. héros, dé; là1, mythologie.
C ’eft que les Grecs primitifs étoient accoutumés
à les appeler les mères des bourgade»
qu’ils avoient connruites fur leurs bords, & qui
fouvent portoient le même nom. Bienfaitrices du
pays, elles furent fouvent appelées les nourrices des.
dieux , comme elles étoient les nourricières des
hommes. Nous voyons huit fontaines en Arcadie,
qui, fous le nom de nymphes, paflbient pour les
nourrices de Jupiter. Les fleuves, chers à ces premières
peuplades à caufe de leurs bienfaits, furent
regardes dans la fuite comme dés rois puifTans; &
leurs noms, fous ce titre , furent confacrés dans
les fâftes de la Grece. Les villes, les états furent
auffi perfonnifies ; & ces perfonnages imaginaires
vinrent fe placer dans l’hiftoire à côté d’ApoUoraî
de Diane, d’Hyacinthe & d’autres perfonnages
auffi peu réels. Lorfqué lesfens des allégories fut
perdu, on fe méprit aux chanfons, aux poèmes,
aux peintures groffières que l’on en avoit fait , &
1 on prit pour des êtres réels plufieurs de ces êtres
purement .repréfentarifs. De tout temps on en
avoit parle comme des pères, des mères,, des rois
des premiers habitans du pays. Leurs noms, franf-
mis d âge en âge jufqu’à celui où l’origine en étoit
perdue, étoient devenus l’objet dç‘ la vénération
publique. On crut à leur exiftence , 8t lorfqué les
premiers écrivains rédigèrenr les hiftoiVés de touà
ces pays pour n’en faire qu’une, ils y ertrafterent
ces.perfonnages allégoriques, qui,, pour la plupart
de nos écrivains modernes, paffent encore pour
des êtres réels.
On ne doit pas être furpris , dit fauteur cité
plus haut , de cette erreur où tombèrent le*
hommes lôrfqu’ils commencèrent à écrire des annales.
Ils. habitoient des pays gouvernés par de
petits princes,♦ & ils crurent qu’il y avoir eu de
tout temps des princes ; ils voyoient fonder des
colonies., & ils crurent que leurs propres villes-
avoient ainfi. commencé. N’ayant fur l'a mémoire
des temps pafles qu’une tradition oracle, & par
confequent incertaine , figurée & par conféquent
inintelligible pour eux , ils adoptèrent ce qur leur
avoit été tranfmis comme fi c’eût été de Thi£
toire.
Rien ne prouve mieux que, dans le langage allé--
gorique, les montagnes avoient été appelées lesrois;
du pays ; que fouvent auffi elles furent peinte*
comme des géans,6c, c’eft qu’en effet dans quelque
lieu qu’il y ait eu un déluge, les montagnes onr
dû y être les fauveurs des habitans ; elles-ont dû
être les premiers lieux habités dans lès- pays couverts
d’eau, que l’opinion que l’on a eue généra»*
lement de facrifier fur lès hauts, d’y bâtir de»
temples. Selon les Grecs , c’étoient les pierres-
échappées des mains de Dèucalion 8c de Pytrha r
qui avoient été les réparateurs de notre efpècev
Ceux qui enfuite défeendoient des montagnes- et»
étoient, dans un fens allégorique, les°enfansv
C ’eft ainfi que chez les Hébreux, Jérufalem étxm
la fille de Sion».