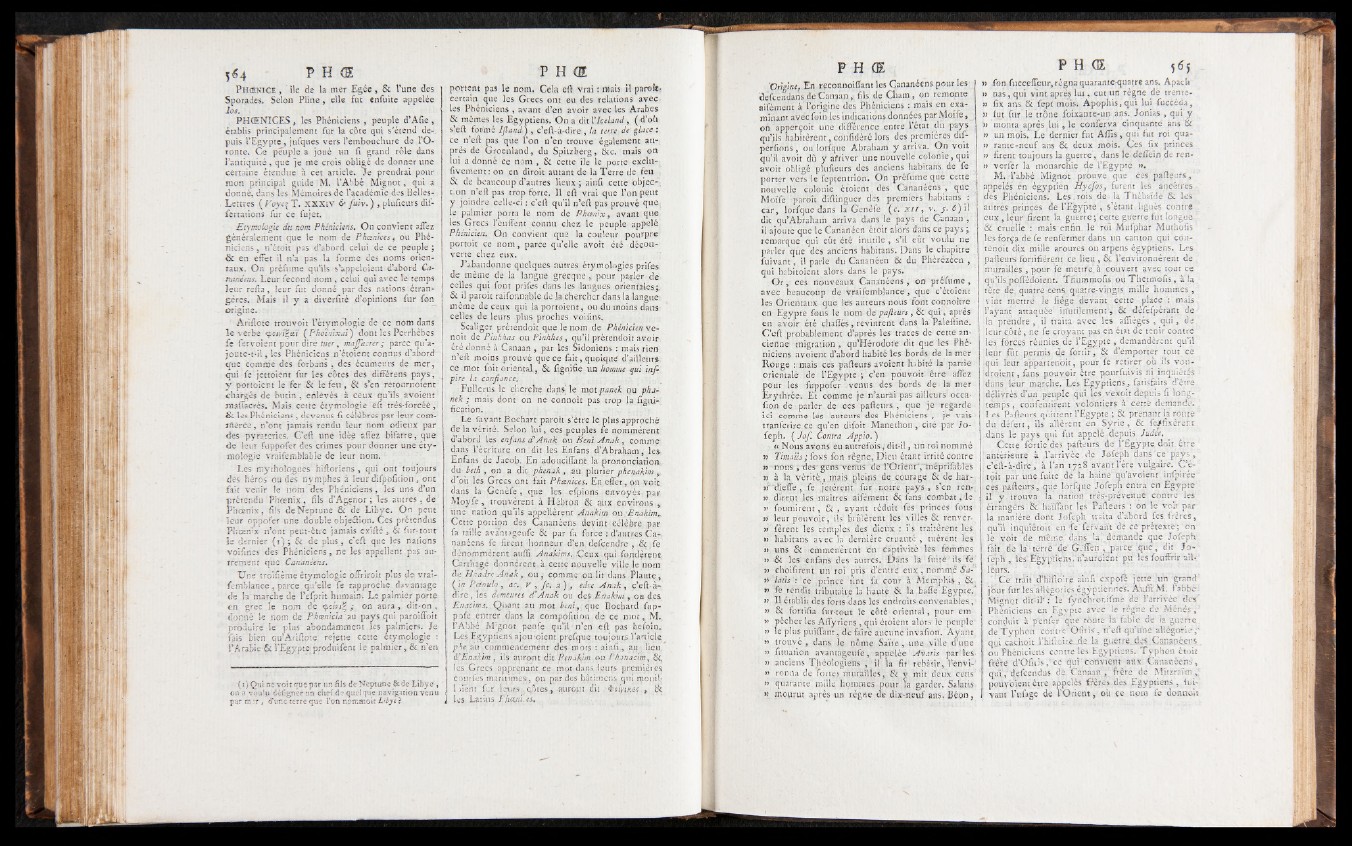
Phoenice , île de la mer Egée , & l*use des
Spor.ad.es. Selon Pline, elle fut enfuite appelée
los.P
HOENICES, les Phéniciens, peuple d’Afie ,
établis principalement fur la côte qui s'étend de-,
puis l’Egypte , jufques vers l’embouchure de l’Q-
ronte. Ce peuple a joué un fi grand rôle dans
l’antiquité, que je me crois obligé de donner une
certaine étendue à cet article. Je prendrai pour
mon principal guide M. l’Abbé Mignot, qui a
donné, dans les Mémoires de l’académie des Belles-
Lettres ( Voye{ T. x x x i v & fuiv. ) , plufieurs dif-
fertations fur ce fujet.
Etymologie du nom Phéniciens. On convient allez
généralement que le nom de Phcsnices, ou Phéniciens
, n’étoit pas d’abord celui de ce peuple ;
& en effet il n’a pas la forme des noms orientaux.
On prèfume qu’ils s’appeloient d’abord Cananéens.
Leur fécond nom , celui qui avec le temps
leur relia, leur fut donné par des nations étrangères.
Mais il y a diverliré d’opinions fur fon
origine. ;
Ariftote trou voit l’étymologie de ce nom dans
le verbe <poivi£etï ( Phoïnixaï) dont les Perrhèbes
fe fervoient pour dire tuer, majfiacrer; parce qu'a-
joute-t-il, les Phéniciens n’étoient connus d’abord
que comme des forbans , des écumeurs de mer,
qui fe jettoient fur les côtes des différens pays,
y portoier.t le fer .& le feu , 8c s’en retournoient
chargés de butin, enlevés à ceux qu’ils avoient
jnaffacrés. Mais cette étymologie eft très-forcéè,
& les Phéniciens, devenus fi célèbres par leur commerce
, n’ont jamais rendu leur nom odieux par
des pyratcries. C ’eft une idée a fiez bifarre, que
de leur fuppofer des crimes pour donner une étymologie
vraifemblable de leur nom.
Les mythologues hiftoriens , qui ont toujours
des héros ou des nymphes à leur difpôfjtion, ont
fait venir le nom des Phéniciens, les uns d’un
prétendu Phoenix, fils d’Agenor ; les autres . de
Phoenix, fils de Neptune 8c de Libye. On peut
leur oppofer une double obje&ion. Ces prétendus
Phoenix n’ont peut-être jamais exifté, 8c fur-tour
le dernier ( i ) ; & de plus, c’efl que les nations
voifines des Phéniciens, ne les appellent pas autrement
que Cananéens.
Une troifième étymologie offriroit plus de vraisemblance.,
parce qu’elle fe rapproche davantage
de la marche de l’efprit humain. Le palmier porte
en grec le nom de ; on aura , dit-on ,
donné le nom de P h oenicia au pays qui paroiffoit
produire le plus abondamment les palmiers. Je
fais bien qu’Ariftote, rejette cette étymologie :
l’Arabie & llEgypte;produifent le palmier, & n’en
(t) Qui ne voit que par un fils de Neptune & de Libye ,
en a voulu défigner un chef de quelque navigation venu
par m ; r , d’ur.ç terre que l’on nommoit Libye ?
portent pas le nom. Cela eft vrai : mais M parofc.
certain que les Grecs ont eu des relations avec
les Phéniciens , avant d’en avoir avec les Arabes
& mêmes les Egyptiens. On a dltVlccland, ( d’oîi
sleft formé Ifiand) , c’efl-à-dire , la terre de glace :
ce n’eft pas que l’on n’en trouve également auprès
de Groenland, du Spitzberg, &c. mais on
lui a donné ce nom , & cette île le porte exclu-;
fivement: on en diroit autant de la Terre de feu
Sc de beaucoup d’autres lieux ; ainfi cette objec-,
t.on n’eft pas trop forte. Il eft vrai que l’on peut
y joindre celle-ci : c’eft qu’il n’eft pas prouvé que;
le palmier porta le nom de Phcmix, avant que
les Grecs T e liftent connu chez le peuple appelé
Phénicien. On convient que la couleur pourpre
portoit ce nom, parce qu’elle avoir été découverte
chez eux.
J’abandonne quelques autres étymologies prifes
i de même de la langue grecque ,, pour parler de
j celles qui font prifes dans les langues orientales *
& il paroît raifonnable de la chercher dans la langue:
même de ceux qui la portoient, ou du moins dans
celles de leurs plus proches voifins.
Scali ger prétendoit que le nom de Phénicien ve~
noit de P in!; ha s on Pinhhes, qu’il prétendoit avoir
été donné à Canaan , par les Sidoniens : mais rien
n’eft moins prouvé que ce fait, quoique" d’ailleurs-,
ce mot foit oriental, 8c ftgnifie un homme qui inf-
pïre la confiance.
Fullerus le cherche dans le mot panek pu phj-
nek ; mais dont on ne connoît pas trop la figni-
fication.
Le favant Bochart paroît s’être le plus approché
de la vérité. Selon lui, ces peuples fe nommèrent
d’abord les enfans a”Anak ou Béni Anak , commp
dans l’écriture on dit les Enfans d’Abraham, les,
Enfans de Jacob. En adouciflant la prononciation
du beth , on a d\t phenak t au plurier phenakim ,,
d’où les Grecs ont fait Phanices. En effet,on voit
dans la Genèfe , que les efpions envoyés, par
Moyfe, trouvèrent à Hébron & aux environs ,
une nation qu’ils appelièrent Anakim ou Enakim*
Cette portion des Cananéens devint célèbre par
fa taille avantageufe & par fa force : d’autres Cananéens
fe firent honneur d’en, defeendre , & ,fe
dénommèrent aufti Anakims. Ceux qui fondèrent
Carthage donnèrent à, cette nouvelle ville je nom
de Hhadrc Anak,. ou , comme on.lit dans Plaute,
( in Pdnulo , ac. v , fc. o ) 3 edr.e Anak , c’efl:-à-
dire , les demeures d’Anak ou des Enakim , ou des
Enacims, Quant au mot béni, que Bocbard fup-
pofe entrer dans la compofition de ce mot, M.
l’Abbé M'gnot penfe qu’il n’en eft pas befoin.
Les Egyptiens ajouroient prefque toujours l’article
phe fin commencement des mots : ain-fi., au lieu,
d'Enakim, iis auront dit P enakim ou P/unacim, 8c,
les Grecs apprenant ce mot dans leurs premières
courfes maritimes;, pu par des bgtimens qui monil-
1 )isht fier’ leurs-,. c,ôtes, auront dit • Qofiiçeç , 8c
] les Latins Phcejû.es,
Origine. En rçconnoîffant les Cananéens pour les
defeendans de Canaan,: fils de Cham, on remonte
alfément à l’origine des Phéniciens : mais en examinant
avec foin les indications données par Moïfe,
on apperçoit une différence entre l’état du pays
qu’ils habitèrent, co'nfidéré lors des premières dif-
perfions , ou. lorsque Abraham y arriva. On voit
qu’il avoit dû y afriver une nouvelle colonie, qui
avoit obligé plufieurs des anciens habitans. de fe
porter vers le feptentrion. On prefume que cette
nouvelle colonie étoient des Cananéens , que
Moïfe paroît, diftinguer des premiers habitans :
car, lorfque dans la Genèfe ( c . x i i , v. y . 6 ) il
dit qu’Abraham arriva dans le pays de Canaan ,
il ajoute que le Cananéen étoif alors dans ce pays ;
remarque qui eût été inutile, s’ il eût voulu ne
parler que des anciens habitans. Dans le chapitre
fuivant, il parle du Cananéen & du Phérézéen ,
qui habitoient alors dans le pays.
O r , ceS nouveaux Cananéens, on préfume,
avec beaucoup de vraifemblance , que c’étoient
les Orientaux que les auteurs nous fontconnoîrre
en Egypte fous le nom de pafteürs, 6c qui, après
en avoir été çhaffés, revinrent dans la Paleftine.
C ’eft probablement d’après les traces de cette ancienne
migration, qn’Hérodote dit que les Phéniciens
avoient d’abord habité les bords de la mer
Rouge : mais ces pafteürs avoient habité la partie
orientale de l’Egypte ; c’en pouvoit être a fiez
ppur les fuppofer venus des bords de la mer
Erythrée'. Et comme je n’aurai pas ailleurs occa-
fio,n de parler de ces pafteürs , que je regarde
ici comme les 'auteurs des Phéniciens, je vais
tranferire ce qu’en difoit Manethon, cité par Jo-
feph. ( Jof. Contra Appio. )
: u Nous avons eu autrefois, dit-il, un roi nommé
v Tims'ùs; fous fon règne, Dieu étant irrité contre
» n ous , des'gens'ven us de l’O rien t', m épr ifablês
» à la vérité., mais pleins, de.courage & de har-
djeffe , fe .jetèrent fur notre pays , s’en ren-,
» dirent-les maîtres aiiement 6c fans combat ,1e
n fournirent, 6c, ayant réduit fés princes fous
s? leur pouvoir, ils brûlèrent les villes 8c renver-
» fièrent les temples des dieux : ils traitèrent les
»> habitans avec la dernière cruauté , tuèrent les
v uns 8c emmenèrent én captivité les femmes
» & les' enfans des autres. Dans la/fui té ils Te'
w choifirent un roi pris d’entre eux , nomme Sa-'
lotis : ce prince tint fa çour à Meni.phis , &
v fè rendit tributaire la haute & la baffe Egypte.'
n II établit des forts dans les endroits convenables ,
« 8c fortifia fur-tout le côté oriental, pour em
» pêcher les Affyriens , qui étoient alors le peuple
» le plus puiffam, de faire aucune invafiôn. Ayant.
» trouve , dans le nôme Saïte, une ville d’une
» fini ation avantageufe, appelée Avons par les
» anciens Théologiens , il la fit rebâtir, Penvi-'
» ronna de fortes murailles, 8c y mit deux cens
» quarante mille hommes pour la garder. Salatis
« mourut après un règne de dix-neuf ans. Bépn,
» fon. fucceffeur, régna quarante-quatre ans. A pack
» nas, qui vint,après lu i, eut un règne dé trente-
» fix ans, 8c fept mois; Apophis, qui lui fuccéda,
» fut fur le trône foixante-un ans. Jonias , qui y
>> monta-après lu i, le conferva cinquante ans 8c
n un mois. Le dernier fut Affis, qui fut roi qua-
w rante-neuf ans 8c deux mois. Ces fix princes
» firent toujours la guerre , dans le. deffein de ren-
» verfer la monarchie de l’Egypte ».
M. l’abbé Mignot prouve que ces pafteürs,
appelés én égyptien Hycfos? furent les ancêtres
dès Phéniciens. Les.rois de la Thébaïde 8c les
autres princes de l’Egypte , s’étant ligués contre
eux , lèur firent la guerre;'cette guerre fut longue
8L cruelle : mais enfin le roi Mufphar Muthofis
les força de fe renfermer dans un canton qui con-
tenoit dix mille aroures ou arpens égyptiens. Les
pafteürs fortifièrent ce lieu , 8ç l’environnèrent de
mijrai-lles , pour fe mettre', à couvert aveç tout ce
qu’ils poffédoient. THummofis 011 Thetmofis, à la
tête de quatre cens, quatre-vingts mille hommes,
vint mettre le fiége devant cette place : mais
l’ayant attaquée’ inutilement, 8c défefpérant de
la prendre , il traita avec les afîiégés , q ui, de
leur côté, ne fe croyant pas en état de tenir contre
lés forces réunies de l’Egypte, demandèrent qu’il
leur fût permis de for tir, 8c d’emporter tout ce
.qui leur ap'partënoit, pour fe retirer pu ils vou-
idroient, fans pouvoir être pourfuivis ni inquiétés
dans leur marche. Les Egyptiens, fatisfaits d’être
délivrés d’un peuple qui jes^vexoit depuis fi longtemps
, confentirent volontiers à cette demande.
Les Pafteürs quittent l’Egypte ; 8c prenant la ronte
du défert, ils allèrent en Syrie , 8c fe/fixèrent
dans lé pays qui fut appelé depuis Judee.
Cette fortiedes pafteürs de l ’Egypte doit, être
'antérieure à l’arrivée, de Jofeph dans ’ ce pays ,
c’eft-'à-diré, à l’an 1728 avantri’ère vulgaire. C é -
' toit par une fuite .de la haine qu’à voient inipirée
ces fleurs, que lorfque jofeph entra en Egypte
if y trouva la nation très-prévenuê contre les
: étfangërs 6c haïffant les Pafteürs : on le voit par
la manière dont Jofeph traita d’abord fes frères,
qu’il inquïétoit en Te' féfv-ant de ce prétexte ; on
rie voit de même ' da'ns la . demande que Jofeph
fait dé la ■ terre/de' Geffen ,. parce que , dit Jo- '
feph , lès'Ë^ÿp/tiensf iTauroiénf pu les fouffrir ail-
i léurs. ' // ' " /. " -, /
[ Ce trait d’iiîfto'rê aîr.fi expOlé jette^ un grand
I jbur fur les allégories égyptiennes. Auftî M. labbé-
Migno.t dit-iP : le fynchronifnte de l’arrivée des
Phéniciens en Egypte avec le règne de'Mènes-,
conduit à ' peu fer que toute la fable de la guerre
; de Typhon contre Ofiris, n’eft qu’une aHégorie,'
; qui.ca.choit .rhiftûir.e...de la guerre,des.Cananéens.
i ou Phéniciens contre les Egyptiens. Typhon êtoit
1 frère d’Ofiiis ,' ce qui convient aux Cananéens ,
' qui, defeendus de. Canaan. ,, frère de Mitzrsïm ,.
‘ pouvoieut être, appelés frètes dés Egyptiens , iui-
; yant l’ufage de l’Orient, où ce nom fe donnoit