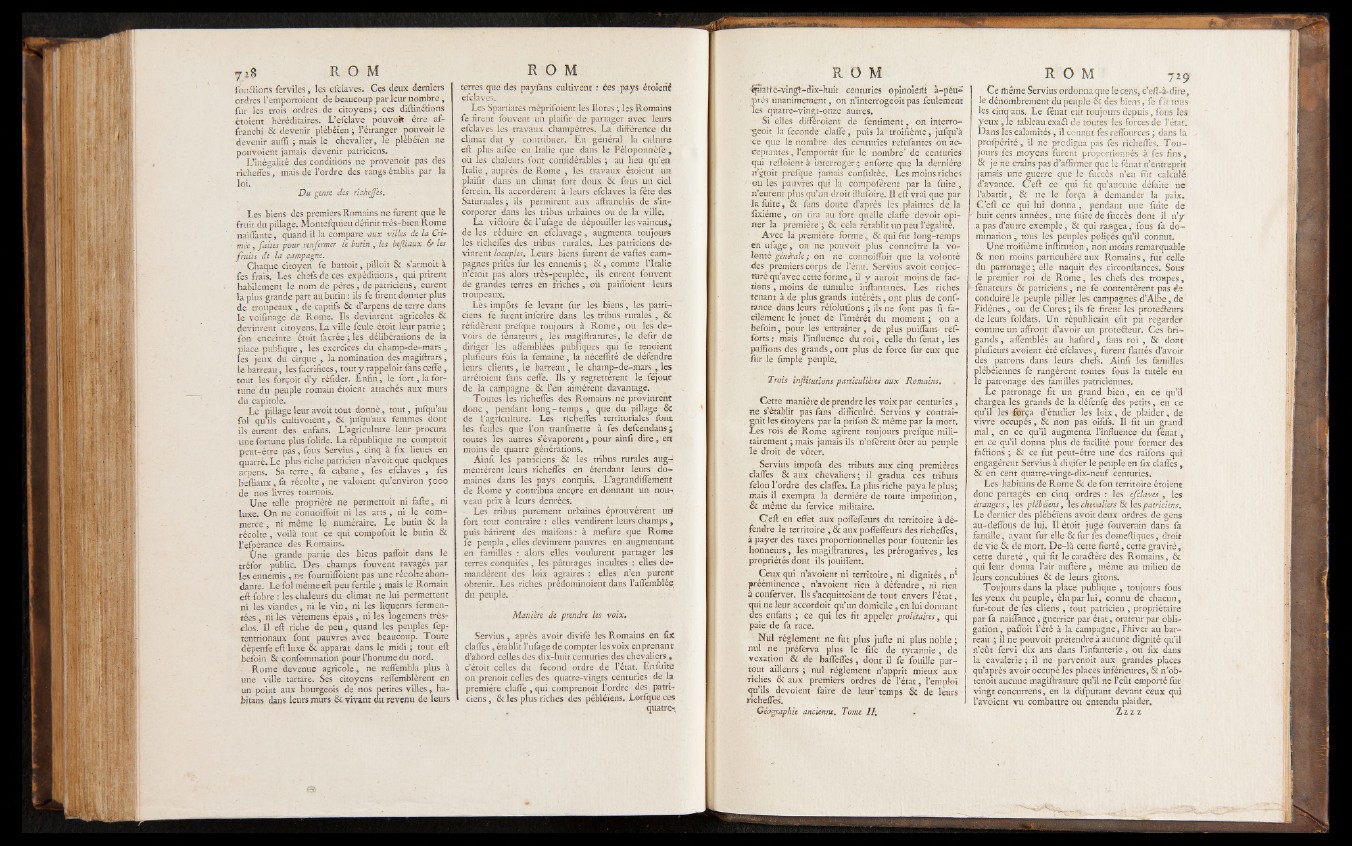
y i 8 R O M
fondions ferviles, les efclaves. Cçs deux derniers
ordres Pemportoient de beaucoup par leur nombre,
fur les trois ordres,de citoyens; ces diftinâions
étoient héréditaires. L’efçlave pouvoir être affranchi
& devenir plébéien ; l’étranger pouvoit le
devenir aufli ; mais le chevalier, le plebéïen ne
pouvoient jamais devenir patriciens.
L’inégalité des conditions ne provenoit pas des
richeffes, mais-de l’ordre des rangs établis par la
loi. > -
Du genre des richeffes.
Les biens des premiers Romains ne furent que te
fruit du pillage. Montefquieu définit tr,ès-bien Rome
naiffante, quand il la compare -aux villes de la Crimée
, faites pour renfermer le butin, les befliaux & les _
fruits de la campagne.
Chaque citoyen fe battoit, pilloit & s’armoit a
fes frais. Les chefs de ces expéditions , qui prirent
habilement 1e nom de pères , de patriciens, eurent
la plus grande part au butin : ils fe firent donner plus
de troupeaux , de captifs & d’arpens de terre dans
le voifinage de Rome. Ils devinrent agricoles &
devinrent citoyens. La ville feule étoit leur patrie ;
fon enceinte étoit facrée ; les délibérations de la
place publique, les exercices du champ-de-mars ,
les jeux du cirque , la nomination des magiftrats,
le barreau, les facrifices, tout y rappeloit fans ceffe,
tout les forçoit d’y réfider. Enfin, le for t, la fortune’
du peuple romain étoient attachés aux murs
du capitole. -
Le pillage leur avoit tout donné, tout, jufqu’au
fol qu’ils cultivoient, & jufqu’aux femmes dont
ils eurent des enfans. L’agriculture' leur procura
une fortune plus folide. La république ne coiiiptoit
peut-être pas, fous Servius, cinq à fix lieues en
quarré. Le plus riche patricien n’avoitque quelques
arpens. Sa terre, fa cabane, fes efclaves , fes
beftiaux, fa récolte , ne valoient qu’environ 5000
de nos livres tournois. .
Une telle propriété ne permettoit ni fàfte, ni
luxe. On ne connoiffoit ni lés arts, ni le commerce
, ni même l e . numéraire. Le butin & la
récolte, voilà tout ce qui compofoit le butin &
î’efpérance des Romains.
Une grande partie des biens pafloit dans le
tréfor public. Des champs fouvent ravagés par
les ennemis , ne fournifloient pas une récolte abondante.
Le fol même eft peu fertile ; mais le Romain
eft fobre : les chaleurs du climat ne lui permettent
ni les viandes, ni le v in, ni les liquenrs fermentées
, ni les vêtemehs épais , ni les logemens très-
clos. Il eft riche de peu, quand les peuples fep-
tentrionaux font pauvres avec beaucoup. Toute
dépenfe eft luxe & apparat dans le midi ; tout eft
befoin & confommation pour l’homme du nord.
Rome devenue agricole, ne reffembla plus à
une ville tartâre. Ses citoyens reffemblèrent en
un point aux bourgeois de nos petites villes, ha-
bjtans dans leurs murs & vivant du revenu de leurs
R O M
terres que des payfans cultivent : ces pays étoïené
efclaves.
Les Spartiates méprifoient les Ilotes ; les Romains
fe firent fouvent un plaiïir de partager avec leurs
efclaves les travaux champêtres. La différerfee du
climat dut y contribuer. En général la culture
eft plus aifee en Italie que dans le Péloponnèfe ,
où les chaleurs font coniidérables ; au lieu qu’en
Italie, auprès de Rome , les travaux étoient un
plaifir dans un climat fort doux & fous un ciel
lerrein. Us accordèrent à leurs efclaves la fête des
Saturnales ; ils permirent aux affranchis de s’incorporer
dans les tribus urbaines ou de .là ville.
La vi&oire & l’ufage de dépouiller les vaincus,’
de les réduire en efclavage, augmenta toujours
les richeffes des tribus rurales. Les patriciens devinrent
locuples. Leurs biens furent de vaftes campagnes
prifes fur les ennemis ; & , comme l’Italie
n’étoit pas alors très-peuplée, ils eurent fouvent
de grandes terres en friches, où paiffoient leurs
troupeaux.
Les impôts fe levant fur les biens, les patriciens
fe firent inferire dans les tribus rurales , &
réfidèrent prefque toujours à Rome, où les devoirs
de fénateurs ^ les magiftratures, le defir de
diriger 'les affemblées publiques qui fe tenoient
plufieurs fois la femaine , la nécefîité de défendre
leurs clients, le barreau, le champ-de-mars , les
arrêtoient fans ceffe. Ils y regrettèrent le féjour
de la campagne & l’en aimèrent davantage. ■ ^
" Toutes les richeffes des Romains ne provinrent
donc, pendant long - temps , que du pillage &
de l’agriculture. Les richeffes territoriales font
les feules que l’on tranfmette à fes defeendans ;
toutes les autres s’évaporent, pour ainfi dire, en
moins de quatre générations.
Ainfi les patriciens & les tribus rurales augmentèrent
leurs richeffes en étendant leurs domaines
dans les pays conquis. L’agrandiffement
de Rome y contribua encore en donnant un nouveau
prix à leurs denrées.
Les tribus purement urbaines éprouvèrent unf
fort tout contraire : elles vendirent leurs champs ,
puis bâtirent des maifons : à mefure que Rome
fe peupla, elles devinrent pauvres en augmentant
en familles : alors elles voulurent partager les
terres conquifes, les pâtuiages incultes : elles demandèrent
des loix agraires : elles n’en purent
obtenir., Les riches prédominoient dans l’affemblée
du peuple.
Manière de prendre les voix.
Servius, après avoir divifé les Romains en fix
claffes, établit l’ufage dé compter les voix en prenant
d’abord celles des dix-huit centuries des chevaliers ,
c’étoit celles du fécond ordre de l’état. En fuite
on prenoit celles des quatre-vingts centuries de la
première claffe , qui comprenoit l’ordre des patri-
i ciens, & les plus riches des pébléïens. Lorfque ces
quatre-
^attè-vlngt-dix-huit centuries opinoîertt à-pèu-
■ ;prè$ unanimement, on n’interfogeoit pas feulement
les quatre-vingt-onze autres.
Si elles différaient de fentiment, on interro-
geoit la fécondé claffe, puis la troifièmev jufqu’à
•ce que le nombre des centuries refufantes ou acceptantes
, l’emportât fur le nombre*' de centuries
qui reftoîent à interroger-; enforte que la dernière
n’étoit prefque jamais confiiltée. Les moins riches
ou les pauvres qui la compôfèrent par la fuite,
n’eurent plus qu’un droit illuioire. Il eft vrai que par
la fuite, & fans doute d’après les plaintes de, la
fixième, on tira au fort quelle claffe devoit opiner
la première & cela rétablit un peu l’égalité.
Avec la première forme, & qui fut long-temps
en ufage, on ne pouvoit plus connoître la "volonté
généfrale ; on ne connoiffoit que la volonté
des premiers corps de l’état. Serf ius avoit conjecturé
qu’avec cette forme, il y aurait moins de factions
, moins de tumulte inftantanés. Les riches
tenant à de plus grands intérêts, ont plus de confiance
dans leurs réfolutions ; ils ne font pas fi- facilement
le jouet de l’intérêt du moment ; on a
befoin, pour les 'entraîner , de plus puiffans ref-
forts: mais l’influence du rai , celle du fénat, les.
paffions des grands, ont plus de force fur eux que
fur le fimple peuple.
Trois injlitutions particulières aux Romains. .
Cette manière de prendre les voix par centuries ,
ne s’établit pas fans difficulté. Servius y contrai-,
gnit les citoyens par la prifon & même par la mort.
Les rois de. Rome agirent toujours prefque militairement
; mais jamais ils n’oférent ôter au peuple
le droit de voter.
Serviits impofa des tributs aux cinq premières
claffes & aux chevaliers ; il gradua ces tributs
félon l’ordre des claffes. La plus riche paya le plus;
mais il exempta la dernière de toute impofition, i
& même du fervice militaire.
Ceft en effet aux poffeffeurs du territoire à défendre
le territoire , & aux poffeffeurs des richeffes,
à payer des taxes proportionnelles pour foutenir les
honneurs, les magiftratures, les prérogatives, les
propriétés dont ils jouiffent.
Ceux qui n’avoient ni territoire, ni dignités, n1
prééminence, n’avoient rien à défendre, ni rien j
à conferver. Ils s’acquittoient de tout envers l’état,
qui ne leur accordoit qu’un domicile, en lui donnant
des enfans ; ce qui les fit appeler prolétaires, qui
paie de fa race.
Nul réglement ne fut plus jufte ni plus noble ;
nul ne préferva plus le fife de tyrannie , de
vexation & de baffeffes, dont il fe fouille partout
ailleurs ; nul réglement n’apprit mieux aux
riches & aux premiers ordres de l’état, l’emploi
qu’ils dévoient faire de leur'temps & de leurs
richeffes.
Géographie ancienne. Tome I I •
Ce même Servius ordonna que le cens, c’eft-à-dire,
le dénombrement du peuple & des biens, fe fît tous
les cinq ans. Le fénat eut toujours depuis, fous les
y eu x , le tableau exaét de toutes les forces de l’état.
Dans les calamités, il connut fes reffources ; dans la
profpérité, -il ne prodigua pas fes richeffes. Tou -
jours fes moyens furent proportionnés à fes fins,
& je ne crains pas d’affirmer que le fénat n’entreprit
jamais une guerre' que le fuccès n’en fût calculé
d’avance. C ’eft ce qui fit qu’aucune défaite ne
l’abattit, & ne le força à demander la paix.
C.’eft ce qui lui donna, pendant une fuite dé
| huit cents années, une fuite de fuccès dont il n’y
.a pas d’autre exemple, & qui rangea, fous fa domination
, tous les peuples policés qu’il connut.
Une troifième inftitution -, non moins remarquable
& non moins particulière aux Romains, fut celle
du patronage ; elle naquit des circonftances. Sous
le premier roi de Rome, les chefs des troupes,
i'-fénateurs & patriciens , ne fe contentèrent pas «Le
conduire le peuple piller les campagnes d’A lbe, dé
Fidènes, ou de Cures ; ils fe firent les protecteurs
de leurs folaats. Un républicain eût pu regarder
comme un affront d’avoir un protecteur. Ces brigands
, afîemblés au hafard, fans roi , & dont
plufieurs avoient été efclaves, furent flattés d’avoir
des patrons dans leurs chefs. Ainfi les familles
plébéiennes fe rangèrent toutes fous la tutèle 611
le patronage des familles patriciennes.
Le patronage fit un grand bien, en ce qu’il
chargea les grands de la aéfenfe des petits, en ce
qu’il les força d’étudier les loix, de plaider, de
vivre occupés, & non pas oififs. Il fit un grand
mal, en ce qu’il augmenta l’infiuence du fénat,
en ce qu’il donna plus dé facilité pour former des
faCtions ; & ce fut peut-être une des raifons qui
engagèrent Servius à divifer le peuple en fix claffes,
& en cent quatre-vingt-dix-neuf centuries.
Les habitans de Rome 8c de fon territoire étoient
donc partagés en cinq ordres : les efclaves , les
étrangers, les plébéiens, les chevaliers 8c les patriciens.
Le dernier des plébéiens avoit deux ordres de gens
au-deffous de lui. Il étoit jugé fouverain dans fa
famille, ayant fur elle & fur fes domeftiques, droit
de vie & de mort. De-là cette fierté, cette gravité,
cette dureté , qui fit le caraftère des Romains, &
qui leur donna l’air auftère, même au milieu de
leurs concubines & de leurs gitons.
Toujours dans la place publique , toujours fous
les yeux du peuple, élu par lui, connu dé chacun,
fur-tout de fes cliens ,'tout patricien , propriétaire
par fa naiffance, guerrier par état, orateur par obligation,
paffoit l’été à la campagne, l’hiver au barreau
; il ne pouvoit prétendre à aucune dignité qu’il
n’eût fervi dix ans dans l’infànterie, ou fix dans
la cavalerie ; il ne parvenoit aux grandes places
qu’après avoir occupé les places inférieures, & n’ob-
teiioit aucune magiftrature qu’il ne l’eût emporté fur
vingt concurrens, en la difputant devant ceux qui
l’avoient vu combattre ou entendu plaider.
Z z z z