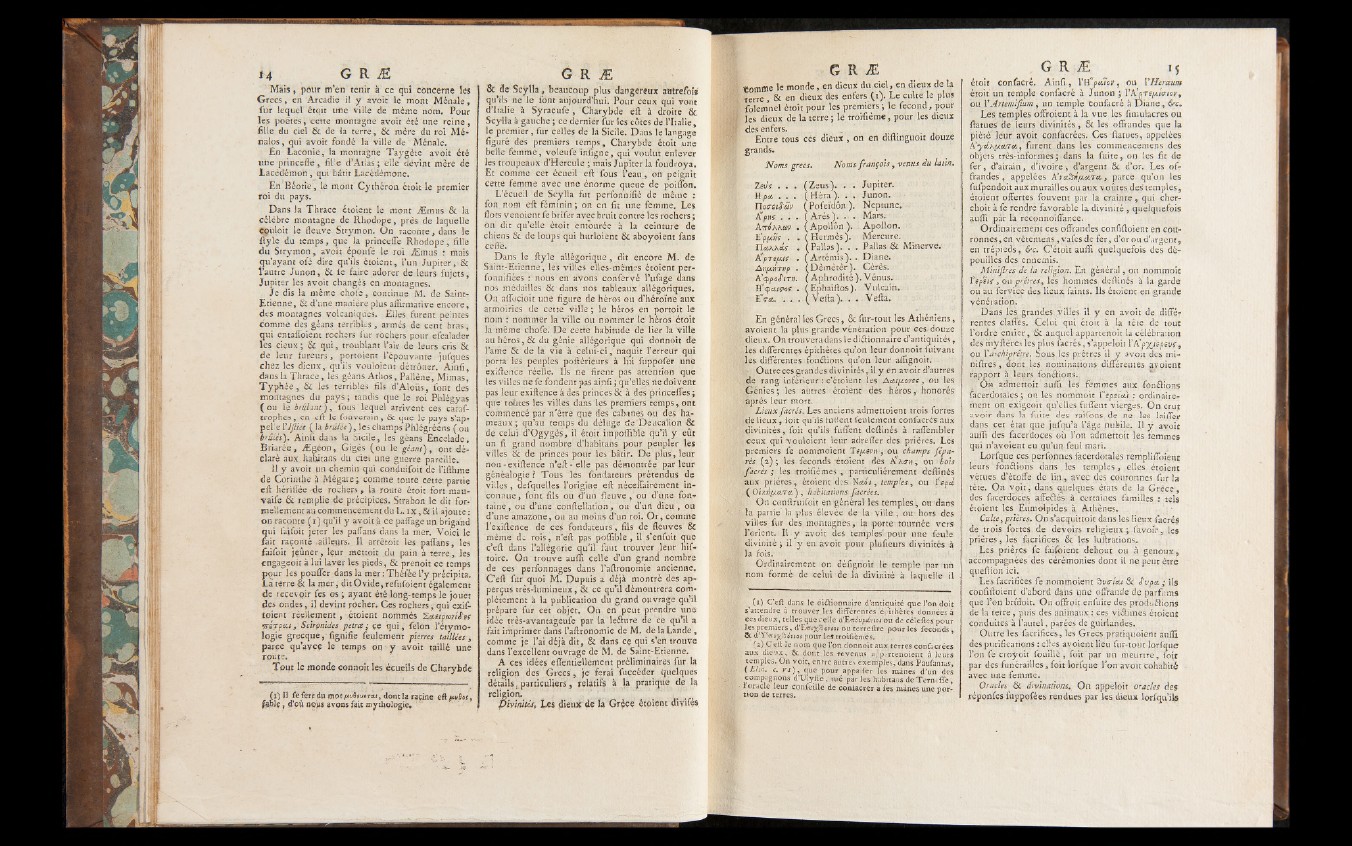
Mais, pour m'en tenir à ce qui concerne les
Gr ecs, en Arcadie il y avoit le mont Ménale,
fur lequel étqit une ville de même nom. Pour
les poètes, cette montagne avoit été une reine,
fille du ciel & de la terre , & mère du roi Mé-
ra lo s , qui avoit fondé la ville de Ménale.
En Laconie, la montagne Taygète avoit été
line princefl'e, fille d’Atlas; elle dévint mère de
Lacédémon, qui bâtit Lacédémone.
En Béotie, le mont Cythéron étoit le premier
roi du pays»
Dans la Thrace étoient le mont Æmus & la
célèbre montagne de Rhodope, près de laquelle
cçüloit le fleuve Strymon. On raconte , dans le
ftyle du temps, que la princeffe Rhodope, fille
du Strymon, avoit époufé le roi Æmus : mais
qu’ayant ofé dire qu’ils étoient, l’un Jupiter, &
l ’autre Junon, 8c le faire adorer de leurs fujets,
Jupiter les avoit changés en montagnes.
Je dis la même choie, continue M. de Saint-
Etienne, 8c d’une manière plus affirmative encore,
des montagnes volcaniques. Elles furent peintes
comme des géans terribles , armés de cent bras,
qui entafloiem rochers fur rochers pour efcalader
les d eu x; & qui, troublant l’air de leurs cris 8c
de leur fureurs, portoient l’épouvante jufques
chez les dieux, qu’ils vouloient détrôner. Ainfi,
dans la Thrace, les géans Athos, Pallène, Mimas,
T y p h é e , 8c les terribles fils d’Aloüs, l'ont des
montagnes du pays ; tandis que le roi Phlégyas
(o u le brûlant), tous lequel arrivent ces cataf-
trophes, en eft le foûverain, 8e que le pays s’appelle
l’lftiée ( la brûlée ) , les champs Phlégréens ( ou
brûlés). Ainfi dans la Sicile, les géans Enceladc,
Briarée , Ægéon, Gigès ( ou le géant) , ont déclaré
aux. hahitans du ciel une guerre pareille;
11 y avoit un chemin qui conduifoif de l’ifthme
de Corinthe à Mégare ; comme toute cétte partie
eft hérill'ée -de rochers, la route étoit fort mau-
vaife 6e remplie de précipices. Strabon le dit formellement
au commencement du L. IX, & il ajoute :
on raconte ( i) qu’il y avoit ;à ce paflage un brigand
qui faifoit jeter les paffans dans la mer. Voici le
fait raçonté ,ailleurs. Il arrêtoit les paffans, les
faifoit jeûner, leur mettoit du pain à terre, les
cngàgeoit à lui laver les pieds, & prenoit ce temps
our les pouffer dans la mer : Théfée l’y précipita.
,a terre & la m er, dit Ovide, refufoient également
de recevoir fes o s ; ayant été long-temps le jouet
des ondes, il devint rocher. Ce§ rochers -, qui exif-
toient réellement, étoient nommés IZetetpwlS'çf
•srérpui, Scirçntdes petrce,• çe qui, félon l’étymo*
logie grecque, fignifie feulement pierres taillées,
parce qu’ayeç le temps on y avoit taillé une
route.
Tout le monde connott les écueils de Charybde
(ï) Il fe fert du mpt/t*w9«w«Tou, dont la raçine eft pvûot ,
fable, d’où «qùs avons fait mythologie.
St de Scy lla, beaucoup plus dangereux autrefois
qifils ne le font aujourd’hui. Pour ceux qui vont
d’Italie à Syracufe , Charybde eft à droite 8c
Scylla à gauche ; ce dernier fur les côies de l’Italie,
le premier, fur celles de là Sicile. Dans le langage
figuré des premiers temps, Charybde était une
belle femme, voleufe infigne, qui voulut enlever
les troupeaux d’Hercule ; mais Jupiter la foudroya.
Et comme cet écueil eft fous l’eau, on peignit
Cette femme avec une énorme queue de poiffon.
L’écueil de Scylla fut perfonnifié de même :
fon nom eft féminin ; on en fit une femme. Les
flots venoient fe brifer avec bruit contre les rochers ;
on dit qu’elle étoit entourée à la ceinture de
chiens 8c de loups qui hurloient 8c aboyoient fans
céffé.
Dans le ftyle allégorique, dit encore M. de
Saiht-Eûenne, les villes elles-mêmes étoient per-
fonnifiées : nous en avons confervé l’ufage dans
nos médailles 8c dans nos tableaux allégoriques.
On alfocioit une figure de héros ou d’héroïne aux
armoiries de cette ville ; le héros en portoit le
nom : nommer la ville ou nommer le héros étoit
la même chofe. De cette habitude de lier la ville
au héros, 6c du génie allégorique qui donnoit de
l’ame 8c de la vie à celui-ci, naquit l’erreur qui
porta lés peuples poftérieurs à lui fuppofer une
exiftence réelle. Ils ne firent pas attention que
les villes ne fe fondent pas aijifi ; qu’elles ne doivent
pas leur exiftence à des princes 6c à des princeffes ;
que toutes les villes dans les premiers temps , ont
commencé par n’être que dés cabanes ou des hameaux;
qu’au temps du déluge dè Deucàlion 8c
de celui d’Ogygès, il étoit impoffible qu’il y eût
un fi grand nombre d’habitàns pour peupler les
villes 8c de princes pour lés bâtir. De plus , leur
non-exiftence n’eft-elle pas démontrée parleur
généalogie ? Tous lés fondateurs prétendus de
v illes, defquelles l’origine eft néceffairement inconnue
, font fils ou d’un fleuve, ou d’une fon«*
taine, ou d’une conftellation, ou d’un dieu , ou
d’une amazone, ou au moins d’un roi. O r , comme
l ’exiftence de ces fondateurs, fils de fleuves 8c
même de rois, n’eft pas pôffible, il s’enfuit que
c’eft dans l’allégorie qu’il faut trouver deur hif-
toire. On trouve auïü celle d’un grand nombre
de ces perfonnages dans l’aftronomie ancienne,
C’eft fur quoi M. Dupuis a déjà montre des ap-
perçus très-lumineux, 6c ce qu’il démontrera com*
plétement à la publication du grand ouvrage qu’il
prépare fur cet objet. On en peut prendre une
idée très-avantageufe par la ’leftnre de ce qu’il a
fait imprimer dans l’aftronomie de M. de la Lande ,
comme je l’ai,déjà dit, 6c dans cç qui s’en trouve
dans l’excellent ouvrage de M. de Saint-Etienne.
A ces idées eflentiellement préliminaires fur la
religion des Grecs , je ferai fuççéder quelques
détails ^particuliers, relatifs à la pratique de la
religion, * . ’ TV,/.'’
Divinités, Les dieux de fa Grèce étoient diyifés
Comme le monde, en dieux du ciel, en dieux de la
terre , & en dieux des enfers ( i) . Le culte le plus
folemnel étoit pour les premiers; le fécond, pour
les dieux de la terre ; lë troifiéme, pour les dieux
des enfers. _
Entre tous cés dieux, on en diftinguoit douze
grands.
jNoms grees. Noms françois, venus du latin.
Zevç . . . (Zeus). . . Jupiter.
H pu . . . (Héra). . . Junon.
noostS'cùv (Pofeïdôn). Neptune.
K'pns . . . (A r è s ) . . . Mars.
hTroKKtov . ( Apollôn ). | Apollon.
Elppenc . . (Hermès). Mercure.
UuhKÙs . (Palbs). . . Pallas 6c Minerve.
Espre/xts . (Ar tém is ).. Diane.
Anptérnp . (Dèmètèr). Cérès.
A’eppod'trn. ( Aphrodité ). Vénus.
ti*<pu/po* . (Ephaiftos). Vulcain.
Éçu. . . . (.Vefta). . .V e f t a .
En général les Grecs, 8c fur-tout les Athéniens,
ayoient la plus grande vénération pour ces^ douze
dieux. On trouvera dans le di&ionnaire d’antiquités,
les différentes épithètes qu’on leur donnoit fuivant
les différentes fondions qu’on leur affignoit. .
; • Outreces grandes divinités ,il y en avoit d’autres
de rang- inférieur : c’étoient les Aa.ip.ovec, ou les
Génies ; les abtres étoient des héros, honorés
après leur mort.
Lieux facrès. Les anciens admettoient trois fortes
ide lieux, foit qu’ils fuffent feulement confacrés aux
divinités, foit qu’ils-fuffent deftinés à raffembler
ceux qiii vouloient leur adreffer des prières. Les
premiers fe nommoient Teptsm■ , ou champs fépa-
rés (a ); les féconds "étoient des Éha~<), ou bois
facres ; les stroifièmes , particuliérement deftinés
aux prières, étoient des N c to itemples, ou l'epci
( OtMip-uru) 9 habitations facrées.
N On conftruifoit en général les temples ; ou 'dans
la partie la plus élevée de la yi-ile, ou- hors des
villes fur des montagnès., la porte tournée vers1
l’orient. Il y avoit des temples“ pour une feule
divinité ; il y en avroit pour plufieurs divinités à
la fois. 1
Ordinairement on défignoit le temple par un
nom formé de celui de la divinité à laquelle il * &
( i) Ceft dans le diéfionnajre d’antiquité que l’on doit
s’attendre à trouver les différentes epitliètés données â
ces dieux, telles que celle d’E^o’ü^vroi ou de céleftes pour
les premiers, d’E‘?rij(,S«»io< ou terreftre pour les féconds,
& d’Y^o^S-ovioj pour les troilièmes.
(.i) le nom que l’on donnoit aux terres confacrées
aux dieux, & dont les revenus aj-pertenoiept à leurs
temples. On voit, entre autres exemples, dans Paufamas,
(Ehd. c. r i ) , que pour appaifer les mânes d’un des
compagnons d’U iyfie, tué par les hàbitaos de'Terneffe,
i oracle leur confeille de conlacrer à fes mânes une portion
de terres.
étoit confacré. Ainfi., l’H,/pe6To»', ou YHereeum
étoit un temple confacré à Junon ; VNprep.ltnovt
ou VArtemiJîum, un temple Confacré à Diane, &c.
Les temples offroient à la vue les fimulacres ou
ftatues de leurs divinités, & les offrandes que la
piété leur avoit confacrées. Ces ftatues, appelées
kyuhpturu, furent dans les commencemens des
objets très'jnformes; dans la fuite, on les fit de
fe r , d’airain, d’ivoire y d’argent 8c d’or. Les ofr
frandes , appelées Pivu^ép.uru, parce qu’on les
fufpendoit aux murailles ou aux voûtes de£temples,
étoient offertes fouvent par la crainte , qui cher-
choit à fe rendre favorable la divinité , quelquefois
auffi par la reconnoiffance.
Ordinairement ces offrandes confiftoient en couronnes,
en vêtemens ,vafesde fer, d’or ou d’argent,
en trépieds, &c. C ’étoit auffi quelquefois des dépouilles
des ennemis. ; |
Minières de la religion. En général, on nommoit
Vepstc 3 ou prêtres, les hommes deftinés à la garde
on àu fervjee des lieux faints. Ils étoient en grande
vénératiop.
Dansjès grandes villes il y en avoit de différ
rentes clafles. Celui qui étoit à la tête de tout
l’ordre entier, 8c auquel-appartenoit la célébration
dés myftères les plus facrés, s’âppeloit \'Npyjispevs,
■ ou. Y.àfchiprêfxfi. .$p,u§,les' prêtres il y avoit des mi-
niftres, dont les nominations différentes ayoient
rapport à leurs fonélioas..
y On admettoit aufti les femmes aux fondions
facerdotales ; on les nommoit V'spgiu) : ordinairement
on exigeoit qu’elles fuffent vierges. On crut
avoir dans la fuite des raifons de ne les laiffer
dans cet état que jufqu’a l’âge nubile. Il y avoit
auffi des facerdoces où l’on admettoit les femmes
qui n’avoient eu qu’un feul mari.
Lorfque ces perfonnés facerdotales rempliffoienc
leurs fondions dans . les temples, elles étoient
Y.êtues d’étoffe de lin, avec des couronnes fur la
tête. On vpit, dans quelques états de la Grèce ,
des facerdoces affeéiés à certaines familles.: tels
étoient les Eumo-lpides à Athènes. .
Culteyprières. On s’acquittoit dans les lieux facrés
de trois fortes de devoirs religieux; favoir^.les
prières, les facrifices 6c les luftrations.
Les prières fe faifoient debout ou à genoux,
accompagnées des cérémonies dont il ne peut être
queftion ici.
Les facrifices fe nommoient Svalui 6c S'vpu; ils
confiftoient d’abord dans une offrande de parfums
que l’on brûioit. On offroit enfuite des produirions
de la ferre, puis des animaux : ces vi&imes étoient
conduites à l’autel, piarées de guirlandes.
Outré les facrifices, les Grecs pratiquoient auftî
des purifications : elles ayoient lieu fur-tout lorfque
l’on fe croÿoit fouillé, foit'par un meurtre, foit
par des funérailles, foit lorfque l’on avoit cohabité
avec une femme. .
Oracles 8c divinations. On appeloit oracles des
réponfes fuppofées rendues par les dieux lorfqu’ils