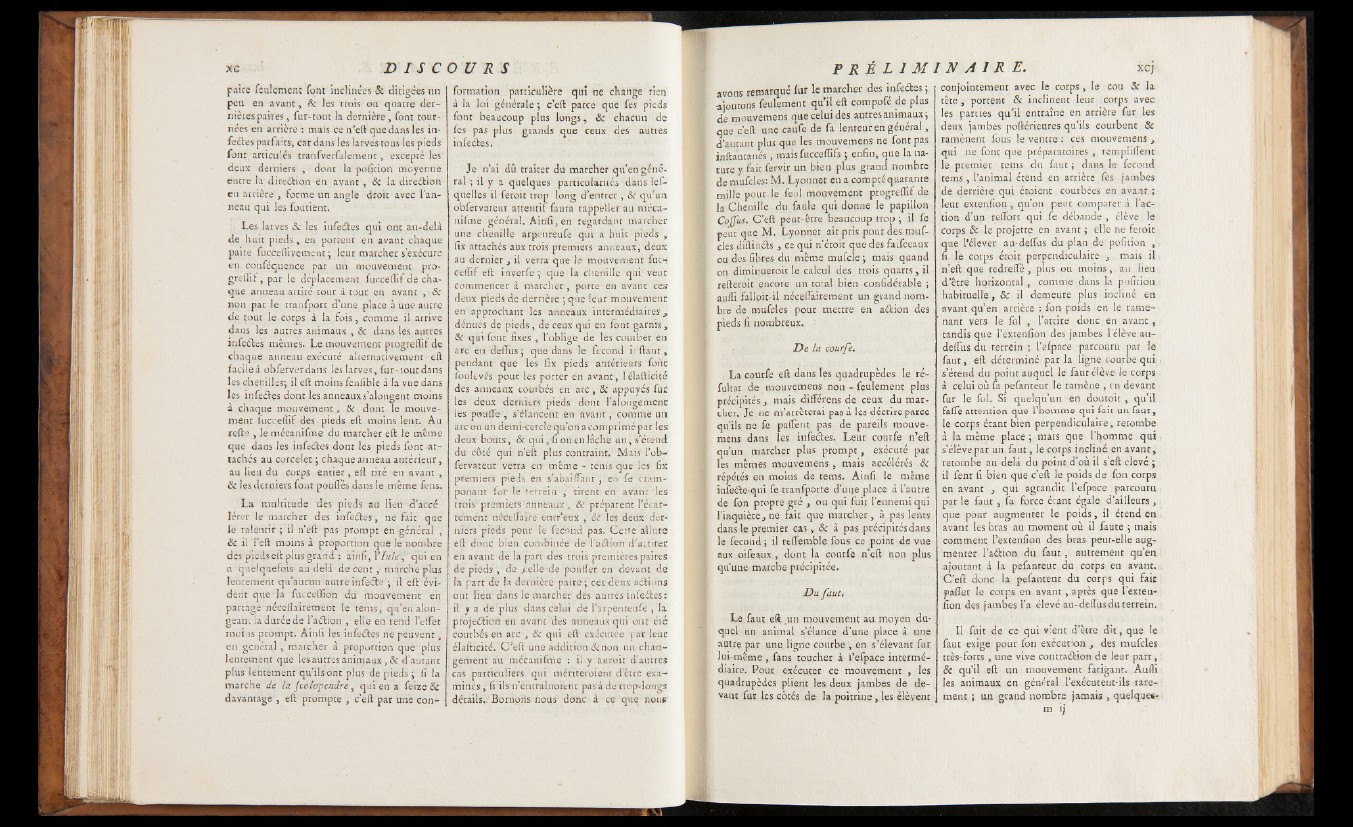
XC D r s C O U R s
paire feulement font inclinées 5c dirigées un
peu en a v an t, « les trois ou quatre dernières
paires , fur-tout la d ernière, font tournées
en arrière : mais ce nfeft que dans les in fectes
parfaits, car dans les larves tous les pieds
font articulés tranfverfalemenc , excepté les
deux derniers , donc la pofition moyenne
entre la direction en avant , 8c la direction
en arrière , forme un angle droit avec l’anneau
qui les foucienr.
Les larves 8c les infeétes qui ont au-delà
de huit p ied s, en portènt en avant chaque
paire fucceflivement j leur marcher s’exécure
en. conféquehçe par un mouvement progreflif
, par le déplacement fucceflif de chaque
anneau attiré tour à-tour en avant , 8c
non par le tranfport d’une place à une autre
de tout le corps à la fo is , comme il arrive
dans les autres animaux , 8c dans les autres
infectes memes. L e mouvement progreflif de
chaque anneau exécuté alternativement 'e it
facile à obferverdans les larves , fur-tout dans
les chenilles; il eft moins fenfible à la vue dans
les infectes dont les anneaux s’alongent moins
à chaque m o u vem en t, 8c dont le mouvement
fucceflif des pieds eft moins lent. Au
refte , le mécanifme du marcher eft: le même
que dans les infeétes dont les pieds fo n t^ t-
tachés au corcelec ; chaque anneau antérieur,
au lieu du corps en tier, eft tiré en avant ,
8c les derniers font poufles dans le même fens.
L a multitude des pieds au lieu d’accé
lérer le marcher des infectes, ne fait que
le ralentir ; il n’eft: pas prompt en général ,
8c il Teft moins à proportion que le nombre
des pieds eft plus grand : ainfi, 1 qui en
a quelquefois au-delà de cent f marche plus
lentement qu’aucun autre infeCte j il eft évident
que la fuceefliôn dû mouvëment en
partagé néceftairemenc le te m s, qu’en alon-
geanc la durée de l’aétion , elle en rend l’effet
moins prompt. A in fl les infeétes ne p eu vent,
en g en eral, marcher à proportion que plus
lentement que lesautresanimaux , & d’autant
plus iehtêment qu’ils ont plus de pieds j fl la
marche de là Jcàlopendre, qui en a feize 8c
davantage , eft prompte , c’eft par une conformation
particulière qui ne change rien
à la loi générale ; c’eft parce que fes pieds
font beaucoup plus longs 3 8c chacun de
fes pas plus grands que ceux des autres
infectes»
Je n’ai dû traiter du marcher qu’en général
; il y a quelques particularités dans lesquelles
il feroit trop long d’en trer, & qu’un
obfervateur attentif faura rappeller au mécanifme
général. A in fi, en regardant marcher
une chenille arpent'eufe qui a huit pieds >
fix attachés aux trois premiers anneaux, deux
au dernier il verra que le mouvement fut*
eeffif eft inverfe j que la chenille qui veut
commencer à m arch er, porte en avant ces
deux pieds de derrière * que leur mouvement
en approchant les anneaux intermédiaires
dénués de pieds, de ceux qui en font garn is,
8c qui font fixes , l’oblige de les coût ber en
arc en deffus • que dans le iecond ir fta n t,
pendant que les fix pieds antérieurs font
foulevés pour les porter en avan t, lélafticicé
des anneaux courbés en a r c , 8c appuyés fur
les deux derniers pieds donc l’alongemenr
les pouffe ', s’élancent en a v a n t, comme un
arc on un demi-cercle qu on a comprimé par les
deux bouts, & q u i, 'fi on en lâche un, s’étend
du côté qui n’eft plus contraint. Mais l’ob-
fervateur verra en même - tems que les fix
premiers pieds en s’ab aifian t, en fe cram-
ponant- fu r le terréin , tirent: en avant les
trois- premiers anneaux 8c préparent l’écar-
temént néeeffairë entr’eux , 8c les d eu x'derniers
pieds pour lë fécond pas. C e tte allure
eft donc bien combinée de l’action d'attirer
en avant de la part des trois premières paires
de pieds , de .celle - de pôtifler en devant de
la part de la dernière paire •, ces deux actions
ont lieu dans le marcher dés autres infeétes:
il y a de plus dan§ celui de l’arpenreufe , la
projeétioiî en avant des anneaux qui ont été
courbés en arc 8c qui eft exécutée par leur
élafticité. Cfeft une addition 8c non un changement
au mécanifme : il y au toit d’autres
cas particuliers qui mériteroient d’être examin
és, fi ils n’en irai'noient pas à de trop-longs
détails-B ornoîïs nous- donc à ce q u e-n eu f
p R É L 1 M
avons remarque fur le marcher des infeétes ;
-ajoutons feulement qu’il eft compofé de plus
de mouvemens que celui des autresanimaux;
que c’eft une caufe de fa lenteur en g é n é ral,
d ’autant plusique les mouvemens ne font pas
inftantanés , mais fucceflifs ; enfin, que la nature
y fait fervir un bien plus grand nombre
de mufcles: M . Lyonnet en a compté quarante
mille pour le feul mouvement progreflif de
la Chenille du faule qui donne le papillon
Cojfus. C ’eft peut-être beaucoup trop ; il fe
peut que M . Lyonnet ait pris pour des mufcles
diftinéts j ce qui n’étoit que des faifeeaux
ou des fibres du même m u fcle; mais quand
on dimir.ueroic le calcul des trois qu arts, il
refteroit encore un total bien çonfidérable ;
aulîi falloit-il néceflairement un grand nombre
de mufcles pour mettre en aétion des
pieds fi nombreux.
De la courfe.
La courfe eft dans les quadrupèdes le ré-
fultat de mouvemens non - feulement plus
précipités, mais différons de ceux du marcher.
Je ne m’arrêterai pas à les décrire parce
qu’ils ne fe paffent pas de pareils mouvemens
dans les infeétes. Leur courfe n’eft
qu’un marcher plus p rom p t, exécuté par
les mêmes mouvemens , mais accélérés &
répécés en moins de tems. Ainfi le même
infeéte-qui fe tranfporte d’uije place à l’autre
de fon propre gré , ou qui fuij l’ennemi qui
l ’inquiète, ne fait que m arch er, à pas lents
dans le premier c a s , & à pas précipités dans
le fécond ; il reffemble fous ce point de vue
aux oifeaux , dont la courfe n’eft non plus
qu’uner marche précipitée.
Du faut.
L e faut eft .un mouvement au moyen duquel
un animal s’élance d ’une place à une
autre pat une ligne courbe , en s’élevant fur
lui-même , fans toucher à l’efpace intermédiaire.
Pour exécuter ce mouvement , les
quadrupèdes plient les deux jambes de devant
fur les côtés d e la po itrin e, les élèvent
N A I R E . xcj
conjointement avec le co rp s, le cou 3c la
tête , portent & inclinent leur corps avec
les parties qu’ il entraîne en arrière fur les
deux jambes poftérieures qu’ils courbent &
ramènent fous le vencre : ces mouvemens ,
qui ne font que préparatoires , rempliffenc
le premier tems du faut j dans le féc o n d .
tems , l’animal étend en arrière fes jambes
de derrière qui étoient courbées en avant ;
leur exten fioo, qu’on peur comparer a l’action
d’un reffbrt qui fe débande , élève le
corps & le projette en avant ; elle ne feroit
que l’élever au-deffus du plan de pofition , .
fi le corps étoic perpendiculaire , . mais il
n’eft que redreffé , plus ou m o in s, au lieu
d ’être horizontal , comme dans la pofition
h ab itu elle, &c il demeure plus incliné en
avant qu’en arrière : fon poids en le ramenant
vers le fol , l’attire donc en avant ,
tandis que l’extenfion des jambes l’élève au-
deffus du terrêin ; i’efpace parcouru par i e
fa u t, eft déterminé par la ligne courbe qui
s’étend du point auquel le faut élève le corps
à celui où fa pefanteur le ramène , en devant
fur le fol. Si quelqu’un en d o u to it, qu’il
faffè attention que l’homme qui fait un fa u t,
le corps étant bien perpendiculaire, retombe
à la même place ; mais que l’homme qui
s’élève par un fa u t, le corps incliné en avan t,
retombe au delà du point d ’où il s’eft élevé ;
il fent fi bien que c’eft le poids de fon corps
en avant , qui agrandit l’efpace parcouru
pat le faut , fa force étant égale d’ailleurs ,
que pour augmenter le p o id s, il étend en
avant les bras au moment où il faute ; mais
comment l’extenfion des bras peut-elle augmenter
[’aétion du f a u t , autrement qu’en
ajoutant à la pefanteur du corps en avant.
C ’eft donc la pefanteur du corps qui fait
paffet le corps en a v a n t, après que l’exten-
fion des jambes l’a élevé au-deffus du terrein.
Il fuit de ce qui vient d’ètre d i t , que le
faut exige pour Ion exécution , des mufcles
très-forts , une vive contraétion de leur p a rt,
& qu’il eft un mouvement fatigant. Au d i
les animaux en général l’exécutent-ils rarement
; un grand nombre jamais , quelques