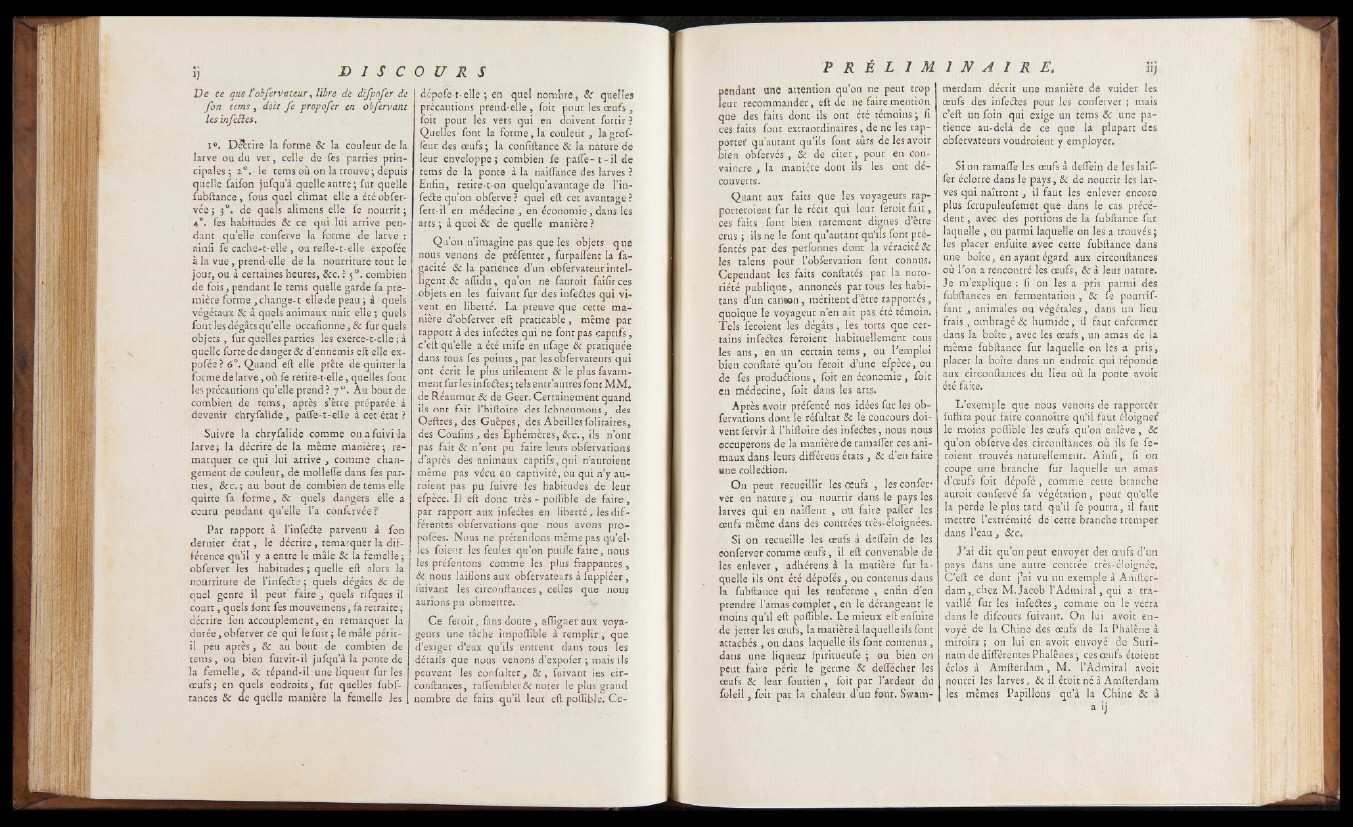
De ce que fobfervateur, libre de difpofer de
fort tems, doit fe propofer en obfervant
les infectes.
i° . Décrire la forme & la couleur de la
larve ou du ver, celle de fes parties principales;
a0.-le tems où on la trouve; depuis
quelle faifon jufqu’à quelle autre; fur quelle
fubftance , fous quel climat elle a été obfer-
vée; 3°. de quels alimens elle fe nourrit;
4*. fes habitudes & ce qui lui arrive pendant
qu’elle conferve la forme de larve :
ainfi fe cache-t-elle , ou relle-t-eile expofée
à la vue, prend-elle de la nourriture tout le
jour, ou à certaines heures, &c. î 50. combien
de fois, pendant le tems quelle garde fa première
forme ,change-t elle de peau; à quels
végétaux & à quels animaux nuit elle ; quels
font les dégâts qu’elle occafionne,& fur quels"
objets , fur quelles parties les exerce-t-elle ; à
quelle forte de danger & d’ennemis eft elle expofée
? 6°. Quand eft elle prête de quitter la
forme de larve, où fe retire-r-elle, quelles font
les précautions qu’elle prend ? 7 0. Au bourde
combien de tems, après s’être préparée à
devenir chryfalide, paffe-t-elle à cet état ?
Suivre la chryfalide comme onafuivifla
larve; la décrire de la même manière; remarquer
ce qui lui arrive , comme changement
de couleur, de molleffe dans fes parties
, &c. ; au bout de combien de tems elle
quitte fa forme, & quels dangers elle a
couru pendant qu’elle l’a confervéef
Par rapport à l’infeâe parvenu à fon
dernier état, le décrire, remarquer la différence
qu’il y a entre le mâle 8c la femelle;
obferver les habitudes; quelle eft alors la
nourriture de l’infeâe ; quels dégâts & de
quel genre il peut faire, quels rifques il
court, quels font fes mouvemens, fa retraite ;
décrire fon accouplement, en remarquer la
durée, obferver ce qui le fuit; le mâle périt-
il peu après, & au bout de combien de
tems, ou bien furvit-il jufqu’à la ponte de
la femelle, & répand-il une liqueur fur les
oeufs ; en quels endroits, fur quelles fubf-
tances 8c de quelle manière la femelle les
j dépofe-t-elle ; en quel nombre, 8c quelles
précautions prend-elle , foit pour les oeufs ,
foit pour les vers qui en doivent fortir ?
Quelles font la forme, la couleur, lagrof-
feur des oeufs; la confiftance & la nature de
leur enveloppe ; combien fe p a fle - t - ild e
tems de la ponte à la nailfance des larves ?
Enfin, retire-t-on quelqu’avantage de l’in-
feâe qu’on obferve ? quel eft cet avantage ?
fert-il en médecine , en économie, dans les
arts; à quoi & de quelle manière?
Qu’on n’imagine pas que les objets que
nous venons de préfenter, furpaffent la fa-
gacité & la patience d’un obfervateur intelligent
& affidu, qu’on ne fauroit faifîr ces
objets en les fuivant fur des infeâes qui vivent
en liberté. La preuve que cette manière
d’obferver eft praticable, même par
rapport à des infeâes qui ne font pas captifs ,
c’eft qu’elle a été mife en ufage & pratiquée
dans tous fes points, par les obfervateurs qui
ont écrit le plus utilement & le plus favam-
ment fur ies infeâes ; tels entr’autres font MM.
de Réaumur & de Geer. Certainement quand
ils ont fait l’hiftoire des Ichneumons, des
Oeftres, des Guêpes, des Abeillesfolitaires,
des Coufms , des Ephémères, & c ., ils n’ont
pas fait & n’ont pu faire leurs obfervations
d’après des animaux captifs, qui n’auroienc
même pas vécu en captivité, ou qui n’y au-
roient pas pu fuivre les habitudes de leur
efpèce. Il eft donc très - poflible de faire,
par rapport aux infeâes en liberté, les différentes
obfervations que nous avons pro-
pofées. Nous ne prétendons même pas qu’elles
foient les feules qu’on puiffè faire, nous
les préfentons comme les plus frappantes ,
& nous laiiïbns aux obfervateurs àfuppléer,
fuivant les circonftances, celles que nous
aurions pu obmettre.
Ce feroit, fans doute, aftîgner aux voyageurs
une tâche impoflible à remplir, que
d’exiger d’eux qu’ils entrent dans tous les
détails que nous venons d’expofer ; mais ils
peuvent les confulter, & , fuivant les cir-
conftançes, raffembler¬er le plus grand
nombre de faits qu’il leur eft poflible. Cependant
une attention qu’on ne peut trop
leur recommander, eft de ne faire mention
que des faits dont ils ont été témoins ; fl
ces faits font extraordinaires, de ne les rapporter
qu’autant qu’ils font sûrs de les avoir
bien obfervés , & de citer, pour en convaincre
, la manière dont ils les ont découverts.
Quant aux faits que les voyageurs rapporteraient
fur le récit qui leur ferait fa it,
ces faits font bien rarement dignes d’être
crus ; ils ne le font qu’autant qu'ils font pré-
fentés par des perfonnes dont la véracité &
les talens pour l’obfervation font connus.
Cependant les faits conftatés par la notoriété
publique, annoncés par tous les habi-
tans d’un caneen, méritent d’être rapportés,
quoique le voyageur n’en ait pas été témoin.
Tels feraient les dégâts, les torts que certains
infeâes feraient habituellement tous
les ans, en un certain tems , ou l’emploi
bien conftaté qu’on feroit d’une efpèce, ou
de fes produâions, foit en économie, foit
en médecine, foit dans les arts.
Après avoir préfenté nos idées fur les obfervations
donc le réfultat & le concours doivent
fetvir à l’hiftoire des infeâes, nous nous
occuperons de la manière de ramafler ces animaux
dans leurs différens états, 8c d’en faire
une colieâion.
On peut recueillir les oeufs , les confer-
ver en nature j ou nourrir dans le pays les
larves qui en naiflent , ou faire paffer les ;
oeufs même dans des contrées très-éloignées.
Si on recueille les oeufs à deffein de les
eonferver comme oeufs, il eft convenable de
les enlever , adhérens â la matière fur la quelle
ils ont été dépofés, ou contenus dans
la fubftance qui les renferme , enfin d’en
prendre l ’amas complet, en le dérangeant le
moins qu’il eft poflible. Le mieux eft enfuite
de jetter les oeuts, la matière à laquelle ils font
attachés , ou dans laquelle ils font contenus ,
dans une liqueur fpiritueufe ; ou bien on
peut faire périr le germe & deffécher les
oeufs & leur fourien , foit par l'ardeur du
foleil, foit par la chaleur d’un four. Swammerdam
décrit une manière de vuider les
oeufs des infeâes pour les eonferver ; mais
c’eft un foin qui exige un tems 8c une patience
au-delà de ce que la plupart des
obfervateurs voudraient y employer.
Si on ramafle les oeufs à deffein de les laif-
fer éclorre dans le pays, 8c de nourrir les larves
qui naîtront , il faut les enlever encore
plus fcrupuleufemet que dans le cas précédent
, avec des portions de la fubftance fur
laquelle , ou parmi laquelle on les a trouvés ;
les placer enfuite. avec cette fubftance dans
une boîte, enayantégard aux circonftances
où l’on a rencontré lès oeufs, & à leur nature.
Je m’explique : fi on les a pris parmi des
fubftances en fermentation, & fe pourrif-
fant , animales ou végétales, dans un heu
frais, ombragé & humide, il faut enfermer
dans la boîte , avec les oeufs , un amas de la
même fubftance fur laquelle on les a pris,
placer la boîre dans un endroit qui réponde
aux circonftances du lieu où la ponte avoir
été faite.
L ’exemple que nous venons de rapporter
fuffira pour faire connoître qu’il faut éloigneé
le moins poflible les oeufs qu’on enlève, 8c
qu’on obferve des circonftances où ils fe feraient
trouvés naturellement. Ainfi, fi on
coupe une branche fur laquelle un amas
d’oeufs foit dépofé , comme cette branché
aurait confervé fa végétation, pour qu’elle
la perde le plus tard qu'il fe pourra ,-il faut
mettre l’extrémité de cette branche tremper
dans l’eau , &c.
J’ai dit qu’011 peut envoyer des oeufs d’un
pays dans une autre contrée très-éloignée.
C ’eft ce dont j’ai vu un exemple à Amfter-
dam,.chez M. Jacob l'Admirai,-qui a travaillé
fur les infeâes, comme on le verra
dans le difeours fuivant. On lui avoit envoyé
de la Chine des oeufs dè la Phalène à
miroirs ; on lui en avoit envoyé de Surinam
de différentes Phalènes ; ces oeufs étoienc
éclos à Amfterdam, M. l’Àdmiral avoic
nourri les larves, & il étoit né à Amfterdam
les mêmes Papillons qu’à la Chine & à
a ij