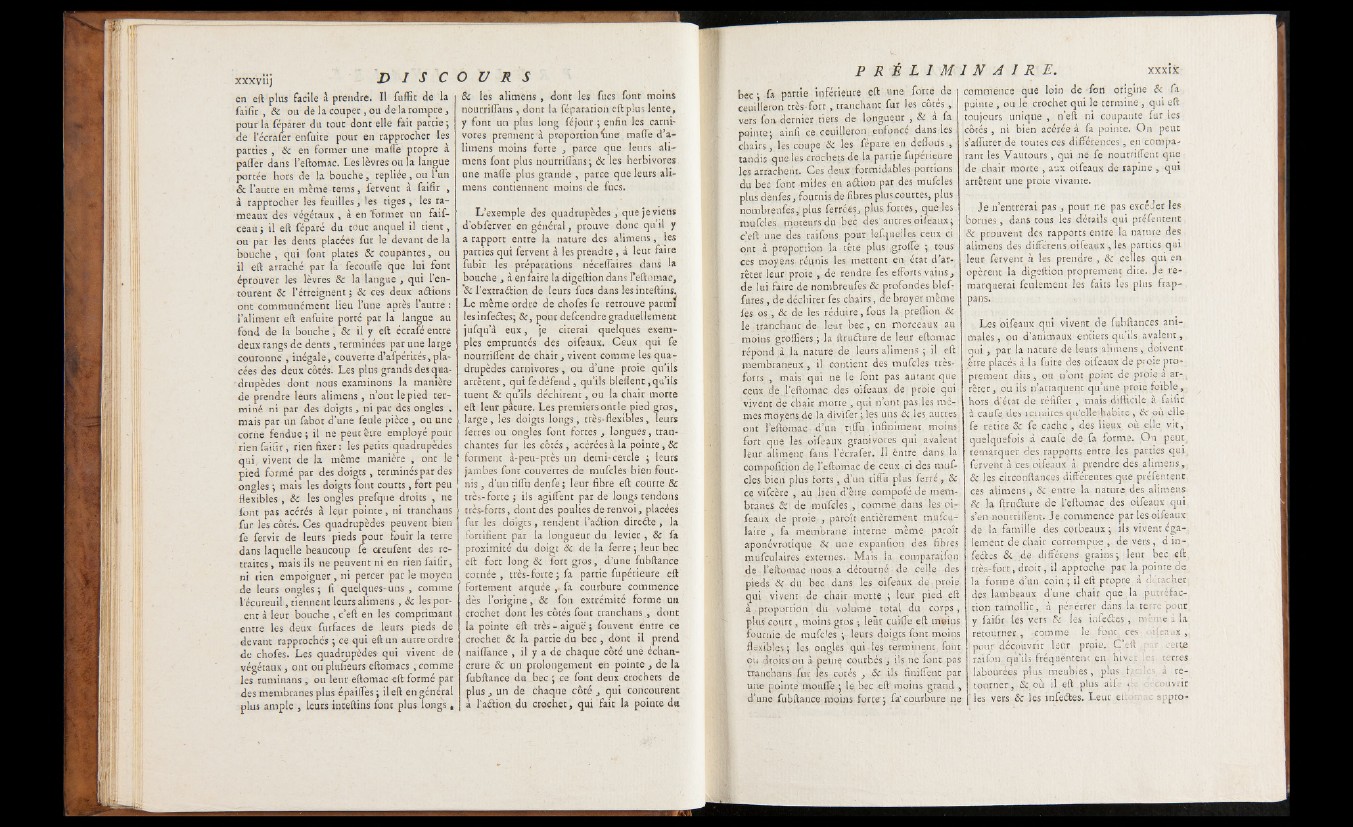
xxxviïj D I S C
en ell plus facile à prendre. Il fuffit de la
faifir, & ou de la couper, ou de la rompre ,
pour la fépàrer du tour dont elle fait partie ;
de l’écrafer enfuite pour en rapprocher les
parties , & en former une mafle propre a
palTer dans l’eltomac. Les lèvres ou la langue
portée hors de la bouche, repliée, ou l’un
& l’autre en même-tems, fervent à faifir ,
à rapprocher les feuilles, les tiges, les rameaux
des végétaux , à en 'former un faif-
ceau; il ell fcparé du tout auquel il tient,
ou par les dents placées fur le devant de la
bouche , qui font plates 8c coupantes, ou
il ell arraché par la fecoufle que lui font
éprouver les lèvres ôc la langue , qui l’entourent
8c l’étreignent ; & ces deux a étions
ont communément lieu l’une après l’autre :
l ’aliment ell enfuite porté par la langue au
fond de la bouche, & il y ell écrafé entre
deux rangs de dents , terminées par une large
couronne , inégale, couverte d’afpérités, placées
des deux côtés. Les plus grands des quadrupèdes
dont nous examinons la manière
de prendre leurs alimens , n’ont le pied terminé
ni par des doigts , ni par des ongles ,
mais par un fabot d’une feule pièce , ou une
corne fendue; il ne peut être employé pour
rien faifir , rien fixer : les petits quadrupèdes
qui, vivent de la même manière , ont le
pied formé par des doigts, terminés par des
ongles ; mais les doigts font courts, fort peu
flexibles, ôc les ongles prefque droits , 'ne
font pas acérés à lepr pointe, ni tranchans
fur les côtés. Ces quadrupèdes peuvent bien
fe fervir de leurs pieds pour fouir la terre
dans laquelle beaucoup fe creufent des retraites
, mais ils ne peuvent ni en rien faifir,
ni rien empoigner, ni percer par le moyen
de leurs ongles; fi quelques-uns , comme
l'écureuil, tiennent leurs alimens , 8c les por-
ent à leur bouche , c’efl en les comprimant
entre les deux furfaces de leurs pieds de
devant rapprochés ; ce qui ell un autre ordre
de chofes. Les quadrupèdes- qui vivent de
végétaux, ont oupluïfeurs eltomacs .comme
les ruminans , ou leur ellomac ell formé par
des membranes plus épailfes ; il ell engénéral
plus ample, leurs inteftins font plus longs ,
O U R S
8c les alimens , dont les fucs font moins
nourriflans, dont la féparation ell plus lente,
y font un plus long féjour ; enfin les carnivores
prennent'à proportion une malfe d’a-
limens moins forte , parce que leurs ali-
mens font plus nourriflans; & les herbivores
une mafle plus grande , parce que leurs ali-
mens contiennent moins de fucs.
L ’exemple des quadrupèdes, que je viens
d’obferver en général, prouve donc qu’il y
a rapport entre la nature des alimens, les
parties qui fervent à les prendre, à leur faire
fubir les préparations néceflaires dans la
bouche , à en faire la digeftion dans l’ eftomac,
ôc l'extraction de leurs fucs dans les inteflins.
Le même ordre de chofes fe retrouve parmi
lesinfeéles; 6c, pour defcendre graduellement
jufqu’à eux, je citerai quelques exemples
empruntés des oifeam;. Ceux qui fe
nourriffent de chair, vivent comme les quadrupèdes
carnivores, ou d’une proie qu’ils
arrêtent, quifedéfend, qu’ils bleflent, qu’ils
tuent & qu’ils déchirent, ou la chair morte
ell leur pâture. Les premiers ont le pied gros,
.large, les doigts longs, très-flexibles, leurs
ferres ou ongles font fortes , longues, tranchantes
fur les côtés . acéréesà la pointe, 8c
forment à-peu-près un demi-cercle ; leurs
jambes font couvertes de mufcles bien fournis
, d’un tiflu denfe ; leur fibre ell courte 8c
très-forte; ils agiflent par de longs tendons
très-forts, dont des poulies de renvoi, placées
fur les doigts, renflent l’aétion flireéle , la
fortifient par la longueur du levier , & fa
proximité du doigt 6c de la ferre ; leur bec
ell fort long 6c fort gros, d’une fübllance
cornée, très-forte ; fa partie fupérieure e£l
fortement arquée , fa courbure commence
dès l’origine, ôc fon extrémité forme un
crochet dont les côtés font tranchans., donc
la pointe ell très - aiguë ; fouvent entre ce
crochet 6c la partie du bec , dont il prend
naiflance , il y a de chaque côté une échancrure
6c un prolongement eft pointe , de la
fübllance du bec ; ce font deux crochets de
plus , un de chaque côté , qui concourent
à laétion du crochet, qui fait la pointe du
P R E L 1 M J N A 1 R E. xxxix
bec; fa partie inférieure ell une .forte de
ceuilleron très-fore , tranchant fur les cotes.,
vers fon dernier tiers de longueur , 6c .a fa
pointe; ainli ce ceuilleron .enfonce dansles
chairs, -lès coupe 6c les fepare en deflotls ,
tandis que les Crochets de la partie fupérieure
les arrachent. Ces deux formidables portions
du bec font -miles en aélion par des mufcles
plus denfes , fournis de fibres plus.cour.tes, plus
nombreufés, plus ferrées, plus.fortes, que les,
mufcles des autres oifeaux;
c’eii une des raifons. pour lefqueiles ceux c i .
ont à proportion la tête plus -greffe ; tous',
ces moyens- réunis les mettent en état d arrêter
leur proie , de rendre fes efforts vains,
de lui faire de nombreufes 8c profondes blef-
fures , de déchirer fes chairs, de broyer même
les os., 6c de les réduire, fous la preflion ôc
le tranchant de- leur bec , en morceaux au
moins grolîîers ; la llruélure de leur ellomac
répond ,à la nature de leurs alimens ; il ell
membraneux, il contient des mufcles très-
forts , mais qui ne le font pas autant que
ceux de. l’ellomaC: des oifeaux de proie qui-
vivent de chair morte , qui n’ont pas les memes
moyens de la dtvifer ; les uns ôc.les autres
ont lèftomac -d’un tiflu infiniment moins!
fort que -les oifeaux granivores qui avalent
leur aliment fans l’écrafer. Il entre dans,la
compofition de l’ellomac de ceux ci des mufcles
bien plus forts , d’un tiflu plus ferre, 6c
ce vifeère , au lieu d’être compofé de membranes
& de mufcles , comme,dans les °i--
feaux de,proie.-, paroît entièrement mufeu-
laire , fa membrane interne même paroît
aponévrodque 6c une expanfion des fibres
mufculaires externes. Mais la comparaifon
de-.ê’eflo.mac nous a détourné.-de celle de.s
pieds 6c du bec dans les: oifeaux de-proie
qui vivent de chair morte ; leur pied ell
.à proportion du volume total du corps,
plus court, moins gros ; leur cuilfe eft meins
fournie de mufcles ; leurs doigts font moins
flexibles ; les, ongles qui des terminent, font
ou droits ou à peine courbés:, ils ne font pas
tranchans-fur les cojés , 8c ils Unifient par
une pointé moufle ; le bec ell moins grand ,
d’une fübllance moins forte"; fa'courbure ne
commence que loin de -fon origine & fa
pointe , ou le crochet qui le termine , qui ell
toujours unique , n’eft ni coupante fur.les
côtés , ni bien acérée à fa pointe. On peut
s’affurer de toutes ces différences , en comparant
les Vautours , qui ne fe nourriffent que •
de chair morte , aux oifeaux de rapine , qui
arrêtent une proie vivante.
Je n’entrerai pas, pour ne pas excéder les
bornes, dans tous les détails qui préfentent
!8c prouvent des rapports entre la nature des
alimens des différens,oifeaux , les parties qui
leur fervent à les prendre , 6c celles qui en
opèrent la digeftion proprement dite. Je remarquerai
feulement les faits les plus frap-
pans. ^
Les oifeaux qui vivent de fubftances animales,
ou d’animaux entiers qu’ils avalent,
oui , par la nature de leurs alimens,. doivent
être placés à la fuite des oifeaux de proie proprement
dits, ou n’ont point de proie à ar-,
rêter, ou ils n’attaquent qu’une proie foible,
hors d’état de réfifter , mais difficile à faifir
à caufe des retraites qu'ellefiabire , 6c où elle
fe retire 8c fe cache , des lieux où elle vit,
quelquefois à caufe de fa forme. ,On peut,
remarquer des rapports, entre les parties qui,
fervent à ces oifeaux à prendre des alimens ,
6c les circonftances différentes que préfentent
ces alimens, 6c entre la nature des alimens
& la llruélure de l’eflomac des oifeaux qui
s’en nourriffent. Je commence par les oifeaux
de la famille des corbeaux; iis vivent éga-
lemènt de chair corrompu« , de vers, d infectes
& de différent : grains ; leur bec ell
très-fort, droit, il approche par la pointe de
la forme d’un coin ; il eft propre à détacher
des lambeaux d’une chair que la putréfaction
ramollir , à pénétrer dans la terre pour
y faifir les vers 6c les infeéles , même à la
retourner, -comme le font, ces oijeaux,‘
! pour découvrir leur proie. C ’ell par cette
raifon qu’ils fréquentent en-hiver les terres
labourées pi us meubles, .plus,prairies, à retourner,
& où il eft plus aifo «le découvrit
’ les vers 6c les infeétes. Leur eltornac appro