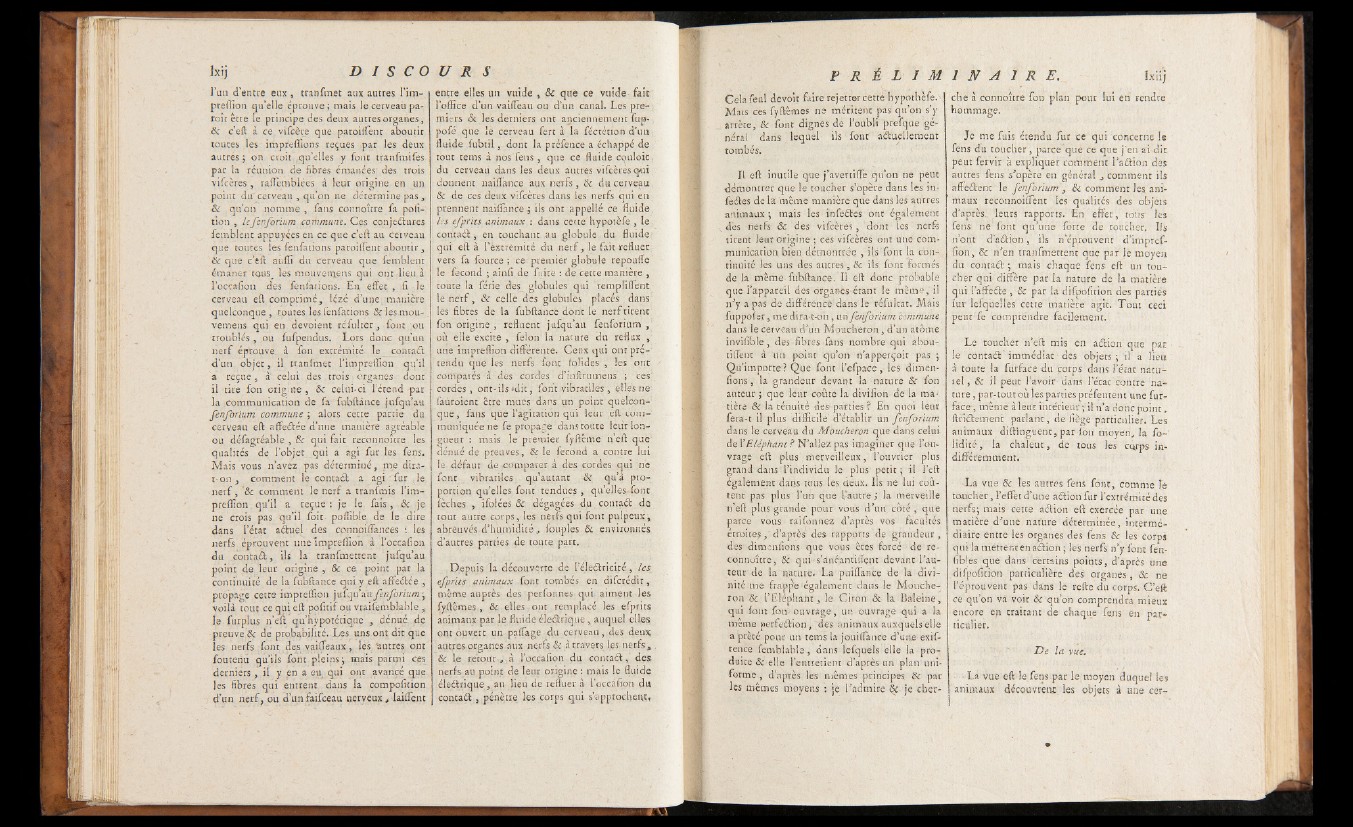
l ’un d’entre eux , tranfmet aux autres l’im-
preOion qu’elle éprouve ; mais le cerveau pa-
roîr être le principe des deux autres organes ,
8c c’eft à ce vifcère que paroilfent aboutir
toutes les impreffions reçues par les deux
autres; on croit .qu’elles y font tranfmifes
par la réunion de fibres émanées’ des trois
vifcères , raflemblées à leur origine en un
point du cerveau , qu’on ne détermine pas ,
8c qu’on nomme , fans çonnoître fa pofi-
tion , lefenforium çqmmune. Ces conjectures
femblent appuyées en ce que c’eft au cerveau
que toutes les fenfations paroilfent aboutir ,
& que c’eft auffi du cerveau que femblent
émaner tous, les mouveniens qui ont lieu à
l ’occafion des fenlations. E n effet , fi le
cerveau eft comprimé, Içzé d’une, manière
quelconque , toutes les fenfations & lesmou-
vemens qui en dévoient réfu lter, font ;ou
troublés , ou fufpendus. Lors donc qu’un
n e rf éprouve à fon extrémité le contaél
d ’un o b je t, il tranfmet l’impreftion qq’il
a reçue , à*'celui des . trois . organes dont
il tire fon origine , 8c celui-ci l’étend par
la communication de fa fubftànce ju fqu ’au
fenforium commune ; alors cette partie du
cerveau eft affeCtée d’une manière agréable
ou défagréable , 8c qui fait reconnoître les
qualités de l’objet qui a agi fur les fen s.
Mais vous n’avez pas-déterminé, me dira-
t - o n , comment le concadt a agi dfur , 1e
n e r f , comment le nerf a tranfmis l’im-
preffion qu'il a reçue : je le fa is , & je
ne crois pas qu’il foie poftible de le dire
dans l’état a&uel des connoiffances *. les
nerfs éprouvent une Impreflion à l’occafion
du contaCt, ils la tranfmettent jufqu’au
point de leur origine , & ce. point par la
continuité de la fubftànce qui y eft affeÇtée ,
propage cette impreflion jufqu’au/è/z/c?rk/72 ;
voilà tout ce qui eft pofitif ou vrailèmblable ÿ
le furplus n’eft qu’hypotétique , dénué, de
preuve 8c de probabilité. Les u.ns ont d it que
les nerfs font des vai (féaux, les. autres, ont
fouteriu qu’ils font pleins; mais parmi ces
derniers , il y en a e a qui ont avancé que.
les fibres qui entrent dans la compofition
d’un n e rf, ou d’unfaifceau nerveux é kiffenc
entre elles un vuide , 8c que ce vu id e-faic
l’office d ’un vaiffeau ou d ’un canal. Les premiers
& les derniers ont anciennement fup-
pofé que le cerveau fert à la féctétion d ’uu
fluide fu b til, dont la préfence a échappé de
tout tems à nos fens , que ce fluide cqu loic.
du cerveau dans les deux autres vifcères qui
donnent naiiïànce aux n erfs, 8c du cerveau
8c de ces deux vifcères dans les nerfs qui en
prennent naiftance ; ils ont appellé ce fluide.
les efprits animaux : dans cette hypotèfe , le
contait , en touchant au globule , du fluide
qu i eft à fixtrêm ité du n e r f, le fait refluer
vers fa fource ; ce premier globule repouffe
le fécond ; arnfi de fuite : de cette manière ,
toute la férié des globules qui remplirent
le n e r f, 8c celle des globules placés dans
les fibres de la fubftànce dont le nerf tirent
fon origine , refluent jufqu’au fenforium ,
où elle excite , félon la nature du reflux ,
une impreflion différente. Ceux qui ont prétendu
que les nerfs font folides , les ont
comparés à des cordes d’üiftrumens ; ces’
co rd es, ont-dls <dit j font vib ratiles, elles ne
fauroient être mues dans un point quelconq
u e , fans que l’agitation qui leur eft communiquée
ne fe propage dans toute leu r longueur
: mais le prèmiet fyfteme n’eft que
dénué d.e .preuves, 8c le fécond a contre lui
le défaut de ,comparer à des cordes qui ne
font vibratiles, . qu’ autant 8c qu’à proportion
qu’elles font tendues , qu’elles-fonc
fèches , ifolées 8c dégagées du contaét de
tout autre corps, les nerfs qui font pulpeux
abreuvés d’h um id ité fo u p le s 8c environnés
d’autres parties de toute part. .
Depuis la découverte de l’éleétricité, les
efprits animaux font tombés en d ifcrédir,
même auprès des perfonnes qui. aiment les
fyftêm es, 8c elles , ont remplacé les efprits
animaux par le fluide électrique,, auquel elles
ont opvert un paffage du cerveau , des deux
autres;prganes aux nerfs 8c à travers 1,es nerfs 3
Ôç le retour .,, à l’occafion du contaét , des
nerfs au point de leur origine : mais le fluide
électrique , au lieu de refluer à l’occafion du
contad , pénètre les corps qui s’approchent,
C e lafeu l devoir faire rejetter cette hypothèfe.v!
Mats ces fyftêmes ne méritent pas qu’on s’y
arrête, 8c font dignes de l’oubli prefque général
dans lequel ils font à&uellement
tombé Si
Il eft inutile que j’avertiffe qu’on ne peut
démontrer que le toucher s’opère dans les in-
fedes de la même manière que dansles autres
animaux ; mais les infed es ont également
dès nerfs 8c des v ifcè res, dont les nerfs
tirent leur origine ; ces vifcères ont une communication
bien démontrée. , ils font la continuité
les uns des autres, 8c ils font formes
de la même-fubftànce. Il eft donc probable
que i’apparéil des organes étant le m êm e,'il
n’ y a pas de différence dans le réfulcat. Mais
fuppofer, me dira-t-on, an fenforium commune
dans le cerveau d’un Mou cheron , d ’un atome
invifible , des fibres Làns nombre qui abou-
tiffent à uti point qu’on n’apperçoit pas ;
Q u ’importe ? Que font l’efp a ce, les dimen-
fions, la grandeur devant la nature 8ç fo n .
auteur ; que leur coûte la divifion de la m atière
8c la ténuité de&-parties ? En c]uoi leur
fera-t il plus difficile- d’établir un fenforium
dans le cerveau du Moucheron que dans celui
de \'Eléphant ? N ’aliez pas imaginer que l’ouvrage
eft plus m erveilleux, l’ouvrier plus
grand dans l’individu le plus p e tit; il l’eft
également dans tous lès deux. Ils ne lui coûtent
pas plus l’un que lrâutre ; la merveille
n’eft plus grande pour vous d ’un cûté , que
parce vous raifonnez d ’après vos facultés
étroites, ' d’après des rapports de grandeur,
des' dimenfions que vous êtes forcé de reconnoître,
8c qui sknéantiffçnt devant Tau-
teur de la nature.- La puiffanbe de la d ivinité
me frappe également dans le Moucheron
8c l’ Ë lép h a iit, le Ciroiv 8c la Baleine,
qui font fon -o u v ra g e, un ouvrage qui a la
même perfection , 'des animaux auxquels elle
a prêté pour lin tems la jouiffance d’ une exif-
tence fem b lab le, dans lefquels elle la produite
& elle l’entretient d’après un plan uniforme
, d’après les mêmes principes 8c par
les mêmes moyens ; je l’admire & je cherche
à çonnoître fon plan pour lui en rendre
hommage.
Je me fuis étendu fur ce qui concerne le
fens du tou ch er, parce que ce que j'en ai dit
peut fervir à expliquer comment l’action des
autres fens s’opère en général , comment ils
affrètent le fenforium , & comment les. animaux
reconnoiffent les qualités des objets
d’après^ leurs rapports. En effet, tous- les
fens ne' font q u ’une forte de toucher. Ifs
n’ont d a é tio n , ils n’éprouvent d ’impref-
fion, & n ’en tranfmettent que par lè moyen
du contad ; mais chaque fens eft un toucher
qui diffère p a c la nature de la matière
qui î’affed e , & par la difpofidon des parties
lu t lefquelles cette'm adère agit. T o u t cëci
peut Te comprendre facilement.
L e coucher n’eft mis en aétion que par
ie c o n ta é l immédiat -des objets ; il a lieu
à. toute la furface du corps dans l’état nantie
! , & i! peut l’avoir dans l’érac contre nature
, par-tour oùlesparriespréfentent une fur-
face , même à leur intérieur ; il n’a donc p o in t,
ftriétemeni parlant, de liège particulier. Les
animaux diftinguenc, par fon moyen, la fo -'
iid ité , la ch aleu r, de tous les corps indifféremment.
L a vue & les autres fens fon t, comme Te
toucher, l’effet d’une a& ion fu r l’extrémité des
nerfs; mais cette aélion eft exercée par une
matière d ’ une nature déterminée, intermédiaire,
entre les organes des fens & les corps
qui la nietrént en aélion; les nerfs n’y font fen-
fibles que dans certains points, d ’après une
difpofition particulière des organes, & ne
l’éprouvent pas dans le refte du corps. C ’eft
ce qu’on va voir & qu’on comprendra mieux
encore en traitant- de chaque fens en particulier.
,
D e la vue.
Là vue eft lefen s par le moyen duquel les
animaux découvrent: les objets à une cer