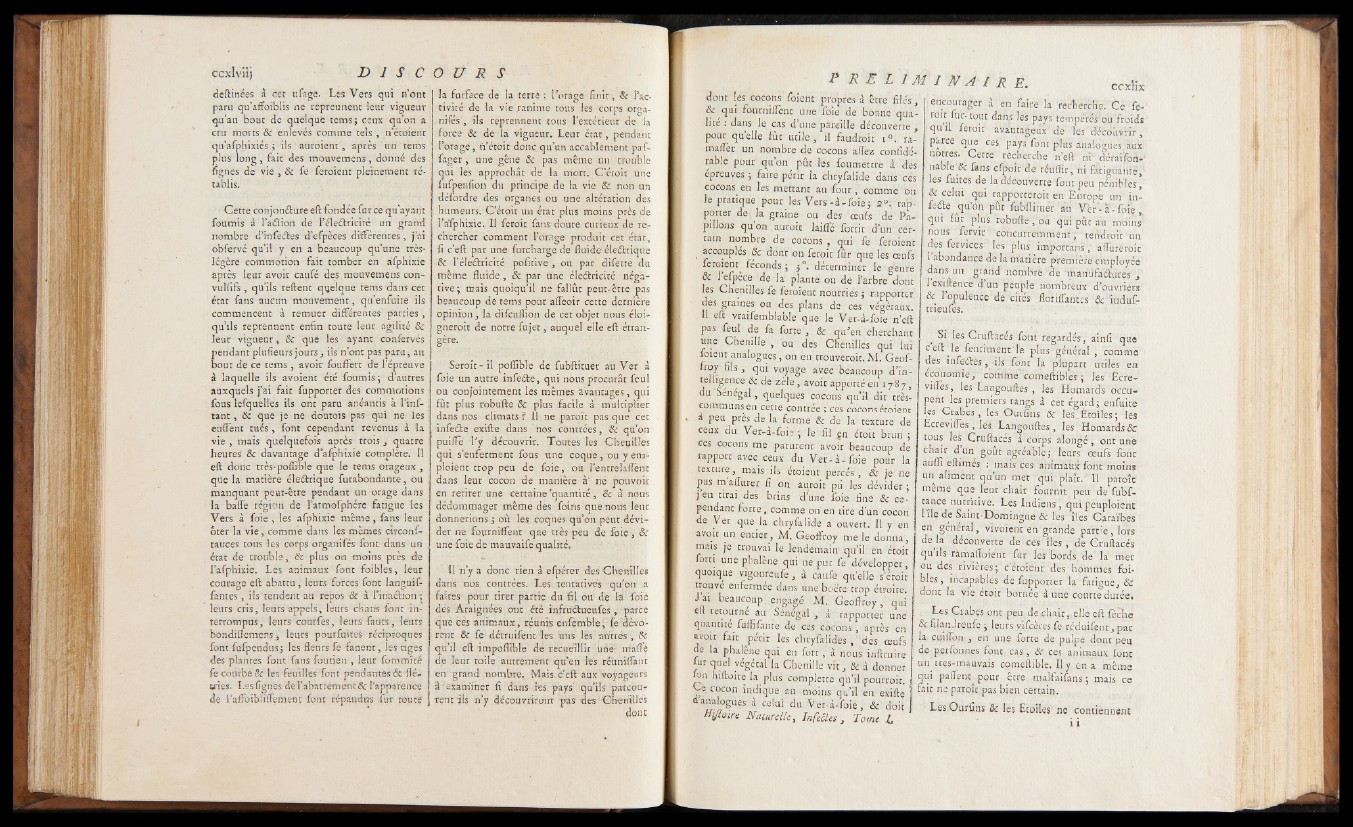
ccxlviij D I S C
deftinées à cet tifage. Les Vers qui n’ont
paru qu’affoibüs ne reprennent leur vigueur
qu’au bouc de quelque tems; ceux qu’on a
cru morts & enlevés comme tels , n’étoient
qu’afphixiés.; ils auroient, après un tems.
plus long, fait des mouvemens, donné des
lignes de v ie , & fe feraient pleinement rétablis.
Cette conjonéture eft fondée fut ce qu’ayant
fournis à l’aélion de l’électricité un grand
nombre d’infeétes d’efpèces différentes, j’ai
obfervé qu’il y en a beaucoup qu’une très-
légère commotion fait tomber en àfphixie
après leur avoir caufé des mouvemens oon-
vulfifs, qu’ils retient quelque tems dans cet
état fans aucun mouvement, qu’enfuite ils
commencent à remuer différentes parties ,
qu’ils reprennent enfin toute leur agilité &
leur vigueur, & que les ayant confervés
pendant plufieurs jours; ils n’ont pas paru, au
bout de ce tems , avoir fouffert de l’épreuve
à laquelle ils avoient été fournis ; d’autres
auxquels j’ai fait fupporter des commotions
fous lefquelles ils ont paru anéantis à Tinf-
tant, & que je rre doutois pas qui ne les
euffent tués, font cependant revenus à la
vie , mais quelquefois après trois , quatre
heures & davantage d’afpbixie complète. 11
eft donc très-poffible que le rems orageux ,
que la matière éleétrique furabondante, ou
manquant peut-être pendant un orage dans
la baffe région de l’atmofphére fatigue les
Vers à foie , les àfphixie même, fans leur
ôter la vie ,-comme dans les mêmes circonf-
tauces tous les corps organifés font dans un
état de trouble, & plus On moins près de
l ’afphixie. Les animaux font foibles, leur
courage eft abattu, leurs forces font languif-
fantes , ils tendent an repos & à 'Pinaétioii'';
leurs cris, leurs appels, leurs chaiisfont interrompus,
leurs courfes, leurs fâuts , leurs
bondiflemensj leurs pourfuites réciproques
font fufpendus; les fleurs fe fanent, les tiges
des plantes font Tans foütien , leur fommîté
fe courbe Sc les feuilles font pendantes & flétries.
Les Ggnès del’abattemenc&l’apparence
4e l’affoiblïffement font répandus .fut toute
O U R S
la furface de la terre ; l’orage finit, & l'activité
de la vie ranime tous les corps orga-
nrfés , ils reprennent tous l'extérieur de la
force & de la vigueur. Leur état, pendauc
l’orage, h’étoit donc qu’un accablement paf-
fager, une gêne & pas même un trouble
qui les approchât de la morr. C ’étoit une
fufpenfion du principe de la vie & non un
défordre des organes ou une altération des
humeurs. C ’étoit un état plus moins près de
l’afphixie. Il ferait fans doute curieux de rechercher
comment l’orage produit cet état,
fi c’eft par une furcharge de fluide élecftrique
-& i’éledlricité pofitive , ou par difette du
même fluide, & pat une éleélricité négative;
mais quoiqu’il ne fallût peut-être pas
beaucoup de tems pour affeoir cette dernière
opinion, la difcuflîon de cet objet nous éloignerait
de notre fujet, auquel elle eft étran-
gère.
Serait-il poflible de fubftituer au Ver à
foie un autre infeéte, qui nous procurât feul
ou conjointement les mêmes avantages, qui
fût plus robufte & plus facile à multiplier
dans nos climats ? Il ne .paraît pas que cet
infeéte exifte dans nos contrées, & qu’on
puifle l’y découvrir. Toutes les Chepilles
qui s’enferment fous une coque, ou y emploient
trop peu de foie, ou l’encrelaffent
dans leur cocon de manière à1 ne pouvoir
en retirer une certaine 'quantité, & à nous
dédommager même des foins que nous leur
donnerions ; ou les, coques qu’on peut dévider
ne Foutniffent que très-peu de foie, &c
une foi:e de mauvaife qualité.
Il n’y a donc rien à elpérer des Chenilles
dans nos contrées. Les tentatives qu’on a
faites pour tirer partie du fil ou' d'e fa Toié
des' Araignées ont été infriréfcueufes , parce
que ces animaux, réunis enfçmbfe; fe dévorent
& fe détruifent les uns les antres , &
qu’il eft impofllble de recueillir iiné maffé
de leur toile autrèmeiit qu’eu les réuniffant
en grand nombre. Mais c’eft aux voyageurs
à examiner fl dans les pays qu’ils parcourent
lis n’y découvriront pas fies''Chenilles
dont
P R E L I A
dont les cocons foient propres â être filés,
de qui fourniffènt une foie de bonne qualité
: dans le cas d une pareille découverte ,
pour quelle fut utile, il faudrait i Q. ra-
maffer un nombre de cocons affèz confidé-
table pour qu’on pût les foumettre à dès
épreuves ; faite périr 1a chryfalide dans cés
cocons en les mettant an fout, comme "on
le pratique pour les Vers-à-foie; rapporter
de, fa graine ou des oeufs de Papillons
qu on .aurait faille fortir d’un certain
nombre de cocons , qui fe feraient
. accouples & dont on ferait fur que les oeufs
feraient féconds ; ; °. déterminer le genre
& 1 efpéce de la plante ou de l’arbre donc
les Chenilles fe feraient nourries ; rapporter
des graines ou des plans de ces végétaux.
Il eft vraifembfable que le Ver-à-foie n’eft
pas feul de fa forte , & qu’en cherchant
une Chenille , ou des Chenilles qui lui
foient analogues, on en trouverait.M. Geoffroy
fils , qui voyage avec beaucoup d’intelligence
& de zèle , avoic apporté en 1787,,
du Sénégal, quelques cocons qu’il dit ttès-
commiinsen cette contrée ; ces coconsécoient
a peu près de 1a forme & de 1a texture de
ceux du Ver-a-fois ; le fil gn étoit brun ;
ce.s cocons me parurenc avoir beaucoup de
rapport, avec ceux du Ver-à-foie pour fa
texture, mais ils étoient percés , & je ne
pus m affurer fi on aurait pii. les dévider ;
j en tirai des brins d’une foie fine & cependant
forte , comme on en tire d’un cocon
de Ver que 1a chryfalide a ouvert. Il y en
avoir un entier, M. Geoffroy me le donna,
mais je trouvai le lendemain qu’il en étoit
forti une phalène qui 11e put fe développer,
quoique vigoureufe, à caufe quelle s’étoit
trouve enfermee dans une boëte trop étroite.
J ai beaucoup engagé M. Geoffroy, qui
eft retourne au Sénégal , à rapporter une
quantité^ fuffifante de ces cocons , après en
avoir fait périr les chryfalides , des oeufs
de 1a phalène qui en fort, à nous inftruire
lur quel végétal fa Chenille v it , & à donner
ion hiftoire fa plus complexe qu’il pourrait.
Ce cocon indique au moins qu’il en exifte
a analogues à celui du Vet-à-foie, & doit
Hÿïoire Naturelle, Infectes, Tçine L,
I N A I R E. ccxlix
; encourager à en faire fa recherche. Ce ferait
fur-tout dans les pays tempérés ou froids
qu il feroic avantageux de les découvrir,
parce que ces pays font plus analogues aux
nôtres. Cette récherche n’eft ni déraifon-
nable & fans efpoir de réiiflïr, ni fftiguàlité,1
les fuites de 1a decouverte font peu pénibles,
& celui qui apporterait en Europe un in-
fetfte ^qu’oit pût fubîlituér ait V ’er - 'i - fpiç ,
qui fut plus robufte, ou qui pût au moins
nous fervir ■ 'concurremment', rendrait un'
des fervices les plus importàns, afluréroic
1 abondance de la matière première employée
dans un grand nômbrè de "manufactures ,
1 exifteuce d un peuple nombreux d’ouvriers
& lopulénce de crtéi flotiffames 5e ïnduf-
frieufes.
, h'u 1®S Cruftacés font regardés, ainfi que
c ‘eft le fentimènt'ie plus général , comme
des infeôhes, -ils font la plupart utiles en
économie, comtne èomeftibles ; les Écre-
viffès, les Langouftes , les Homards occupent
les premiers rangs à cet égard; enfuite
les Crabes, les Ourfins 6e les.Étoiles; les
Ecreviffes , lés Langouftes , les Homards 8c
tous les Cruftacés a corps alongé , ont une
chair d un goût agréable; leurs oeufs fonc
aufîî eftimes : mais ces animaux font moins
un aliment qu’un met qui plaît. ’ 11 paroîc
meme que leur chair fournit peu de fubf-
tance nutritive. Les Indiens , qui peuploienc
1 île de Saint-Domingue 5e les îles Caraïbes
en general, vivoient en grande partie, lors
de fa découverte de c e s île s , de Cruftacés
qu’ils rapiaffoient fur les bords, de' fa met
ou des rivières ; c broient des hommes foibles,
incapables de fupporter 1a fatigue, &
dont la vie etoit bornée aune courte durée.
Les Crabes ont peu. de chair,,elle eft fèche
& filanJreufe ; leurs yifçères fe réduifent, pat
1a çuiffon, en une force de pulpe dont peu
de perfonnes font cas, & ces animaux font
un très-mauvais comeftible. Il y en a même
qui paffent^ pour être malfaifans; mais ce
fait ne paraît .pas bien certain.
Les.Ourfins & les Etoiles 11e contiennent
i i