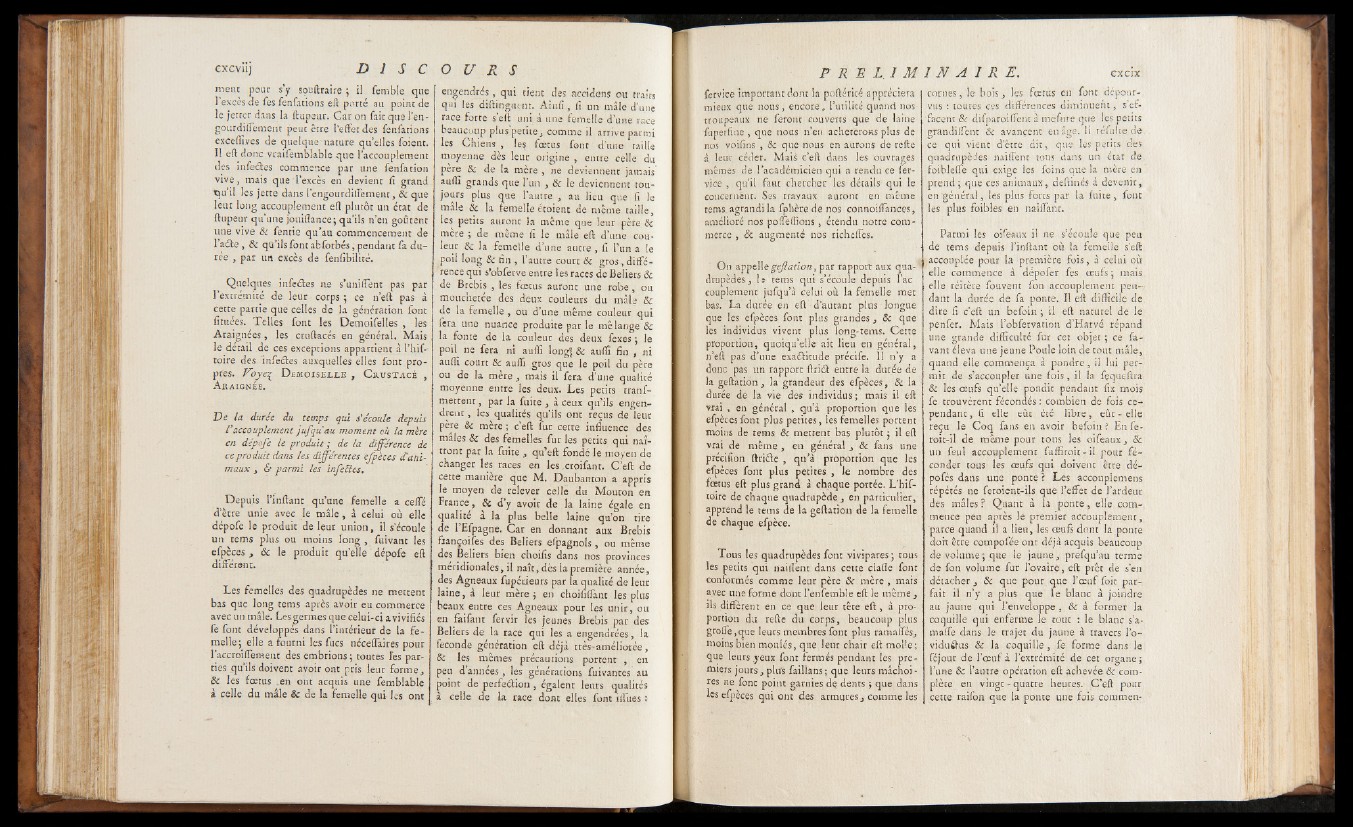
ment pour s’y souftraire ; il femble que
I excesde fes fenfations eft porté au point de
le jecter dans la ftupeur. Car on fait que l’en-
gourdiffement peut être l'effet des fenfations
exceffives de quelque nature qu’elles foient.
II eft donc yraifemblable que l’accouplement
des infeétes commence par une fenfâtion
vive, mais que l’excès en devient fi grand
qu’il les jette dans i’engourdilFement, & que
leur long accouplement efl plutôt un état de
ftupeur qu’une jouiflance; qu’ils n’en goûtent
une vive & fende qu’au commencement de
l ’aéte , & qu’ils font abforbés, pendant fa durée
, par un excès de fenlibilité.
Quelques infeéles ne s'unifient pas par
l ’extrémité de leur corps ; ce n’eft pas à
cette partie que celles de la génération font
fituées. Telles font les Demoifelles , les
Araignées, les cruftacés en général. Mais
le détail de ces exceptions appartient à l’hif-
toire des infeétes auxquelles elles font propres.
Voye-^ D e m o i s e l l e , C r u s t a c é ,
A r a i g n é e .
De la durée du temps qui s'écoule depuis
Vaccouplement jufquau moment où la mire
en dépofe le produit ; de la différence de
ce produit dans les différentes efpèces cl animaux
, & parmi les infecles.
Depuis l’inftant qu’une femelle a celle
d’être unie avec le mâle , à celui où elle
dépofe le produit de leur union, il s’écoule
un tems plus ou moins long , fuivant les
efpèces j Sc le produit qu’elle dépofe eft
différent.
Les femelles des quadrupèdes ne mettent
bas que long tems après avoir eu commerce
avec un mâle. Les germes que celui-ci a vivifiés
fe font développés dans l’intérieur de la femelle;
elle a fourni les fucs néceflàires pour
raccroiffement des embrions ; toutes fes patries
qu’ils doivent avoir ont pris leur forme,
Sc les foetus .en ont acquis une femblable
à celle du mâle & de la femelle qui les ont
engendrés, qui tient des accidens ou traits
qui les diftingutnt. Ainfi , fi un mâle d’une
race forte s’eft uni à une femelle d’une race
beaucuup plus petite, comme il arrive parmi
les Chiens , le$ foetus font d’une raille
moyenne dès leur origine , entre celle du
pere Sc de la mère , ne deviennent jamais
aufïi grands que l’un , Sc le deviennent Toujours
plus que l’autre , au lieu que fi le
male Sc la femelle croient de même taille,
les petits auront la même que leur père &
mere ; de meme fi le mâle eft d’une couleur
& la femelle d’une autre , fi Pun a le
poil long & fin , l’autre court & gros, différence
qui s’obfetve entre les races de Beliers &
de Brebis , les foetus auront une robe, ou
mouchetée des deux couleurs du mâle Sc
de la femelle, ou d’une même couleur qui
fera une nuance produite par le mélange &
la fonte de la couleur des deux fexes ; le
poil ne fera ni aulli longf & aufïi fin , ni
aufïi court & auffi gtos que le poil du père
ou de la mère , mais il fera d’une qualité
moyenne entre les deux. Les petits tranf-
mettent, par la fuite , à ceux qu’ils engendrent
, les qualités qu’ils ont reçus de leur
père Sc mère ; c’eft fur cette influence des
males & des femelles fur les petits qui naîtront
par la fuite j qu’c il fondé le moyeu de
changer les races en les .croifant. C ’eft de
cette maniéré que M. Daubanton a appris
le moyen de relever celle du Mouron en
France, Sc d’y avoir de la laine égale en
qualité a la plus belle laine qu’on tire
de l’Efpagne. Car en donnant aux Brebis
fiançoifes des Beliers efpagnols, ou même
des Beliers bien choifis dans nos provinces
méridionales, il naît, dès la première année,
des Agneaux fupérieurs par la qualité de leur
laine, à leur mère; en choififfant les plus
beaux entre ces Agneaux pour les unir, ou
en faifant fervir les jeunes Brebis par des
Beliers de la race qui les a engendrées, la
fécondé génération eft déjà très-améliorée,
& les mêmes précautions portent , en
peu d’années, les générations fuivantes au
point de perfeétion, égalent leurs qualités
à celle de la race dont elles font iflùes :
fervice important dont la poftérité appréciera
mieux que nous, encore, l’utilité quand nos
troupeaux ne feront couverts que de laine
fuperfine , que nous n’en achèterons plus de
nos voifins , & que nous en aurons de relie
à leur céder. Mais c’eft dans les ouvrages
mêmes de l ’académicien qui a rendu ce fer-
vice , qu’il faut chercher les détails qui le
concernent. Ses travaux auront en même
tems. agrandi la fpbère de nos çonnoiflances,
amélioré nos poflefiions , étendu notre commerce
, & augmenté nos richeffes.
On appelle gejlation, par rapport aux qua-*
drupèdes, 1î tems qui s’écoule depuis l’ac
couplement jufqu’à celui où la femelle met
bas. La durée en eft - d’autant plus longue
que les efpèces font plus grandes , Sc que
les individus vivent plus long-tems. Cette
proportion, quoiqu’elle ait lieu en général,
n’eft pas d’une exactitude précife. 11 n’y a
donc pas un rapport ftriét entre la durée de
la geftation, la grandeur des efpèces, & la
durée de la vie des individus ; mais il eft
vrai, en général , qu’à proportion que les
efpèces font plus petites, les femelles portent
moins de tems & mettent bas plutôt ; il eft
vrai de même, en général , Sc fans une
precifion ftriite , qu’à proportion que les
efpèces font plus petites , le nombre des
foetus eft plus grand à chaque portée. L’bif-
toire de chaque quadrupède , en particulier,
apprend le tems de la geftarion de la femelle
de chaque efpèce.
Tous les quadrupèdes font vivipares; tous
les petits qui liaiflent dans cette clafle font
conformés comme leur père Sc mère , mais
avec une forme dont l’enfemble eft le même ,
ils diffèrent en ce que leur tête eft, à proportion
du relie du corps, beaucoup plus
groffe,que leurs membres font plus ramaffés,
moins bien moulés, que leur chair eft molle ;
que leurs .yeux font fermés pendant les premiers
jours, plu's faillans; que leurs mâchoires
ne font point garnies dç dents ; que dans
les efpèces qui ont des armures, comme les
cornes, le bois, les foetus en font dépourvus
: toutes ces différences diminuent, s’effacent
& difparoiffent à meftire que les petits
grandilfent & avancent en âge. H réfultede.
ce qui vient detre dit, que les petits des
quadrupèdes naiflent tous dans, un état de
foibleffe qui exige les foins que la mère en
prend ; que ces animaux, deftinés à devenir,
en général, les plus forts par la fuite , font
les plus foibles en naiffanr.
Parmi les oifeaux il ne s’écoule que peu
de tems depuis l’inllant où la femeile s'eft
accouplée pour la première fois, à celui où
elle commence â dépofer fes oeufs ; mais
elle réitère fouvent fon accouplement pendant
la durée de fa ponte. Il eft difficile de
dire fi c’eft un befoin ; il eft naturel de le
penfer. Mais l’obfervatiou d’Harvé répand
une grande difficulté fur cet objet; ce fa-
vant éleva une jeune Poule loin de tout, mâle,
quand elle commença à pondre, il lui permit
de s’accoupler une fois, il la fequeftra
& les oeufs qu’elle pondit pendant fix mois
fe trouvèrent fécondés : combien de fois cependant,
fi elle eut été libre, eût - elle
reçu le Coq fans en avoir befoin ? En fe-
roit-il de même pour tous les oifeaux, &
un feul accouplement fuffiroit - il pour féconder
tous les oeufs qui doivent être dé-
pofés dans une ponté ? Les accouplemens
répétés ne feroieut-i|s que l’effet de l’ardeur
des mâles ? Quant à la ponte, elle commence
peu après le premier accouplement,
parce quand il a lieu, les oeufs dont la ponte
doit être compofée ont déjà acquis beaucoup
de volume; que le jaune, prefqu’au terme
de fon volume fur l’ovaire, eft prêc de s’en
détacher , & que pour que l’oeuf foit parfait
il n’y a plus que le blanc à joindre
au jaune qui l’enveloppe, & à former la
coquille qui enferme le tout : le blanc s’a-
mafle dans le trajet du jaune à travers l’o-
vidtiélus & la coquille, fe forme dans le
féjour de l’oeuf à l’extrémité de cet organe ;
l’une & l’autre opération eft achevée & complète
en vingt-quatre heures. C ’eft pour
cette raifon que la ponte une fois commen