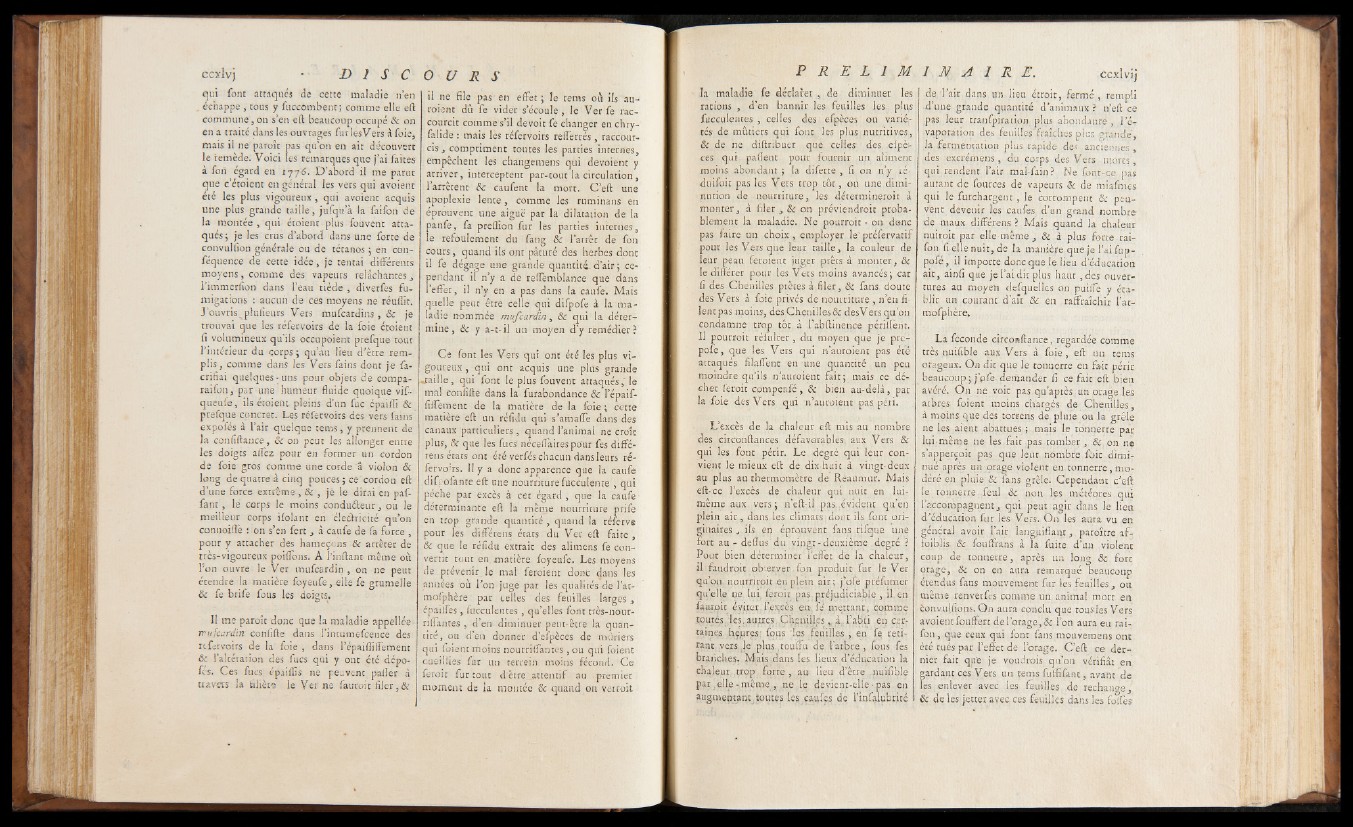
qui font attaques de cette maladie n’en
. échappe , tous y fuccombent; comme elle eft
commune, on s’en eft beaucoup occupé & on
en a traité dans les ouvrages furies Vers à foie,
mais il ne paroît pas qu’on en ait découvert
le remède. Voici les remarques que j’ai faites
à fon égard en 1776. D ’abord il me parut
que c’étoient en général les vers qui avoient
été les plus vigoureux, qui avoient acquis
une plus grande taille, jufqu’à la faifon de
la montée, qui étoient plus fouvent attaqués;
je les crus d’abord dans une forte de
convulfion générale ou de tétanos ; en con-
féquence de cette idée, je tentai différents
moyens, comme des vapeurs relâchantes,
l’immerfion dans l’eau tiède , diverfes fumigations
: aucun de ces moyens ne réuflît.
J’ouvris^plulieurs Vers mufcardins , & je
trouvai que les réfervoirs de la foie étoient
fi volumineux qu’ils occupoient ptefque tout
l’intérieur du corps ; qu’au lieu d’être remplis,
comme dans les Vers fai ns dont je fa-
crifiai quelques-uns pour objets de compa-
raifon, par une humeur fluide quoique vif-
queufe, ils étoient pleins d’un fuc épaiflî &
prefque concret. Les réfervoirs des vers fains
expofés à l’air quelque rems, y prennent de
la confiftance, & on peut les allonger entre
les doigts allez pour en former un cordon
de foie gros comme une corde â violon &
long de quatre à cinq pouces; ce cordon eft
d’une force extrême, & , jè le dirai en paf-
fant, le corps le moins eonduéteur , ou le
meilleur corps ilolant en électricité qu’on
connoiffè : on s’en fert , à caufe de fa force ,
pour y attacher des hameçons & arrêter de
très-vigoureux poiffons. A l’inftant même où
l’on ouvre le Ver mufcardin , on ne peut
étendre la. matière foyeufe ,-elle fe gtumelle
& fe brife fous les doigts.
II me paroît donc que la maladie appellée-
mufcardin confifte dans l’inrumefceuce des
rtfervous de la foie , dans l’épaiffiffement
& l’altération des fucs qui y ont été déposés.
Ces fucs. épaiffis ne peuvent palier à
travers la filière le Ver ne fauroit filer,&
il ne file pas en effet; le tems où ils"au-
roient dû fe vider s’écoule, le Ver fe raccourcit
comme s’il devoir fe changer en chry-
falide : mais lès réfervoirs refferrés , raccourcis
, compriment toutes les parties internes,
empêchent les changemens qui dévoient y
arriver, interceptent par-tout la circulation,
l’arrêtent & caufent la mort. C ’eft une
apoplexie lente, comme les ruminans en
éprouvent une aiguë par la dilatation de la
panfe, fa prellion fur les parties internes,
; le refoulement du fang & l’arrêt de fon
cours, quand ils ont pâturé des herbes dont
il fe dégage une grande quantité- d’air ; cependant
il n’y a de relfemblance que dans
l’effet, il n’-y en a pas dans la caufe. Mais
quelle peut être celle qui difpofe à la maladie
nommée mufcardin, & qui la détermine,
& y a-t-il un moyen d’y remédier?
Ce font les Vers qui ont été les plus vigoureux
, qui ont acquis une plus grande
.taille, qui font le plus fouvent attaqués,' le
mal confifte dans la furabondance 6c l’épaif-
fiflement de la matière de la foie } cette
matière eft un réfidu qui sJamaffe dans des
canaux particuliers , quand l ’animal ne croît
plus, 8c que les fuc$ nécefiaires pour fes diflFé-
rens états ont été verfés chacun dans leurs ré-
fervo?rs. II y a donc apparence que la caufe
difpofante eft une nourriture fucculente , qui
pèche par excès à cet égard , que la caufe
déterminante eft la même nourriture prife
en trop grande quantité , quand la réferve
pour les différens états du Ver eft faite ,
& que le réfidu extrait des alimens fe convertit
tout en matière foyeufe. Les moyens
de prévenir, le mal feroient donc dans les
années où Ton juge par les qualités de l’at-
mofphère par celles des feuilles larges y
épailfes, fucculentes , qu’elles font très-nour-
rifîantes , d’en diminuer peut-être la quantité,
ou d’èn donner d’efpèces de mûriers
qui foient moins nourriftances , ou qui foient
cueillies fur un rerrein moins fécond. Ce
feroic fur tout d être attentif au premier
moment de la montée 6c quand on verroit
la maladie fe déclarer , de diminuer les
rations , d’en bannir les feuilles les pli^s
fucculentes, celles des efpèces ou variétés
de miniers qui font les plus nutritive?,
8c de ne diftribuer que celles des .efpèces
qui paftent pour fournir un aliment
moins abondant ; la difetté , fi on n’y ré-
duifoit pas les Vers trop tô t, ou une diminution
de nourriture, les dpcermineroïc à
monter a filer y 8c on préviendroit probablement
la maladie. Ne pourroit - on donc
pas faire un choix , employer le' préfervacif
pour les Vers que leur caille3 la couleur de
leur peau feroient juger prêts à monter, 6c
le différer pour les Vers moins avancés ; car
fi des Chenilles prêtes à filer, 6c fans doute
des Vers à foie privés de nourriture , n’en fi-
lentpas moins, des Chenil les& desVêrsqu’on .
condamne trop tôt à rabftinençe pétillent.
11 pourroit réfulter , du moyen que je prc-
pofe, que les Vers qui n’auroient pas été
attaqués filaffent en une quantité un peu
moindre qu’ils n’auroient fait} mais ce déchet
feroic compenfé, 6c bien au-delà, par
la foie desVers qui »’auraient pas péri.
L’excès de la chaleur eft mis au nombre
des circonftances défavorables, aux Vers 8c
qui les font périr. Le degré qui leur convient
le mieux eft de dix huit à vingt-deux
au plus au thermomètre de Rëaumur. Mais
eft-ce l’excès de chaleur qui nuit en lui-
même aux, vers} n’eft-il pas..évident qu’en
plein a ir, dans les climats dont ils font originaires
j .ils en éprouvent fans rifque une
fort- au - deffus du vingt:-deuxième degré ?
Pour bien déterminer l’effet de la chaleur,
il faiidroic obierver fon produit fur le Ver
qu’on, nourriroic .en plein air; j’ofe préfumer
quelle ne lui, feroic. pas.préjudiciable , il en
faiirpic éviter, l’^cès en\ fe mettant, comme
ïouîèsjles.autres,.Cl^nillps fabri en cen
tain^s hçjiires: fqus 'iqs feuilles , en fe retirant,
jVexs, Je plus touffu de i ’arbre , fous fes
branches. Mais dans les lieux d’éducation, la
chaleur.,çrop forte , au lieu d’être .nuifible
p^t .elle-même , ne le devient-elle pas en
augme^antjtoutes les canfç^ de rinfalubrité
de i ; air dans un lieu étroit, fermé , rempli
d’une: grande quantité d’animaux ? n’eft ce
pas leur tratifpiration plus abondante , l ’é—
■ vaporation des feuilies'fraîches plus grande,
la fermentation plus rapide des anciennes ,
des excrémens , du corps des Vers morts,
qui rendent l’air malfain? Ne font-ce pas
autant de fources de vapeurs & de miafmes
qui le furchargent , le corrompenc & peuvent
devenir les caufes d’un grand nombre
de maux différens? Mais quand la chaleur
nuirait par elle même , & à plus forte rai-
fon fi elle nuit, de la manière que je l’aifup-
pofé, il importe donc que le lieu d’éducation
ait, ainfi que je l’ai dit plus haut, des ouvertures
au moyen desquelles on puifle y établir
un courant d’aîr & en raffraîchir i’at-
mofpiière.
La fécondé circonftance, regardée comme
très nuifible aux Vers à foie, eft un tems
orageux. On dit que le tonnerre en fait périr
beaucoup ; j ’pfe-demander fi ce fait eft bien
avéré. On ne voit pas qu’aptès; un orage les
arbres foient moins chargés de Chenilles,
à moins que des tortens de pluie ou la grêle
ne les aient abattues,; .mais le tonnerre par
lui -même ne les.fait pas tomber, &,on ne
s’apperçoit pas que leur nombre foit diminué
après un orage violent en tonnerre,modéré
en pluie & fans grêle. Cependant c’eft
le tonnerre, feul & non les météores qui
raccompagnent, qui peut agir dans le lieu
d’éducàtion fur les. Vers. On les aura vu en
général avoir l’air ianguiflant, paraître af-
foiblis & fouffrans à la fuite d’uu violent
coup de tonnerre, après un long & fort
orage, & on en aura remarqué beaucoup
étendus; fans mouvement fur les feuilles, ou
même renverfes comme un animal mort en
convulfions. On aura conclu que tous les Vers
avoient fouftert de l’orage , & l’on aura eu rai-
fon, que ceux qui fonr laus mouvemens ont
été rués par l’effet de l’orage. C ’eft ce dernier
fait qii’e je voudrais qu’on vérifiât en
gardant ces Vers un tems fuffifanc, avant de
lps, enlever avec les feuilles de rechange,
de les jet ter avec ces feuilles dans les foliés