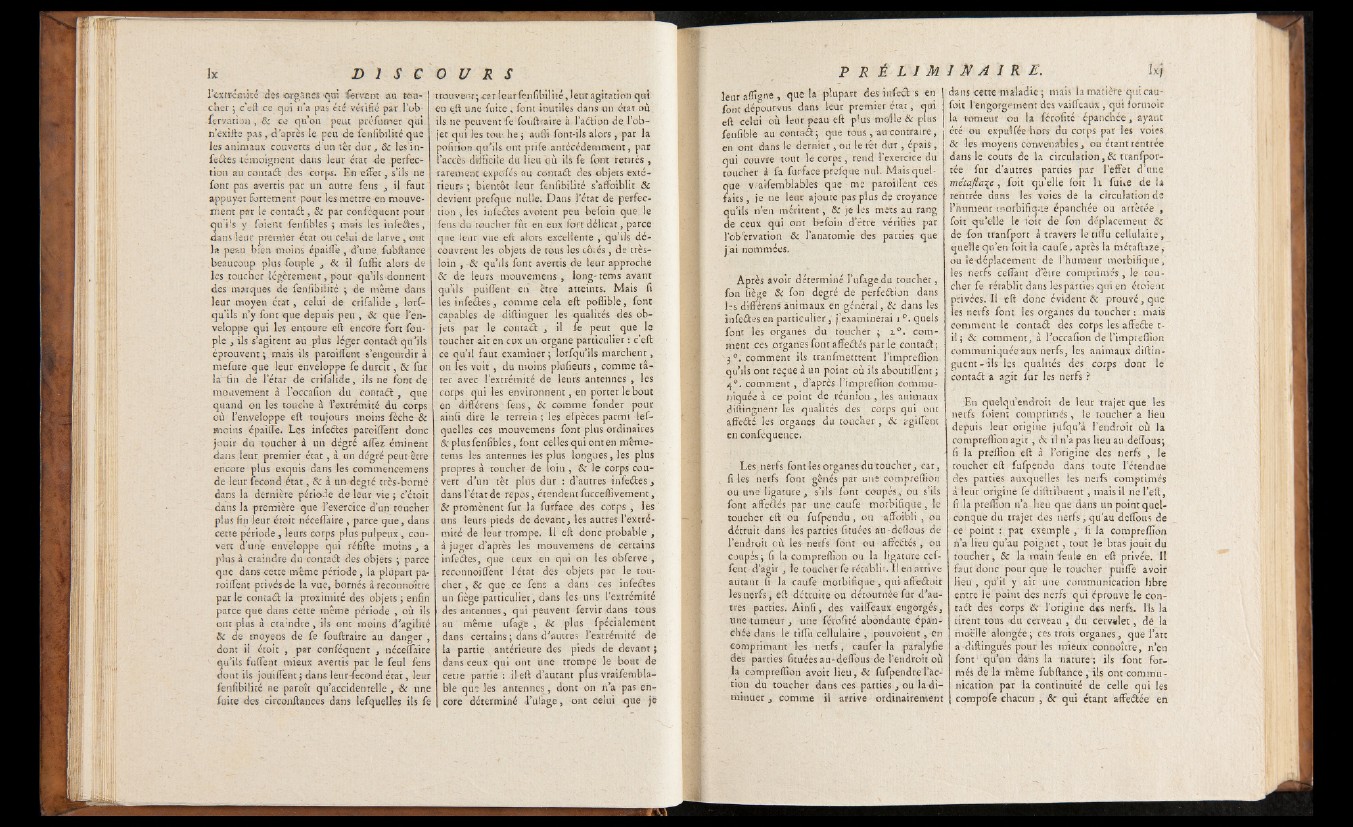
r-exci'etracé des organes 'qui Servent su toucher
; c’efl ce qui n’a pas été vérifié par Pub-
le rv atio u , & ce qu’on peut préfomer qui.
n’exifte pas , d ’après le peu de fenfibilité que
les animaux couverts d ’un têt d u r , & lésin -
feéles témoignent dans leur état de -perfection
au coutaél des corps. En effet , s’ils ne
font pas avertis par un autre feus j il faut
appuyer fortement pour les mettre en mouvement
par le co n ta ct, & par confcquem pour
qu'ils y foienc fenfibles ; .mais les infeétes,
dans leur premier état ou celui de larve , ont
la peau bien moins ép aiffe, d ’une, fubftance
beaucoup plus fouple , & il fuffic alors de
les toucher légèrement, pour qu’ils donnent'
des marques de fenfibiliré ; d e même dans
leur moyen é ta t, celui d e crifalide , lotf-
qu’iis n’y font 'que depuis peu , & que l’enveloppe
qui les entoure eft encore fort fou ple
, ils s’agitent au plus léger contaét qu’ils
éprouvent ; mais ils paroilfent s’engourdir à
mefure que leur enveloppe fe d u rc ir, & fur
la fin de l’érar de crifalid e, ils ne font de
mouvement à l’occafion du contaét | que
quand on les touche à l’extrémité du corps
où l’enveloppe eft toujours moins fèche &
moins épaiffe. Les in fe êtes paroifferrr donc
jouir du toucher à un degré affez éminent
dans leur premier é ta t, à un degré peut-être
encore plus exquis dans les commencemens
de leur fécond é ta t, & à un d egré très-borné
dans la dernière période de leur vie ; c’étoit
dans la première que l’exercice d’un toucher
plus fin leur éroic néceffaire , parce q u e , dans
cette périod e, leurs corps plus pulpeux, couvert
d’une enveloppe qui réfifte m o in s, a
plus à craindre du coniaét des objets ; parce
que dans cette même période , la plupart pa-
roiflènt privés de la vue, bornés âreconnoîrre
par le contaét la proximité des objets ; enfin
parce que dans cette même période , où ils
ont plus à crain d re, ils ont moins d’agilité
fie de moyens de fe fouftraite au danger ,
dont il croit , par conféquent , néceffaire
qu’ils fuffent mieux avertis par le feul fens
dont ils jouiffent ; dans leur-fecond é ta t, leur
fenfibiliré ne paroît qu’accidentelle, Si un,e
fuite des circonftances dans lefquelles ils fe
trouvent ; car leur fenfibiliré, leur agitation qui
en eft une fuite , font inutiles dans un état où
ils ne peuvent fe fouftraire à l’aétion de, l’objet
qui les totuhe ; auffi font-ils alors , par la
pofition qu ’ils ont prife antécédemment, par
l’accès difficile du beu où ils fe font retirés ,
rarement ex-pofés au contaét des objets extérieur
» ; bientôt leur fenfibiliré s’affaiblit &
devient prefque nulle. Dans l’état de perfection
, les infectes avoient peu befoin que le
fens du toucher fût en eux fort d élicat, parce
que leur vue eft alors excellente , qu’ils découvrent
les objets de tous les c ô ié s , de très-
loin , & qu’ ils font avertis de leur approche
& de leurs mouvemens , long-tems avant
qu’ils puiffent en être atteints. Mais fi
les infeétes, comme cela eft poffible, font
caDables de diftinguer les qualités des objets
par le contaét , il fe peut que le
toucher a it en eux un organe particulier : c’eft
ce qu’il faut examiner ; lorfqu’ils m arch ent,
on les voit , du moins plufieurs, comme tâter
avec l’extrémité de leurs antennes , les
corps qui les environnent, en porter le bout
en différens fens, & comme fonder pour
ainfi dire le terrein ; les efpèces parmi lef—
quelles ces mouvemens font plus ordinaires
& plus fenfibles, font celles qui ont en même-
tems les antennes les plus longues , les plus
propres à toucher de loin , & le corps couvert
d ’ un têt plus dur : d’autres infeétes ,
dans l’état de repos, étendent fucceffivement,
& promènent fur la furfaee des corps , les '
uns leurs pieds de d evant, les autres l’extrémité
de leur trompe. 11 eft donc probable ,
à juger d ’après les mouvemens de certains
infeétes, que ceux en qui on les obferve ,
reconnoiffent létat des objets par le toucher
, & que ,ce fens a dans ces infeétes
un fiège particulier, dans les uns l’extrémite
des antennes, qui peuvent fervir ,dans tou s
au même ufage , & plus fpécialement
dans certains ; dans d’autres l’extrémité de
la partie antérieure des pieds de devant ;
dans ceux qui ont une trompe le bout de
cette partie : il-eft d’autant plus vraifembla-
ble que les antennes , dont on n’a pas encore
déterminé J’u la g e, ont celui que je
leur alîîgne , que la plupart des i-iïfeét 's en
font dépourvus dans leur premier éca t, qui
eft celui où leur peau eft plus molle & plus
fenfible au contaét; que tous ,-atrcomraire,
en ont dans le d ern ier, ou le têt dm , ép ais,'
qui couvre tout le corps, rend l'exercice du
toucher à fa furfaee prefque nul. Mais qu elque
v.aifemblables que me paroilfent ces
faits , je ne leur ajoute pas plus de croyance
qu’ils n’en m éritent, & je les mets au rang
de ceux qui ont befoin d’être vérifiés par
]’obrervation Si l’anatomie des parties que
j'ai nommées.
Après avoir déterminé 1’ufagedu tou ch er,
fon fiège Si fon degré de perfeétion dans
les différeiùfànimaux en général, fit dans les
infeétes en particulier ,, (’examinerai 1 °. quels
font lés organes du toucher ; i ° . com ment
ces .organes font affeétés par le contaét ;
j ° . comment ils tranfmetttent l’impreffion
qu’ils ont reçue à un point où ils aboutiffent ;
4 °. comment , d’après l’impreffion communiquée
à ce point de réunion , des animaux
diftinguent les qualités des corps qui ont
affeété les organes du to u ch er, Si sgiffent
en conféquence.
Les.nerfs font les organes d u ‘tou ch er, car,
fi les nerfs font gênés par une compreffion
ou une ligature , s’ils font coupés , ou s’ils
font affeétés par une caufe morbifiqu e, le
toucher eft ou fu fp end u , ou affoibli , ou
détruit dans les parties (nuées au-de!ïous de
l’endroit où les nerfs font ou affeétés, ou
coupés; fi la compreffion ou la ligature cef-
feut d’a g ir , le toucher fe rétabli;. Il en arrive
autant fi la caufe morbifique , qui affeétoit
les n erfs, eft détruite ou détournée fur d ’autres
parties. Ainfi , des vaiffeaux engorgés,
une tumeur , une férofité abondante épanchée
dans le tiffu cellulaire , po u vo ien t, en
comprimant les n e tfs , eau fer la paraly-fie
des parties fituées au-deffous de l’endroit où
la compreffion avoit lie u , Si fufpendre l’action
du -toucher dans ces' parties , ou la d iminuer
, comme il arrive ordinairement
dans cette maladie ; mais la matière qui cau-
foit l’engorgement des vaiffeaux , qui formoit
la -tn-meur ou la férofité épanchée , ayant
été ou expulfée hors du corps par les voies
& -les moyens convenables, ou étant rentrée
dans le cours de la circu la tion ,& tranfpor-
tée fur d ’autres parties par l ’effet d ’une.
mécaftaye , foit q u e lle foit 1 1 fuite de la
rentrée dans les voies de la circulation de
l’ humeur morbifique épanchée ou arrêtée ,
foit qu ’elle le loir de fon déplacement &
de fon rranfporr â travers le tiffu cellu laire,
quelle qu’en foit la ca u fe, après la méraftaze,
oule-déplacement de l’humeur morbifique,
les nerfs ceffant d’être comprimés , le tou cher
fe rétablit dans les parties qui en étoient
privées. -Il eft donc évident & p ro u vé, que
les nerfs font les organes du toucher : mais
comment le contaét des corps les affeéte t- '
il; Si comment, à i’occafion de l’itnpreffion
communiquée aux nerfs, les animaux diftin-
g u e û t-ils les qualités des corps dont le
contaét a agit fu t les nerfs ?
-En quelqu’endroit de leur trajet que les
nerfs foient comprimés, le toucher a lieu
depuis leur origine jufqu’à l’endroit où la
compreffion a g it , iSc il n’a pas lieu'au .deffous;
fi la preflion eft à l'origine des nerfs , le
roucher eft fufpendu dans toute l’étendue
des parties auxquelles les netfs comprimés
à leur origine fe d iftiib u en r, mais il n e l’eft,
fi la preffion n’a l ieu que dans un point quelconque
du trajet des n erfs, qu’au deffous de
ce point : pat exemple , fi la compreffion
n’a lieu qu’au poignet , tout le bras jouit du
tou ch er, & la main feu le en eft privée. 11
faut donc pour que le toucher puiffe avoir
lieu , qu’il y ait une communication libre
entre lé point des nerfs qui éprouve le contaét
des corps & l’origine des nerfs, lis la
rirent tons d u cerveau , du c e r v e le t, dé la
moelle alongée; ces trois organes, que l’art
a-diftinguês pour les mieux con.noître, n’en
fo n t1 qu’un dàhs la nature ; .ils font formés
de la même fubftance , ils ont com m u nication
par la continuité de celLe qui les
compofe chacun , & qui étant affeétée en