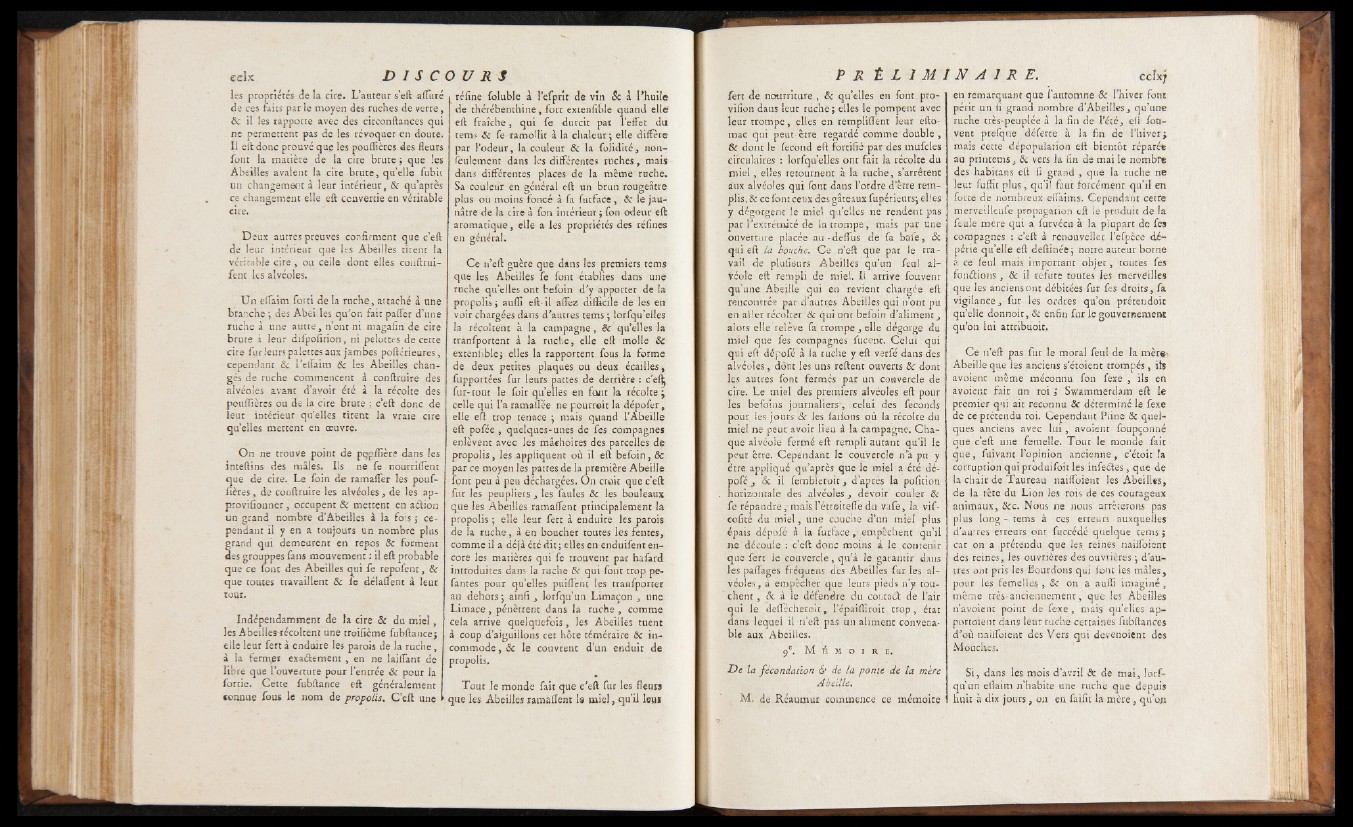
eelx D I S C O U R S
les propriétés de la cire. L'auteur s’eft alluré
de ces faits par le moyen des ruches de verre,
&c il les rapporte avec des circonftances qui
ne permettent pas de les révoquer en doute.
Il eft donc prouvé que les poullîères des fleurs
font la matière de la cire brute ; que les
Abeilles avalent la cire brute, quelle fubit
un changement à leur intérieur, & qu’après
ce changement elle eft convertie en véritable
cire.
Deux autres preuves confirment que c’eft
de leur intérieur que les Abeilles tirent la
véritable cire , ou celle dont elles couftrui-
fènt les alvéoles.
Un effaim forri de la ruche, attaché à une
branche ; des Abei les qu'on fait palier d'une
ruche à une autre, n’ont ni magafin de cire
brute à leur difpofirion, ni pelotres de cette
cire fur leurs palettes aux jambes poftérieures,
cependant & l'eflaim & les Abeille^ changés
de ruche commencent à confttuire des
alvéoles avant d’avoir été à la récolte des
ponlïières ou de la cire brute ; c’eft donc de
leur intérieur qu’elles rirent la vraie cire
qu’elles mettent en oeuvre.
On ne trouve point de pqpflîère dans les
inteftins des mâles. Ils ne fe nourriflënt
que de cire. Le foin de ramafler les pouf-
lières, de conftruire les alvéoles , de les ap-
provifiouner, occupent & mettent en aâion
un grand nombre d’Abeilles à la fois ; cependant
il y en a toujours un nombre plus
grand qui demeurent en repos & forment
des grouppes fans mouvement : il eft probable
que ce font des Abeilles qui fe repofent, &
que toutes travaillent & fe délaftent à leur
tour.
Indépendamment de la cire & du miel
les Abeilles-récoltent une troifième fubftance;
elle leur fert à enduire les parois de la ruche,
â la fermer exaélement, en ne lailfant de
libre que l’ouverture pour l’entrée & pour la
fortie. Cette fubftance eft généralement
«onnue fous le nom de propoüs. C ’elt une
réfine foluble à l’efprit de vin & à l’huile
de thérébenthine, fort extenfible quand elle
eft fraîche, qui fe durcit pat l’effet du
rems & fe ramoHit à la chaleur ; elle diffère
par l’odeur, la couleur & la folidité, non-
leulement dans les différentes ruches, mais
dans différentes places de la même rnche.
Sa couleur en général eft un brun rougeâtre
plus ou moins foncé à fa furface, & le jaunâtre
de la cite à fon intérieur; fbn odeur eft
aromatique, elle a les propriétés des réfines
en général.
Ce n’eft guère que dans les premiers tems
que les Abeilles fe font établies dans une
ruche quelles ont befoin d’y apporter de la
propolis; aufli eft-il affez difficile de les en
voir chargées dans d’autres tems ; lorfqu’elles
la récoltent à la campagne, Sc quelles la
tranfportent à la ruche, elle eft molle &
extenfible; elles la rapportent fous la forme
de deux petites plaques ou deux écailles,
fupportées fur leurs pattes de derrière : c’ef|
fur-tout le fuir quelles en font la récolte;
celle qui l’a ramaffée ne pourrait la dépofer,
elle eft trop tenace ; mais quand l’Abeille
eft pofée , quelques-unes de fes compagnes
enlèvent avec les mâchoires des parcelles de
propolis, les appliquent où il eft befoin, &
par ce moyen les partes de la première Abeille
font peu à peu déchargées. On croit que c’eft
fur les peupliers , les faules & les bouleaux
que les Abeilles ramaffent principalement la
propolis ; elle leur fert à enduire les parois
de la ruche, à en boucher toutes les fentes,
comme il a déjà été dit ; elles en enduifent encore
les matières qui fe trouvent par hafard
introduites dans la ruche & qui font trop pe-
fantes pour qu’elles puiffent les tranfporter
au dehors ; ainfi , lorfqu’un Limaçon , une
Limace, pénètrent dans la ruche , comme
cela arrive quelquefois, les Abeilles tuent
à coup d’aiguillons cer hôte téméraire & incommode,
& le couvrent d’un enduit de
propolis.
Tout le monde fait que c’eft fur les fleurs
que les Abeilles ramaffent le miel, qu’il le»i
P R t L l M Î N A I R E .
fert de nourriture , ôc qu’elles en font pro-
vifion dans leur ruche; elles le pompent avec
leur trompe, elles en remploient leur efto-
mac qui peut-être regardé comme double,
& dont le fécond eft fortifié par des mufcles
circulaires : lorfquelles ont fait la récolte du
miel, elles retournent à la ruche, s’arrêtent
aux alvéoles qui font dans l’ordre d’être remplis,
& ce font ceux des gateaux fupérieurs; elles
y dégorgent le miel qu’elles ne rendent pas
par l'extrémité de la trompe, mais par une
ouverture placée au-deftus de fa bafe, &
qui eft la bouche. Ce n’eft que par le travail
de plufieurs Abeilles qu’un feui alvéole
eft rempli de miel. Il arrive fouvenr
qu’une Abeille qui en revient chargée eft
rencontrée par d’autres Abeilles qui n’ont pu
en aller récolter 6c qui ont befoin d’aliment
alors elle relève fa trompe 3 elle dégorge du
miel que fes compagnes fucent. Celui qui
qui eft dépofé à la ruche y eft verfé dans des
alvéoles, dont les uns reftent ouverts ôc dont
les antres font fermés par un couvercle de
cire. Le miel des premiers alvéoles eft pour
les befoins journaliers', celui des féconds
pour les jours ôc les faifons où la récolte du
miel ne peut avoir lieu à la campagne. Chaque
alvéole fermé eft rempli autant qu’il le
peut être. Cependant, le couvercle n’a pu y
être appliqué qu’après que le miel a été dépofé
^ <5c il fembleroit , d’après la pofition
horizontale des -alvéoles , devoir couler 6c
fe répandre, mais Pétroitefle du vafe, la vif-
cofité du miel, une couche d’un miel plus
épais dépofé à la furface, empêchent qu’il
ne découle : c’eft donc moins à le contenir
que fert le couvercle, qu’à le garantir dans
les paffages fréquens des Abeilles fur les alvéoles,
à empêcher que leurs pieds n’y touchent
, St à le défendre du cootad de L’air
qui le deftecheroit, l’épaidîroic trop, état
dans lequel il n’eft pas un aliment convenable
aux Abeilles.
9e. M é m o i r e ,
De la fécondation & de la ponte de la mère
Abeille.
M. de Rcaumur commence ce mémoire
cclxj
en remarquant que l’automne ôc Thiver font
périr un fi grand nombre d’Abeilles, qu’une
ruche très-peuplée à la fin de Tété., efl fou-
vent prefque déferre à la fin de l’hiver $
mais cette dépopulation eft bientôt réparée
au printems, & vers la fin de mai le nombre
des habitans eft fi grand , que la ruche ne
leur fuffit plus, qu’il faut forcément qu’il en
forte de nombreux effaims. Cependant cette
merveilleufe propagation eft le produit de la
feule mère qui a furvécu à la plupart de fes
compagnes : c’eft à renouveller l’efpèce dé-
périe qu’elle eft deftinée; notre auteur borne
à ce feul mais important objet, toutes fes
fondions, ôc il réfute toutes les merveilles
que les anciens ont débitées fur fes droits, fa
vigilance j fur les ordres qu’on prétendoic
qu’elle donnoic, ôc enfin fur le gouvernement
qu’on lui attribuoic.
Ce n’eft pas fur le moral feul de la mèr^
Abeille que les anciens s’étoient trompés, it$
avoient même méconnu fon fexe , ils en
a voient fait un roi ; Swammerdam eft le
premier qui ait reconnu & déterminé le. fexe
de ce prétendu roi. Cependant Pline Ôc quelques
anciens avec lu i, avoient foupçonné
que c’eft une femelle. Tout le monde fait
que, fuivanc l’opinion ancienne, c’étoit la
corruption qui produifoit les infedes, que de
la chair de Taureau naiftoient les Abeilles,
de la tête du Lion les rois de ces courageux
animaux, &c. Nous ne nous arrêterons pas
plus long - tems à ces erreurs auxquelles
d’autres erreurs onr fuccédé quelque rems ;
car on a prétendu que les reines naiftoient
des reines, les ouvrières des ouvrières j d’au-
très onr pris les Bourdons qui font les mâles,
pour les femelles , ôc on a aufli imaginé,
même très-anciennement, que les Abeilles
n’avoient point de fexe , mais qu’elles apportèrent
dans leur ruche certaines fubftances
d’où naiftoient des Vers qui devenoient des
Mouches.
Si, dans les mois d’avril & de mai, lorf-
qu’un eftaim n’habite une ruche que depuis
huit à dix jours, on en faiftt la mère, qu’on