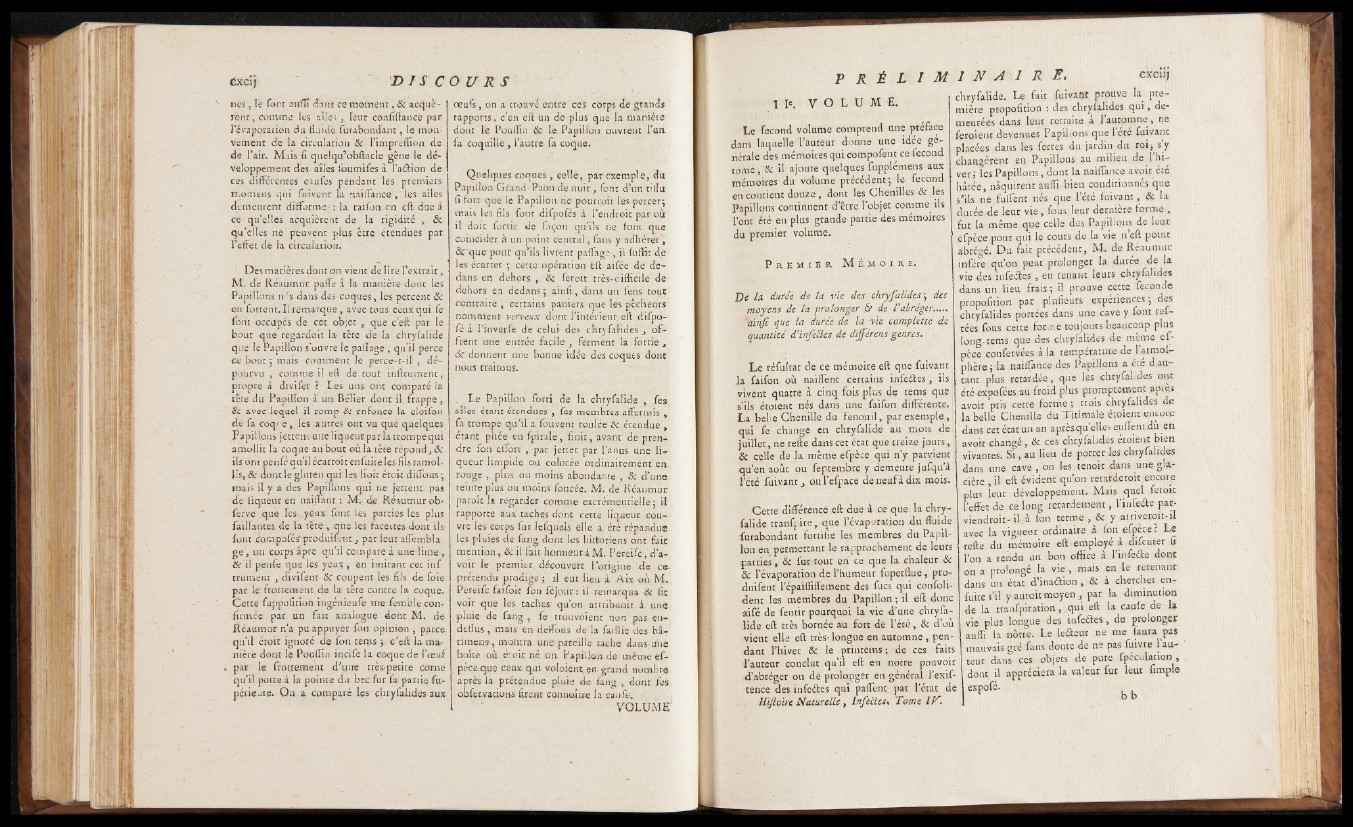
Cxc\) D I S C O U R S
nés , le font Sn&u dans ce moment, & acquéreur',
comme les aîle^ x leur confiftance par
l’évaporation du fluido fur-abondant, le mouvement
de la circulation & l’impreflion de
de l’air. Mais fi quelqu’obftacle gêne le développement
des âîles foumifes à l’aftion de
ces différentes eaufes pendant les premiers
mom'ens qui fui veut la nailfance , ' les ailes
demeurent difforme': la raifon.cn eft due à
ce qu'dles acquièrent de la rigidité , &
qu’elles ne peuvent plus être étendues par
l’effet dé la circulation.
Des matières dont on vient de lire l'extrait,
M. de Réaumur pafte a la manière dont les
Papillons 3fy dans des coques, les percent &
e-n forcent. Il remarque , avec tous ceux qui fe
font occupés de cet objet , que c’eft par le
bouc que regardoit la tête de la chryfalide
que le Papillon s'ouvre le, paflage , qu’il perce
ce bout ; mais comment le peree-t-il , dépourvu
, comme il eft de tout infiniment ,
propre à divifeT î Les uns ont comparé la
tête du Papillon a un Bélier dont il frappe ,
& avec lequel il romp & enfonce la cloifon
de fa coq<e, les autres ont vu qué quelques
JPapillons jettent une liqueur par la trompe qui '
amollit la coque au bout où la tête répond , &
ils ont penfé qu’il écarroit en fuite les filsramoL-
lis, & dont le gluten qui les Hoir étok diftous ;
mais il y a-des Papillons qui ne jettent pas
de liqueur en naiffant : M. de Réaumur ob-
ferve .que les yeux font les parties les plus
faillances de la tête , que les facettes dont ils
font jCompofe^produikrnt par leur affembla
ge , un corps âpre q.u’il compare à une lime r
& il penfe que les yeux, en imitant.cet inf
trumenx , divifent ôC coupent les fils de foie
par le frottement de la tête contre la coque.
Cette fuppofuion ingénieufe me femblçcon-
firméç par un fait analogue donc M. de
Réaumur n’a pu appuyer fon opinion , parce
qu’il éroit ignoré de fon rems * e'eft la manière
donc lç Poufîin incife la coque de l’oeuf
pat le frottement d’uiTe très-petite corne
qu’il porte à la pointe du bec fur fa partie fn-
pçrieare. On a Comparé les çhryfalides aux
oeufs,. on a crouvé entre ces corps de grands
rapports, c’en eft: un de plus que la manière
dont le Pouffin & le Papillon ouvrent l’un
fa coquille > l’autre fa coque.
Quelques coques , celle, par exemple, du
Papillon Grand- Paon de nuit , font d’un tillu
fi-fort que le Papillon ne pourront les percer;
mais les fils font difpofés à l’endroit par où
il doit forcir de façon qu’ils ne. font, que
coïncider à un point central, fans y adhérer
&"que pouf qu’ijs livrent paftage , il fufîit de
les écarter ; cette opération êft aifce de dedans
en dehors , & feroit très-difficile de
dehors en dedans ; ainfi, dans un feus tout
contraire , certains paniers que les pêcheurs
nomment verveux dont l’intérieur eft difpo-
fé à i’inverfe de celui des çhryfalides > offrent
une encrée facile , ferment la forrie «
Sc donnent une bonne idée des coques dont
nous traitons.
. Le Papillon forti de la chryfalide , fes
ailes étant étendues , fes membres affermis v
fa trompe qu'il a fôuvenr roulée & étendue ,
étant pliée en fpirale , finit, avant de prendre
ion elfort , par jetter par l’anus une li-r
queur limpide ou -colorée ordinairement en
rouge , plus ou moins abondante , & d’une
teinte plus ou moins foncée. M. de Réaumur
paroît la regarder comme excrémentielle; il
rapporte aux caches dont cette liqueur couvre
les corps fur lefqueis elle a été répandue
les pluies de fang. donc les hi-ftoriens ont fait
mention il fait honneur à M. Pereifc, d’avoir
le premier découvert 1 origine de ce-
précendu prodige ; il eut lieu i Aix où M.
Pereifc fai foi t fonféjour: il remarqua & fit
voir que les caches qu’on attribuoic à une
pluie de fang , {ç trouvoient non pas en-
deftus, mais en-deffbus de la faillie des bâti
mens», montra une paieilfce tache ians uine
boîte où é:oie né un Papillon de même efpèce
que ceux qui voloienx, çn grand nombre
! après la prétendue pluie de fang , dont, fes
obfecv a dons firent connaître la eaufe.
VOLUME'
P R É L I M
I I» . V O L U M E.
Le fécond volume comprend une préface
dans laquelle l’auteur donne une idée générale
des mémoires qui compofent ce fécond
tome-, & il ajoure quelques fupplémens aux
mémoires du volume précédent ; le fécond
en contient douze , dont les Chenilles & les
Papillons continuent d’être l’objet comme ils
l’ont été en plus grande partie des mémoires
du premier volume.
P r e m i e r . M é m o i r e .
De la durée de la vie des çhryfalides ; des
moyens de la prolonger .& de l’abréger.....
'ainfi que la durée de la vie complette de
quantité d’infectes de dijférens genres.
Le réfultar de ce mémoire eft que fuivant,
la faifon où nailfent certains infeâes , ils
vivent quatre à cinq fois plus de rems que
s’ils étoient nés dans une faifon différente.;
La behe Chenille du fenouil, par exemple,
qui fe change en chryfalide au mois de.
juillet, ne reûe dans cet état que treize jours,
& celle de la même efpèce qui n’y parvient
qu’en août ou feptembre y demeure jufqu’à
l’été fuivant j oul’efpace deneufàdix mois.
Cette différence eft due à ce que la chryfalide
tranfpire, que l’évaporation du fluide
furabondant fortifie les membres du Papil-
Ion en permettant le rapprochement de leurs
parties, & fur-tout en ce que la chaleur &
& l’évaporation de l’humeur fuperflue, pro-
duifent répaiflîffemenr des fucs qui confoli-
dént les membres du Papillon ; il eft donc
aifé de fentir pourquoi la vie d’une chryfalide
eft très bornée au fort de l’été, & d’ou
vient elle eft très- longue en automne , pendant
l’hiver & le printems ; de ces faits
l’auteur conclut qu’il eft en notre pouvoir
d’abréger ou de prolonger en général l’exif-
tence des infeâes qui patient par l’état de
Hifioire Naturelle, Infectes, Tome I P .
1 N A 1 R E. exelij
chryfalide. Le fait fuivant prouve la première
propofition : des çhryfalides qui, demeurées
dans leur retraite a 1 automne, ne
feroient devenues Papihons que lete fuivanc
placées dans les ferres du jardin du roi, s’y
changèrent en Papillons au milieu de 1 hiver;
les Papillons, dont la nailfance avoir été
hâtée, naquirent auffl-bien conditionnés que
s’ils ne fulfent nés que l’été fuivant, & la
durée de leur vie , fous, leur dernière forme ,
fut la même que celle des Papihons de leur
efpèce pour qui le cours de la vie n’eft point
abrégé. Du fait précédent, M. de Réaumur
infère qu’on peut prolonger la durée de la
vie des infeétes , en tenant leurs çhryfalides
dans un lieu frais ; il prouye cette fécondé
propofition par plufieurs expériences ; des
çhryfalides portées dans une-cave y font ref-
tees fous cette forme toujours beaucoup plus
long-rems que des çhryfalides de meme efpèce
confervées à la température de 1 atmol-
phère ; la nailfance des Papillons a été d autant
plus retardée, que les chryfahde.s ont
été expofées au .froid plus promptement aptes
avoir pris cette forme ; trois chryfalid.es de
la belle Chenille du Titimale étoient encore
dans cet étatun an aprèsqu’elles enf&m.dù en
avoir changé, & ces çhryfalides étoient bien
vivantes. Si, au lieu de porter les çhryfalides
dans une cave, on les tenoit dans une glacière
, il eft évident qu’on retarderait encore
plus leur développement. Mais quel ferait
l’effet de ce long retardement, l’infe&e parviendrait
il à fon terme, & y airiverait-il
avec la vigueur ordinaire .a fon efpece ? Le
refte du mémoire eft employé à difeuter û
l’on a rendu un bon office à l’infeéte .dont
on a prolongé la vie, mais en le retenant
dans Un état d’inaâion, & à chercher en-
fuite s’il y aurait moyen , par la diminution
de la tranfpiration, .qui eft la caufe de la
vie plus longue des infedes, de prolonger
aufli la notre. Le leefteur ne me (aura ^pa$
mauvais gré fans doute de ne pas fuivre 1 auteur
dans ces objets de pure fpéculation ,
dont il appréciera la valeur fur leur fimple
expofé. b b