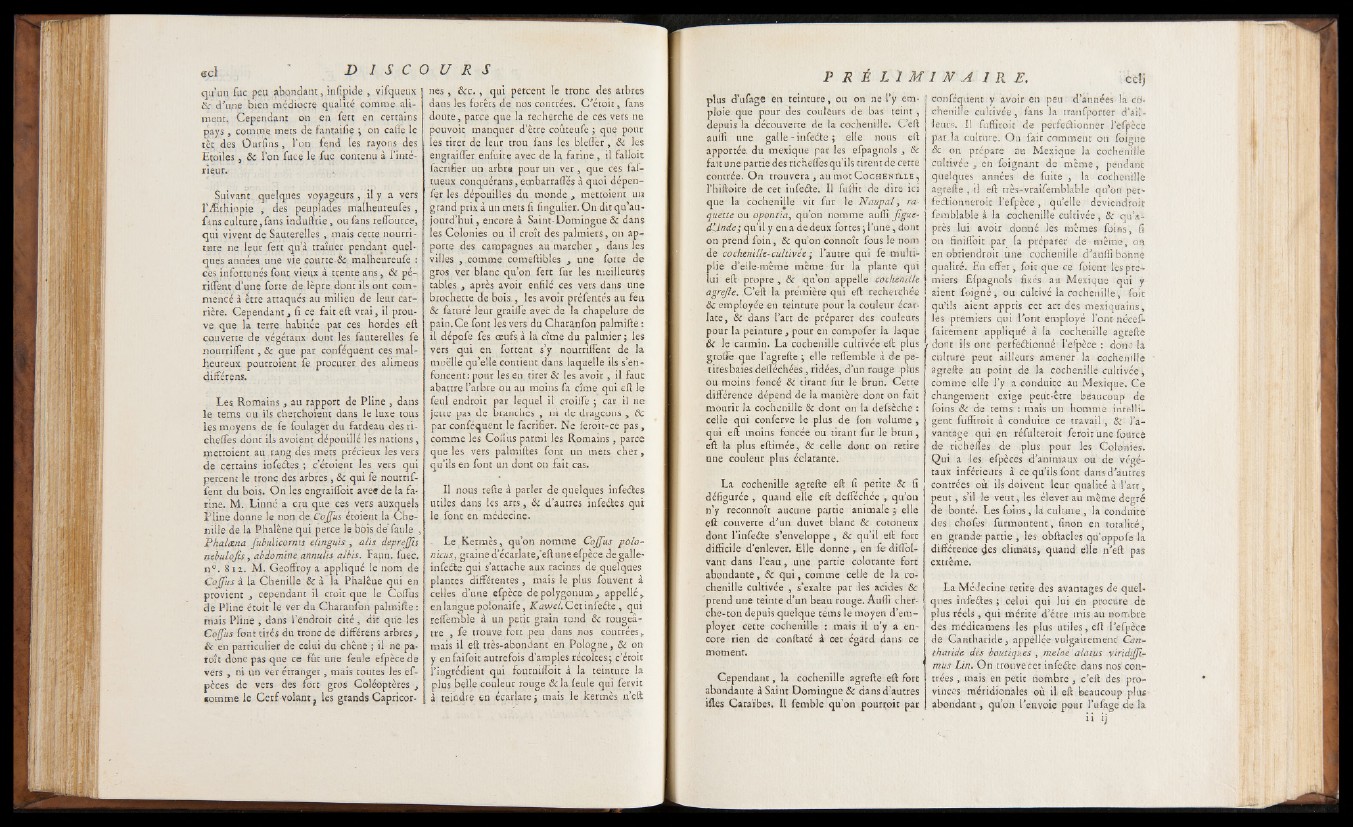
«cl D I S C O U R S
qirun lue peu abondant, infipide , vifqueux
& d'uns bien mçdio.çrç qualité comme aliment,
Cependant on en fert en certains
pays , comme mets de fantailiç ; on cafife le
têt des Üurfms, l’on fe.nd les rayons des
Etoiles j & l’on fuce le fus contenu à l'intérieur.
Suivant quelques voyageurs,, il y a vers
rÆtKiopie , des peuplades malheureufes,
fans culture, fans indufttie, ou fans reffource,
qui vivent de Sauterelles,, mais cette nourriture
ne leur fert qu’à traîner pendant quelques
années une vie ç.QHtte-&. malheureufe :
ces,infortunés font vieux à trente ans, & pé-
riifent d’unç forte de lèpre dont ils ont commencé
à être attaqués au milieu de leur carrière.
Cependant » fi ce fait eft vrai, il prouve
que la terre habitée par ces hordes eft
couverte de végétaux dont les fauterelles fe
nourrirent, & que par conféquent ces malheureux
pourraient fe procurer des alimens
différent.
Les Romains, au rapport de Pline , dans
le tems ou ils chetchoient dans le luxe tous
les moyens de fe foulagér du fardeau des ri-
chefles dont ils avoient dépouillé les, nations,
me croient au.ra.og des mets précieux les vers
de certains infeéies, ; c’étoienc les vers qui
percent ie tronç des arbres , & qui fe nourrif-
fent du bois. On les engraifloit aveé de la farine.
M. Linné a cru que, ces vers auxquels
Pline donne le non d.e. Cojfus etoient la-Chenille
de la Phalène qui perce le bois, de faule ,
Pkaloena fubulicorrm eiinguis , alis dtprejjis
nebulojis, abdomine annulis albis. Faun. fuec.
n°. 812. M. Geoffroy a appliqué le nom de
CoJJus à la Chenille & à la Phalène qui en
provient » cependant il croit que le Coffus
de Pline étoit le ver du Charanfon palmifte:
mais Pline , dans l’endroit cité, die que les
Cojfus font tirés dn tronc de différens arbres ,
& en particulier de celui du chêne ; il ne parole
donc pas que ce fût une feule efpècë de
vers , ni un ver étranger, mais toutes les èf-
pèces de vers des fort gros Coléoptères »
tomme le Cerf volant, les grands Capricornes
, & c . , qui percent le tronc des atbres
dans les forêts de nos contrées. C'étoit, fans
doute, parce que la recherche de cês vers ne
pouvoir manquer d’être coûteufe ; que pour
les tirer de leur trou fans les bleffer, & les
engraiffer enfuite avec de la farine, il falloir
facrifier un arbrt pour un ver, que ces faf-
tueux conquérans, embarraffés à quoi dépen-
fçr les dépouilles du monde , mettaient un
grand prix à un mets li fingulier. On dit qu’au-
jourd’hui, encore à Saint-Domingue & dans
les Colonies ou il croît des palmiers, 011 apporte
des campagnes au marcher , dans les
villes , comme comeftibles , une forte de
gros ver blanc qu’on fert fur les meilleures
tables j après avoir enfilé ces vers dans une
brochette de bois., les avoir préfentés au feu
& fatuté leur graille avec de la chapelure de
pain.Ce font les vers du Charanfon palmifte :
il dépofe fes oeufs à la cîme du palmier ; les
vers qui en fortenc s’y nourriflènr de la
moelle qu’elle contient dans laquelle ils s’enfoncent:
pour les en tirer & les avoir , il faut
abattre l’arbre ou au moins fa cîme qui eft le
feu! endroit par lequel il croiffe ; car il ne
jette pas de branches , ni de drageons „ &
par conféquent le facrifier. Ne feroit-ce pas ,
comme les Coiius parmi les Romains, parce
que les. vers palmiftes font un mets cher,
qu’ils en font un dont on fait cas.
Il nous relie à parler de quelques infeétes
utiles dans les arts, & d’autres infeétes qui
le font en médecine.
Le Kermès, qu’on nomme Cojfus polo-
niçus, graine d’écarlate/eft une efpèce de galle-
infeéte qui s’attache aux.racin.es de quelques
plantes différentes, mais le plus fouvent à
celles d’une efpèce de polygpnuro., appelle»
en langue polonaife, Kawel. Cet infeéte , qui
reffemble à un petit gtain rond & rougeâtre
, fe trouve fort peu dans nos contrées »
mais il eft très-abondant en Pologne, & on
y enfaifoit autrefois d’amples récoltes; c’étoit
l'ingrédient qui fourniffoit à la teinture la
plus belle couleur rouge & la feule qui fervic
à teindre en écarlate; mais le kermès n’eft
P R É L 1 M
plus d’ufage en teinture, ou on ne l'y emploie
que pour des couleurs de bas teint,
depuis la découverte de la cochenille. C’eft
auilî une galle - infeéte ; elle nous elt
apportée, du mexique par les efpagnols , ôc
fait une partie des richeffes qu’ils tirenede cette '
contrée. On trouvera , au mot C ochenUle ,
l’hiftoire de cet infeéte. Il fuffic de dire ici
que la cochenille vit fur le Naupal, raquette
ou opontia, qu’on nomme aufli figue-
dLlnde; qu’il y en a de deux fortes j l’une, donc
on prend foin, & qu’on connoît fous le nom
de cochenille-cultivée ’y l’autre qui fe multiplie
d’elle-même même fur la plante qui
lui eft propre , ôc qu'on appelle cochenille
agrefie. C ’eft la première qui eft recherchée
ôc employée en teinture pour la couleur écarlate,
& dans l’art de préparer des couleurs
pour la peinture., pour en compofer la laque
ôc le carmin. La cochenille cultivée eft plus
grolïe que l’agrefte j elle reffemble a de petites
baies defléchées, ridées, d’un rouge plus
ou moins foncé & tirant fur le brun. Cetce
différence dépend de la manière dont on fait
mourir la cochenille & dont on la defs'èche :
celle qui conferve le plus de fon volume ,
qui eft moins foncée ou tirant fur le brun,
eft la plus eftimée, & celle donc on retire
une couleur plus éclatante.
La cochenille agtefte eft fî pëtite ôc fi
défigurée , quand elle eft defféchée , qu’on
n’y reconnoîc aucune partie animale 5 elle
eft couverte d’un duvet blanc & cotdneux
dont l’infeéte s’enveloppe , ôc qu’il eft fort
difficile d’enlever. Elle donne, en fe diffol-
vant dans l’eau, une partie colorante fort
abondante, 6c qui, comme celle de la co- i
chenille cultivée , s’exalte par les acides ôc !
prend une teinte d’un beau rouge. Audi cher-
che-ton depuis quelque tems le moyen d’em- I
ployer cette cochenille : mais il n’y a en- '
core rien de conftaté à cet égard dans ce
moment.
Cependant, la cochenille agrefte eft fort
abondante à Saint Domingue Ôc dans d’autres
ifles Caraïbes. Il femble qu’on pour roi t par
I N A I RE. cèîf
conféquent y avoir en peu d’années la Cci-
chenille cultivée, fans la tranfporcer d’ailleurs.
Il fuffiroit de perfeétionner l’efpèce
par,la culture. On fait comment on foigne
Sc on prépare au Mexique la cochenille
cultivée y en foignanc de même, pendant
quelques années de fuite , la cochenille
agrefte , il eft crès-vraifemblable qu’on pet-
feéfionneroir l ’efpèce , qu’elle deviendroit
femblable à la cochenille cultivée, & qu’a-
près lui avoir donné .les mêmes foins, fi
on finiffoit par la préparer de même, on
en obtiendroit une cochenille d’aufli bonne
qualité. E11 effet, foie que ce fpieiït les premiers
Efpagnols fixés ail Mexique qui y
aient foigné , ou cultivé la cochenille, foie
qu’ils aient appris cet art des mexiquains,
les premiers qui l ’ont employé font- iiécefi
fairement .appliqué à la cochenille agrefte
' dont ils ont perfectionné l’efpèce : donc la
culture peut ailleurs amener la cochenille
agrefte au point de la cochenille cultivée,
comme elle l’y a conduite au Mexique. Cè
changement exige peut-être beaucoup de
foins & de tems : mais un homme intelligent
fuffiroit à conduire ce travail, Ôc l’a-
vantâge qui en réfulteroit feroic une fource
de richefîes de plus pour les Colonies.
Qui a les. efpèces d’animaux ou de végétaux
inférieurs a ce qu’ils font dans d’autres
contrées où ils doivent leur qualité à l’art,
peut, s’il le veut, les élever au même degré
de bonté. Les foins , 1a culture., la conduite
des chofes furmontent, finon en totalité,
en grande partie , les obftacies qu’oppofe la
différence des climats, quand elle n’eft pas
extrême.
La Médecine retire des avantages de quelques
infectes ; celui qui lui én procure de
plus réels , qui mérite d’être mis au nombre
des médieamens les plus utiles, eft l’efpèce
de Cantharide, appéllée vulgairement' Cantharide
des boutiques , meloé alatus yiridijji-
mus Lin. Gn trouve cet infeéte dans nos contrées
, mais en petit nombre , c’eft des provinces
méridionales où fif eft beaucoup plus
abondant, qu’on l ’envoie pour l’ufage de là