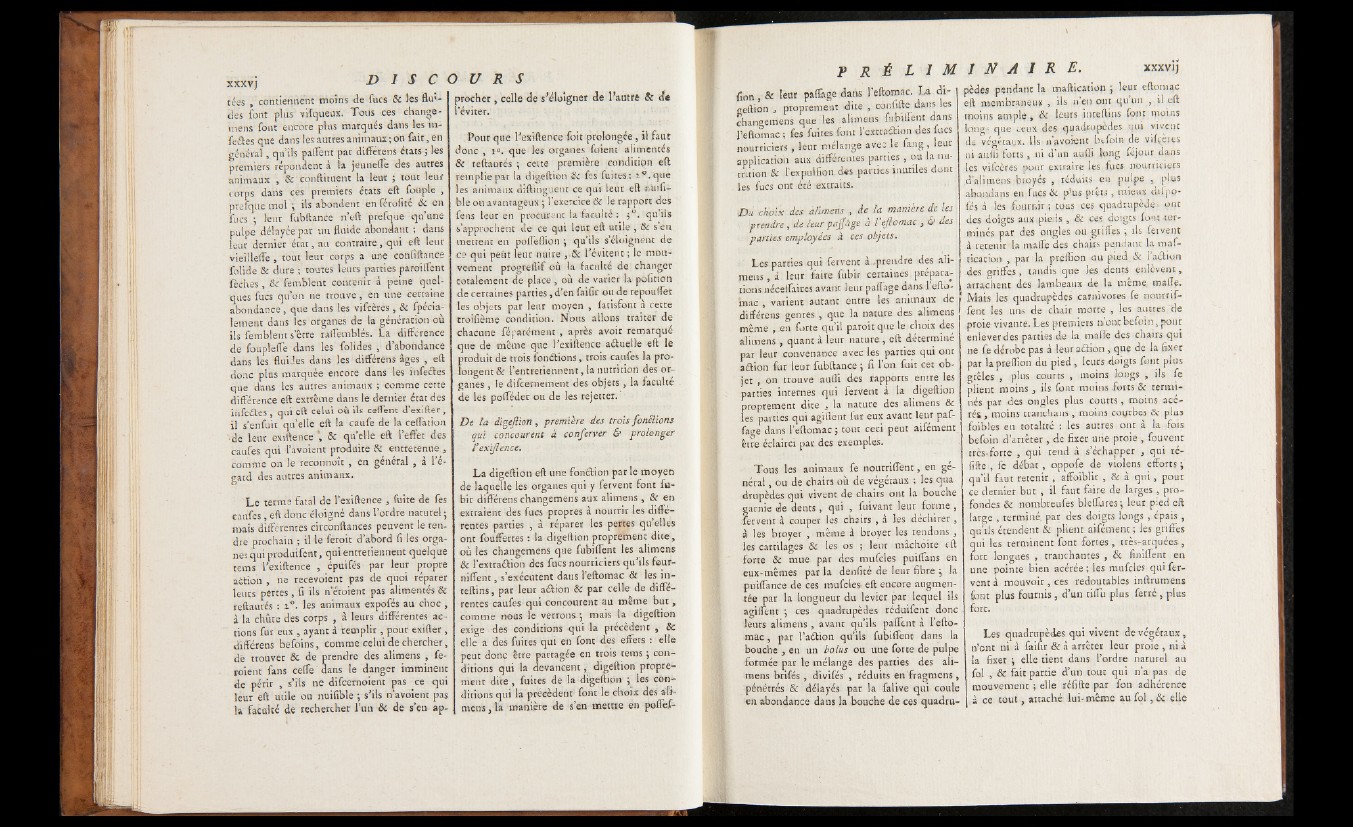
xxxvj D I S C O U R S
tées , contiennent moins de fucs & les fluides
font pins vifqueux. Tons ces Change-
mens font encore pins marqués dans les in-
feéies que dans les autres animaux ; ori fait, en
général, qu’ils paffent par différens états ; les
premiers répondent à la jeunefle des autres
animaux , Sc conftituent ia leur ; tout leur
corps dans ces premiers états eft fouplé ,
prefque mol ; iis abondent enferofité & en
fucs ; leur fubftance n’eft prefque qu’une
pulpe délayée par un fluide abondant ; dans
leur dernier état, au contraire, qui eft leur
vieilleife , tout leur corps a une confiftance
folide & dure ; toutes leurs parties paroiffenr
fèches , &' femblent contenir à peine quelques
fucs qu’ on ne trouve, en une certaine
abondance , que dans les vifcères , & fpécia-
lement dans les organes de la génération où
ils femblent s’être ralfemblés. La différence
de foupleffe dans les folides , d’abondance
dans les fluides dans les différens âges , eft
donc pins marquée encore dans les infeftes
que dans les autres animaux ; comme cette
différence eft extrême dans le dernier état des
iiifetffes , qui eft celui où ils ceffent d’exifter,
il s’enfuit quelle eft la caufe de la ceffation
■ de leur exiftence *, & qu elle eft l’effet des
caufes qui l’avoient produite Sc entretenue ,
comme on le reconnoît , en général , â 1 e-
gatd des autres animaux.
Le terme fatal de l’exiftence , fuite de fes
caufes, eft donc éloigné dans l’ordre naturel ;
mais différences circonftances peuvent le rendre
prochain ; il le feroit d’abord fi les organes
qui produifent, qui entretiennent quelque
tems l’exiftence , épuifés par leur propre
action , ne recevoient pas de quoi réparer
leurs pertes , fi ils n’étoient pas alimentés &
reftaurés : z°. les animaux expofés au choc ,
à la chûte des corps , à leurs différentes actions
fur eux , ayant à remplir , pour exifter ,
différens befoins, comme celui de chercher,
dé trouver & de prendre des alimens , fe-
roient fans celle dans le danger imminent
de périr , s’ils ne difcernoienc pas ce qui
leur eft utile ou nuifible ; s’ils n’avoient pas
la faculté de rechercher l ’un & de s’en approcher
, celle de s’éloigner de l ’autre & de
l’éviter.
Pour que l’ exiftence foit prolongée , il faut
donc , i°. que les organes foient alimentes
& reftaurés ; cette première condition eft
remplie par la digeftion Sc fes fuites.: z ç .que
les animaux dtftinguent ce qui leur eft nuifible
cm avantageux ; l’exercice & le rapport des
feus leur en procurent la faculté : qu ils
s’approchent de ce qui leur eft utile , & s’en
mettent en poffeflion ; qu’ils s’éloignent de
ce qui petit leur ntiire , & l’évitent ; le mouvement
progreflif où la faculté de changer
totalement de place , où de varier fa- pofition
de certaines parties, d’en faifir ou de repoulïèt
les objets par leur moyen , fatisfont à cette
troifième condition. Nous allons traiter de
chacune féparément , après avoir remarque
que de même que l’ exiftence aéiueile eft lé
produit de trois fonction*, trois caufes la prolongent
& l’entretiennent, la nutrition des organes
, le difcernement des objets , la faculté
de les pofféder ou de les rejetter.
De la digeftion, première des trois fonctions
qui concourent à conferver & prolonger
V exijlence.
La digeftion eft une fonction par le moyen
de laquelle les organes qui y fervent font fu-
bir différens changemens aux alimens , & en
extraient des fucs propres à nourrir les différentes
parties , à réparer les pertes quelles
ont fouffertes : la digeftion proprêhaent dite,
où les changemens que fubiffènt les alimens
& l’extra&ion des fucs nourriciers qu’ils faur-
niffent . s’exécutent dans l’eftomac & les in-
teftins, par leur a&ion & par celle de différentes
caufes qui concourent au même but,
comme nous le verrons-; mais la digeftion
exige des conditions qui la précèdent , &
elle a des fuites qui en font des effets : elle
peut donc être partagée en trois rems ; conditions
qui la devancent, digeftion proprement
dite , fuites de H digeftion ; -les conditions
qui la précèdent- font le choix des alf-
metis, la manière de s’en mettre en paffeffion,
Sc leur paffage dans l’eftomac. La. digeftion
, proprement dite , confifte dans les
changemens que les alimens. fubiffènt dans
l’eftomac; fes fuites font l’extraétion des fucs
nourriciers , leur mélange avec le fang , leur
application aux différentes parties , ou la nutrition
& l’expulfion dès parties intuiles dont
. le« fucs ont été extraits.
Du choix des alimens , de la manière de les )
prendre , de leur paffâge a l ejlomac , & des
. parties employées à ces. objets.
Les parties qui fervent à-prendre des aîi-
mens , à leur faire fnbir certaines préparations
néceffaites avant leur paffage dans l’eftomac
, varient autant entre les -animaux de
.différons genres., que la nature des alimens
même , en forte qu’il paraît que le choix des
alimens , quant à leur nature, eft déterminé
par leur convenance avec les parties qui ont
aâion fur leur fubftance ; fi l’on fuit cet objet
, on trouve auffi d-es rapports entre les
parties internes qui fervent à la digeftion
proprement dite , la nature des alimens Sc
les parties qui agiffenr fur eux avant leur paffage
dans l’eftomac ; tout ceci peut aifément
être éclairci par des exemples.
Tous les animaux fe nourriffent, en général
, ou de chairs où de végétaux ; les qua
drupèdes qui vivent de chairs ont la bouche
garnie de dents , qui , fuivant leur forme ,
.fervent à couper les chairs , a les déchirer ,
â les broyer , même à broyer les tendons ,
les cartilages & les os ; leur mâchoire eft
forte & mue par des mufcles puiffans en
eux-mêmes par la denfité de leur fibre ; la
puiffance de ces mufcles- eft encore augmentée
par la longueur du levier par lequel ils
agiffenr ; ces quadrupèdes réduifenr donc.
leurs alimens , avant qu’ils paffent à l’efto-
mac, par l'action qu’ils fubiffènt dans la
bouche , en un bolus ou une forte de pulpe
formée par le mélange des parties des alimens
brifés , divifés , réduits en fragmens,
pénétrés & délayés par la falive qui coule
en abondance dans la bouche de ces quadrupèdes
pendant la maftication ; leur eftoruac
eft membraneux , ils nen ont qu un , il eft
moins ample, Sc leurs inreftins font moins
long* que ceux des quadrupèdes, qui vivent
de végétaux. Ils n’avoienc btfoin de vdeetes
ni aufii forts , ni d’un auffi long fejour dans
les vifcères pour extraire les fucs nourriciers
d’alimeus broyés . réduits en pulpe , plus
aboudans en fucs & plus prêts , mieux dijpo-
£cs à les fournir ; tous ces quadrupède; ont
des doigts aux pieds , .& ces doigts font terminés
par des ongles ou griffes ; ils fervent
à retenir la maffe des çhaiis pendant La maftication
, par la preffion au pied. & faction
d.es griffes, taudis que les dents enlcvent,
arrachent des lambeaux de la même malle.
Mais les quadrupèdes carnivores fe nourriffent
les uns de chair morte , les autres 'de
proie vivante. Les premiers n ont befoin, pour
enlever des parties de la ma Ile des chairs qui
ne fe dérobe pas à leuraétion , que de la fixer
par lapreffion du pied, leurs doigts font plus
grêles , plus courts , moins longs , ils fe
plient moins , ils font moins forts Sc terminés
par des ongles plus courts, moins acérés,
moins tranchans, moins coyïbes & plus
faibles en totalité : les autres ont à la fois
befoin d’arrêter, de fixer mie proie , fouvent
très-forte , qui tend à s’échapper , qui ré-
fifte , fe débat, oppofe de violens. efforts ;
qu’il faut retenir , affoiblir , & à q u i, pour
ce dernier but , il faut faire de larges , profondes
Sc nombreufes bleffures; leur pied eft
large , terminé, par des doigts longs , épais ,
qu’ils étendent & plient aifément ; les griffes
qui les terminent font fortes, très-arquées ,
fort longues , tranchantes , & finiffent en
une pointe bien acérée ; les mufcles qui fervent
à mouvoir , ces redoutables inftrumens
font plus fournis , d’un tiffu plus ferré , plus
fort.
Les quadrupèdes qui vivent de végétaux,
n’ont ni à faifir & â arrêter leur proie , ni à
la fixer ; elle lient dans l’ordre naturel au
fol , Sc fait partie d’un tout qui n’a pas de
mouvement ; elle réfifte par fon adhérence
à ce tout, attaché: lui-même au fol ,.& elle