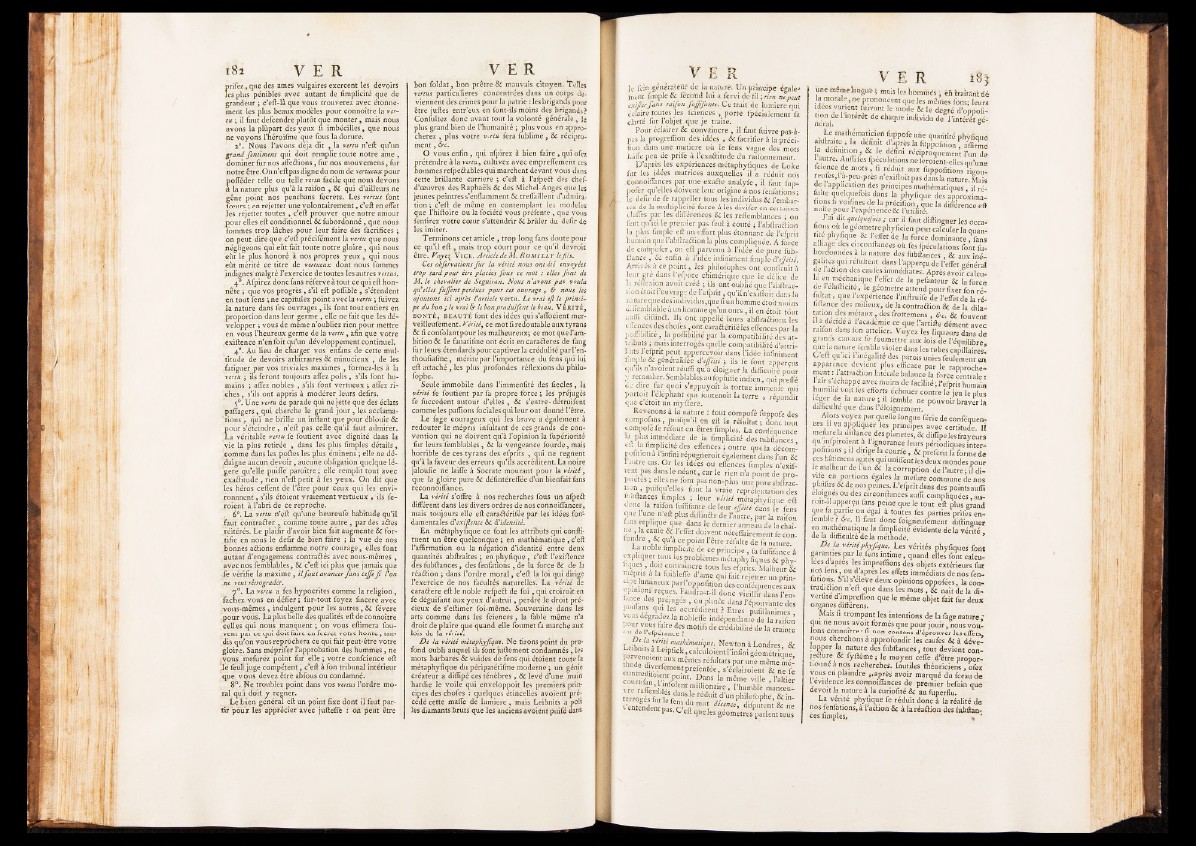
prifez, que des âmes vulgaires exercent les devoirs
les plus pénibles avec autant de fimplicité que de
grandeur ; c’eft-là que vous trouverez avec étonnement
les plus beaux modèles pour connoître la vertu
; il faut defcendre plutôt que monter , mais nous
avons la plupart des yeux u imbécilles, que nous
ne voyons l’néroïfme que fous la dorure.
2°. Nous l ’avons déjà dit , la venu n’eft qu’un
grand fentiment qui doit remplir toute notre ame ,
dominer fur nos affeôions, fur nos mouvemens, fur
notre être. On n’eft pas digne du nom de vertueux pour
fofleder telle ou telle venu facile que nous devons
la nature plus qu’ à la raifon , &C qui d’ailleurs ne
gêne point nos penchans fecrets. Les venus font
Tceurs ; en rejetter une volontairement, c’eft en effet
les rejetter toutes , c’eft prouver que notre amour
pour elles eft conditionnel & fubordonné , que nous
Tomrties trop lâches pour leur faire des facrifices ;
on peut dire que c’eft précifément la vertu que nous
négligeons qui eût fait toute notre gloire , qui nous
eût le plus honoré à nos propres y e u x , qui nous
eût mérité ce titre de vertueux dont nous fommes
indignes malgré l’exercice de toutes les autres vertus.
4 ° . Afpirez donc fans réferve à tout ce qui eft honnête
; que vos progrès, s’il eft polîible , s’étendent
en tout fens ; ne capitulez point avec la vertu ; fuivez
la nature dans fes ouvrages * ils font tout entiers en
proportion dans leur germe , elle ne fait que les développer
; vous de même n’oubliez rien pour mettre
en vous l’heureux germe de la vertu , afin que votre
exiftence n’enfoit qü’un développement continuel.
4 °. Au lieu de charger vos enfans de cette multitude
de devoirs arbitraires & minucieux , de les
fatiguer par vos triviales maximes , formez-les à la
vertu ; ils feront toujours affez polis , s’ils font humains
; affez nobles ,, s’ ils font vertueux ; affez riches
, s’ils ont appris à modérer leurs défirs.
f i . Une vertu de parade qui ne jette que des éclats
paffagers , qui cherche le grand jour , les acclamation
s ; qui ne brille un inftant que pour éblouir &
pour s’éteindre, n’ëft pas celle qu’il faut admirer.
La véritable vertu fe foutient avec dignité dans la
vie la plus retirée , dans les plus fimples détails,
‘comme dans les poftes les plus éminens ; elle ne dédaigne
aucun devoir, aucune obligation quelque légère
qu’elle puiffé paraître ; elle remplit tout avec
exactitude , rien n’eft petit a fes yeux. On dit que
les héros ceffent de l’etre pour ceux qui les envi-
ronnnent, s’ils étoient vraiement vertueux , ils feraient
à l’abri de ce reproche.
, 6 La vertu n’eft qu’une heureufe habitude qu’il
faut contrarier , comme toute autre , par dès aftes
. réitérés. Le plaifir d’avoir bien fait augmente & fortifie
en nous le defir de bien faire ; la vue de nos
bonnes actions enflamme notre courage, elles font
autant d’engageinens cùntraâés avec nous-mêmes ,
avec nos femblables, & c’eft ici plus qué jamais que
-fe vérifie la maxime , il faut avancer fans ceffe J i l'on
ne veut rétrograder.
7 ° . La vertu a fes hypocrites comme la religion ,
fâchez vous en défier ; fur-tout foyez fincere avec
.vous-mêmes , indulgent pour les autres, & févere
pour vous. La plus belle des qualités eft de connoître
celles qui nous manquent ; on vous eftimera fou-
.vent par ce qui doit faire, en fecret votre honte, tandis
qu’on vous reprochera ce qui fait peut-être votre
gloire. Sans méprifer l’approbation des hommes, ne
jvqus, mefuréz point fur elle ; votre confidence eft
dé feiill juge compétent, c’eft à fon tribunal intérieur
que- vous devez être abfous ou condamné.
8°. Ne troublez point dans vos vertus l’ordre moral
quii doit y regner.
Le Êiien général eft un point fixe dont il faut partir'p
our les apprécier avec jûfteffe : oil jSeiit être
bon foldat, bon prêtre & mauvais citoyen. Telles
vertus particulières concentrées dans un corps deviennent
dés crimes pour la patrie : les brigands pour
être juftes entr’eux en font-ils moins des brigands ?
Confultez donc avant tout la volonté générale, lé
plus grand bien de l’humanité ; plus vous en approcherez
, plus votre v.rtu fera fublime , & récipro-
ment, &c.
O vous enfin, qui afpirez à bien fa ire , qui ofez
prétendre à la vertu, cultivez avec empreffement ces
hommes refpeétables qui marchent devant vous dans
cette brillante carrière ; c’ eft à l’afpeét dés chef-
d’oeuvres des Raphaëls & des Michel-Anges que les
jeunes peintres s’enflamment & treffaillent d’admiration
; c’eft de même en contemplant les modèles
que l’hiftoire ou là fociété vous préfente , que vous
fentirez votre coeur s’attendrir & brûler du defir de
les imiter.
Terminons cet a rticle, trop long fans doute pour
ce qu’il eft , mais trop court pour ce qu’il dévroit
être. Voye{ V ic e . Article de M. R o m i l l y le jils.
Ces obfervations fu r la vérité nous ont été envoyées
trop tard pour être placées fous ce mot : elles font de
M. le chevalier de Seguiran. Nous n'avons pas voulu
qu'elles fujfent perdues pour cet ouvrage , & nous les
ajoutons ici après Üarticle vertu. Le vrai ejl le principe
du bon ; le vrai & le bonproduifent le beau. V ÉRITÉ,
bo n t é , b e a u t é font des idées qui s’affocient mer-
veilleufement./^eVf«', ce mot fi redoutable aux tyrans
& fi cônfolantpour les malheureux; ce mot que l’ambition
& le fanatifine ont écrit en caraéteres de fang
fur leurs étendards pour captiver la crédulité par l’en-
thoufiafme, mérite par l’importance du fens qui lui
eft attaché , les plus profondes réflexions du philo-
fophe.
Seule immobile dans l’immenfité des fied e s, là
vérité fe foutient par fa propre force ; les préjugés
fe füccedent autour d’elles , &c s’entre - detruifent
comme les pallions fociales qui leur ont donné l ’être.
Le fage courageux qui les brave a également à
redouter le mépris infultant de ces grands de convention
qui ne doivent qu’à l’opinion la fupériorité
fur leurs femblables, & là vengeance foiirde, mais
horrible de ces tyrâns des efprits , qui ne régnent
qu’à la faveur deS erreurs qu’ils accréditent. La noire
jaloùfie ne laiffe à Socrate mourant pour la vérité,
que là gloire pure & défintéreffée d’un bienfait fans
réconnôiffance.
La vérité s’offre à nos recherches fous un afpeét
différent dans les divers ordres de nos cônnoiffances,
mais toujours elle eft caraétérifée par les idées fort1
damentalés d'exiftence & d'identité.
En métâphyfique ce font les attributs qui confti-
tuent un être quelconque ; èn mathématique , c’eft
l’affirihâtion ou la négation d’identité entre deux
quantités abftraites ; en phyfique , c’èft Pexiftencé
des fubftances, des ferifàtions , de la force & de là
réaétion ; dans l’ordre moral, c’eft la loi qui dirige
l’exercice de nos facultés naturelles ^ La vérité de
caraètere eft le noble refpeÇt de fo i , qui croirait en
fe déguifant aux yeux d’autrui, perdre le droit précieux
dé s’eftimer foi-même. Souveraine dans les
arts comme dans leS fcieiices, la fable même n’a
droit de plaire que quand elle foumet fa màrche aux
lôis de la vérité.
De la vérité métâphyfique. Ne tirons point du profond
oubli auquel ils font juftement condamnés , lés
mots barbares & vuides de fens qui étoient toute la
métâphyfique du péripatétifme moderne ; un génie
créateur a diffipé ces ténèbres , & levé d’une maiii
hardie le voile qui envéloppoit les premiers principes
des chofes : quelques étincelles avoienf précédé
cette maffe de lumière, mais Leibnits a poli
les diamants bruts que les anciens âvoienf puifé dans
le fc:n générât éür de la natufëv Ün principe égaie-*
ment fimple & féchhd ïtii a fervi de fil ;r« « ne peut
txifer fan s raifon fuffifantu Ce trait de lumière qui
éclaire toutes les fciences , porte fpéeialement fa
clarté fur l’objet .que je traite.
Pour éclairer &c convaincre , il faut fuivre paS-à-
nas la progreffion des idées ; & facrifier à la préci-
fion dans une matière où le fens vague des mots
laiffe peu de prife à l’exaâitude du raifonnement.
D’après les expériences métaphyfiques de Loke
fur les idées matrices auxquelles il a réduit nos
troftnoiffances par une exaéte analyfe, il faut fup-
pofièr qu’elles doivent leur origine à nos fenfations •
L le defir de fe rappeller tous les individus & i’embar-
raè de la multiplicité force à lés divilèr en certaines
claffes par les différences & les reffemblances ; on
fent qu’ici le premier pas feul à conté ; l’abftraftion
Ja plus fimple eft un effort plus étonnant de l’efprit
humain que l’abffraftion la plus compliquée. A force
de compofer, on'eft parvenu à l’idée de pure fub-
llancé , & enfin à l’idée infiniment fimple à'efjéité.
Arrivés à ce point * les philofophes ont confirait à
leur gre dans l’efpace chimérique que le délire de
h réflexion aVoit créé ; ils ont oublié que l’abftrac-
tion croit l’ouvrage cle l’efprit, qu’il n’exiftoit dans la
nature que des individus,que fi ün homme étoit moins
diffêmblable à un homme qu'un ours , il en étoit tout
auifi diftinét. Us ont appelle leurs abftràtfions les
eiîencès des chofes, ont caraélérifé les effences par la
pofîibiiité, la pofîxbilifé par la compatibilité des attributs
; mais interrogés quelle compatibilité d’attri-
l uts l ’efprit peut appercevoir dans l’idée infiniment
fimple & gëneralifee d'ejjeité ; ils fe font apperçus
qu’ils n’a voient réufiî qu’à éloigner la difficulté pour
y retomber.Semblables aufophifîeindien, qui prelle
de dire fur quoi s’àppuyoit la tortue imiqeniè qui
portoit 1 eléphaüt qui fouienoit la terre , répondit
eue c’étoit un myfterév
Revenons à là nature i tout compofé fiîppofe des
compofans, puifqtfil en eft le réfultat ; donc tout
compofe fe réfout en êtres fimples. La conféquence
la plus immédiate de la limplicifé des îubftances
eft !a fimplicité des effences ; outre que la déeom-
polition à l’infim répugnerait également dans l’un &
1 autre cas. Or les idées où effences fimples n’eXif-
tent ças dans le néant, car le rien n'a point de propriétés
; elles ne font pas non-plus Une pureabftrac-
t^n , puifqu elles font la vraie repréfentation des
ïi.oitances fimples ; leur vérité métâphyfique eft
donc la raifon fuffifante de leur efjéitè dans le fens
que 1 une n eft plus^iftinfte de l’autre, par la raifon
ians répliqué que dans le dernier anneau de la ehaî-
ne la caufe & l’effet doivent néceffaireriiërit fe con-
tondre & H à ce point l’etre réfulte de fa nature.
La noble fimplicité de ce principe , fa fuffifimee à
expliquer tous les problèmes métaphyfiques & phy;
H les efPfirs- Malheur &
rïnl l, J foibfoffe d'ame qui fait rejetter un prin-
upe lumineux pari oppofition des conléquences aux
opinions reçues. Ealidra^t-il donc vieillir dans ü
S H ’ ° u.Pkltôt ^ l’époüvante des
? Etres pufillanimes ,
_ l degradez la nobieffe indépendante de la raifon
ihode a v f f aUX ment!? réfultats Par un<= même iré-
^ W e m « nt Prd ê nté e , s'éclairoiènf & ne fe
courtifan I*' tfPi°lnt' S ? DS ?a > l’altier
vre raffembr M M M EMM MH l ’huniblè minoeo.
^ ^ l ^ k . r é d u i t dWphUôfopte, WÈÈÊMBÊÈ m mi & i i elt que les geometres parlent tous
W
uné irremefengu'è ; mais les hbmmés ; ëfl fraitàntdé
la morale, ne prononcent que les mêmes fdrts; leurs
içlees varient luxant le mode & le degré d^opdofi-
tipn de 1 intérêt de ehaque individu de l ’intérêt eé-
nerah 6
W B n U Ê B Ê quantité phygqnë
■ M a i i m m
? * Ie réciproquèmént l’ün de
1 autre. Auffifa Spéculations ne i'eroient-elles qu’une
kience de mots, fi réduit aux fuppofitions rieoiP
renies,ld-peu-pres n’ exiftoit pas dansla nature; Mais
de 1 application des principes mathématiques il ré-
iune quelquefois dans la phyfique dès approximations
il voifînes de la précifion, que la différence eft
nulle pour 1 expérience & l’utilité;
J ’ai dit quelquefois; car il faut diliinglier les occa-"
lions ou le geometrephyficien peut calculer la quan.
tite phyfique & 1 effet de la force dominante , fans
a.liage des circonftanees où fes fpécuiations font fu-
botdonnees à la nature des fubftances , & aux inégalités
qui reiultent dans l’apperçu de l’effet général
de 1 action des caules immédiates. Après avoir calcu.
i M U Ê M M m i ’t& t de la pefanteur & la force
ne 1 elafticite, le géomètre attend pour fixer fon ré-
lidtat, que 1 expenence l’inftruife. de l ’effet de la ré-
filtance des milieux, de la contraflion & de la dilatation
des métaux , des frottemens , Æ-r. & fouvent
il à décidé à l’académie ce que l’artifte dément avec
raiion dans Ion attelier. Voyez les liqueurs dans de
grands canaux fi* foumettre aux lois de l ’équilibre •
que la nature.iemble violer dans les tubes capillaires,
C eft qu ici 1 inégalité des parois unies feulement en
apparence devient plus efficace par le rapproche-,
ment : i attradion latérale balance la force centrales
1 dlr s echêppe avec moins de facilité; l’ efprit humain
humilie voit fes efforts- echcruer contre le jeu le plus
Jeger de la natu re ; il feffihle ne pouvoir braver la
dimctilte que dans l’eloignement*
Alors voyez par quelle longue férié de eonféquen-
tes n va appliquer fés principes avec certitude. 11
meiurela diftance des planètes, & diffipelesfrayeürs
quinlpiroient à l’ignorance leurs périodiques inter-
p ofitiqns;tl dirige lacourfé , & preferit la forme d®
. çes Mtimens agites qui unifient les deux mondes pour
le malheur de I un & la corruption de l’autre ; il di-
v‘V ‘V ° Jrtl0nS é^ales ,a mefure commune de nos
plaihrs & de nos peines, L ’efprit dans des points auffi
éloignés Ou des eirconftances aufiî compliquées au-
rOit-il apperçu fins peiné que le tout eft plus grand
que fa partie ou égal à toutes fes. parties prifes en-
lembJe ? &c. Il faut donc foigneufement diftinguep
en mathématique la fimplieité évidente delà vérité ,
de la difficulté de la méthode.
De la vérité phyfique. Les vérités phyfiques font
garanties par le, fens intime, quand elles font calculées
d apres les impreffions des objets extérieurs fur
nos fons, ou d’après les effets immédiats de nos fen-
lations. S il s eleVe deux opinions oppofées, la con-
tradittion n eft que dans les mots, & naît de la di-
verfite dimpreffion que le même objet fait fur deux
orsanes differens.
Mais fi trompant les intentions de la fage nature :
qui ne nous avoit formés que pour jouir, nous voulons
connoître : fi non eontens d’éprouver les effets*'
nous cherchons à approfondir les caufes & à développer
la nature des fubftancès, tout devient con-
jeéUire & fyftètiie ; le moyeri ceffe d’être proportionné
à nos recherches. Inutiles théoriciens , ofez
vous en plaindre »après avoir marqué du fceau de
1 evidence les connoiffances de premier befoin que
devoit la nature à la curiofité & au fuperflu.
La vérité phyfique fe réduit donc à la réalité de
nos fenfations, à l’aétion ôc à la réaction des lubftan-
ces fimples, * ^