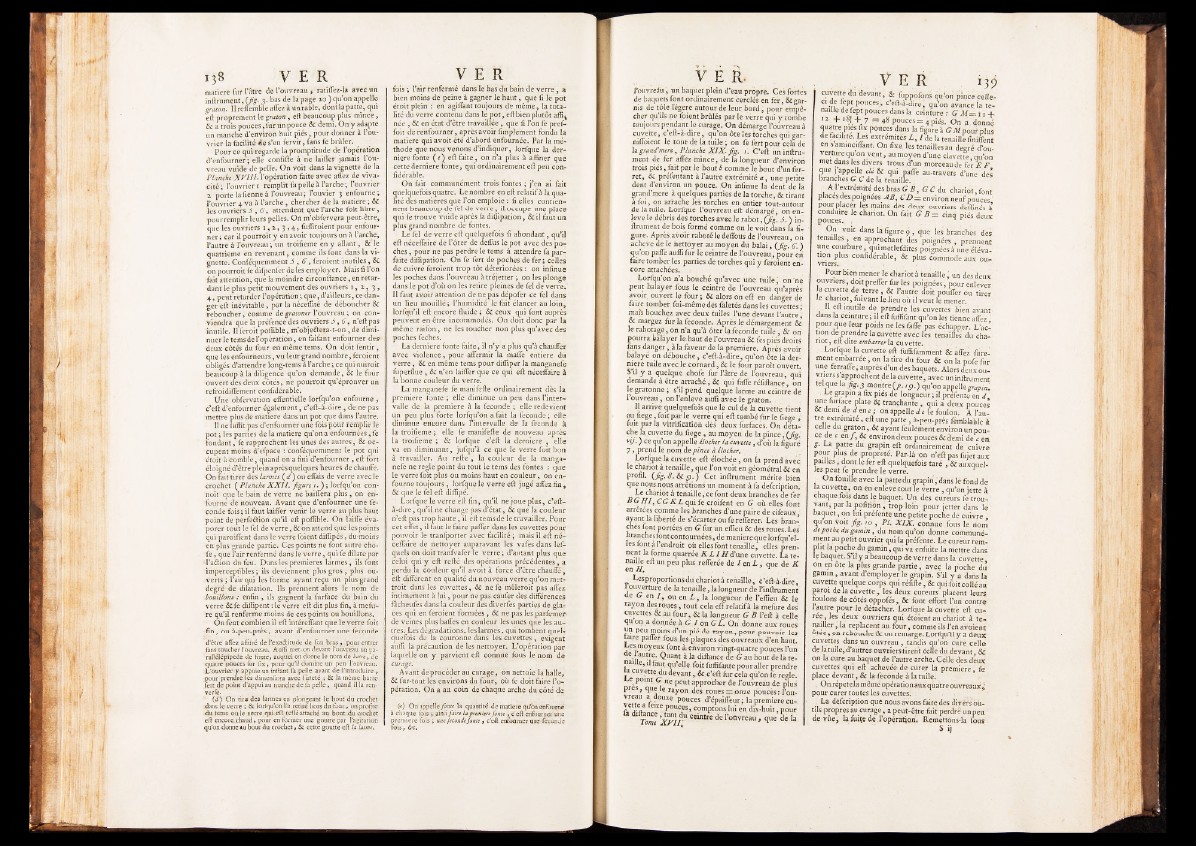
matière fur l’ âtre de l’ouvreau * ratiffez-la avec un
infiniment, (fig . 3 . bas de la page 20 ) qu on appelle
graton. Ilreffembieaffezà unrable, dont la patte, qui
eft proprement le graton, eft beaucoup plus mince,
& a trois pouces, fur un pouce & demi. On y adapte
un manche d’environ huit pies, pour donner à l’ouvrier
la facilité de s’en fervir, fans fe brûler. ^
Pour ce qui regarde la promptitude de 1 operation
d’enfourner ; elle confifte à ne laifl'er jamais l’ouvreau
vuide de pelle. On voit dans la vignette de la
Planche X V I I I- l’opération faite avec affez de vivacité
; l’ouvrier 1 remplit fa pelle à l’arche ; l’ouvrier
2 porte lafienneà l’ouvreau; l’ouvier 3 enfourne;
l’ouvrier 4 va à l’arche, chercher de la matière ; &
lés ouvriers 3 , G, attendent que l’arche foit libre,
pourremplir leurs pelles. On m’obfervera peut-être,
que les ouvriers 1 , 2 , 3 , 4 , fuffiroient pour enfourner
; car il pourroit y en avoir toujours un à l’arche,
l’autre à l’ouvreau; un troifieme en y allant, S f le
quatrième en revenant, comme ils font dans la v ignette.
Conféquemment 3 , G , feroient inutiles, &
on pourroit fe difpenfer de les employer. Mais fi l’on
fait attention, que la moindre circonfiance, en retardant
le plus petit mouvement des ouvriers 1 , 2 , 3 ,
4 , peut retarder l’opération ; que, d’aiileurs, ce dang
e r eft inévitable, par la néceflité de déboucher &
reboucher, comme de gratoncr l ’ouvreau ; on conviendra
que la préfence des ouvriers 3 , G, n’eftpas
inutile. Il feroit poflible, m’objetteta-t-on , de diminuer
le tems de l’opération, en faifant enfourner des*
deux côtes du four en même tems. On doit fentir,
que les enfourneurs, vu leur grand nombre, feroient
obligés d’attendre long-tems a l’arche ; ce qui nuiroit
beaucoup à la diligence qu’on demande, & le four
ouvert des deux côtés, ne pourroit qu’éprouver un
refroidilfement confidérable.
Une obfervation efléntielle lorfqu’on enfourne ,
c’ eft d’enfourner également, c’eft-à-dire , de. ne pas
mettre plus de matière dans un pot que dans Pautre.
II ne fuffit pas d’enfourner une fois pour remplir le
pot ; les parties de la matière qu’on a enfournées, fe
fondant, fe rapprochent les unes des autres, & occupent
moins d’efpace : conféquemment le pot qui
étoit-à comble, quand on a fini d’ enfourner , eft fort
éloigné d’être plein après quelques heures de chauffe.
On fait tirer des larmes ( d ) ou effais de verre avec le
crochet ( Planche X X I I . figure,!. ) ; lorfqu’on con-
noît que le bain de verre ne baiffera plus , on enfourne
de nouveau. Avant que d’enfourner une fécondé
fois ; il faut laifl’er venir le verre au plus haut
point de perfeÔion qu’il eft poflible. On laifl'e évaporer
tout le fel de verre, & on attend que les points
qui paroiflent dans le verre foient diflipés, du-moins
en plus grande partie. Ces points ne font autre cho-
f e , que l’air renfermé dans le ve r re , qui fe dilate par
•l’a&ion du feu. Dans les premières larmes , ils font
imperceptibles ; ils deviennent plus gros , plus ouverts
; l’air qui les forme ayant reçu un plus grand
degré de dilatation. Ils prennent alors le nôin de
bouillons : enfin , ils gagnent la furface du bain du
verre & f e diflipent : le verre eft dit plus fin, à mefu-
re qu’il renferme moins de ces points ou bouillons.
On fent combien il eft intérefiant que le verre foit
fin , ou à-peu-près, avant d’enfourner une fécondé
d’être affez affuïé de l’exa&itude de fon braspour entrer
fans toucher l’ouvreau. Auffi met-on devant l’ouvreau un parallélépipède
de fonte, auquel on donne le nom de barre, de
quatre pouces fur fix, pour qu’il domine un peu Touvreati.
L ’ouvrier y appuie un inftant fa pelle avant de l’introduire ,
pour prendre les dimenfions avec lûreté ; & la même barre
fert de point d’appui au manche de fa pelle, quand il la ren-
verfe. ■
(d ) On tire des larmes en plongeant le bout du crochet
dans le verre.; & lorfqu’On l'a retiré hors du Jour, on profite
du tems où le verre qui .eft relié attaché au bout du crochet
eft encorej:haud, pour en former une goutte par l’agitation
qu’on donne au bout du crochet, & cette goutte eft la larme.
fois ; l’air renfermé dans le bas du bain de v e r re , a
bien moins de peine à gagner le haut, que fi le pot
étoit plein : en agiffant toujours de même, la totalité
du verre contenu dans le p ot, eft bien plutôt affi*
née ,•& en état d’être travaillée , que fi l’on fe pref-
foit de renfourner, après avoir Amplement fondu la
matière qui avoit été d’abord enfournée. Par la méthode
que nous venons d’indiquer, lorfque la dernière
fonte ( e ) eft faite, on n’a plus à affiner que
cette derniere fonte, qui ordinairement eft peu confidérable.
On fait communément trois fontes ; j’en ai fait
quelquefois quatre. Le nombre en eft relatif à la qualité
des matières que l’on emploie : fi elles contiennent
beaucoup de fel de v e r re , il( occupe une place
qui fe trouve vuide après fa diflipation, & il faut un
plus grand nombre de fontes.
Le fel de verre eft quelquefois fi abondant, qu’il
eft néceflaire de l’ôter de defliis le pot avec des po-^
ches, pour ne pas perdre le tems à attendre fa parfaite
diflipation. On fe fert de poches de fer ; celles
de cuivre feroient trop tôt détériorées : on infinue
les poches dans l’ouvreau à tréjetter ; on les plonge
dans le pot d’où on les retire pleines de fel de verre.
Il faut avoir attention de ne pas dépofer ce fel dans
un lieu mouillé; l’humidité le fait élancer au loin,
lorfqu’il eft encore fluide ; & ceux qui font auprès
peuvent en être incommodés. On doit donc par la
même raifon, ne les toucher non plus qu’avec des
poches feches.
La derniere fonte faite, il n’y a plus qu’à chauffer
avec violence, pour affermir la maffe entière du
v e r re , & en même tems pour difliper la manganefe
fuperflue , & n’en laifl'er que ce qui eft néceflaire à
la bonne couleur du verre.
La manganefe fe manifefte ordinairement dès la
première fonte ; elle diminue un peu dans l’intervalle
de la première à la fécondé ; elle redevient
un peu plus forte lorfqu’on a fait la fécondé ; elle
diminue encore dans l’intervalle de Ta fécondé à
la troifieme ; elle fe manifefte de nouveau après
la troifieme ; & lorfque c’eft la derniere , elle
va en diminuant, jufqu’à ce que le verre foit bon
à travailler. Au refte , la couleur de la manganefe
ne réglé point du tout le tems des fontes : que
le verre foit plus ou moins haut en couleur, on enfourne
toujours, lorfque le verre eft jugé affez fin ,
& que le fel eft diflipé.
Lorfque le verre eft fin, qu’il ne joue p lus, c’eft-
à-dire , qu’il ne change pas d’état, & que la couleur
n’eft pas trop haute, il eft tems de le travailler. Pour
cet effet, il faut le faire paffer dans les cuvettes pour
pouvoir le tranfporter avec facilité ; mais il eft né-
ceffaire de nettoyer auparavant les vâfés dans Ief-
quels on doit tranfvafer le ve r re ; d’autant plus que
celui qui y eft refté des opérations précédentes, a
perdu la couleur qu’il avoit à force d’être chauffé,
eft différent en qualité du nouveau verre qu’on met-
troit dans les cuvettes, & ne fe mêleroit pas affez
intimement à lu i, pour ne pas càufer des différences
fâcheufes dans la couleur des diverfes parties de glar
ces qui en feroient formées, & ne pas les parfemer>
de veines plus baffes en couleur les unes que les autres.
Les dégradations, les larmes, qui tombent quel-
quefois de la couronne dans les cuvettes , exigent
auffi la précaution de les nettoyer. L ’opération par
laquelle on y. parvient eft connue fous le nom de
curage.
Avant de procéder au curage, on nettoie la halle,
& fur-tout les environs du four, où fe doit faire l’opération.
Ort a au coin de chaque arche du côté de.
©n‘ appelle fonte la quantité-de matière qu'on enfourne
à chaque fois ; ,ainli faire la première finie , c'eft enfourner' uine
première fois ; une fécondé finie, c’eft enfourner une féconde
fois, 6>c,
l’ouvredu, un baquet plein d’eau propre. Ces fortes
de baquets font ordinairement cerclés en fe r, & garnis
de tôle légère autour de leur, bord, pour empêcher
qu’ils lie (oient .brûlés par le verre qui y,tombe
toujourspendant le curage. On démarge Pôuvreàu à
cuvette, c’eft-à-dire, qu’on ôteîqs torches qui gâr7
niffoient le tour de la tuile ; on fe fert pour cela de
la granetmere, Planche X lX . fig. 1. Ç’eft un infiniment
de ferafféz inince, de la longueur d’environ
trois piés,jfait par le bout b comme Te bout d’iinfer-
ret, & préfentant à l’autre extrémité a , une petite
dent d’environ un pouce. .On infinue la dent de là
grand’mere à quelques parties de la torche, & tirant
à fo i, qn arrache leé. torches en entier tout-autour
de la tuile. Lorfque l’ouvreau eft démargé, on en-
|eve le débris des torches avec le rabot, (fig. 3 . ) infiniment
de bois formé comme on le voit dans la figure.
Après.avbir raboté le déffoùs dë l’ouvreàu, on
achevé dé le nettoyer au moyen du balai, (fig. G. )
,qu’on pafle aufli fur lè ceintre de l’oiivreau , pour en
faire tomber les parties de torches qui y feroient encore
attachées!. ...
Lorfqu’on n’a boiiché qii’âvec une tuile," on ne
peut balayer fous le ceintre de l’ouvreau qu’aprè^
avoir ouvert le foùr ; & alors on eft en danger de
faire tomber, foi-même des faletés dans les cuvettes ;
maïs bouchez avec deux tuiles l’une devant l'autre '
& margez fur la fécondé. Après le démargèment &
le rabotage j on n’à.qu’à ôter la fécondé tuiié , & on
pourra balayer le. haut de l’ouvreau & (es piés droits
fans danger ,.à la faveur de la première. Après avoir
balayé on débpuche, c’eft-à^dire, qu’on ôte la der- 1
niere tuile avec le cornard, & le four paroît ouvert. !
S’il ÿ a quelque chofé für Pâtre de l’ouvreau, qui j
demande à être attaché, & qui faffe réfiftance, on
le gratonne ; s’il pend quelque larme au ceintre dè
l’ouvreau, on l’enlève auffi avec, le graton.
Il arrive quelquefois que le cul de la cuvéttè tient
au fiege, foit pat le verre qui eft tombé fur le fiege
foit par la vitrification dés deux furfaceS, On déta-
che la aiyette du fiege , àu moyen de la pince, (fig.
yij. ) ce qù’on appelle clocher la cuvette, d’où la figuré
7 , prend le nom .d.e pince à clocher.
Lorfque la cuvette eft élôchée, on la prend avec
le chariot à tenaille, que l’on voit en géométral & en
Cet iriftrümènt mérite bien
que nous nous,arrêtions un moment à fa defcription.
Le chariot à, teriaille,cefont deux branches de fer.
^ G K L qui fe .çroifent en G où elles font
arrçtees comme les branchés d’uné paire de cifeaux,
ayant là liberté dë s’écarter ou fe refferer. Les branchés
font portées en G fur ùn eflieu & des touçs. Les
branches font contournées, de manière que lorfqu’el-
les font à l’endroit où elles font tenaille, elles prennent
là forme quarrée K L I H d’une cuvette. La tenaille
eft un peu plus refferée de / en L , que de K.
en H.
ivuyerture de la tenaille, la longueur de (’infiniment
de G en ƒ , ou en l , la longueur de l’eflieu & le
rayon des roije$, tout cela eft relatif à la mefure des'
cuvettes & à.u four, & la longueur G B l’èft à celle
°n a donnée .à G J ou G L . ô n donne aux roués
un peu moins d’un.pié de rayon., pouf pouvoir les
aire paffer fous. les plaqués des ouvreaux d’en haut.
JLes.mpyeux font à. ehviron.vingt-quatre pouces l’un
e ...al1îy®,* Quant à la diftance de G àu bout delà te-
nai e, il (aut qu’elle foit fuffifante pour aller prendre
a cuvette ^u devant, ÔC e’eft fur cela.qu’on fe réglé.
nrè« ° lnt‘ 1 ne Peilt approcher de l’ouvreau de plus
P 9 4uc le rayon des roues = :onze pouces: l’ou-
reau a ouze pouces d’épaiffeur;. la première eu-.
yvC,.^a eize pouces, comptons lui en dix-huit, pour
Tome X r i r 1 r ° 0vreau ^ W ! la
cuvette du devant, .& fuppofons qu’on pince celle-
ci de fept pouces ; c’eft-à-dire ’ qu’on avance ia tenaille
de fept pouces dans la ceinture : G M — i 1 +
S ü == 48 pouces = 4 piés. On a . donné
quatre pmsfix pouces dans lafigure à GM p o u t plus
de facilite. Les extrémités L , I de ta tenaille finiffent
en s aminciffant. On fixe les tenailles au degré d’ouverture
qu’on y eut, au moyen d’une clavette, qu’on
met dans les divers trous (d’un morceau de fer E F
que j ’appelle c /à& qui paffe au-travers d’une des
brianches G. C de la tenaille. •
A l extrémité des bras G B , G C du chariot; font
places, de&poignées A B , C D = , environ neuf pouces'
pour placer lejs mains des deu(X ouvriers deilinés i
conduire le chariot. On fait G B = cinq piés deux
pouces... j
„ V01t dans la figure cj, que les branches des
tenailles, ert approchant des poignées, prennent
une courbure , qui met lefdites poignées à une élévation
plus confiderabie, & plus commode aux ouvriers.
. •. . . . • . . .
Pour bien mener le chariot à tenaille j un des deux
ouvriers, doit preffer fur ies poignées, pour enlever
la cuvette de te r re , & l’autre doit pouffer ou tirer
le chariot, fuivant le-lieu où il veut le mener.
j . , 1 Çfi inutile de prendre les cuvettes bien avant
dans la ceinture; ii eft fuffifant qu’on les tienne affez '
pour que leur poids ne les faffe pas échapper. L ’action
de: prendre la cuvette avec les tenailles du chariot
, ell dite embarrerta cuvette.
■ Lorfque la cuvette eft fuffifàmment & affez rarement
embarree, on la tire, du four & on la pofè fur
une terraffe; auprès d’un des baquets. Alors deux ouvriers
s approchent de la cuvette, avec uninftrument
tel que la fig. montré ( p t /cj.) qu’on appelle grapin'.
ë^a Pin a “ x pjés de longueur; il prefente en d
qne fiirface plate Ôç tranchante , qui a deux pouces
c5c demi de d ën c ; ôri appelle d e le foulon, A l’au-
tre extrémité, eft une patte, à-peu-près fèmblable à
celle du graton,.& ayant feulement environ un pou^
ce de c e n / ’, & environ deux pouces & demi de c ert
g. La patte du grapin eft ordinairement de cuivre
1 P‘u,s de propreté. Par-là on n’éft pas fujet aux
pailles, dont le fer eft quelquefois taré , & auxquelles
petit fe prendre le verre.
On fouille avec la patte du grapin, dans lé fond de
là cuyette, on en enlevé tout le Verre , qu’on jette à
chaque fois dans le baquet. Un. des cureurs fe trou-?
vant; par la pofitiôri, trop loin .pour jettér dans le
baquet, on lui préfente une petite poche de cuivre ,
qu on voit fig. 10 , PI. X I X . connue , fous le nom
de poche, du gamin , du nom qu’oii donne communément
au petit ouvrier qui la préfénte. Le curèur remplit
la poche du gamin, qui va énfuite la mettre dans
le baquét. S’il y,a beaucoup de verre dans là cuvette,
on eti ote la plus grande partie, avec la poche du
gamin, avant d’employer le grapin. S’il y a daiis la
cuvette quelque corps qtji réfifte, & qui loit collé au
paroi de la cuvette, lés deux cureurs placent leurs;
foulons de côtés oppofés,,fie font effort l’un contre
lfîiitre pour le détacher. Lorfque là cuvette eft curé
e , les deux ouvriers qiii étoient au chariot à tenailler
, la replacent au. four, comme ils l’eft a voient
Ofee, on rebouche & on remarge, Lorfqu’il y a deux
ciivettes dans un ouvreau , tandis qu’on cure celle
de la tuile, d’autres ouvriers tirent celle du devant Sc
on là cure, au baqu.et .de l’autre arche. Celle des deux
cuvettes qui eft achevé^ de curer la première fe
place devant la.fécônde à la tuile;
. Oiuépeteia même opération aux quatre ouvreaux^
pour curer toutes les cuvettes; :
La dèfcription que nous avons faite des divers ôù-
tils propres au curage ,.a peut-être faii perdre unpeu
de vue j la fuite de .fopératjon, Remettons-la fous
S ij