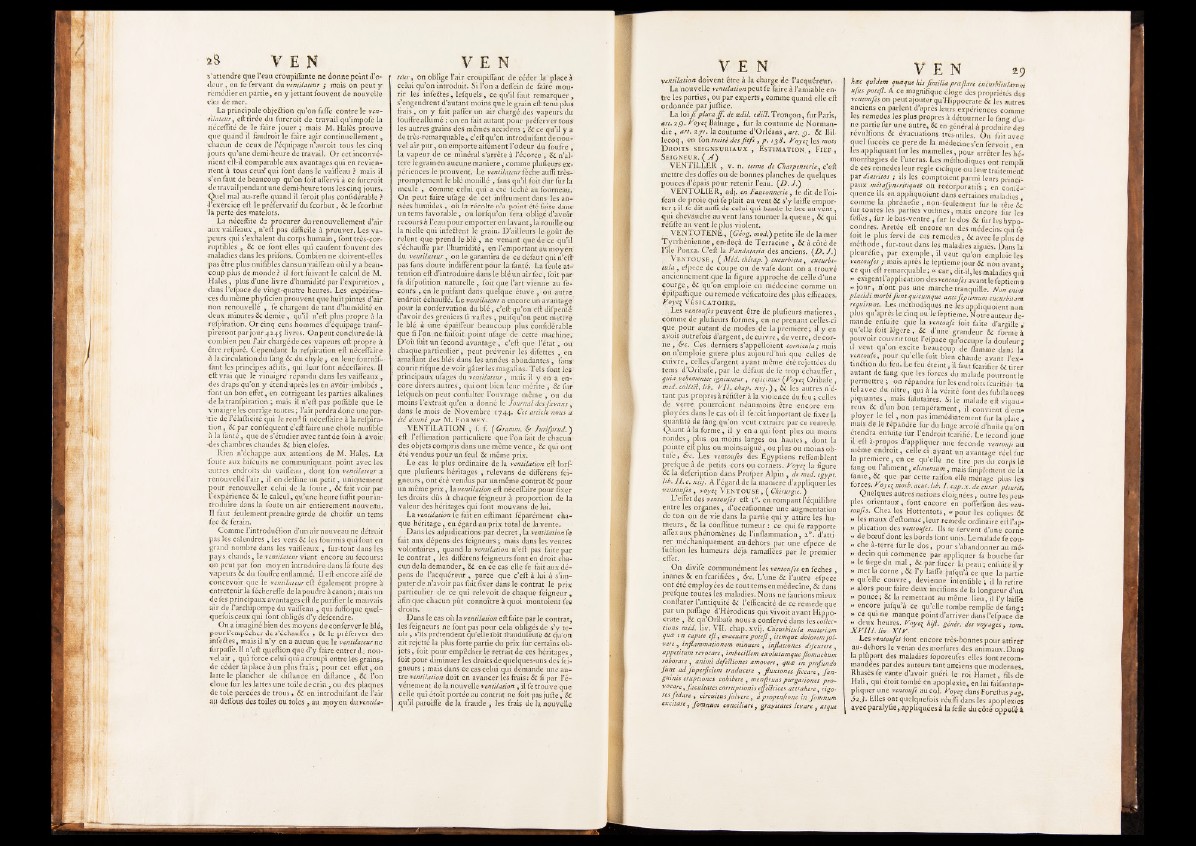
s ’ attendre que l’eau cïoupiffante ne donne point d’odeur
, en le feryant du ventilateur } mais on peut y
remédier en partie, en y jettant fou vent de nouvelle
eau de mer.
La principale ©bjeôion qu’on faffe contre le ventilateur,
eft tirée du furcroît de travail qu’impofe la
néceflîté de le faire jouer ; mais M. Halés prouve
que quand il faudroit le faire agir continuellement,
■ chacun de ceux de l’équipage n’auroit tous les cinq
jpurs qu’une demi-heure de travail. Or cet inconvénient
elt-il Comparable aux avantages qui en reviennent
à tous ceint qui font dans le vaifleau ? mais il
s’en faut de beaucoup qu’on foit affervi à ce furcroît
de travail pendant une demi-heure tous les cinq jours»
Quel mal au-refte quand il feroit plus conliderable ?
•l’exercice eft le préfervatif du fcorbut, & le fcorbut
la perte des matelots.
La néceflite àz procurer du renouvellement d’air
aux vaifleaux, n’eft pas difficile à prouver. Les vapeurs
qui s’exhalent du corps humain, font très-corruptibles
, & ce font elles qui caufent fouvent des
maladies dans les prifons. Combien ne doivent-elles
pas être plus nuifibles dans un vaifleau où il y a beaucoup
plus de monde ? il fort fuivant le calcul de M.
Haies , plus d’une livre d’humidité par l’expiratiorv,
dans l ’efpace de vingt-quatre heures. Les expériences
du meme phyficien prouvent que huit pintes d’air
non renouvelle , fe chargent de tant d’humidité en
tjeux minutes & demie , qu’il n’eft plus propre à Ja
respiration. Or cinq cens hommes d’équipage tranf-
pireront par jour 4245 livres. On peut conclure d e là
combien peu l’air chargé de ces vapeurs eft propre à
êtrerefpiré. Cependant la refpiration eft nécefl'aire
à la circulation du fan g& du chyle i en leur fournif-
fant les principes aéufs, qui leur fçnt néceffaires. Il
eft vrai que le vinaigre répandu dans les vaifleaux,
des draps qu’on y étend après les en avoir-imbibés ,
font un bon effet, en corrigeant les parties alkalines
de la tranfpiration ; mais il n’eft pas poflible que le
vinaigre les corrige toutes; l’air perdra donc une part
ie de l’élafticité qui le rend fi nécefl’aire à la r'efpira-
rion, & par conféquent c’eft faire une chofe nuifible
à la fanté, que de s’étudier avec tant de foin à avoir
•des chambres chaudes & bien clofes.
Rien n’échappe aux attentions de M. Haies. La
foute aux -bifeuits ne communiquant point avec les
qutres endroits du vaifleau, dont fon ventilateur a
renouvellé l’a ir , il en deftine un petit, uniquement
pour renouveller celui de la foute , & fait "voir par
l’ expérience & le calcul, qu’une heure fuffit pourin-
tVoduire dans la foute un air entièrement nouveau.
Il faut feulement prendre garde de choifir untems
fec & ferain.
Comme l’introduétton d’un airnouveau ne détruit
pas les calendres , les vers & les fourmis qui font en
grand nombre dans les vaifleaux , fur-tout dans les
pays chauds, le ventilateur vient encore au fecours :
on peut par fon moyen introduire-dans la foute des
vapeurs & du fouffre enflammé. Il eft encore aifé de
concevoir que le ventilateur eft également propre à
entretenir la féchereffe delà poudre à canon ; mais un
de fes principaux avantages eft de purifier le mauvais
aîr de l’archipompe du vaifleau , qui fuffoque quelquefois
ceux qui font obligés d’y defeendre.
On a imaginé bien des moyens de conferver le blé,
pour l’empêcher de s’échauffer , & le préferver des
in fe â e s, mais il n’y en a aucun que le ventilateur ne
furpaffe. Il n’eft queftion que d’y faire entrer de nouvel
air , qui force celui qui a croupi entre les grains,
de céder là place à un plus frais ; pour cet effet, on
latte le plancher de diftance en diftance , & l’on
cloue fur les lattes une toile de c r in , ou des plaques
de tôle percées de trous, & en introduifant de l ’air
au deffous des toiles ou tôles , au moyen du ventilatetir,
on oblige l’a ir croupiffant de céder la place à
celui qu’on introduit. Si l’on a deffein de faire mourir
les infeftes, lefquels, ce qu’il faut remarquer,
s’engendrent d’autant moins que le grain eft tenu plus
frais, on y fait palier un air chargé des vapeurs du
fouffre allumé : on en fait autant pour préferver tous
les autres grains des mêmes accidens ; & ce qu’il y a
de très-remarquable, c’eft qu’en introduifant de nouvel
air pur, on emporte aifement l’odeur du foufre ,
la vapeur de ce minéral s’arrête à l’écorce , & n’al-
tere le grain en aucune maniéré, comme plufieurs expériences
le prouvent. Le ventilateur féene aufli très-
promptement le blé mouillé , fans qu’il foit dur fur la
meule , comme celui qui a été féché au fourneau.
On peut faire ufage de cet infiniment dans les années
humides , où la récolte n’a point été faite dans
un tems favorable, ou lorfqu’on fera obligé d’avoir
recours à l’ eau pour emporter en lavant, la rouille ou
la nielle qui infeftent le grain. D’ailleurs le-goût de
relent que prend le blé , rie venant que de ce qu’il
s’échauffe par l’humidité, en l’emportant aiimoyen
du ventilateur, on le garantira de ce défaut quin’èft
pas fans doute indifférent pour la fanté. La leule attention
eft d’introduire dans le blé un air fe c , foit par
fa difpofition naturelle , foit que l’art vienne au fé--
cOufs , .én le puifant dans quelque étuve , • ou- autre
endroit échauffé. Le ventilateur a encore un avantage
pour la confervation du b lé , c’eft qu’on eft difpenfé
d’avoir des greniers fi vaftes , puifqu’on peut mettre
le blé à une épaifleur beaucoup plus confidërable
que fi l’on .né faifoit. point ufage de cette machine»
D ’où fuit un fécond avantage , c’eft que l’é ta t, ou
chaque.particulier, peut prévenir les difettes , en
amaflant des blés dans les années abondantes , fans
courir rifque de voir gâter les magaftns. Tels font lé6 '
principaux ufages du ventilateur, mais il y en a encore
divers autres, qui ont bien leur mérite , & fur
lefquels on peut conlulter l’ouvrage même , ou du
moins l’extrait qu’en a donné le Journal des favans »
dans le mois de Novembre 1744. Cet article nous a
été donné par M. FüRMEY.
VENTILATION , f. f. ( Gramm. & Jurifprud. )
eft l’eftimation particulière que l’on fait de chacun
des objets compris dans une même vente, & qui ont
été vendus pour un feul & même prix.
Le cas le plus ordinaire de la ventilation eft lorf-
que plufieurs héritages , relevans de différens fei-
gneurs, ont été vendus par. un même contrat & pour
un meme p rix , la ventilation eft néceffaire pour fixer
les droits dûs à chaque feigneur à proportion de la
valeur des héritages qui font mouvans de lui.
La ventilation fe fait en eftimant féparément chaque
héritage, eu égard au prix total de la vente.
Dans les adjudications par. decret, la ventilation fe
fait aux dépens des feigneurs ; mais dans les ventes
volontaires , quand la ventilation n’eft pas faite par
le contrat, les différens feigneurs font en droit chacun
delà demander, & en ce cas elle fe fait aux dépens
de l’acquéreur , parce que c’eft à lui à s’imputer
de n’avoir pas fait fixer dans le contrat le prix
particulier de ce qui relevoit de chaque feigneur,
afin que chacun pût connoître à quoi montoient fes
droits.
Dans le cas où la ventilation eft faite par le contrat,
les feigneurs ne font pas pour cela obligés de s’y ten
ir , «’ils prétendent qu’elle foit frauduleufe & qu’on
ait rejetté la plus forte partie du prix fur certains objets
, foit pour empêcher le retrait de ces héritages,
Ibit pour diminuer les droits de quelques-uns des feigneurs
; mais dans ce cas celui qui demande une autre
ventilation doit en avancer les frais : & fi par l’é—
venement de la nouvelle ventilation , il fe trouve, que
celle qui étoit portée au contrat ne foit pas jufte, &
.qu’il paroiffe de la fraude , les frais de la nouvelle
\ventilation doivent être à la charge de l’acquéreur»
La nouvelle ventilation peut (e faire à l’amiable entre
les parties, ou par experts, comme quand elle eft
ordonnée par juftice.
La loi f i plura j f . de cedil. edicl. T rotiçon, fur Paris»
art. 2(). Voyc{ B in a g e , fur la coutume de Normandie
, are» 27/. la coutume d’Orléans, art. o. & Bil-
lecoq, en fon traité des fie fs , p. 138 . Voye{ les mots
D r o it s s e ig n e u r ia u x , E s t im a t io n . , F i e f ,
S e ig n e u r » { A )
V EN T IL LE R , v. n* terme de Charpenterie, c’eft
mettre des doffes ou de bonnes planches de quelques
pouces d’épais pour retenir l’eau. (JD. J . )
V EN TO L IER , adj. en Fauconnerie , le dit de Poireau
de proie qui fe plait au vent 6c s’y laifle emporter
; jl fe dit aufli de celui qui bande le bec au v en t,
qui chevauche au vent- fans tourner la queue, & qui
refifte au vent le plus violent.
VEN f O T EN E , (Géog. mod.) petite île de la mer
Tyrrhénienne, en-deçà de Terracine , & à côté de
l ’ile Ponza. C’eft la Pandataria des anciens. (JD. 7.)
r VENTOUSE, ( Méd. thérap. ) cucurbitta, cucurbi-
tu la, efpece de coupe ou de vafe dont on a trouvé
anciennement que la figure approche de celle d ’une
courge, & qu’on emploie en médecine comme uh
épifpaftique ou remede véficatoire des plus efficaces.
Voyéy_ V é s ic a t o ir e .
, Les ventoufes peuvent être de plufieurs matières,
comme de plufieurs formes, en ne prenant celles-ci
que pour autant de modes de la première; il y en
avoit autrefois ff argent, de cuivre, de verre, de corne
, &c,. Ces. derniers s’appelloient cornicula; mais
on n’emploie guère plus aujourd’hui que celles de
cuiv re , celles d’argent ayant même été rejettees du
tems d’Oribafe, par le défaut de fe trop échauffer,
quia.yehementer igniuntur, rejicimus (Voye{ Oribafe ,
med. colùâ. lib. VIL. chap. xvj. ) , & les autres n'étant
pas propres à réfifter à la violence du feu ; celles i
de verre, pourraient néanmoins être encore em- 1
ployées dans le cas où il feroit important de fixer la j
quantité de fang.qu’on veut extraire par ce remede.
Quant à la forme., il y en a qui font plus ou moins
rondes, plus ou moins larges ou hautes, dont la
pointe eft plus ou moins aiguë, ou plus ou moins ob-
tiife, &c. Les ventoufes des Egyptiens reffemblent
prefque à de petits cors ou cornets. Voyt{ la figure
& la defeription dans Profper Alpin , de med. egypt.
lib. I I . c. xiij. A l’égard de la maniéré d’appliquer les
ventoufes , voyeç V en to u s e , ( Chirurgie. )
L ’effet des ventoufes eft i° . en rompant l’équilibre
entre les organes , d’occafionner une augmentation
de ton ou de vie dans la partie qui y attire les hur
ïïieurs, & la conftitue tumeur : ce qui fe rapporte
affezaux phénomènes de l’inflammation, z °. d’attirer
méchaniquement au-dehors par une efpece de
fu&ion les humeurs déjà ramaffées par le premier
effet.
On divife communément les ventoufes en feches ,
jnanes & en fearifiées , &c. L ’une & l’autre efpece
ont été employées de tout tems en médecine, & dans
prefque toutes les maladies. Nous rie faurions mieux
conftater l’antiquité & l’efficacité de ce remede que
par un paflage d’Hérodicus qui yivoit avant Hippocrate
, & qu’Oribafe nous a confervé dans fes collections
med. liv. VII. chap. xvij. Cucurbitula matenam
quoe in capite efi, evacuare potefi, item que dolorem Jol-
vere, infiammationem minuere , injlationes dijeutere
appetitum revocare, imbecillem exolutumque fiomachum
roborare , animi defecliones amovere, quæ in profundo
Junt ad fuperficiem traducere , fluxiones fie c are, fan-
guinis eruptiones cokibere , menfiruas purgaùones pro-
vocare, facilitâtes corrUptionis effectrices attrahere, rigo-
resfedare , circuitus folvere, à propenfione in fomnutn
exettare, fomnutn concUiare, grayitaces levare, atque
hxc quidam quaqut his Jimilia proeflarc iucurbïtuiàrum
ufus poteft. A ce magnifique éloge des propriétés des
ventoufes on peutajoutérqu’Hippocrate & les autres
anciens en parlent d’après leurs expériences comme
les remedes les plus propres à détourner le fang d’u>
ne partie fur une autre, Sc en général à produire des
revulfions & évacuations très-utiles. On fait avec
quel fuccès ce pere de la médecine s’en fervoit en
les appliquant fur les mamelles j pour arrêter les’ hé.
morrhagies de l’uterus, Les méthodiques ont rempli
de ces remedes leur réglé eiclique ou leur traitement
par dUlriios ; ils les comptoientparmi leurs principaux'
mitafyncritiqucs ou reéotÿàratifs ; en conté--
quence ils enappliquoient dans cettaines maladies ,
comme la phrenefte , npn-feulement fur la tête Sc
fur toutes les parties voifmes, mais encore fur les
feffes .fu r le bas-ventre , fur le dos & fur léshypo-
condres. Aretée eft encore un des médecins qui fe
foit le plus fervi de ces remedes, & avec le plus de
méthode , fur-tout dans les maladies aiguës. Dans la
pleuréfie * par exemple, il veut qu’on emploie les
ventoufes ; mais après le feptiéme jour 8c non avant,'
ce qui eft remarquable ; << c a rd it-il, les maladies qui
» exigent rapplieatiOn desvenmtt/ès. avant lefeptieme ,
» jou r, n’ont pas une marche tranquille. Nouenim
placidtmorbi fu nt quicumiue ante fepümum eucurbitum
rcquirUnn Les méthodiques, ne les appliquoient non
pl,i)s .qu’après le cinq ou le feptieme. Notre auteur demande
enfuite que la ventoufe foit faite d’argille ,
qft elle foit'légère , & d’une grandeur 8c forme à
pouvoitcOuvrirtout l’efpace qu’occupe la douleur;
il veut qu’on .excite beaucoup de flamme dans la
ventoufey pour qu'elle foit bien chaude avant l’ex-
tin£h,on du feu. Le feu, éteint:, il faut fearifier 8c tirer
autant de fang que les forces du malade pourront le
permettre ,; on répandra fur les endroits tcarifiés iu
tel avec du nitre, qui à là vérité font des fubftahces
piquantes ? mais falutaires. Si le malade eft vigoureux
8c d’un bon tempérament, il convient d'employer
:1e f e l , non pas immédiatement fur la -plaie ,
mais de le répandre fur du linge arrofé d’huileqifon
étendra enluite fur l’endroit lèarifié. Le fécond jour
il eft àrpropos d appliquer.une fécondé ventoufe au
même endroit, celle ci .ayant, un avantage réel fur
la première , en ce qu’elle ne tire pas dit corps la
fang ou l’aliment, alimentüm ,: mais fnnplèinent de la
famé, 8c que par cette raifon elle ménage plus lès
forces. Koy>e{ morb. aeut.Libi I. cap.x. de curât, pteurit,
Quelques autres nations éloignées, outre les peuples
orientaux , font encore en pofleffion des rea.
toufes. Chez Us Hottentots, « pour les coliques 8c
» les maux d’eftomac, leur remede ordinaire eftl’ap-
» plication des ventoufes. ils ic fervent d’une corne
.» de boeuf dont les bords font unis. Le malade fe cou-
» che à-terre fur lé dos, g fu r s’abandonner u mé*
» decm qui commence par appliquer fa bouche fur
» le fiege du mal, &c par fucer la peau ; enluite il y
» met la corne , & l’y laifle jufqu’à ce que la partie
» qu’elle couvre, devienne infenfible ; il la retire
» alors pour faire deux incifions de la longueur d’un
» pouce; & la remettant au même lieu, il l’y laifle
» encore jufqu’à ce qu’elle tombe remplie de fang:
»> ce qui ne manque point d’arriver dans l’efpace de
» deux heures. Voyez hifi. génér. des voyages, tom, xvm.iiv.xir> ■ ^ 6
Les ventoufes font encore très-bonnes pour attirer
au-dehors le venin desmorfures des animaux.Dans
laplûpart des maladies foporeufes elles font recommandées
par des auteurs tant anciens que modernes.
Rhasès fe vante d’avoir guéri le roi Hamet, fils de
Hali, qui etoit tombé en apoplexie, en lui faifantap-
pliquer une ventoufe au col. Voye^ dans Forelluspag.
6 2 3 . Elles ont quelquefois réuffi dans les apoplexies
ayec paraiyfie».appliquées à la feffe du côté oppefé à