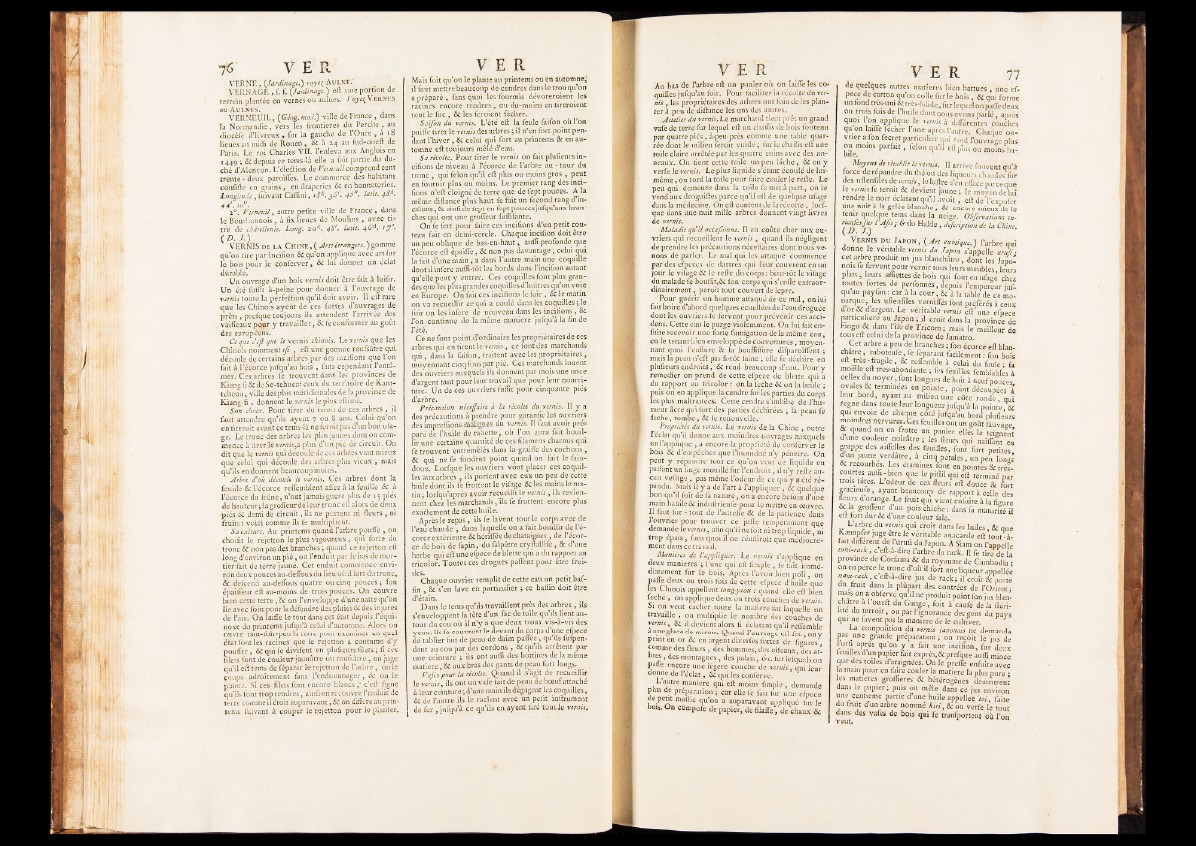
VERNE, (Jardinage!) voye\ AulnE.
VERNAGE , f. f. (Jardinage.) eft une portion de
terrein plantée en vernês ou aulnes. Foye^VERNES
ou A u l n e s .
VERNEUIL, (Géog.mod.) ville de France, dans
la Normandie, Vers les frontières du Perche , au
diocèfe d’Evreux, fur la gauçhe de l’Oure , à 18
lieues an midi de Rouen , 6c à 24 au fùd-oueft de
Paris. Le roi Charles VII. l’enleva aux Auglois en
3 449 ; 6c depuis ce tems-là elle a fait partie dit duché
d’Alençon. L’éleftion de Verneuil comprend cent
trente-deux paroïffes. Le commerce des habitans.
confifte en grains, eft draperies & en bonneteries.
Longitude, fuivant Càffini, i8 A. g S '. 4 ^ . latit. 48 A.
4 4 !. 10".
i°. Verneuil, autre petite ville de France, dans
le Bourbonnois, à fix lieues de Moulins , avec titre
de châtellenie. Long. z o A. 4$ '• Itttdt. 4&A. 1 y •
( D . J . )
VERNIS DE LA C h in e , ( J rts etrangers. ) gomme
qü’on tire par incifion 6c qu’on applique avec art fur
le bois pour le conferver, 6c lui donner un éclat
durable. _ .
Un ouvrage d’un bois vernis doit être fait a loifir.
Un été fuffit à-peine polit donner à l’ouyrage de
vernis tome la perfection qu’il doit avoir. 11 eu rare
que les Chinois ayent de cés fortes d’ouvrages de
prêts , prefque toujours ils attendent l’arrivée des;1
vàiffeaux pqjir y travailler, 8ifeconformer au goût
des européèns.
Ce que défi, que le vernis chinois. Le vernis que les
Chinois nomment tjî , eft une gomme roufsatre qui
découle de certains arbres par des incifions que l’on
fait à l’écorce jufqu’au bois , fans cependant l’entamer.
Ces arbres fe trouvent dans les provinces de
Kiang-fi & de Se-tehuen: ceux du territoire de Kant-
tcheou, ville des plus méridionales de la province de
Kiang-fi , donnent le vernis le plus eftimé.
Son choix. Pour tirer du vernis de ces arbres , il
faut attendre qu’ils ayent 7 ou 8 ans. Celui qu’on
en tireroit avant ce tems-là ne feroit pas d’un bon ufa-
ge. Le tronc des arbres les plus jeunes dont on commence
à tirer le vernis,a plus d’un pie de circuit. On
dit que le vernis qui découle de ces arbres vaut mieux
que celui qui découle des arbres plus vieux , mais
qu’ils en donnent beaucoup moins.
Arbre d’où découle le vernis. Ces arbres dont la
feuille &: l’écorce reffemblent affez à la feuille & à
l’écorce du frêne, n’ont jamais guere plus de 1 5 piés
de hauteur ; la groffeur de leur tronc eft alors de deux
-piés 6c demi de circuit, ils ne portent ni fleurs , ni
fruits : voici comme ils fe multiplient.
Sa culture. Au printems quand l’arbre pouffe , on
choifit le rejetton le plus vigoureux, qui forte du
tronc 6c non pas des branches ; quand ce rejetton eft
long d’environ un pié, on l’enduit par le bas de mortier
fait de terre jaune. Cet enduit commence environ
deux pouces au-deffous du lieu où il fort du tronc,
& defeend au-deffous quatre ou cinq pouces ; fon
épaifieur eft au-moins de trois pouces. ■ On couvre
bien cette terre ,& on l’enveloppe d’une natte qu’on
lie avec foin pour la défendre des pluies ck des injures
de l’air. On laiffe le tout dans cet état depuis l’équinoxe
du printems jufqu’à celui d’automne. Alors on
ouvre tant-foit-peu la terre pour examiner en quel
état font les racines que le rejetton a coutume d’y
pouffer , 6c qui fe divifent en plufieurs filets ; fi ces
filets font de couleur jaunâtre ou roufsatre , on juge
qu’il eft tems de féparer le rejetton de l’arbre , on le
çoupe adroitement fans l’endommager, & on le
planté. Si ces filets font encore blancs |f c’eft figne
qu’ils font trop tendres, ainfion recouvre l’enduit de
terre comme il étoit auparavant, & on différé au printems
fiüvant à couper le rejetton pour le planter.
Mais Toit qu’on le plante au printems ou en automne^
il faut mettre beaucoup de cendres dans le trou qu’on
a préparé , fans quoi les fourmis dévoreroient les
racines encore tendres ,. ou du-moins en tireroient
tout le fuc , 6L les feroient fécher.
Saifon du vernis. L’été eft la feule faifon où l’on
puifl’e tirer le vernis des arbres ; il n?en fort point pendant
l’hiver, & celui qui fort au printems & en automne
eft toujours mêlé d’eau.
Sa récolte. Pour tirer le vernis on fait plufieurs incifions
de niveau à l’écorce de l’arbre au - tour du
tronc , qui félon qu’il eft plus ou moins gros , peut
eft fournir plus ou moins. Le premier rang des incifions
n’eft éloigné de terre que de fept pouces. A la
même diftance plus haut fe fait un fécond rang d’in-
cifions, & ainfide fept en fept pouces jufqu’aux branches
qui ont une groffeur fuffifante.
On fe fert pour faire ces incifions d’un petit couteau
fait en demi-cercle. Chaque incifion doit être
un peu oblique de bas-en-haut, aufli profonde que
l’écorce eft épaiffe, 6c non pas davantage ; celui qui
la fait d’une main, a dans l’autre main une coquille
dont il inféré aufli-tôt les bords dans l’incifion autant
qu’elle peut y entrer. Ces coquilles font plus grandes
que les plus grandes coquilles d’huitres qu’on voie
en Europe. On fait ces incifions le foir , 6c le matin
on va recueillir ce qui a coulé dans les coquilles ; le
foir on les inféré de nouveau dans les incifions , 6c
l’on continue de la même maniéré jufqu’à la fin de
l’été.
Ce ne font point d’ordinaire les propriétaires de ces
arbres qui en tirent levernis, ce font des marchands
qui, dans la faifon, traitent avec les propriétaires, :
moyennant cinq fous par pie. Ces marchands louent
des ouvriers auxquels ils donnent par mois une once
d’argent tant pour leur travail que pour leur nourriture.
Un de ces ouvriers fuffit pour cinquante piés
d’arbre.
Précaution nécejfaire a la récolte du vernis. Il y a
des précautions à prendre pour garantir les ouvriers
. des impreffions malignes du vernis. Il faut avoir préparé
de l’huile de rabette, où l’on aura fait bouillir
une certaine quantité de ces filamens charnus qui
fé trouvent entremêlés dans la graiffe des cochons ,
& qui ne fe fondent point quand on fait le fain-
doux. Lorfque les ouvriers vont placer ces coquilles
aux arbres , ils portent avec eux un peu de cette
huile dont ils fe frottent le vifage & lés mains le matin;
lorfqu’après avoir recueilli le vernis, ils reviennent
chez les marchands, ils fe frottent encore plus
exaftement de cette huile.
Après le repas, ils fe lavent tout le corps avec de
l’eau chaude , dans laquelle on a fait bouillir de l’écorce
extérieure &hénffée de châtaignes , de l’écorce
de bois de fapin, du falpêtre cryftallifé , & d’une
herbe qui eft une efpece de blette qui a du rapport au
tricolor. Toutes ces drogues paffent pour être froides.
' .
Chaque ouvrier remplit de cette eau un petit baf-
fin 6c s’en lave en particulier ; ce bafîin doit être
d’étain.
Dans le tems qu’ils travaillent près des arbres , ils
s’enveloppent la tête d’un fac de toile qu’ils lient autour
du cou où il n’y a que deux trous vis-à-vis des
yeux. Ils fe couvrent le devant du corps d’une efpece
de tablier fait de peau de daim paffée, qu’ils fufpen-
dent au cou par des cordons , 6c qu’ils arrêtent par
une ceinture ; ils ont aufli des bottines de la même
matière, 6c aux bras dès gants de peau fort longs,
Vafes pour la récolte. Quand il s’agit de recueillir
le vernis, ils ont un vafe fait de peau de boeuf attaché
à leur ceinture ; d’une main ils dégagent les coquilles,
6c de l’autre ils le raclent avec un petit inftrument J de fer , jufqu’à ce qu’ils en ayent tiré tout-le vernis.
Au bas de i’arbre eft un panier où on laifle les coquilles
jufqu’au foir. Pour faciliter la récolte du ver-
nis 9 les propriétaires des arbres ont foin de les planter
à peu de diftance les uns des autres.
Attelier du vernis. Le marchand tient prêt un grand
vafe de terre fur lequel eft Un chaffis de bois fijutenu
par quatre p iés, à-peu-près comme une,table quar-
rée dont le milieu feroit vuide ; furie chaffis eft une
toile claire arrêtée par les quatre coins avec des anneaux.
On tient cette toile un peu lâche, 6c on y
verfe le vernis. Le plus liquide s’étant écoulé de lui-
même , on tord la toile pour faire couler le refte. Le
peu qui demeure dans la toile fe met à part, on le
vend aux droguiftes parce qu’il eft de quelque ufage
dans la médecine. On eft content de larécolte , lorfque
dans une nuit mille arbres donnent vingt livres
de vernis.
Maladie qu’i l occafionne. Il en coûte cher aux ouvriers
qui recueillent le vernis , quand iis-négligent
de prendre les précautions néceflaires dont nous ve nons
de parlef. Le mal qui les attaque commence
par des efpeces de dartres qui leur couvrent en un
jour le vifage 6c le refte du corps : bien-tôt le vifage
du malade fe bouffit,& fon corps qui s’enfle extraordinairement
, paroît tout couvert de lepre.
Pour guérir un homme attaqué de ce mal, on lui
fait boire d’abord quelques écuellées de l’eau droguée
dont les ouvriers le fervent pour prévenir ces acci-
dens. Cette eau le purge violemment. On lui fait en-
fuite recevoir une forte fumigation de la même eau,
en le tenant bien enveloppé de couverturesmoyennant
quoi l’enflure & la bouffiffure difparoiffent ;
mais la peau n’eft p'as fi-tôt faine ; elle fe déchire en
plufieurs endroits, 6c rend beaucoup d’eaü. Pour y
remedier on prend de cette efpece de blette qui a
du rapport au tricolor : on la lèche 6c on la brûle ;
puis on en applique la cendre furies parties du corps
les plus maltraitées. Cette cendre s ’imbibe de l’humeur
âcre qui fort des parties déchirées ; la peau fe
feche, tombe, 6c fe renouvelle.
Propriétés du vernis. Le vernis de la Chine , outre
l’éclat qu’il donne aux moindres ouvrages auxquels
on l’applique , a encore la propriété de conferver le
bois 6c d’empêcher que l’humidité n’y pénétré. On
peut y répandre tout ce qu’on veut de liquide en
paffant un linge mouillé fur l’endroit, il n’y refte aucun
veftige , pas même l’odeur de ce qui y a été répandu.
Mais il y a de l’art à l’appliquer , 6c quelque
bon qu’il foit de fa nature, on a encore béfoin d’une
main habile 6c induftrieufe pour le mettre en oeuvre.
Il faut fur - tout de l ’adrefiè 6c de la patience dans
l’ouvrier pour trouver ce jufte tempérament qije
demande le vernis, afin qu’il ne foit ni trop liquide, ni
trop épais, fans quoi il ne réuffiroit que médiocrement
dans ce travail.
Maniérés de l'appliquer. Le vernis s’applique en-
deux maniérés ; l ’une qui eft fimple , fe fait immédiatement
fur le bois. Après l’avoir bien p o li, on
paffe deux ou trois fois de cette efpece d’huile que
les Chinois appellent tongyeou : quand elle eft bien
le ch e , on applique deux ou trois couches de vernis.
Si ori veut cacher toute la matière fur laquelle on
travaille , on multiplie le nombre des couches de
vernis, & il devient alors fi éclatant qu’il reffemble
a une glace de miroir. Quand l’ouvrage eft fe c , on y
peint en or & en argent diverfes fortes de figures
comme des fleurs , des hommes, d'es oifeaux, des ar-
brel , des montagnes , des palais, &c. furlefquelson
patte encore une légère couche de vernis, qui leur
donne de l’é c la t, 6c qui les conferve.
L autre maniéré qui eft moins fimple , demande
plus de préparation ; car elle fe fait lur une efpece
de petit maftic qu’on a auparavant appliqué fur le
bois. On compoie de papier, de filaffe, de chaux 6c
(îè quelques autres matières bien battues , une ef-
pece de carton qu’on colle furie bois , & qui forme
un fond tres-um & très-folide/fur lequel on paffe deux
ou trois fois de l’huile donnjous ayons parlé, après
quot 1 on applique le verdis à différentes Couches
qu on laiffe fécher l’une après l ’autre. Ch aâu é ouvrier
a fon fecret particulier qui rend l’ouvrage plus
ou moins parfait, félon qu’il' eft plus ou moins ha-
Moyens dtrlmbltrlevtmiS. Il arnve fouventqu’à
force de répandre du thé ou dès liqueurs chaudes fur
des uftenfiïès de vernis, leluftre s’en efface parce que
le vernis fe ternit & devient jaune ; le moyen de lut
rendre _Ie noir éclatant qu’tfavOit , eft de l’expofer
une nuit à la gelee blanche, & encore mieux de le
tenir quelque tems dans la neige. Obfirvaùons su-
l AJ u > &dlt H d ïe , defeription de là Chine,
V e r n i s # J a p o n , ( A r t e x o d ^ u e . ) l’arbre qui
donne le véritable vernis du Jupon s’appelle mûris
cet arbre produit un jus blanchâtre, .dont les Japo-
nois le lerventpôur vernir tous leurs meubles leurs
plats s leurs affiettes de bois qui fontenufagè che2
toutes fortes dé peffonnes, depuis l’empereur iuf-
qu au payfan : car à la cour, & à la tablé de ce monarque,
lès üftenfiles vernifles font préférés à ceux
d or & d argent. Le véritable vernis eft'une efpèce
particulière au Ja’p'on; il croît dans la province de
Fingo & dans l ’île de Tricom; mais le meilleur de
tous eft celui de la province de Jamatto.
Cet arbre a peu de branches ; fon écorce eftblan-
c-hâtre, raboteufe fe féparant facilement : fon bois
H i r a r a i celui du faille; fa
moelle eft tres-abondante ; Tes feuilles femblables à
celles du n o y e r , font longues de huit à n euf pouces
Ovales oc terminées, en pointe, point d&ëùp'ées à’
leur „bord, ayant au milieu une côte ronde, oui
régné dans toute leur longueur jufqu’à la pointe &
qui envoie de chaque côté jufqu’au bord plufieurs
moindres nervures. Ces feuilles ont un goût fàuvage
& quand oq en frotte un panier elies le téigrient
dune coul-eilr noirâtre ; les fleurs qui naiffent en
grappe des aiffelles des feuilles, font fort petites'
ffun jaune verdâtre, à cinq pétales,, ud peu longs’
oc recourbes. Les etammes font en pointes & très-
courtes aufli-bien que le piftil qui eft terminé par
trois têtes. L odeur de ces fleurs eft douce & fort
gracieufe, ayant beaùcotip de rapport à celle des
Heurs d orange. Le fruit qui vient enfuite à la figure
& la groffeur d’un pois chiche : dans fa maturité il
elt tort dur 6c d une couleur fale.
L’arbre durerais qui croît dans les Indes, & que
Kæmpfer juge être lé véritable anacarde eft tout-à-
f e t différent de l’urufi du Japon, k Siatn on l ’appelle
toni~rack , e eft-à-dire l’arbre du rack. Il fe tiré de la
province de Corfama & du royaume de Cambodia •
on en perce le tronc d’oû il fort une liqueur appelléê
nam raek c eft-à-dlre jus de rack; il croît à porte
du truit dans la plupart des contrées de l’Orient;
mais on a obfervé qu’il ne produit point fon jus blanchâtre
à 1 oueft du Gange, foit à caufé de la ftéri-
. du terroir, ou pat l’ignorance des gens du pays
qui ne favent pas la maniéré de le cultiver.
La compoution du vernis japonais ne demande
pas une grande préparation ; on reçoit le jus de
lurfi après qu’on y a fait une incifion, fur deux
feuilles d’un papier 6 it exprès, & prefque aufli mince
que des toiles d’araignées. On le preffe enfuite avec
la main pour en faire couler la matière la plus pure •
les matières groflieres & hétérogènes demeurent
dans le papier; puis on mêle dans ce jus environ
une centième partie d’une huile appèileé à c i, faite
du fruit d’un arbre nommé k ir i, & oh verfe le tout
dans des vafes de bois qui fe tranfportent dû l’on
veut.