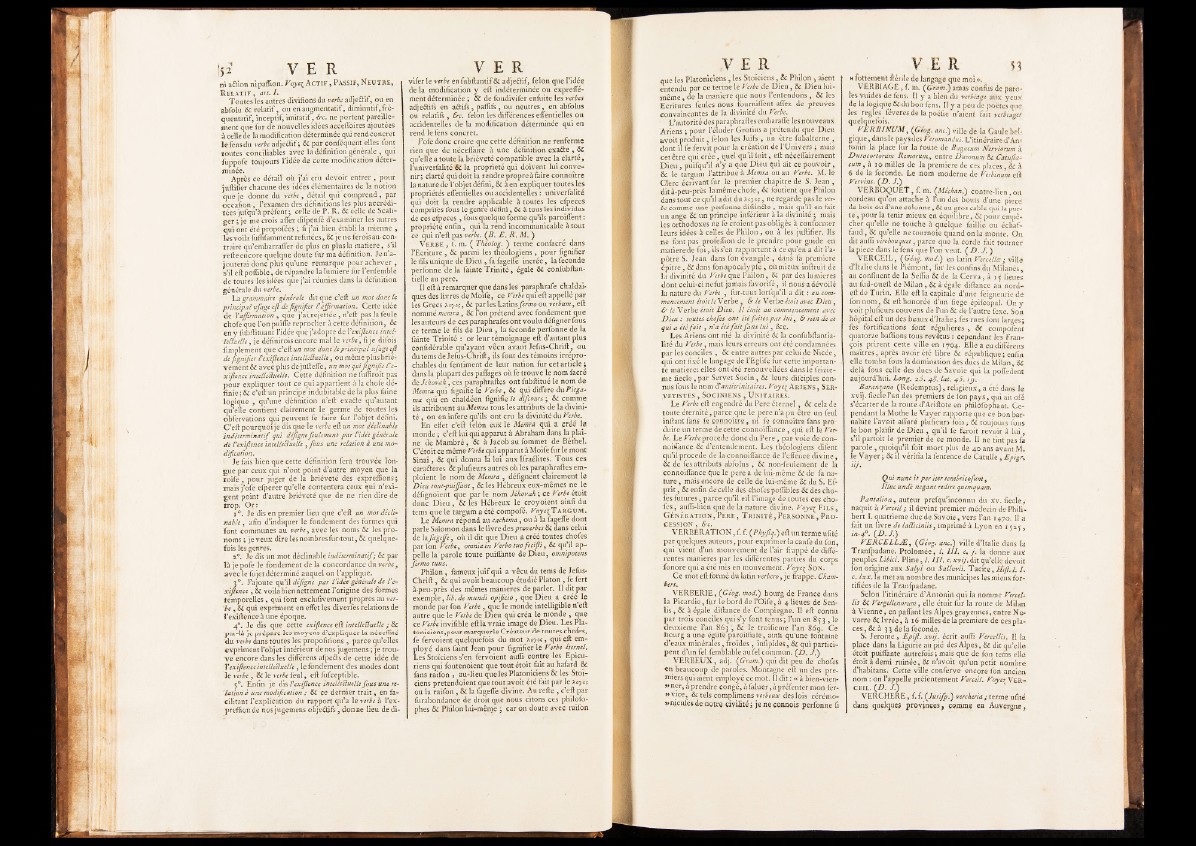
ni aôion nipaffion. Voyt{ A c t i f , P a s s if , N e u t r e ,
R e l a t i f , art. I.
Toutes les autres divifionsdu verbe adjeéhf, ou en
abfolu & relatif, ou en augmentatif, diminutif, fréquentatif,
inceptif, imitatif, &c. ne portent pareillement
que fur de nouvelles idées accefloires ajoutées
à celle de la modification déterminée qui rend concret
lefensdu verbe ad je â if ; 8c par conféquent elles font
toutes conciliables avec la définition générale , qui
fuppofe toujours l’idée de cette modification déterminée.
Après ce détail oît j’ai cru devoir entrer , pour ‘
juftifier chacune des idées élémentaires de la notion
que je donne du verbe , détail qui'comprend , par
occafion, l’examen des définitions les plus accréditées
jufqu’à préfent; celle de P. R. & celle de Scali-
ger ; je me crois affez difpenfé d’examiner les autres
qui ont été propofées ; fi j’ai bien établi la mienne ,
les voila fuffifamment refutées, & je ne ferois au-contraire
qu’embarraffer de plus en plus la matière, s’il
refte encore quelque doute fur ma définition. Je n’ajouterai
donc plus qu’une remarque pour achever ,
s’il eft poffible, de répandre la lumière fur l’enfemble
de toutes lés idées que j’ai réunies dans la définition
générale du verbe.
La grammaire generale dit que c’ eft un mot dont le
principal ufage ejl de Jignifier l'affirmation. Cette idée
de Y affirmation , que j’aire je ttée , n’eft pas la feule
chofe que l’on puiffe reprocher à cette définition, 8c
en y fubftituant l’idée que j’adopte de Yexijlence intellectuelle
, je définirois encore mal lé verbe, fi je difois
finalement que c’eft un mot dont1 le principal ufage ejl
de (ignifier Pexifience intellectuelle, ou même plus brièvement
8c avec plus de jufteffe, un mot quifignifie Ve-
xijlence intellectuelle. Cette définition ne fuffiroit pas
pour expliquer tout ce qui appartient à la chofe définie
; & c’eft un principe indubitable de la plus faine
logique , qu’une définition n’eft exafte qu’autant
qu’elle contient clairement le germe de toutes les
obfervations qui peuvent fe faire fur l’objet défini.
C ’eft pourquoi je dis que le verbe eft un mot déclinable
indéterminatif qui défigne feulement par l'idée générale
de Pexifience intellectuelle , fous une relation à une modification.
Je fais bien que cette définition fera trouvée longue
par ceux qui n’ont point d’autre mbyen que la
îoife , pour juger de la brièveté des expreflîons;
mais j’ofe efperer qu’elle contentera ceux qui n’exigent
point d’autre brièveté que de ne rien dire de
trop. Or:
i ° . Je dis en premier lieu que c’eft un mot déclinable
, afin d’indiquer le fondement des formes qui
font communes au verbe, avec les noms 8c les pronoms
; je veux dire les nombres fur-tout, 8c quelquefois
les genres.
i ° . Je dis un mot déclinable indéterminatif; 8c par
là je pofe le fondement de la concordance du verbe,
avec le fujet déterminé auquel on l ’applique.
3 ° . J’ajoute qu’il déjigne par l'idée générale de Ve-
xijtence , 8c voila bien nettement l’origine des formes
temporelles, qui font exclufivement propres au ver-
‘le , 8c qui expriment en effet les diverfes relations de
l’exiftence à une époque.
4°. Je dis que cette exijlence eft intellectuelle ; 8c
^par-là je prépare les moyens d’expliquer la néceflité
du verbe dans toutes les propofitions , parce qu’elles
expriment l’objet intérieur de nos jugemens ; je trouv
e encore dans les différens afpefts de cette idée de
Yexijtence intellectuelle, le fondement des modes dont
le verbe , & le verbe feul, eft fufceptible.
5°. Enfin je dis Texijlence intellectuelle fous une réflation
à une modification : 8c ce dernier trait, en facilitant
l’explication du rapport qu’a le verbe à l’ex-
preflionde nos jugemens objectifs, donne lieu de divifer
le verbe enfubftantif 8c adje&if, félon que l’idée
de la modification y eft indéterminée ou expreffé-
ment déterminée ; 8t de foudivifer enfiiite les verbes
adjettifs en a ftifs, paffifs , ou neutres, en abfolus
ou relatifs , &c. félon les différences effentielles ou
accidentelles de la modification déterminée qui en
rend le fens concret.
J ’ofe donc croire que cette définition ne renferme
rien que de néceffaire à une définition exafte , 8c
qu’elle a toute la brièveté compatible avec la clarté,
Euniverfalité’& la propriété qui doivent lui convenir;
clarté qui doit la rendre propre à faire connoître
la naturé de l’objet défini, & à en expliquer toutes les
propriétés effentielles ou accidentelles : univerfalité
qui doit la rendre applicable à toutes lés efpeces
comprifes fous le genre défini, & à tous les individus
de ces efpeces, fous quelque forme qu’ils paroiffent :
propriété enfin, qui la rend incommunicable à tout
ce qui n’ eft pas verbe. (B . E . R . M. )
V e r b e , 1’. m. ( Theolog. ) terme confacré dans
l’Ecriture, 8c parmi les théologiens , pour fignifier
le fils unique de Dieu , fa fageffe incrée, la fécondé
perfonne d e là fainteTrinité, égale 8c confubftan-
tielle au pere.
Il eft à remarquer que dans les paraphrafe chaldaï-
ques des livres de Moïfe, ce Virbe qui eft appellé par
les Grecs hoyoè, 8c parles Latins fermo ou verbum, eft
nommé memra, 8c l’on prétend avec fondement que
les auteurs de ces parapnrafes ont voulu défigner fous
ce terme le fils de D ie u , la fécondé perfonne de la
fainte Trinité : or leur témoignage eft d’autant plus
confidérable qu’ayant vécu avant Jefus-Chrift, ou
dutemsde Jefus-Chrift, ils font des témoins irréprochables
du fentiment de leur nation fur cet article ;
dans la plupart des paffages otife trouve le nom facré
de Jéhovah, ces paraphraftes ont fubftitué le nom de
Memra qui fignifie le Verbe, 8c qui différé du Pitga-
ma qui en chaldéen fignifie le difeours ; 8c comme
ils attribuent au Memra tous les attributs de la divinité
, on en inféré qu’ils ont cru la divinité du Verbe.
En effet c’êft félon eux le Memra qui a créé le
monde ; c’eft lui qui apparut à Abraham dans la plaine
de Mambré, 8c à Jacob au fommet de Béthel.
C’étoit ce même Verbe qui apparut à Moïfe fur le mont
Sin aï, 8c qui donna la loi aux Ifràélites. Tous ces
cara&eres & plufieurs autres où les paraphraftes emploient
le nom de Memra , défignent clairement le
Dieu tout-puiffiant, & les Hébreux eux-mêmes ne le
défignoient que par le nom Jéhovah ; ce Virbe étoit
donc D ie u , & les Hébreux le croyoient ainfi du
tems que le tàrgum a été compofé. V jy^TARGUM.
Le Memra répond au cachema, ou à la fageffe dont
parle Salomon dans le livre des proverbes 8c dans celui
de lafageffe, où il dit que Dieu a créé toutes chofes
par fon Verbe, omnia in Verbo tuo fecifti, 8c qu’il appelle
la parole toute puiffante de D ieu, omnipotens
fermo tuus.
Philon, fameux juif qui a vécu du tems de Jefus-
Chrift , 8c qui avoit beaucoup étudié Platon , fe fert
à-peu-près des mêmes maniérés de parler. II.dit par
exemple, lib. de mundi opificio, que Dieu a créé le
monde par fon Verbe , que le monde intelligible n’eft
autre que le Verbe de Dieu qui créa le monde , que
ce Verbe invifible eft la vraie image de D ieu. Les Platoniciens,
pour marquer le Créateur de toutes chofes,
fe fervoient quelquefois du mot xoyoç, qui eft employé
dans faint Jean pour fignifier le Verbe éternel.
Les Stoïciens s’en fervoient aufli contre les Epicuriens
qui foutenoient que tout étoit fait au hafard 8c
fans raifon , au-lieu que les Platoniciens & les Stoïciens
pretendoient que tout avoit été fait par le Xoyoc
ou la raifon, 8c la fageffe divine. Au refte , c’ eft par
furabondance de droit que nous citons ces philofo-
phes 8c Philon lui-même ; car on doute avec raifon
que les Platoniciens, les Stoïciens , 8c Philon > aient
entendu par ce terme le Verbe de D ieu , 8c Dieii hti-
même, de la maniéré que nous l’entendons , 8c les
Ecritures feules nous fôurniffent affez de preuves
convaincantes de la divinité du V>.rbè.
L’autorité des paraphraftes eftibaraffe les nouveaux
Ariens ; pour l’éluder Grotius a prétendu que Dieu
avoit p rod u it fé lon les Juifs -, un être fübalterne ,
dont il fe fervit pour la création de l ’Univers ; mais
cet être qui crée , quel qu’il fo it, eft nécèffairement
D ie u , puifqu’il n’y a que Dieu qui ait ce pouvoir,
8c le targuin l’attribue à Memra ou au Verbe. M. le
Clerc écrivant fur le premier chapitre de S. Jean ,
dit à-peu-près la même chofe, 8c foutient que Philon
dans tout ce qü’il a dit du hoyce, ne regarde pas le verbe
comme une perfonne diftinâe , mais qu’il en fait
un ange 8c un principe inférieur à la divinité ; mais
les orthodoxes ne fe croient pas obligés à conformer
leurs idées à celles de Philon, ou à les juftifier. Ils
ne font pas prôfeflion de le prendre pour guide eii
matière de fo i, ils s’en rapportent à Ce qu’ èn a dit l’â-
pôtre S. Jean dans fon évangile , dans fâ première
épitre, & dans fonapOcalypfe , où mieux inftruit dé
la divinité du Verbe que Philon, 8c par des liimieres
dont celui-ci ne fut jamais favorifé, il nous a dévoilé
la nature du Verbe , fur-tout lorfqli’il a dit : au commencement
étoit le V erbe , & le Verbe éloit avec Die ii,
& le y erbe étoit Dieu. I l étoit au commericernent avec
Dieu : toutes chofes ont été fûtes par lu i, & rien de ce
qui a étéfait , r i a été fait fan s lui , & c .
Les Ariens ont nié la divinité 8c la confubftaiitia-
lité du Verbe, mais leurs erreurs ont été condamnées
par les conciles , 8c entre autres par celui de Nicée,
qui ont fixé le langage de l’Eglife fur cette importan- ,
te matière: elles ont été renOuvellées dans le feizie-
me fiecle, par Servet S ocin, 8c leurs difciples connus
fous le nom d'antitrinitaires. Voye{ A r Ie Ns , S er -
VETISTES , SOCINIENS , UNITAIRES.
Le Verbe eft engendré du Pere éternel, 8c cela de
toute éternité, parce que le pere n’a pu être un feitl
inftant fans fe connoître , ni fe connoître fans produire
un terme de cette connoiffartce , qui eft le Verbe.
Le Verbe procédé donc du Pe re , par voie décon-
noiffance 8c d’entendement. Les théologiens difertt
qu’il procédé de la connoiflance de l’effence divine,
8c de fes attributs abfolus , 8c non-feulement de la
connoiflance que le pere a de lui-même 8c de fa nature
, mais encore de celle de lui-même 8c du S. Ef-
p r it, 8c enfin de celle des chofes pofliblês 8c des choies
futures, parce qu’il eft l’image de toutes ces choie
s , aufli-bien que de la nature divine. Voye^ F il s ,
G é n é r a t io n , Pe r e , T r in it é , Pe r so n n e , Pr o c
e s s io n , &c.
V ER B ÉR A T IO N , f. f. (Phyfiq.) eft un terme ufité
par quelques auteurs, pour exprimer la caufe du fort,
qui vient d’un mouvement de l’air frappé de différentes
maniérés par les différentes parties du corps
fonore qui a été mis en mouvement. Voye\ S o n .
Ce mot eft formé du latin verbtro, je frappe. Charniers.
V E R B E R IE , ( Géog. rnodJ) bourg de France dans
la Picardie, fur le bord de l’Oife, à 4 lieues de Sen-
l i s , 8c à égale diftance de Compiegne. Il eft connu
par trois conciles qui s’y font tenus ; l’un en 8 5 3 , le
deuxieme l’an 863 ', 8c le troifieme l’an 869. Ce
bourg a une églife paroifîiale, ainfi qu’une fontaine
d’eaux minérales, froides , infipides, 8c qui participent
d’un fel femblableâufel commun. (D . / .)
V E R B EU X , adj. (Gram'.) qui dit peu de chofes
en beaucoup de paroles. Montagne eft un des premiers
qui aient employé ce mot. 11 dit : « à bien-vien*
» ner, a prendre congé, à faluer, à préfenter mon fer-
»v ice , 8c tels complimens verbeux des lois cérémo-
wniçufes de notre civilité; je ne connois perfonne fi
» fotiement ftérile de langage que moi »*
V E R B IA G E , f. m» (Gram.) ànïâs confus de paro-*
l'eS viiides de fens. Il y a bien du verbiage aux yeuX
de la logique 8c du bon-fens. Il y a péu de poètes que
les réglés féveres de la poéfie n’aient fait verbiaget
quelquefois.
, V E R B ÎN Ü M , (Géog. ànci) ville de la Gaule bel*
gique, dans le pays dès Veromandui. L^tinéraire d’An*
tonitï là placé fur la foute de Bagacum Nerviorum à
Durocortortlm RemorUrn, entre Duronum 8c Catufia*
cum, à ïô milles de la pfemiere de ces places 8c à
6 de la fécônde. Le nom moderne de Verbinum eft
Vervins. (D.
VERBO.QUET , f. m. (Méchani) contre-lien, oit
Cordeau qù’on attache à l’un des bouts d’une pièce
dé bois OU d’une colonne, 8c au gros cable qui la por*
tè y pour lâ tenir mieux en équilibre, 8t pour empê*
cher qu’elle ne toiiche à qiielque faillie ou échafr
faiid, 8t qu’elle ne tournoie quand on la monte. On
dit aufli Viïebbuquet, parce que la corde fait tourner
la piece dans le fens que l’on veut. (D . J . )
V E R C E IL , (Géog. rtîodf en latin Vercelloe ; ville
d’Italie dahs le Piémont, fur les confins du Milanès *
ali Confluent de la Seflia 8c de la Ce rv a , à 15 lieues
âu fiid-oueft de Milan, 8c à égale diftance au nord-^
eft dé Turiil. Elle èft la capitale d’une feigneurie dé
fon nom, 8c eft honorée d’un fiege épifcopal. On y
voit plufieurs couvens de l’un 8c de l’autre fexe. Son
hôpital eft un des beaux d’Italie ; fes rués font larges;
fe$ fortifications font régulières , 8c compofent
quatorze battions tous revêtus : cependant les François
prirent Cette ville en 1704. Elle a eu différens
maîtres, après avoir été libre 8c république ; enfin
elle tomba fous la domination des ducs de Milan 8c
delà fous celle des ducs de Savoie qui la poffedent
aujourd’hui. Long. 26. 48. lat. 46. icn
Barançario (Redemptus), religieux, à été dans le
xvij. fiecle l’urt des premiers de fort p a y s, qui ait of0
S’écarter de la route d’Ariftote en philôfophant. Ce*
pendant la Mothe le Vayer rapporte que ce bon bar*
nabite l’avoit affuré plufieurs fo is , 8C toujours fous
le bon plaifir de Dieu , qu’il fe feroit revoir à lu i ,
s’il partoit le premier de Ce monde. Il ne tint pas fa
parole, quoiqu’il foit mort plus de 40 ans avant M*
le V ayer ; 8c il vérifia la fentence de Catulle, Epigr.
ïtj.
Qui nunc it per iter tenebrûofum,
Illuc und'e ne gant redire quemquam.
Pantalion, auteur prefqu’inconnu du Xv. fiecle,
naquit à Virceil; il devint premier médecin de Philibert
L quatrième duc de Savoie, vers l’an 1470! Il a
fait un livre de lacliciniis. imprimé à Lyon en t <5 5, ç
in-4°t (D . J . ) ; ;
V E R C E L LÆ , ( Géog* anc.) ville d’Italie dans la
Tranfpadane. Ptolomée, l. I I I . c. j . la donne aux
peuples Libici. Pline, l. I I I . c. x vij, dit qu’elle devoit
fon origine aux Salyi ou Salluvii. Tacite , l î f i . 1. 1.
c. Ixx. la met aü nombre des municipes les mieux fortifiées
de la Tranfpadane.
Selon l’itinéraire d’Antôniii qui la üomme Vercel-
lis 8c Virgellenorum, elle étoit fur la route de Milan
à V ienne, en paffant les Alpes graÿennes, entre No*
varre 8c Ivré e , à 16 milles de la première de ces places,
& à 3 3 de la feConde.
S. Jerome, Epifi. xvij. écrit aufli Vereellis. Il la
place dans la Ligurie aü pié des Alpes, 8c dit qu’elle
étoit puiffante autrefois ; mais que de fon teins elle
étoit à demi ruinée, 8c n’aVoit qu’un petit nombre
d’habitans. Cette ville confefve encore fon ancien
nom : on l’appelle préfentettient Vereeil. Voye? V e r -
c e il . (D . ƒ.)
V ER CH ER E , f. f. (Jurifp.) vercheria; terme ufité
dans quelque? provinces, comme en Auvergne,