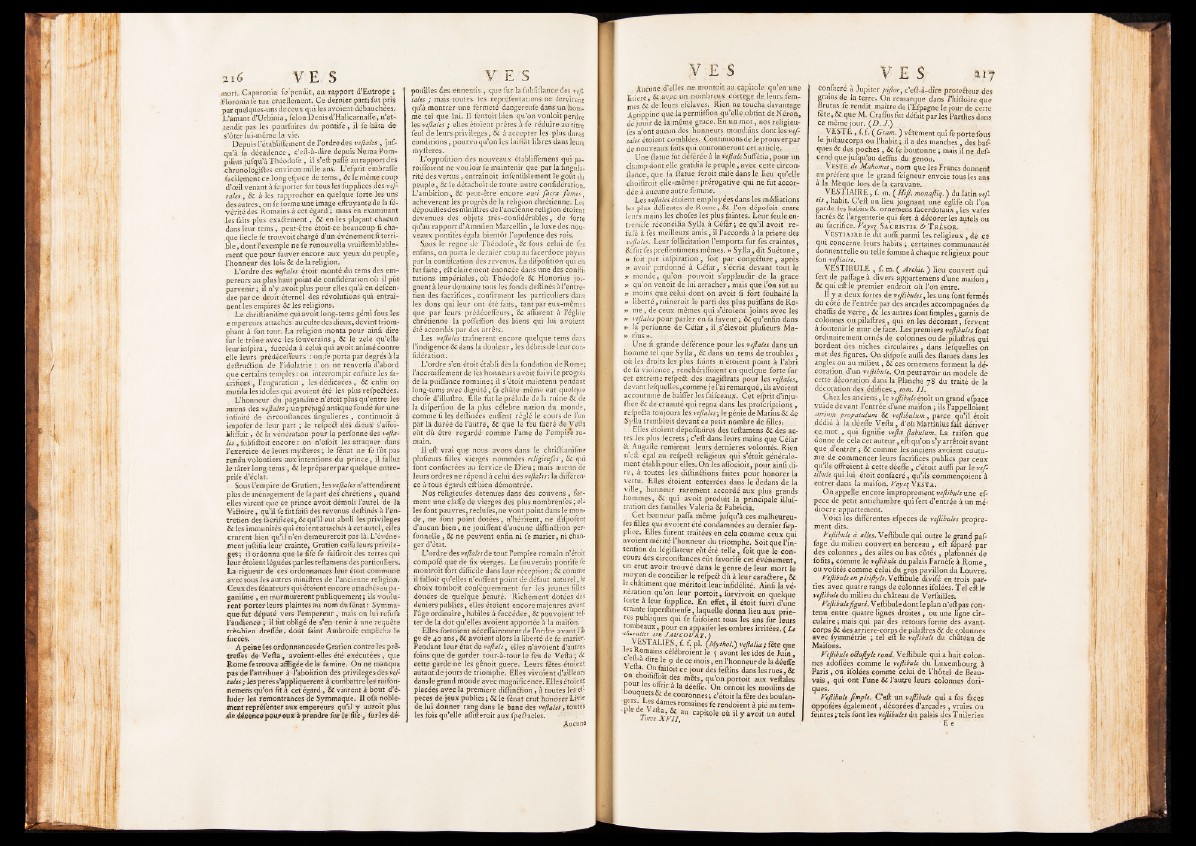
mort. Caparoma fo pendic, au: rapport cEEutrope ;
JFloroniafe tua cruellement. Çe dernier paistifut pris
par quelques-uns deceuxquües avoient débauchées.
L ’amant d’Urbinia, félon Denis d?Halicarnaffe<, n’attendit
pas. les pour fuites du pontife , i l fe<hâta do
s ’ôter lui-même la vie-.
Depuis rétabliffement çle l’ordredes vefiales-, juf-
qu’à fa décadence, c’efi-à-dire depuisNumaPom.-
pilius jufqù’à Théodofe , il s’ eft paffé au rapport dès
chronologiftes environ milleians. L’efprit- embraffe
facilement .ce long efpaee de temsi, & le même coup
d’oeil venant à fe porter fur tousdes-fupplicesÀeswefi.
taies, & à les rapprocher en quelque forte les uns
des autres,.on fe forme une image effrayante de la fé-
véritédes Romains.à.cet égard-; mais.en examinant
le s faits plus exa&ement, (te en le s plaçant chacun
dans leur tems, peut-être étoit-ce; beaucoup fi chaque
fiecle fe trou voit chargé d’un.événementfi'terri-
Jble ,.dont l’exemple n efe renouvella .yraiffemblable.-
ment que pour fauver encore, aux yeux du peuple,
l’honneur des lois>& delà religion.
L ’ordre des vefiales étoit raonté.du tems des empereurs
au plus haut point de çonfidération où il pût
parvenir ; il n’y .avoit plus pour elles,qu’à en descendre
par ce droit éternel des révolutions, qui entraînent
les empires & les religions.
L e chriftianifine qui avoit long-tems gémi fous les
e mpereuns attachés au culte des dieux, devint triomphant
à fon tour. La religion monta pour ainfi dire
fur le trône avec les fbuverains, & le zgte qu’elle
leur infpira, fuccéda à celui qui avoit animé contre
elle leurs prédécelïeurs : on;fe porta par degrés à la
deftrufiio.n de l’idolâtrie QU. ne renverfa. d’abord
que certains temples : on interrompit enfuite les fa-
orifices, l’auguration , les dédicaces , & enfin on
mutila lesidol.es qui avoient été les plus refpefiées.
L’honneur du paganifme n’étoit plus qu’entre les
mains des vefiales; un préjugé antique fondé fur une
infinité de circonftançes fingulieres , continuoit A
impofer de leur part ; le refpeét des dieux s’affoi-
kiiflbit, & la vénération pour la perfonne des vefiales
, fubfiftoit encore : on n’ofoit les attaquer dans
l’exercice de leurs myfteres ; le fénat ne fe fut pas
rendu volontiers aux intentions du prince , il fallut
le tâter long-tems i, & le préparer par quelque jsntre-
prife d’éclat:
. Sous l’empire de Gratien, le svefiales n’attendirent
plus de ménagement de la part des chrétiens » quand
elles virent q;ue ce prince avoit démoli l’autel de la
Vifto ire , qu’il fe fut faifi des revenus deftinés à l’entretien
des fàcrifices, & qu’il eut aboli les privilèges
& les immunités qui étoient attachés à cet autelelles
crurent bien qu’ il n’en demeureroit pas là. L ’événement
juôifia leur crainte, Gratien caira leurs privilèg
e s ; il ordonna que le fife le faifiroitdës terres qui
leur étoient léguées parles teftamens des particuliers.
La rigueur de ces' ©rdonnanees-leur étoit commune
..avec tous les autres miniftres de l’ancienne religion'.-
Ceux des fénateurs qui étoient encore attachésau pa-
ganifme , en murmurèrent publiquement; ils voulurent
porter leurs plaintes au nom dti fénat: Symma-
qu e fu t député vers l’empereur, mais on lui rëfufa
l’audience ; il fut obligé de s’ en tenir à une requête
très-bien dreffée, dont faint Ambroife empêcha le
iuccèSv
A peiaelés ordonnances de Gratien contre lesprê*
treflês de Veftâ , avoient-elles été exécutées, que
Körne fe trouva affligée d elà famine. On ne manqua
pas d e f attribuer à l’abolition des privilege&des,ve/£
taies ; les peres s’appliquèrent à combattre le^ raifort-
nemens qu’on fit à cet égard, & vinrent à bout d?é-
luder lés remontrances de Symmaqiîe. Il ofa noble*
ment rèpréfenter aux empereurs qu’il y auroic plus
«de décence peureux à prendre fur le fife , fur ie s dé*
poiulles des/ennemis-, que-fur. la fubfiftance des vefl
taies ; mais toutes fes repréfentations- ne fervirent
qu’à montrer une fermeté dangereufe dansun-hom:
nie tel que lui. Il fentoit bien qu’on vouloitperdre
ÏQSiv.efiales ; elles étoient'prêtes à fe réduire au titre
feul ae leurs privilèges, & à accepter les plus dures
conditions, pourvu qu’on les 1 aillât libres dans leurs
my lier es.
L ’oppofition des nouveaux établiflemens qui pa-
roiffbient ne vouloir fe maintenir que par la fingula-
rité des vertus, entraînoit infenfiblement legoftt du
peuple, & ie détachoit de toute autre çonfidération.
L ’ambition , &• peut-être encore auri facra famés}
achevèrent les progrès de la religion chrétienne. Les
dépouillesdes minières de l’ancienne religion étoient
devenues des objets très-confidérables, de forte
qu’au rapport d’Amniien Marcellin , le luxe des nouveaux
pontifes égala bientôt l’opulence des rois.
Sous le régné de Théodofe, & fous celui de fes
enfans, on porta le dernier coup au facerdoce payeri
par la eonfifeation des-revenus. La difpofition qui en
fut faite, eft clairement énoncée dans une des confia
tntions impériales, où Théodofe & Honorius joignent
à leur domaine tous les fonds deftinés à l’entretien
des fàcrifices, confirment les particuliers dans
les dons qui leur ont été faits , tant par eux-mêmes
que par leurs prédéceffeurs, & afflue nt à l’égliie
chrétienne la pofl’effion des biens qui lui avoient
été accordés par des arrêts.
Les vefiales traînèrent encore quelque tems dans
l’indigence dedans la douleur, les débris de leur con-
fidératjon.
L ’ordre s’en étoit établi dès la fondation de Rome;
FàccroifFement de fes honneurs-avoit fuivi le progrès
de la puifiance romaine; il s’étoit maintenu pendant
long-tems avec dignité, fa-chute même eut- quelque
chofe d’iHuftre. Elle fut le prélude de la ruine & de
la difperfion de la plus célébré nation du monde,
comme fi les deflinées euffent réglé le cours de l’un
par la durée de l’autre, & que le feu facré de Yéfta
eût dû être regardé comme l’ame do l’empire romain.
R eff vrai que nous avons dans le chriftianifme
•plufieurs filles vierges nommées religieufes, & qui
font confacrées au férviee de Dieu ; mais aucun dé
leurs ordres ne répond à celui des vefialts: la difFéren-
.ee à-tous égards eft bien démontrée.
Nos religieufes detenues dans des couvens , forment
une çlaffe de vierges des plus nombreufes ; elles
font pau vres, reelufes,ne vont point dans fe mon?
d e , ne font point dotées, n’héritent, ne difpofent
d’aucun bien, ne jouiffent d’aucune diflinèHon per-
fonnelle , ôf ne peuvent enfin ni fe marier, ni changer
d*état.
L’ordre des veflales de tout l’ empire romain n’étoit
compofé que de fix vierges, Le fouverain pontife fé
montroit fort difficile dans leur réception ; & comme
il faüoit qu’elles n’euffent point d,e défaut naturel,le
choix tomboit conféquemment fur les jeunes filles
douées de quelque beauté;. Richement dotées deà
deniers publies, elles étoient encore majeures avant
l’âge ordinaire, habiles à fucçéder, & pouvoient tester
de la dot qu’elles avoient apportée à la maifon.
EUèsTortoient néçeffairementde l’ordre avant l’â»
ge de 40 ans, & avoient alors la liberté de fe marier.
Pendant leur état de vefiale, elles n’avoiént d’autres
foins que de garder tour-à-tour le feu de Vefta; &
Cette garde nè lës gênoit guere. Leurs fêtes étoient
autant de jours de triomphe. Elles vivoient d’ailleurs
dans le grand monde avec magnificence. Elle? étoient
placées avec la première difiintiion, à toute? les ?f-
peces de jeux publics ; & le fénat crut honorer Livie
de lui donner rang dans le banc des veflales toute?
les fois qu’elle affifferoit aux fpeélacles.
Aucune
AliClfne, d’elles ne montoit au çapitole' qu'en ufiè
litière, ôc^v^ee un.nombreux cortege de leurs.femmes
& .de: leurs efdayes. Rien ne toucha, davantage
Agrippine queJa permiffion;qu’elle ;Obtint de? N é ro ^
de; jouir de la même grâce. En un mot, nos rçligieu-
fes n’ont aucun, des. honneurs mondajns dont les vef-
taies étoient comblées. Continuons de le prouver par
de nouveaux faits qui couronneront cet article,
], Une fiatuê fut deférée à la vefiale Suffétia, ppur un
champ donkeRo gratifia le peuple -, aye.c cette cirçonr
iftance, que fa ffatue, feroit mife dans le lieu qu’elle
çhoifir.oit elle-même : prérogative qui ne fut accor-
dée.à aucune autre femme.
. Les veflales étoient employées dans les médiations
les plus délicates de Rome , & l’on -dépofoit entre
leurs mains les chofes les plus faintes. Leur feule en-
tremife réconcilia Sylla à Gélar ; ce qu’il avoit re-
fu'fe à fes meilleurs amis, il l’accorda à la priere des
vefiales. Leur follicitation l’emporta fur fes craintes,
&:fur fes preffentimens mêmes. « S y lla , dit Suétone,
» foit par infpiration, foit par conjecture, après
» avoir pardonné à C é fa r, s’écria devant tout le
» monde, qu’on pouvoit s’applaudir de la grâce
» qu’on venoit de lui arracher, mais que l’on sût au
» moins que celui dont on avoit fi fort fouhaité la
» liberté, ruineroit le parti des plus puiflans de Ro^
» me, de ceux mêmes qui.s’étoient joints avec les
» vejtales pour parler en fa faveur ; & qu’enfîn dans
» la perfonne de C é la r, il ^s’élevoit plufieurs Ma-
» rius »,
. Une fi grande déférence pour les vejlales dans uii
homme tel que S y lla , & dans un tems de troubles ,
où les droits les plus faints n’étoient point à l ’abri
de fa violence, renchériffoient en quelque forte fur
cet extrême refpeét des magiffrat? pour les vefiales,
devant lefquelles,comme je l’ai remarqué,, ils avoient
accoutumé de baiffer les faifeeaux. Cet efprit d’inju-
ftice & de cruauté qui régna dans les proferiptions ,
refpeCla toujours les vefiales ; le génie de Marius & de
•Sylla trembloit devant ce petit nombre de filles.
-. Elles étoient dépofitaires des teftamens & des actes
les plus lècrets ; c’eft dans leurs mains que Céfar
& Augufte remirent leurs dernières volontés. Rien
•n’eft. égal au refpeCl religieux qui s’étoit généralement
établi pour elles. On les aflbcioit, pour ainfi dire
, à toutes les diftin(fiions faites pour honorer la
vertu. Elles étoient enterrées dans le dedans de la
ville, honneur rarement accordé aux plus grands
hommes, (te. qui avoit produit la principale illustration
des familles Valeria & Fabricia.
Cet honneur paffa même jufqu’à ces malheureu-
fes filles qui avoient été condamnées au dernier Supplice.
Elles furent traitées en cela comme ceux qui
avoient mérité l’honneur du triomphe. Soit que l’in-
lention du législateur eût été telle, foit que le concours
des circonftances eût favorifé cet événement,
on crut avoir trouvé dans le genre de leur mort le
moyen de concilier le refpeél dû à leur cara&ere, &
le châtiment que méritoit leur infidélité. Ainfi la vénération
qu’on leur portoit, furvivoit en quelque
forte à leur fupplice. En effet, il étoit fuivi d’une
crainte fuperftitieufe, laquelle donna lieu aux prières
publiques qui fe faifoient tous les ans fur leurs
tombeaux, pour en appaifer les ombres irritées. (Le
ch evalier D E J A U CO V R T . \
VESTALIES, f. f, pl. (Mythol.) V e fia lia ; fête que
les Romains célébroient le 5 avant les ides de Ju in ,
V-6 4 r>,re c® mo*s >en l’honneur de la déeffe
6 t -rrr . : c e îour ^es ^èftins dans les rues , &c
©n e oifiiloit des mêts, qu’on portoit aux veflales
p ur es offrir à la déeffe. On ornoit les moulins de
ouquets & de couronnes ; c’étoit la fête des boulan-
f ? rSj l amoS romainès fe rendoient à pié au tem-
' ^ e t e t l J f r au caP^°^e où il y avoit un autel Tome X K I I , J
côniacre à Jupiter pifior, c’eft-à-dire proteèleur des
grains de la terre. On remarque dans l’hiftoire que
Brutus fe rendit maître de i’Efpagne le jour de cette
fete, & que M. Crgffus fut défait par les Parthes dans
ce meme jour. (D . ƒ.) ,
V E ST E j f. f. ( Gram, j vetement qvti fe porte fbliS
le juftaucorps ou l’habit ; il a des manches , des baf*
ques & des poches , & fe boutonne ; mais il Æ défi1
cend que jufqu’au-deffus du genou.
V e s t e de Mahomet, nom qüeles Frahçs donnent
au préfent que le grand feigheur envoie tous les ans
à. la Meqüe lors de la caravane.
V ESTIA IRE , f. m. ( Hifh monafiiq. ) du îatiri vefi
tis , habit. C’qft un lieu joignant une églife où l ’on
garde; le§ habits & ornemens facerdotaux j les vafes
facres & l’argenterie qui fert à décorer les autels ou
au fa.crifiçe. Voyt^Sa c r is t ie & T r Ï sor. *,
VESTiAiRE-fe dit auffi p a rmi le s re lig ie u x , de cé
qui concerne, leurs habits ; certaines communautés
donnent telle ou telle fomme à chaque re ligieux p o u f
fon vefiiaire.
VE S 1 IBULË , f. m. ( Archii. ) lieu Couvert qui
fert de paffage à divers appartemens d’une maifon i
& qui eft le premier endroit où l’o’n entre.
Il y a deux fortes de vefiibules, les uns font fermés
du côté de l’entrée par des arcades accompagnées de
chaffis de verre, & les autres font fimples * garnis de
colonnes oupilaftres , qui en les décorant, fervent
à foutenir le mur de face. Les premiers vefiibules font
ordinairement ornés de colonnes ou de piîaftres qui
bordent des niches circulaires , dans lefquelles on
met des figures. On difpofe aùffi des ftatues dans les
angles ou au milieu , &T ces ornemens forment la dé*
cotation d’un vefiibule. Oit-,peut avoir un modèle dé
cette décoration dans la planche ,78 du traité de la
décoction des.édifiçes, tom. I I .
Chez les anciens, le vefiibuli étoit un grand elpacé
yuide devant l ’entrée d’une maifon ; ils Pappelloient
atrium prppatulum & veflibulum, parce qu’il étoit
dédié, à la.déeffe Vefta , d’oùMartmius fait dériver
,cea mot , qi\i fignifie vefia fiabulum. La raifon que
donne de cela cet auteur, eft.qu’on s*y arrêtôit avant
que d’entrer ; & comme lés anciens avoient coutume
de commencer leurs fàcrifices publics par ceux
qu’ils offroient à cette déeffe , c’étoit auffi par \e vefi
tibule qui lui étoit confaçré ^ qu’ils commençoient à
entrer dans la maifon. V o y e ^ V e s t a .
Oh appelle encore improprement vefiibule une efi
pece de petit antichambre qui fert d’entrée à un médiocre
appartement.
Voici les différentes efpeces de vefiibules proprement
dits.
Vefiibule à ailes. Vefiibule qui outre le grand paffage
du milieu couvert ert berceau , eft féparé par
des colonnes , des ailes ou bas côtés , plafonnés de
fofits, comme le vefiibule du palais Farnèfe à Rome,
ou voûtés comme celui du grçs pavillon du Louvre.
Vefiibule en périfiyle.Ve ftibule divifé en trois parties
avec quatre rangs de colonnes ifolées. Tel eft le
vefiibule du milieu du château de Verfailles.
Vfiibulefiguré. Veftibule dont le plan n’eftpas contenu
entre quatre lignes droites, ou uiie ligne circulaire
; mais qui par des retours forme des avant-
corps & des arriere-corps de piîaftres & de colonnes
avec fymmétrie ; tel eft le vefiibule du château de
Maifons.
Vfiibule oclojlyle rond. Vefiibule qui a huit colonnes
adoffées comme le vefiibule du Luxembourg à
P aris, ou ifolées comme celui de l ’hôtel de Beauvais
, qui ont l’une & l ’autye leurs colonnes doriques.
Vefiibule fimple. C ’eft un vefiibule qui a fes faces
ôppofées également, décorées d’arcades, vraies ou
feintes ;ie ls font les Vefiibules du palais des Tuileries
£ e