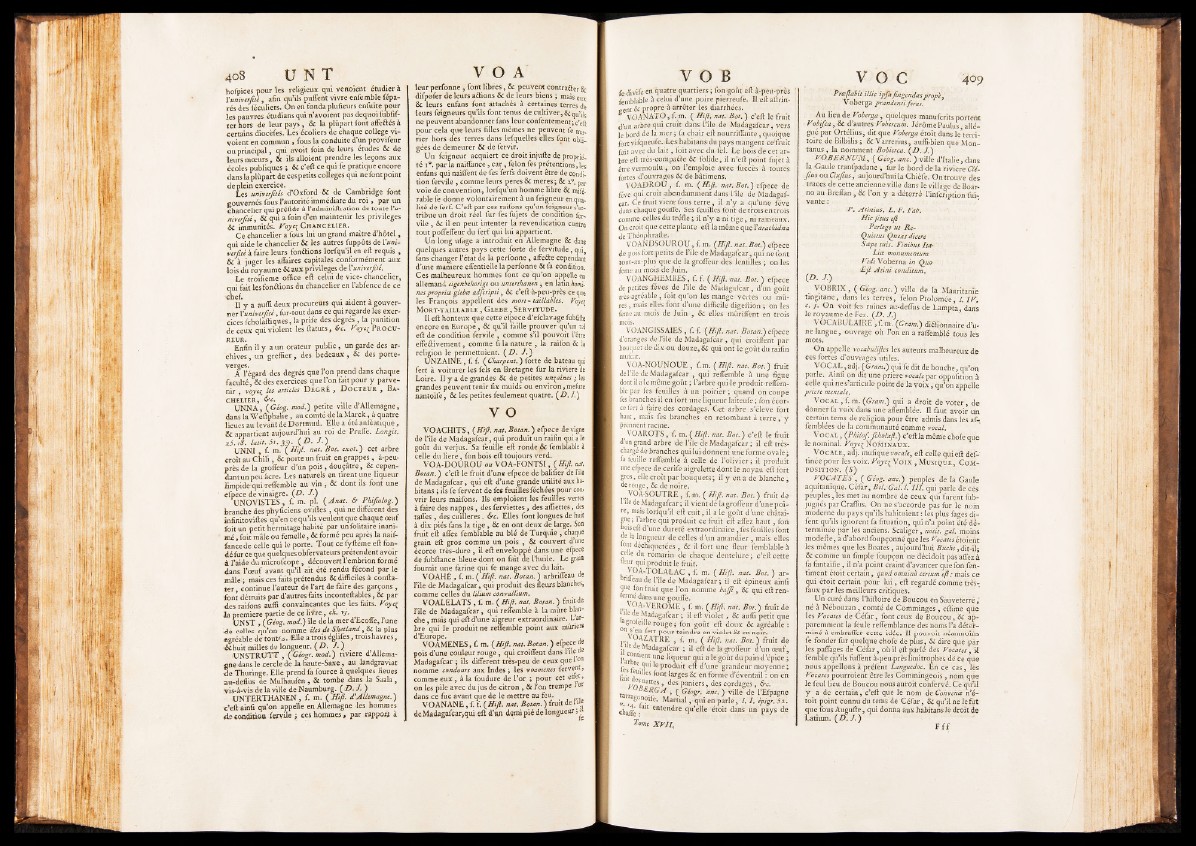
408 U N T
hofpices pour les religieux qui vefioiè'nt étudier à
Vuniveeftté, afin qu’ils puffeïit vivre enfemble fépa-
rés des fïculiers. On en fonda plufieurs enfuite pour
les pauvres étudions qui n’avoient pas dequoi fubfif-
terhors de leur pays , 8ç la plupart font affeftés à
certains diocèfes. Les écoliers de chaque college vl-
voient en commun > fous la conduite d un provifeur
ou principal, qui avoit foin de leurs études & de
leurs moeurs, & ils alloient prendre les leçons aux
écoles publiques ; 8c c’eft ce qui fe pratique encore
dans la plupart de cespetits colleges qui nefontpoint
de plein exercice. ' _. . _ . . . .
Les leniverfitls d’Oxford ■ & de Cambridge font
gouvernés fous l’autorité immédiate du r o i , par un
chancelier qui préfide à radminiltration de toute l’n-
mverfiti, & qui a foin d’en maintenir les privilèges
&c immunités. Voyt[ Chancelier.
Ce chancelier a fous lui un grand maître d’hôtel *
qui aide le chancelier & les autres fuppôts de l’nni-
ytrfui à faire leurs fonûions lorfqu’il en eft requis ,
& à juger les affaires capitales conformément aux
lois du royaume & aux privilèges de YuniverfiU.
-Le troifieme office eft celui de vice-chancelier,
qui fait-lesfonaions du chancelier en l’abfence de ce
chef. . . . ,
Il y a auffi deux procureurs qui aident à gouverner
l’univcrjàc, fur-tout dans ce qui regarde les exercices
fcholaftiques, la prife des degrés , la punition
de ceux qui violent les ftatuts, £ c, f ’oyeç Pro cu r
e u r .
Enfin i l y a un orateur public, un garde des arc
h iv e s , tin g re ffie r, des bedeaux, & dés porte-
verges.
A l’égard des degrés que l’on prend dans chaque
fa culté 7& des exercices que l’on fait pour y parvenir
, ï’Oy.Ç As articles DEGRÉ , D octeur , Bachelier,
fir.
U N N A , (Grog, moi.') petite ville d Allemagne,
dans la Weftphalie, au comté de la Marclc, à quatre
lieues au levant de Dortmud. EUéa été anféatiqué ,
& appartient aujourd’hui au roi de Pruffe. Longée.
2S.1&. lu e it .S 1 .3 3 . ( D . ƒ .) •
DNNI f. m. ( Hijl. tuu. Bot. exot. ) cet arbre
c ro îtauC h ili, & p o rteu n fruit en grappes, à-péu-
près de la groffeur d’un p o is, douçâtre, & cependant
un peu âcre. Les naturels en tirent une liqueur
limpidequireffemble au vin , & dont ils font une
efpece de vinaigre. (D . A )
U NO V IST E S , C m. pl. ( Jn a t . * Phifwlog. )
branche des phyficiens oviftes , qui ne différent des
infinitoviftes qu’ en ce qu’ils veulent que chaque oeuf
foitun petit hermitage habité par unfolitaire inanimé
, foit mâle ou femelle, & formé peu après la naif-
fancede celle qui le porte. Tout ce fyftème eft fondé
fur ce que quelques obfervateurs prétendent avoir
à l’aide du microfcope , découvert l’embrion formé
dans l’oeuf avant qu’il ait été rendu fécond par le
mâleq mais ces faits prétendus & difficiles à confta-
ter continue l’auteur de l’art de faire des garçons ,
font détruits par d’autres faits inconteftables, 8c par
desraifons auffi convaincantes que les faits. Voye^
la première partie de ce liv re , ch. vj..
UN ST , (Géog. mod.) île delà m erdEcofle, l’une
d e celles qu’on ■ nomme :tles- de Shetland, 8c la plus
agréable de toutes. E lle a trois églifes, trois havres,
•dchuit milles de longueur. (D . / . )
AJN5T R U T T , (Géogr. mod.) riviere d Allemagne
dans le cercle d e là haule-Saxe, au .landgraviat
d e Thuringe. Elle prend fa fource à quelques lieues
au-deflus de Mulhaufen , 8c tombe .dans la Saala,
vis-à-vis de la ville deNaumburg. (.D. J . )
■ UNTERTHANEN , f. m. (H ifi. d’Allemagne.)
c’eft ainli qu’on appelle en Allemagne les hommes
de condition fervile ; ces hommes, par rappoij à
V O A
leur perfonne, font libres, & peuvent contrarier Sc
difpofer de leurs avions 6c de leurs biens ; mais eux
6c leurs enfans font attachés à certaines terres de
leurs feigneurs qu’ils font tenus de cultiver, & qu’ils
ne peuvent abandonner fans leur confentement; c’eft
pour cela que leurs filles mêmes ne peuvent fe marier
hors des terres dans lefquelles elles font obligées
de demeurer & de fervir.
Un feigneur acquiert ce droit injufte de proprié,
té i® . par la naiffance > c a r , félon fes prétentions,les
enfans qui naifl'ent de fes ferfs doivent être de condition
fervile , comme leurs peres 6c meres ; 6c 20. par
voie de convention, lorfqu’un homme libre 6c mifé-
rable fe donne volontairement à un feigneur en qua-
lité de ferf. C ’eft par ces raifons qu’un feigneur s’attribue
un droit reel fur fes fujets de condition fer-
vile , 6c il en peut intenter la revendication contre
tout polfeffeur du fe rf qui lui appartient.
Un long ufage a introduit en Allemagne & dans
quelques autres pays cette forte de fervitude, qui
fans changer l’état de la perfonne, affe&e cependant
d’une maniéré effentielle la perfonne & fa condition.
Ces malheureux hommes font ce ^u’on appelle en
allemand eigenbehorige ou unttrthamn en latin Aowî-
nes proprioe gleboe adfcripti, 6c c’eft-à-peu-près ce que
les François appellent des mort- taillables. Voye[
Mort-taillable , Glebe , Servitude.
Il eft honteux que cette efpece d’efclavage fubfîfte
encore en Europe , 6c qu’il faille prouver qu’un tel
eft de condition fervile , comme s’il pouvoit l’être
effectivement, comme fi la nature , la raifon & la
religion le permettoient. (D . / . )
UN Z A IN E , f. f. ( Charpent. ) forte de bateau qui
fert à voiturer les fels en Bretagne fur la riviere de
Loire. Il y a de grandes 6c de petites un^aines ; les
grandes peuvent tenir fix muids ou environ,mefure
nantoife, 6c les petites feulement quatre. (D , J.)
V O
VOACHITS, (Hiß. nat.Botan. ) efpece de vigne
de l’île de Madagafcar, qui produit un raifin qui a le
goût du verjus. Sa feuille eft ronde & Semblable à
celle du liere, fon bois eft toujours verd.
VOA-DOUROU ou V OA -FONTSI, ( Hiß. mu
Botan.) c’eft le fruit d’une efpece de balifier de l’île
de Madagafcar, qui eft d’une grande utilité aux ha*
bitans ; ils fe fervent de fes feuilles féchées pour cou»
vrir leurs maifons. Ils emploient les feuilles vertes
à faire des nappes, des Serviettes , des affiettes, des
taffes , des cuillères, &c. Elles font longues de huit
à dix piés fans la tig e , 6c en ont deux de large. Son
fruit eft affez Semblable au blé de Turquie , chaque
grain eft gros comme un pois , 6c couvert d’une
écorce très-dure , il eft enveloppé dans une efpece
de fubftance bleue dont on fait de l’huile. Le grain
fournit une farine qui fe mange avec du lait.
VOAHÉ , f. m. ( Hift. nat. Bocan. ) arbriffeau de
l’île de Madagafcar, qui produit des fleurs blanches,
comme celles du lilium convàllium.
VOALELATS , f. m. (Hiß . nat. Botan. ) fruit de
l’île de Madagafcar, qui reffemble à la mûre blanche
, mais qui eft d’une aigreur extraordinaire. Uar-
bre qui le produit ne reffemble point aux mûriers
d’Europe. ,
VOAMENES, fi m. (Hiß. nat. Botan. ) efpece de
pois d’une couleur rouge, qui croiffent dans l’île de
Madagafcar ; ils different très-peu de ceux que 1 on
nomme condours aux Indes ; les voamems fervent,
comme e u x , à la foudure de l ’or ; pour cet effet,
on les pile avec du jus de citron , & Fon trempe 1 or
dans ce fuc avant que de le mettre au feu.
VO AN AN E , f. f. (Hiß. nat. Botan. ) fruit de 1 »0
de Madagafcar,qui eft d’un demi pié de longueur ; *
V O B
fe divife en quatre quartiers ; fon goût eft à-peu-près
femblable à celui d’une poire pierreufe. Ileftaftrin-
ent & propré à arrêter les diarrhées.
VOANATO, f. m. ( Hiß. nat. Bot. ) c’eft le fruit
d’un,arbre qui croît dans I’île de Madagafcar, vers
le bord de la mer ; fa chair eft nourriffante, quoique
fort vifqueufe. Les habitans du pays mangent ce*fruit
foit avec du la it , foit avec du fél. Le bois de cet arbre
eft très^eompafte & folide, il n’eft point fujet à
être vermoulu i, on l’emploie avec fuecès à toutes
fortes d’ouvrages 6c de bâtimens.
VOADROU, f. m. (Hiß. nat. Bot.') efpece de
fève qui.croît .abondamment dans i’île de Madagafcar.
Ce fruit vient fous terre, il n’y a qu’une fève
dans chaque goüffe. Ses feuilles font de trois entrois
comme celles du trèfle ; il n’y a ni tige, ni rameaux.
On croit que cette plante eft la même que Varachidna
de Théophrafte.
VOANDSOUROU, f. m. (Hiß. nat. B o t efpece
de pois fort petits de l’île de Madagafcar, qui ne font
tout-au-plus que de la groffeur des lentilles ; on les
ferne au mois de Juin.
VOANGHEMBES, fi f. ( Hiß. nat. Bot. ) efpece
de petites fèves de l’île de Madagafcar, d’un goût
très-agréable, foit qu’on les mange vertes ou mûres
, mais ellés font d’une difficile digeftion ; bn les
ferne au mois de Juin , & elles mûriffent en trois
mois..
d’oranges de File de Madagafcar, qui croiftènt par
bouquet de dix ou douze, 6c qui ont le goût du raifin
mufeat. •>'
VOA-NOUNOUE , fim. (H iß . nat. Bot.') fruit
de l’île de Madagafcar , qui reffemble à une figue
dont il a le même goût ; l’arbre qui-le produit reffemble
par fes feuilles à un poirier ; quand on c'Oupe
fes branches il en fort une liqueur laiteufe ; fon écorce
fert à faire des cordages. Cet arbre s ’élève fort
haut, mais fes branches en retombant à te r re , y
prennent racine.
VOAROTS, fi m. ( Hiß. nat. Bot. ) c’eft le fruit
d’un grand arbre de l’île de Madagafcar ; il eft très-
chargé de branches qui lui donnent une forme ovale ;
fa feuille reffemble à celle de l’olivier ; il produit
une efpece de cerife aigrelette dont le noyau eft fort
gros, elle croît par bouquets ; il y en a de blanche,
de rouge, 6c de noire.
,a VOA-SOUTRE ,.ft m. ( Hiß. nat. Bot. ) fruit de
l ’île de Madagafcar ; il vient de la groffeur d ’une poire,
mais lorfqu’il eft cuit, il a le goût d ’une châtaigne
; l’arbre qui produit ce fruit eft affez haut , fon
bois eft d’une dureté extraordinaire, fes feuilles font
de la longueur de celles d’un amandier , mais elles
font déchiquetées , 6c il fort une fleur femblable à
celle du romarin de chaque dentelure ; c’eft cette
fleur qui produit le fruit.
, VOA-TOLALAC , f. m. ( Hiß. nat. Bot. ) ar-
bnffeau de l’île de Madagafcar ; il eft épineux ainfi
Sue fdn fruit que l ’on nomme ba£i 9 6c qui eft renferme
dans une gouffe.
p.^^A'VEROME , f. m. (Hiß. nat. Bot.) fruit de
ue de Madagafcar ; il eft v io le t, 6c auffi petit que
agrofeille rouge; fon goût eft doux 6c agréable :
°nxLen ^ert Polir teindre en violet 6c en noir.
]*.; j AZATRE , f. m. ( Hiß. nat. B o t.) fruit de
m e . Madagafcar ; il eft de la groffeur d’un oeuf,
l’arbntient-Une ^ tïuei,r R1“ a Ie goût du pain d ’épice ;
fes f " ? 11 Pr°d uit e f t d’uné grandeur moyenne ;
fait ?Ul es ^ont larges & en forme d’éventail : on en
J e t t e s , des paniers, des cordages, &c.
tai-ro , ( Géogr. anc. ) ville de l’Efpagne
v t S0apife. Martial, qui en parle, l. I . épigr. 5 a\
«haffè •3lt entent^re Ru’elle étôit dans un pays de
Tomç XVII.
V O C 4°9
Pfoejlabiiillic ipfafingendaspropi,
Voberga prandmti feras.
Au lieu de Vtbcrga, quelques manuferits portent
Vobifca, 6c d’autres Fobercutn. Jérôme Paulus, allègue
par Ortélius, dit que Voberga étoit dans ^ te r r itoire
de Bilbilis ; 6c Varrerius , auffi-bien que Mon-
tanus,, la nomment Bobierca. (D . J .)
VO B ERN UM ., ( Géog. anc. ) ville d’Italie, dans
la Gaule tranfpadane , fur le bord de la riviere Clé-
Jiu s omCIuJ ius, aujourd’hui la Chièfe. On trouve des
traces de cetteancienne ville dans le village deBoar-
no au Br’effan , 6c l’on y a déterré Tiftfcription-fui-
vante :
P . Atinius. L . F. Fab.
Hic Jîtus efi
Perlege Ut Re-
Quiuus Queas dicére
S ape tuïs. Finibus lia-
L ia nionumtnium
Vidi Voberna in Quo
‘E ft Atini conditum.
(O- J )
VO B R IX , ( Géog. anc.) ville de la Mauritanie
tingitane, dans les terres, félon Ptolo'mêë, L. IV .
c. j . On voit fes ruines au-deffus de Lampta, darts
le royaume de Fez. (D . J . ) •
VO CABULAIR E, f. m. (Gram.) difrionnaire d’une
langue, ouvragé oii l’on en a raffemblé tous les
motsi
On appelle vocabulifies les auteurs malheureux de
ces fortes d’ouVragés utiles.
VO C A L , adj. (Gram.) qui Te dit de bouche, qû’on
parle. Ainfi on dit une prière vocale par oppofition à
celle qui ne s’articule point de la v o ix , qu’on appelle
priere mentale.
Vocal , fi ni. (Gram.) qui a droit de voter, de
donner fa voix dans une afiemblée. Il faut avoir un
Certain tems de religion pour être admis dans les àf-
femblées de la communauté comme vocal.
V ocal , (Philof. fehoiaft.) c’eft la même chofe que
le nominal. Voye^ NoMinaux.
Vocale, adj. 'müfique vocà/è, eft celle qui eft dëf-
tinéepour les vo ix .’VdyeçV o i x , Musique., Composition.
(S )
V O C A T É S , ( Géog. anc.) peuples de là Gaule
aquitanique. Céfar, Bel. Gai. I. I I I . qui parle de cés
peuples, les met àu nombre de ceux qui furent fub-
jugués par Craffus. On ne s’accorde pas fur le nom
moderne du pays qu’ils habitoient : les plus fages di-
fent qu’ils ignorent fâ fituation, qui n’a point été déterminée
par les anciens. Scâliger, no'tït. gàl. moins
modefte, a d’abord foupçonné que les Votâtes qXoient
les mêmes que les BoateS, aujourd’hui Buchs, dit-il;
6c comme un fimple foupçon ne décidoit pas àflèz à
fa fantaifie , il n’a point craint d’avancer que fon fen-
timent étoit certain, quod omninb certum eft : mais ce
qui étoit certain pour lu i , eft regardé Comme très-
faux par les meilleurs critiqués.
Un curé dans l’hiftoire de Boücoii en Sàüvéterré
né à Nébouzan, comté de Comiiiirigës , eftimë qüe
les Vocates de Céfar, font Ceux de Boucou, & apparemment
la feule reffemblance des hômsi’â déterminé
à embraïîèr cette idée. Il pouvoit néanmoins
fe fonder fur quelque chofe de plus, & dirë que par
les paffages de Cé lar, où il eft parlé dés Vocates , il
femble qu’ils fuffent à-peu-près limitrophes de te que
nous appelions à préfent Languedoc. En cè ca s , lès
Vocates pourroiênt être les Commingèois , nom que
le feul fieu de Boucou nous aufoit confervé. C e qu’il
y a de certain, c’eft que le nom de Cohvehoe n’é-
toit point connu du tems de C é far, & qu’il ne lé fut
que fous Aügufte, qui donfia aux habitans lê droit de
Latium. (D . J . )
F f f