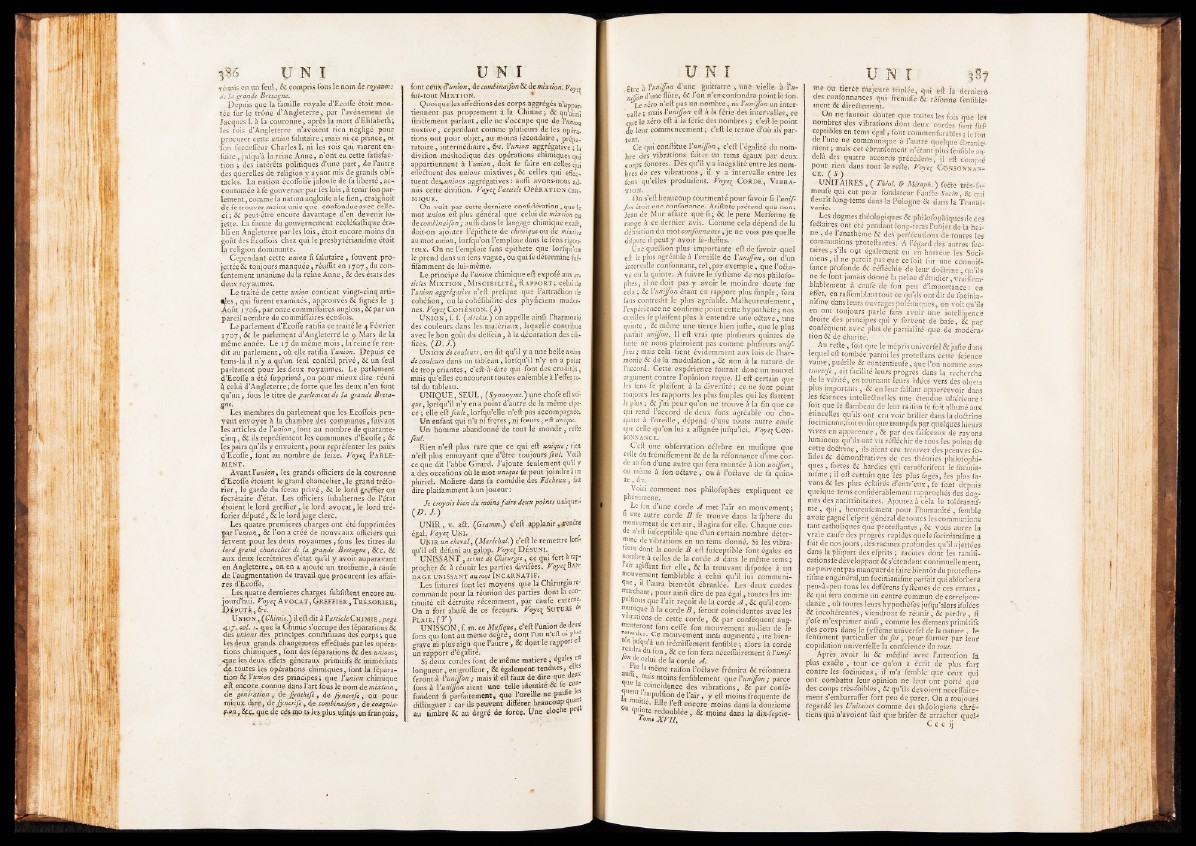
■ réunis, en un feul, & compris fous le nom de royanmz
■ di lu grande Bretagne
Depuis qup la famille royale d’Ecofîe étoit montée
fur le trône d’Angleterre, par l’avénement de
Jacques I. à la couronne, après la mort d’Elifabeth;
les fois d’Angleterre n’avoient rien négligé pour
procurer cette union falutaire ; mais ni ce prince, ni
ion facceffeur Charles I. ni les rois qui vinrent en-
fuite v jufqu’à la reine Anne, n’ont eu cette fatisfac-
tion ; des intérêts politiques d’une part, de l’autre
«des querelles de religion y ayant mis de grands obf-
■ tacles. La nation écoffoife Jaloufe de fa liberté, ac-
pputumée à fe gouverner par fes lo is, à tenir fon parlement,
comme la nation angloife a le fxen, craignoit
de fe trouver moins unie que confondue avec celle-
c i ; & peut-être encore davantage d’en devenir fillette.
La forme du gouvernement eccléfiaftique établi
en Angleterre par le.$ lo is, étoit encore moins du
gôut des Ëcoffois chez qui lepresbytérianifme étoit
la -religion dominante.
Cependant cette union fi falutaire , fouvent pro-
jettée & toujours manquée, réuffit en 17 0 7 , du çon-
fenternent unanime de la reine Anne, & des états des
•deux royaumes.
Le trqité de cett,e union contient vingt-cinq articles
, qui furent examinés, approuvés & Agnès le 3
Août 17.06, par onze commiflaires anglois, & p a r un
pareil nombre de commiflaires écoflois.
Le parlement d’Ecofle ratifia ce traité le 4 Février
*7 0 7 , & le parlement d’Angleterré le 9 Mars de la
même année. Le 17 du même mois, la'reine fe rendit
au parlement, oit elle ratifia Yunion. Depuis ce
tenis-là il n’y a qu’un feul confeii privé, & un feul
parlement pour les deux royaumes. Le parlement
d’Ecofle a « té fupprimé, ou pqqr mieux dire réuni
•a celui d’Angleterre ; de forte que les deux n ’en font
qu’tm j fous le titre de parlement de la grande Breta-
ÇM 1
Les membres du parlement que les Ecoflois peuvent
envoyer à la chambre des communes,, fuivant
les articles de l’union, font au nombre’de quarante-
•çinq, &.ils repréfentent les communes d’Ecofle ; &
les pairs qu’ils y envoient, pour repréfenter les pairs
d ’E cofle, font au nombre de feize. Voye{ P a r l e m
e n t .
Ayant Yunio,n^ les grands officiers de la couronne
d’Ecofle étoient le grand chancelier, le grand tréfo-
r ie r , le garde du fceau privé, & le lord greffier ou
foçrétaite d’état. Les officiers fubalternes: de l’état
étoient le lord greffier, lè lprd avocat, le lord tré-
forier député, & le lord juge clerc.
Les quatre premières charges ont été fupprimçes.
pgr Y union, & l’on a créé de nouveaux officiers qui
fervent pour les deux royaumes, fous les titres de
lç.rd grqnd chancelier de la grande. Bretagne, & ç . &
aux deux fecrétaires, d’ état qu’il y ayoit auparavant;
en Angleterre,, on en a ajouté un troifieme, à caufe
d e l’augmentation de travail que procurent les affai-.
ces d’Ecoffe.
Les. quatre dernieres charges fubfiflent encore aujourd’hui.
fcye^A yQç^ t , G r e f f ie r , T r é so r i e r ,
QÉPUTÉj &C.,
" U p ipN y{ChàiriitY) il eft dit à Y article C h im ie ,page
■ ■ 4,1^-ad, j . que la Chimiç s’occupe des féparations &
■ des unions des principes, cpnftituans des corps ; que
les deuy grands changemens effeélués par les opérations,
d iinpques, font des féparations. & des unions;
<me les deux effetsi généraux primitifs & immédiats
de, foutes ffo opérations chimiques, font la.fépara-
tfon: fyV union des principe^; que Y union chimique
eft epqqrAçpnRue dans l’art fous le nom de mixtion,
de genéra^pn.y, de ,Jy.%tktft, de. jyjicrefe , ou pour
-nAe^Çt fpnçnj*:9. de combinaijon -, de coagulaçé$
iRO ts les plus, foites; en français,
font ceux Sunion, de combiriaifon & de mixtion. Poyit
fur-tout Mix t io n . * 1
Quoique les affeâiofis des corps aggrégés n’appai>
tiennent pas proprement à la Chimie ; ùu’ainfi
ftri&ement parlant, elle ne s’occupe que de Y union
mixtive, cependant comme plufieurs de fes opéra,
tions ©nt pour objet, au-moins fecondaire, préparatoire
, intermédiaire, &c. Y union aggrégative ; la
divifion méthodique des opérations chimiques qui
appartiennent à Y union, doit fe faire en celles qui
effeékient des unions mixtives, &c celles qui- effec*
tuent désunions aggrégatives : ânffi avons-nous admis
cette divifion. V o y eç Varticle Opération chi.
MIQUE.
On voit par cette derniere confidération , que le
mot union eft plus général que celui de mixtion, ou
de combinaifon ; aufli dans lé langage chimique exact,
doit-on ajouter l’épithete de chimique ou de mixùvc
au mot union, lorfqu’on l’emploie dans le fens rigou*
reux. On ne l’emploie fans épithete que lorfquoa
le prend dans un fens vague, ou quife détermine fuf*
fifamment de lui-même.
Le principe de Yunion, chimique efl: expofé auxar*
tides Mixtion, Misg ib il it é , R apport; celui de
Yunion aggregative n’eft prefque que l’attraftion de
cohéfion, ou la cohéfibilité des phyficiens modernes.
Voyei Cohésion, (h)
Union , f. f. (drehiti) on appelle ainfi l’harmonie
des couleurs dans les matériaux, laquelle contribua
avec le bon goût du deflein, à la décoration des éçli-
fices. (Z>. / J
UNioiN de couleurs , on dit qu’il y 3 une belle union
de couleurs dans un tableau, lôrfqu’ il n’y en a point
de trop criantes, c’eft-à-dire qui font des crudités,
mais qu’elles concourent toutes enfemble à l’effet to-,
tal du tableau.
UNIQUE, S EU L , (Synonyme.) une chofeefl:unique,
lprfqu’il n’y en a point d’aiitre de la même efpe-
ce ; elle eft/e?//e, lorfqu’elle n’efl: pas accompagnée.
Un enfant qui n’a ni freres, ni foetirs, eft unique.
Un homme abandonné de tout le monde, relie
feul. .
Rien n’ efl: plus rare que ce qui efl: unique ; rien;
n’efl plus ennuyant que d’être tou jours feul. Voilà
ce que dit l’abbé Girard. J ’ajoute feulement qu’il y
3 des oecafions oit le mot unique fe peut joindre à un
pluriel. Moliere dans fa comédie des Fâcheux, fait
dire plaifamment à un joueur :
Je croyois bien du tnoins faire deux points Uniques«1
{D . J . )
U N IR , v . a£l. ('Gfajnm.) ç’eft applanir gendre
égal. Voye^ U n i , j _-ox : • ;
U|^ir un cheval, ( Maréchal.) c’ efî le remettre lorft
qu’il efl défqni au galop, Voye^ Q e su n j.
UNISSÂNT, terme de Chirurgie , ce qui fert à rap-»
: proçher’ & à réûtifr les. parties 'çUvifçes.' Voye^ Ban-,
; DAGE VNISSANT
Les "futures fopt les: ^oyens que la Chinirgia re-
commande pour la réunion des parties dont la ÇPA“*;
tinuité efl détrqite récemment, pgr caufe externe.
. On à fort abufé. de, ce fecours. Voyt^ SUTURE 68
P L A iE j( ÿ ) ' : ' . . , „
; UNISSON, f. m. en Mufique, c’efl l’union de deux
r fons qui font au même degré, dorçt l’un n efl ni p 1**
: grave rii plus aigii que l’autre, & dont le rapport e
: un rapport d’égalité. .
! Si deux cordes font de même matière Régales en
longueur, en groffeur, & également tendues, ggi-
I forontA Yunijfbn ; mais il eft faux 4e dire que deu^
I fons à Yunijjon aient une telle identité & .^C°w
: fondent û parfaitement, que l’oreille ne pu e
diftinguer : car ils peuvent différer beaucoup qu _
an timhre 8>r an Ae.orA de force. Une cloche p
U N I
.être à ŸUrujjon d’une 'guitt'arre •, lifté vielle, à Ÿu-
' niflo*1 d’une flûte, & l ’on n’en confondra^ointle fon.
Le zéro n’efl pas un nombre ni YuniJ/on un intervalle
} mais Yunijfon efl à. la férié dès intervalles:,;éè
que le zéro èfl à la férié des nombres ; e’efUeipoint
de leur comiftencemertt ; c ’efl lé terme d’où ils parvenu
■ : •: ; . • • -■ ^
Ge qui coriftihié Yunijfon -, c’efl l’égalité du nombre
dès vibrations faites en tems égaux par deux
corps fonorés. Dès qu’il y a inégalité entre les nombres
de ces. vibrations, il y a intervalle entre les
fons qu’elles produifent. Voye^ Corde, Vibration.
On s’eft beaucoup tôurttienté pour favoir fi Y u n if
fon étoit une corifonance. Ârifloteprétend que non;
Jean dè Mur afliire que fi ; & lé pere Merfenne fe
range à ce dernier avis. Comme cela dépend de la
définition du mot conjbnnance ,;je ne vois pas quelle
difpute il peut y avoir là-defîiis.
Une queflion plus importante efl de favoir quel
efl le plus agréable à l’oreille de Yunijfon, ou d’un
intervalle eonfonnant, te l, par exemple, que l’ofta-
ve ou la quinte; A fuivre le fyflème de nos philofo-
phes , il ne doit pas y avoir le moindre doute fur
cela; & Yunijfon étant en rapport plus Ample, fera
fans contredit le plus agréable. Malheureufement-,
l’expérience ne confirme point cette hypothèfe ; nos
oreilles fe plaifent plus à entendre une oétave, une
quinte, & même une tierce bien jufle , que le plus
parfait unijfon. Il efl vrai que plufieurs quintes de
fuite ne nous plairoient pas comme plufieurs unif-
fons; mais cela tient évidemment aux lois de l’har-
mofiie & de la modulation, & non à la nature de
l’accord. Cette expériencé fournit donc un nouvel
argument contre l’Opinioii reçue. Il efl certain que
les fens fe plaifent à la diverfité ; ce ne font point
toujours les rapports les plus Amples qui les flattent
le plus ; & j ’ai peur qu’on ne trouvé à la fin que ce
qui rend l’accord de deux fons agréable ou choquant
à l’Oreille j dépend d’une toute autre caufe
que celle qu’on lui a affignée jufqu’iei. Voye{ C on-
ÉONNANCE.
C’efl une bbfervation célébré en mufique que
celle du frémiflement & de la réfonnance d’une çor- j
de au fon d’une autre qui fera montée à fon unijfon,
ou même à fon ottave , ou à l’oélave de fa quinte
, &c. ■
: Voici comment nos philofophes expliquent cè
phénomène..
Le fon d’une corde A met l’air en mouvement;
fi une autre corde B fe trouve dans la fphere du
mouvement de cet a ir , il agira fur elle. Chaque corde
n efl fufceptible que d’un certain nombre déterminé
de vibrations en un tems donné. Si les vibrations
dont la corde B efl fufceptible font égales en
nombre à celles de là corde A dans le même tems ;
air agiflant fur e lle , & la trouvant difpofée à uiî
mouvenient femblable à celui qu’il lui communi- I
que, il l’aura bien-tôt ébranlée. Les deux cordes
marchant, pour àinfi dire de pas égal, toutes les im-
pulhons que l’air reçoit de la corde A , & qu’il communique
à la corde B , feront coincidentes avec les
vibrations de cette corde, & par cofiféquent augmenteront
fans ceffe fon mouvement au-lieu de le'
etarder.^ Ce mouvement ainfi augmenté, ira bien-
°t lu*qu’à un frémiflement fenfiblê ; alors la cordé
ra du fon, & ce fon fera nécefiairement à Yunif-
/ n; de celui de la corde A.
auffar ^ ra‘bon l’oélave frémira & réfonnera
que1 î mai.s n?°tns fonfiblement que Yüriijfon • parce
que ^v^heidence des vibrations, & par confé-
îa m ' •l?1Pu^ on > y efl moins fréquente de
ou n " ' encofe nioins dans la douzième
quinte, redoublée, & moins dans la dix-fèptie-
Tomt X V I I% ' r
U N I
« é Bit iiêicê mâjéüre triplée, qui sft fe àèfnierè
des. cortfonnances qui fréihiffe & réfëHne Fenfible*
ment & direélement. '
On ne fauroit douter que toutes les fois que les
nombres des vibrations dônt deux cordes font fufi
eeptibles en tems égal j font coinmenfurables ; le fort
de l’une ne communique à l’autre quelque ébranle*
nient ; mars cet ébranlement n’étant plus fènfible au*
delà des quatre accords préëédens, il e f t compté
pour rien dans tout le rêfte. Foyer CGNSONnaN-
( A )
UNITAIRES , ( Thèol. & Métapk. ) feélê -très-fa*
meufe qui eut pour fondateur Faufre Socïn, & qui
fleurit long-tems dans la Pologne & dans là TraniiU
vanie.
dogmes theologiqiies & philofophiquèsde ces
fediaires^ont été pendant long-tems l’objet de la haine
; de i’a'nathènie &C des petfécütions de toutes les
communions protèftantèS. A l’égard des autres foc*
foires > s’ils ogt également eu en horreur les Sôci*
niens, il ne paroît pas que ce foit fur Une connoif-
fance profonde & refleêhië de leur doctrine ^ qu’ils
ne fe font jamais donné la peine d’étudier, VraifTem*
blablement à caiifé de fort peu d’importance : en
effet, en raffemblant tOiît ce qii’ils ont dit dû foeinia-
nifine dans leurs ouvrages polémiques, on voit qu’ils
en ont toujours parlé fans avoir une intelligence
droite des principes qui y fervent de bafe, & par
confequent- avec plus dé partialité què de modération'&
de charité.
Au re fte , foit que le mépris univerfel & jufte dans
lequel efl tombée parmi les proteftans cette fciencé
vaine,puérile & cohténtieufe ■, que l’on nomme con*
troVerfe , ait facilité leurs progrès dans la recherche
de la vérité , en tournant leurs idées vers des objets
plus importâns , & en leur faifant appercevoir dans
les fciences intelleéluelles une étenduè ultérieure i
foit que le flambeau de leur raifon fe foit allumé aux
étincelles qu’ils ont cru voir briller dans la doftrine
focinienné;foit enfin que trompés par quelques lueurs
vives en apparence , & par des faifeeaux dè rayons
lumineüx qu’ils ont vu réfléchir de tous les points de
cette doctrine, ils âiértt cru trouver dès preuves fo-
lides & démonftratives de ces théories philofophi-
ques , fortes & hardies qui caraélérifent le focinia*
nifmë ; il eft certain que les plus fages, les plus fa-
vans & les plus éclairés d’éntr’eux, fe font depuis
quelque tems Confidérablement rapprochés des dogmes
des antitrinitaifes. Ajoutez à cela le tolérantif-
m e , q u i, heureufement pour l’humanité , femblè
avoir gagné l’efprit général de toutes les communions
tant catholiques que proteftantes , & vous aurez la
vraie caufe des progrès rapides que le focinianifme à
fait de nos jours, dès racines profondes qu’il a jettées
dans la plupart des efprits ; racines dont les ramifications
fe développant & s’étendant continuellement,
ne peuvent pas tnanqiiër de faire bientôt du proteftan-
tifme érîgénéral,un focinianifme parfait quiabforbera
peu-à-p'éu tous les différens fyftèmes dé ces errans j
& qui fera comme un centré commun de correfporc-
dance, oii toutes leurs hypothèfes jufqu’alors ifolées
& incohérentes, viendront fe réunir, & perdre, fl
j’ofe m’exprimer ainfi , comme les élemens primitifs
des corps dans le fyflème univerfel de la nature , le
fentiment particulier dix f o i , pour former ~par leur
.éopiilàtion uriivèrfelle la confidence du tout.
Après avoir lu & médité avec l’attention la
plus exaéle , tout ce qu’on a écrit de plus fort
contre les fociniéns, il m’a fèmblé que ceux qui
ont combattu leur opinioh ne lèur ont porté que
des coups très-foiblés, & qu’ils dévoient néceflaire-
mént s embarrafler fort peu de parer. On a fôujoürà
regardé les Unitaires comme des théologiènrs dire-1
tiens qui n’àvûiènt fait que brifér & afraefiér quel*