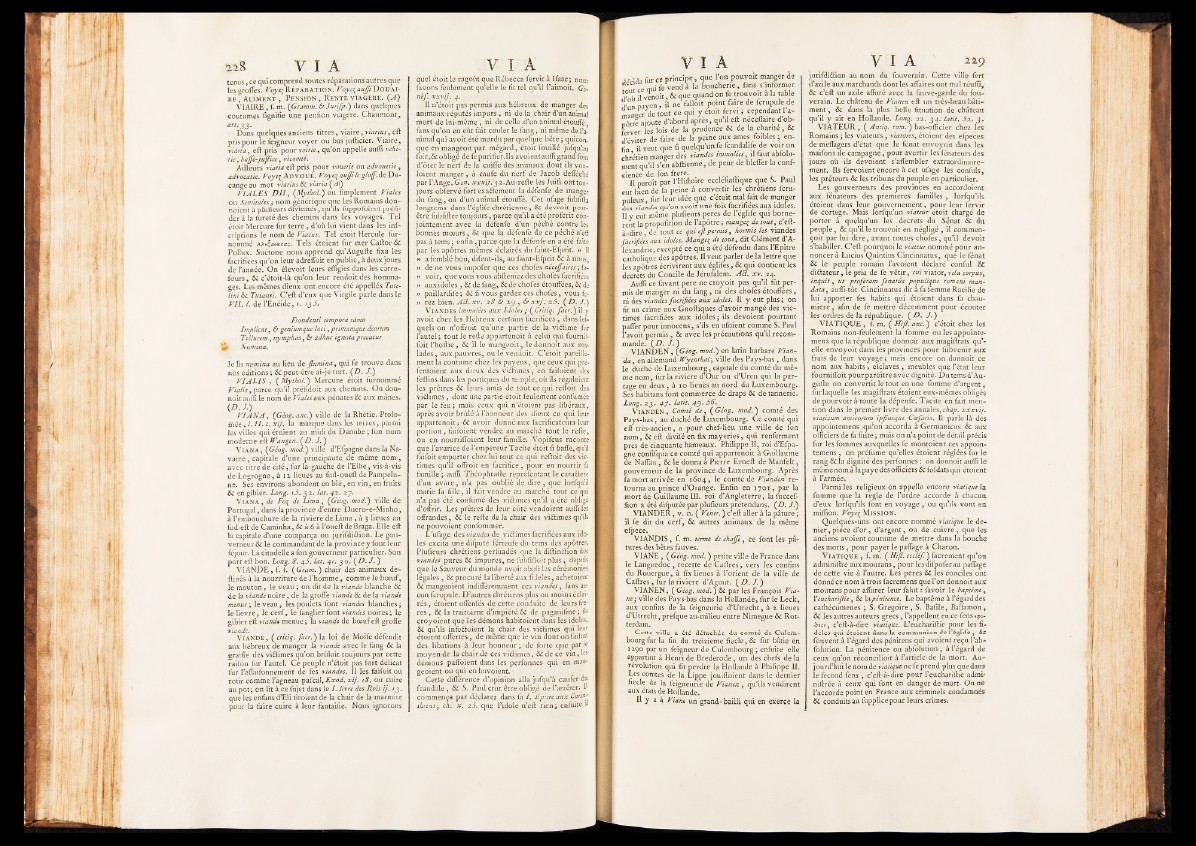
mt V I A
tenus, ce qui comprend toutes réparations autres que
lesgroffes. Voye[ R é p a r a t io n . Voye^aufflDovAi-
E E , Al im e n t , P e n s io n , R e n t e v i a g è r e . (A )
V IA IR E , f. m. (Gramm. & Jurifp.) dans quelques
coutumes lignifie une penfion viagère. Chaumont,
art.3 3 .
Dans quelques anciens titres, v k ir e , eft
pris pour le feigneur voyer ou bas jufticier. Viaire,
viaria, eft pris pour voirie, qu’on appelle aufli vehe-
rie, baffe-jufiiee, vicomte.
Ailleurs viaria eft pris pour vouerie ou advoutrie,
advocatie. Voye{ Ad vo u É. Voye{ aujjilegloff. de Du-
cangeau mot viarius & viaria (A\)
V IA L E S D U , (Mythol.) ou fimplement Viales
t)u Semitales ; nom générique que les Romains don-
noient à plufieurs divinités, qu’ils fuppofoient préfi-
•der à la fureté des chemins dans les voyages. Tel
étoit Mercure fur te rre , d’oii lui vient dans les inscriptions
le nom de Viacus. Te l étoit Hercule fur-
nommé AAi%iKttKctç. Tels étoient fur mer C a fto r&
Pollux. Suétone nous apprend qu’Augufte fixa les
Sacrifices qu’on leur adreffoit en public, à deux jours
de l’année. On élevoit leurs effigies dans les carrefours
, & c’étoit-là qu’on leur rendoit des hommages.
Les mêmes dieux ont encore été appellés Tute-
lini &c Tutanei. C’eft d’eux que Virgile parle dans le
V II . I. de l’Enéide, v. 1 3 3*
Frondenti tempora ramo.
Implicat, & geniunique loci, primamque deorum
Tellurem, nymphas, & adhuc ignota precatur
Numina.
Je lis numina au lieu de jlumina, qui fe trouve dans
nos éditions ; & peut-être ai-je tort. (D . J .)
1V IA L IS , ( Mythol. ) Mercure étoit furnommé
Vialis , parce qu’il préfidoit aux chemins. On don-
noit auffi le nom de Viales aux pénates & aux mânes.
m m m
V I A N A , (Géog. anc'.) ville de la Rhetie. Ptolo-
mée, l. I L c. x ij. la marque dans les terres, parmi
les villes qui étoient au midi du Danube ; fon nom
moderne eft Wangen. (D . J . )
V ia n a , (Géog. mod.) ville d’Efpagne dans la Navarre
, capitale d’une principauté de même nom,
avec titre de cité, fur la gauche de l’Elbe, vis-à-vis
de Logrogno, à 1 2 lieues au fud-oueft de Pampelu-
ne. Ses environs abondent en blé, en v in , en fruits
& en gibier. Long. tS. 3 2 . lat. 42. 27.
V ia n a , de Fo[ de Lima, (Géog. mod.') ville de
Portugal, dans la province d’entre Duero-e-Minho,
à l’ embouchure de la riviere de Lima , à 3 lieues au
fud-eft de Caminha, & à 6 à l’oueft de Braga. E lle eft
la capitale d’une comparça ou jurifdi&ion. Le gouverneur
& le commandant de la province y font leur
féjour. La citadelle a fon gouverneur particulier. Son
port eft bon. Long. 8. 46. lat. 41. 3 0 . (D . J . )
VIANDE,, f. f. (Gram. ) chair des animaux de-
ftinés à la nourriture de l’homme, comme le boeuf,
le mouton, le veau- ; on dit de la viande blanche &
de la viande noire, de la groffe viande & de la viande
menue ; le veau, les poulets font viandes blanches ;
le lievre, le c e rf, le fanglier font viandes noires; le
gibier eft viande menue ; la viande de boeuf eft groffe
viande.
V ia n d e , ( critiq. facr.) la loi de Moïfe défendit
aux hébreux ae manger la viande avec le fang & la
graiffe des vi&imes qu’on brûloit toujours par cette
raifon fur l’autel. Ce peuple n’étoit pas fort délicat
fur l’affaifonnement de fes viandes. Il les faifoit ou
rôtir comme l’agneau pafcal, Exod. x ij. 18. ou cuire
au pot; on lit à ce fujet dans le I. livre des Rois ij. 13 .
que les enfans d’Eli tiroient de la chair de la marmite
pour la faire cuire à leur fantaifie. Nous ignorons
V I A
quel étoit le ragoût que Rébecca fervit à ïfaac ; nous
favons feulement qu’elle le fit tel qu’il l’aimoit. Ge-
nef. xxvij-, 4.
Il n’étoit pas permis aux hébreux de manger des
animaux réputés impurs, ni de la chair d’un animal
mort de lui-même , ni de celle d’un animal étouffé
fans qu’on en eût fait couler lé fang ,.ni même de l’animal
qui avoir été mordu par quelque bête ; quiconque
en mangeoit par mégard , étoit fouillé jufqu’au
foir,&obligé de fe purifier.Ils avoient aufli grand foin
d’ôter le nerf de la cuiffe des animaux dout ils von-
loient manger, à caufe du nerf de Jacob defféché
par l’Ange. Gen. x x x i j.3 2. Au-refte les Juifs onttou-
jours oblêrvé fort exactement la défenfe de manger
du fang, ou d’un animal étouffé» Cet ufage fubfifta
longtems dans l’égiife chrétienne, & devroit peut-
être fubfifter toujours, parce qu’il a étéproferit conjointement
avec la défenfe d’un péché contre les
bonnes moeurs, & que la défenfe de ce péché n’eft
pas à tems ; enfin, parce que la défenfe en a été faite
par les apôtres mêmes éclairés du faint-Efprit. « 11
» afemblé bon, difent-ils, au faint-Efprit Sc à nous,
» de ne vous impofer que ces chofes nécejfaires ; fa-
» voir, que vous vous abfteniez des chofes facrifiées
» aux idoles , & de fang, & de chofès étouffées, & de
» paillardife ; & fi vous gardez ces chofes, vous fe-
» rez bien.A c l.x v . 2.8 & 29., & x x j. z 3 . ( D .- JA
VIANDES immolées aux Idoles; ( Critiq. facr.) il y
avoit chez les Hébreux certains facrifices , dans lesquels
on n’offroit qu’une partie de la viétime fur
l’autel ; tout le refte appartenoit à celui qui fournif-
foit l’hoftie , & il le mangeoit, le donnoit aux malades,
aux pauvres, ou le vendoit. C ’étoit pareillement
la coutume chez les payens, que ceux qui pré-
fentoient aux dieux des victimes, en faifoient des
feftins dans les portiques du temple, oit ils régaloient
les prêtres & leurs amis de tout ce qui reftoit des
victimes, dont une partie étoit feulement confumée
par le feu; mais ceux qui n’étoient pas libéraux,
après avoir brûlé à l’honneur des dieux Ce qui leur
appartenoit, & avoir donné aux facrificateurs leur
portion, faifoient vendre au marché tout le refte,
ou en nourriffoient leur famille. Vopifcus raconte
que l’avarice de l’empereur Tacite étoit fi baffe, qu’il
faifoit emporter chez lui tout ce qui reftoit des victimes
qu’il offroit en facrifice, pour en nourrir fa
famille ; aufli Théophrafte repréfentant le caraCtere
d’un ava re , n’a pas oublié de d ire , que lorfqu’il
marie fa fille, il fait vendre au marché tout ce qui
n’a pas été confumé des victimes qu’il a été obligé
d’offrir. Les prêtres de leur côté vendoient aufli les
offrandes, & le refte de la chair des victimes qu’ils
ne pouvoient confommer.
L ’ufage des viandes de victimes facrifiées aux idoles
excita une difpute férieufe du tems des apôtres.
Plufieurs chrétiens perfuadés que la diftinCtion des
viandes pures & impures, ne fubfiftoit plus , depuis
que le Sauveur du monde avoit aboli les, cérémonies
légales, & procuré la liberté aux fideles, achetoient
& mangeoient indifféremment ces. viandes 9 fans aucun
fcrupule. D’autres chrétiens plus ou moins éclairé
s , étoient offenfés de cette conduite de leurs frères
, & la traitoient d’impiété & de paganifme ; ils
croyoient que les démons habitoient dans les idoles,
& qu’ils infeCtoient lq chair des victimes qui leur
étoient offertes, de même que le vin dont on faifoit
des libations à leur honneur ; de forte que par le
moyen de la chair de ces victimes, & de ce vin, les
démons paffoient dans les perfonnes qui en man-
geoient ou qui en buvoient.
Cette différence d’opinion alla jufqu’ à caufer du
fcandale, & S. Paul crut être obligé de l’arrêter. U
commença par déclarer dans fa I. £ pitre aux .Corin*
thiens, ch. x. z 5. que l’idole n’eft rien; enfuite u
V I A
J H I I ce principe > que l’on pouvoir manger àe
i l ce nui fe vend à la boucherie, fans s informer
H il venolt, & que quand on fe trouvoit à la table
H H „ ayen , il ne ftUoit point faire.de fcrupute.de
manger de tout ce qui y, étoit fe rv it cependant l ’a-
pôtre ajoute d’abord apres, qu’il eft neceffaire d ob-
ferver les lois de la prudence & de la chante, &
d’éviter de faire de la peine aux âmes foibles ; enfin
il veut que fi quelqu’un fe feandalife de voir un
chrétien manger des viandes immolées, il faut abfolu-
ment qu’il s’ en abftienne, de peur de bleffer la conf-
«ience de fon frere. M B i c r» 1
Il paroît par l’Hifloire ecclefiaftique que S. Paul
eut bien de la peine à convertir les chrétiens feru-
piileux, fur leur idée que c’étoit mal fait de manger
des viandes qu’on avoit une fois facrifiées aux idoles.
Il y eut même plufieurs peres de l’églife qui bornèrent
la propofition de l’apôtre; mange{ de tout, c’eft-
à-dire de tout « qui ejl permis, hormis les viandes
facrifiées aux idoles. Mange{ de tout, dit Clément d’A-
léxandrie, excepté ce qui a été défendu dans l’Epitre
catholique des apôtres. Il veut parler de la lettre que
les apôtres écrivirent aux églifes, & qui contient les
decrets du Concile de Jérufalem. A 3 , x v. 24.
Aufli ce favant pere ne croyoit pas qu’il fut permis
de manger ni du fang , ni des chofes étouffées,
ni des viandes facrifiées aux idoles. Il y eut plus ; on
ƒ'. I IH . . . A i« ,-A r V twnnnp dûc
paffer pour innocens, s’ils en ufoient comme S. Paul
l’avoit permis, & avec les précautions qu’il recommande.
( D . J . )
V IÀ N D EN , (Géog* mod.) en latin barbare Vtan-
da en allemand Wyenthal; ville des Pays-bas , dans
le duché de Luxembourg, capitale du comté du même
nom, fur la riviere d’Our ou d’Uren qui la partage
en deux, à 10 lieues ali nord du Luxembourg.
Ses habitans font commerce de draps &: dè tannerie.
Long. 2 3 . 4 7 . latit. 4 ^ . 6'Çv
V ia n d eN , Comté d e , (Géog. mod.) comté des
Pays-bas , au duché de Luxembourg. Ce comté qui
eft très-anden, a pour chef-lieu une ville de fon
nom, & eft divifé en fix mayeries, qui renferment
près de cinquante hameaux. Philippe II, roi d’Efpagne
confifqua ce comté qui appartenoit à Guillaume
de Naflau , & le donna à Pierre Erneft de Manfelt,
gouverneur de la province de Luxembourg. Après
fa mort arrivée en 16 0 4 , le comté de Vianden retourna
au prince d’Orange. Enfin en 1 7 0 1 , par la
mort de Guillaume III. roi d’Angleterre, la fuccef-
fion a été difputéepar plufieurs prétendans. (D . J . )
V IA N D E R , v. n. ( Vener. ) c’ eft aller à la pâture ;
il fe dit du ce rf, & autres animaux de la même
efpece»
V IAN D IS , f. m. terme de ckafiè, ce font les pâtures
des bêtes fauves.
V IA N E , ( Géog. mod. ) petite ville de France dans
îe Languedoc, recette de Caftres, vers les confins
du Rouergue, à fix lieues à l’orient de la ville de
Caftres, fur la riviere d’Agout. (D . J . )
VIANEN, ( Géog. mod. ) & par les François Via-
n e; ville des Pays-bas dans la Hollande, fur le Leck,
aux confins de la feigneurie d’Utrecht, à i lieues
d’Utrecht, prefque au-milieu entre Nimegue & Rotterdam.
Cette ville a été détachée du comté de Culeiii-
bourgfur la fin du treizième fiecle, & fut bâtie en
119 0 par un feigneur de Culembourg ; enfuite elle
appartint à Henri de Brederode, un des chefs de la
révolution qui fit perdre la Hollande à Philippe II.
Les comtes de la Lippe jouiffoient dans le dernier
fiecle de la feigneurie de Vianen , qu’ils vendirent
aux états de Hollande.
Il y a à Viane un grand-bailli qui en exerce là
V I A 249
jurifdiôion au nom du fouverain. Cette ville fert
d’azile aux marchands dont les affaires ont mal réuflï,
& c’eft un azile affuré avec la fauve-garde du fouverain.
Le château de Vianen eft un très-beau bâtiment
, & dans la plus belle fituation de château
qu’il y ait en Hollande. Long. 22. 3 4 . latit. 62. 3 .
V IA T E U R , ( Antiq. rom. ) bas-officier chez les
Romains ; les viateurs , viatores, étoient des efpeces
de meffagefs.d’état que le fénat envoyoit dans les
maifons de campagne, pour avertir les fénateurs des
jours oii ils dévoient s ’affembler extraordinairement.
Ils fervoient encore à cet ufage lés confuls,
les préteurs & les tribuns du peuple en particulier.
Les gouverneurs des provinces en accordoient
aux fénateurs des premières familles , lorfqu’ils
étoient dans leur gouvernement, pour leur fervir
de cortège. Mais lorfqu’un viateur étoit chargé de
porter à quelqu’un les decrets du Sénat & du
peuple, & qu’il le trouvoit en négligé, il commen-
çoit par lui dire, avant toutes chofes, qu’il de voit
s’habiller. C’ eft pourquoi le viateur nommé pour annoncer
à Lucius Quintius Cincinnatus, que le fénat
& le peuple romain l’avoient déclaré conful &
diâateur, le pria de fe v ê tir , eut viator, vêla corpus,
inquit, ut proferam fenatûs populique romani mandata
, aufli-tôt Cincinnatus dit à fa femme Racilie de
lui apporter fes habits qui étoient dans fa chaumière
, afin de fe mettre déceriiment pour écouter
les ordres de la république. ( D . ƒ» )
V IA TIQU E , f. m. f Llifi. anc.) c’étoit chez les
Romains non-feulement la fomme ou les appointe-
mens que la république donnoit aux inagiftrats qu’elle
envoyoit dans les provinces pour fubvenir aux
frais de leur vo y a g e ; mais encore on donrioit ce
nom aux habits > efclaves , meubles que l’état leur
fourniffoit pour paroître avec dignité. Du tems d’Au*
gufte on convertit le tout en une fomme d’argent,
fur laquelle les .magiftrats étoient eux-mêmes obligés
de pourvoir à toute la dépenfe. Tacite en fait mention
dans le premier livre des annales, chap. x xx v ij.
viaticum àmicorüm ipfiusqùe Ccefiaris. Il parle là des
appointemens qu’on accorda à Germanicus & aux
officiers de fa fuite ; mais on n’a point de détail précis
fur les fommes auxquelles fe montoient ces appointemens
j on préfume qu’elles étoient réglées fur lé
rang & la dignité des perfonnes : on donnoit aufli le
même nom à la paye des officiers & foldats qui étoient
à l’armée-.
Parmi les religieux on appelle ericôrè viatique là
fomme que la regle de l’ordre accorde à chacun
d’eux lorfqu’ils font en voyage , ou qu’ils vont eu
million. Voye^ MISSION.
Quelques-uns ont encore nommé viatique le denier
, piece d’o r , d’argent, ou de cuivre , que les
anciens avoient coutume de mettre dans la bouche
des morts, pour payer le paffage à Charon.
V ia t iq u e , f. m. ( Hiß. eccléf. ) facrement qu’on
àdminiftre auxmourans, pour les difpoferaü paffage
de Cette vie à l’autre. Les peres & les conciles ont
donné ce nom à trois facremens que l’on donnoit aux
mourans pour affurer leur falut ; favoir le baptême,
Yeucharifiie, & la pénitence. Le baptême à l’égard des
cathécumenes ; S. Grégoire , S. Bafile, Balfamon*
& les autres auteurs gréés, l’appellent en ce fens t<po-
5 tov, c’eft-à-dire viatique. L’euchariftie pour les fideles
qui étoient dans là communion de l’églife,
fouvent à l ’égard des pénitens qui avoient reçu l’ab-
folütion. La pénitence ou abfolution 9 à l’égard de
ceux qu’on réconcilioit à l’article de la mort. Aujourd’hui
le hom de viatique ne fe prend plus quedans
le fécond fens , c’eft-à-dire pour l’euchatiftié admij
niftrée à ceux qui font en danger de mort. On né
l’accorde point en France aux criminels condamnés
& conduits au fupplieepour leurs crimes*