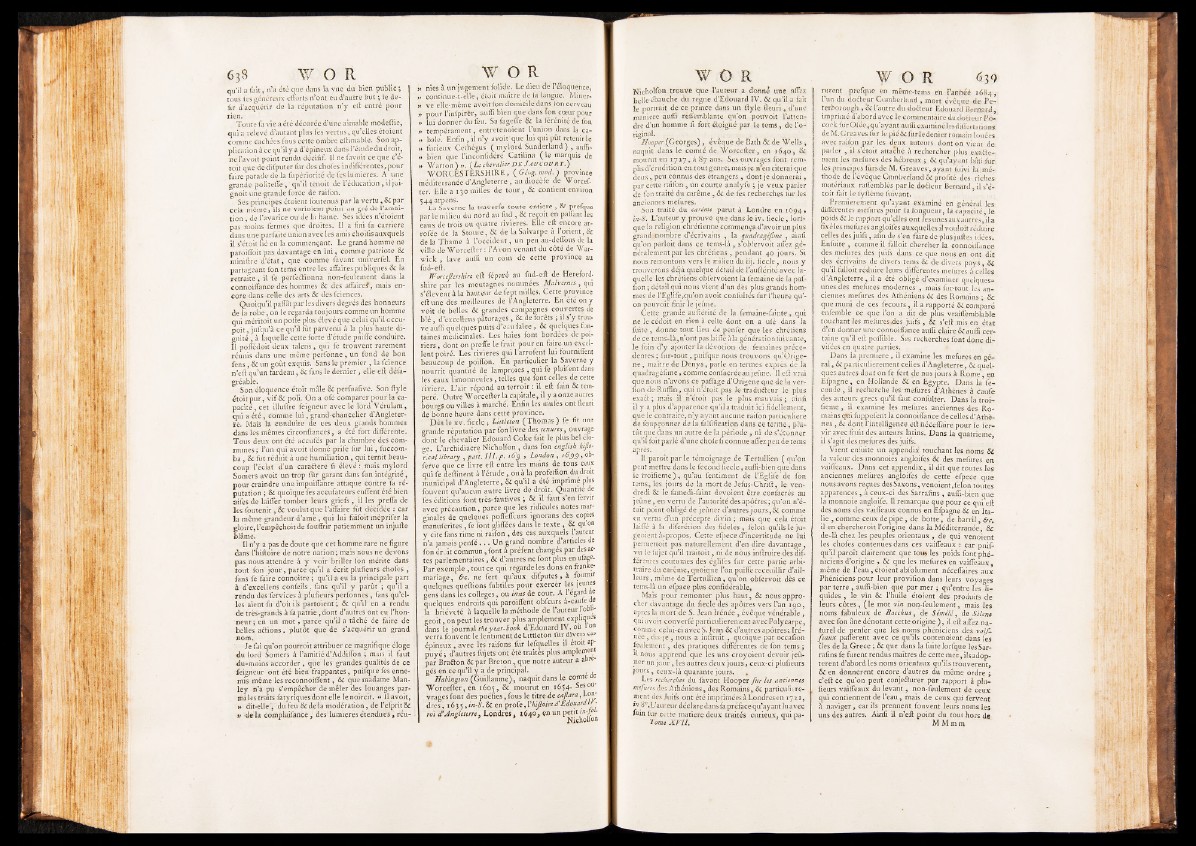
qu’il a fa it | n’ a été que dans la vue du bien public ;
tous les généreux efforts n’ont eu d’autre but ; le de-,
fir d’acquérir de la réputation n’y eft entré pour
rien.;
Toute fa vie a été décorée d’une aimable modeftie,
qui a relevé d’autant plus fes vertus, qu’elles étoient
comme cachées fous cette ombre eftimable. Son application
à ce qu’il y a d’épineux dans l ’étude du droit,
ne l’avoit point rendu décifif. Il ne favoit ce que c’é-
toit que de difputer fur des chofes indifférentes,pour
faire parade de la fupériorité de fes lumières. A une
grande politeffe , qu’il tenoit de l’éducation, il joi-
gnoit une grande force de raifon.
Ses principes étoient foutenus par la vertu, & par
cela même, ils ne varioient {foint au gré de l’ambition
de l’avarice ou' de la haine. Ses idées n’étoient
pas moins fermes que droites. Il a fini fa carrière
dans une parfaite union avec les amis choifis auxquels
il s’étoit lié en la commençant. Le grand homme ne
paroiffoit pas davantage en lu i, comme patriote &
mini tire d’é ta t, que comme favant univerfel. En
partageant fon tems entre les affaires publiques & la
retraite, il fe perfectionna non-feulement dans la
connoiffance des hommes & des affaire?, mais encore
dans celle des arts & des fciences.
Quoiqu’il paflât par les divers degrés des honneurs
de la robe, on le regarda toujours comme un homme
qui méritoit un polie plus élevé que celui qu’il occu-
po it, jufqu’à ce qu’il rut parvenu à la plus haute dignité
, à laquelle cette forte d’étude puiffe conduire.
Il poffédoit deux talens, qui fe trouvent rarement
réunis dans une même perfonne, un fond de bon
fens , & un goût exquis. Sans le premier , la fcience
n’ell qu’un fardeau, & fans le dernier, elle eft défa-
gréable.
Son éloquence étoit mâle & perfuafive. Son ftyle
étoit pur, v i f & poli. On a ofé comparer poufla capacité,
cet illultre feigneur avec le lord Vérulam,
qui a é té , comme lu i, grand-chancelier d’Angleterre.
Mais la conduite de ces deux grands hommes
dans les mêmes circonftances, a été fort différente.
Tous deux ont été accufés par la chambre des communes
; l’un qui avoit donné prife fur lu i, fuccom-
b a , & fut réduit à une humiliation , qui ternit beaucoup
l’éclat d’un cara&ére fi élèvé : mais mylord
Somers avoit un trop fûr garant dans fon intégrité,
pour craindre une impuiffanre attaque contre fa réputation
; & quoique fes accufateurs euffent été bien
aifes de laiffer tomber leurs griefs, il les prefla de
les foutenir , & voulut que l’affaire fût décidée : car
la même grandeur d’ame , qui lui faifoit méprifer la
gloire, i’empêchoit de fouffrir patiemment un injufle
blâme. .
Il n’ y a pas de doute que cet homme rare ne figure
dans l’hiftoire de notre nation; mais nous ne devons
pas nous attendre à y voir briller fon mérite dans
tout fon jo u r, parce qu’il a écrit plufieurs chofes ,
fans fe faire connoître ; qu’il a eu la principale part
à d’excellens confeils. fans qu’il y parût ; qu’il a
rendu des fervices à plufieurs perfonnes , fans qu’elles
aient fu d’où ils partoient ; & qu’il en a rendu
de très-grands à fa patrie /dont d’autres ont eu l’honneur;
en un mot , parce qu’il a tâché de faire de
belles a&ions, plutôt que de s’acquérir un grand
nom.
’ Je fai qu’on pourroit attribuer ce magnifique éloge
du lord Somers à l’amitié d’Addiffon ; mais il faut
du-moins: accorder , qtie les grandes qualités de ce
feigneur ont été bierf frappantes, puitqu e fes ennemis
même les reconnoiffent, & que madame Man-
le y n’a pu -s’ empêcher de mêler des louanges parmi
les traits fatyriques dont elle le noircit. « Il avoit,
» dit-elle', du feu &c de la modération, de l’èfprit &
» de la complaifancc, des lumières étendues, réu-
» nies à un’jugement folide. Le dieu de l’éloquence,
„ continue-t-elle , étoit maître de tflàngüe. Miner-
„ ve elle-même avoit ion domicile dans/on cerveau
» pour Pinfpirêr, aufîi-bien que dans Ion coeur pour
,, lui donner du feu. S a fag e ffe'& la férénité de fon
» tempérament, entreteuoient l’union dans la ca-
». baie. Enfin , il n!ÿ ayoit'.que lui qui pût. retenir le
I» furieux Céthégus { mylord Sunderlànd ) , auili-
,, bien que l’inconficiere Catilina ( le marquis de
» Wartdn ) ». { L t d Ü vM Ü r D E JA U C O D R T . )
W O R C E ST E R SH 1R E , ( ') province
méditerrance d'Angleterre , au dloeêfe (le Worcel-
ter Elle a 130 milles de tou r, & contient environ
544arpènS.
La Sa vei ne la traverfe toute entière, & prefque
par le milieu du nord au fud , & reçoit en patfant les
eaux de trois ou quatre rivières. Elle eft encore ar-
rofée de la Stoure, & de laSalvarpe à l’orient,&
de la Thame à l’occident, un peu au-deffous de la
ville de Worcefter : i’Avon venant du côté 4e War-
wick , lave auffi un coin de cette province au
fud-eft.
JForceJlershire eft féparé au fud-eft de Hereford-
shire par les montagnes nommées Malvernes, qui
s’élèvent à la hauteur de fept milles. Cette province
eft une des meilleures de l’Angleterre. En été on y
voit de belles & grandes campagnes couvertes, de
blé , d’excellens pâturages, & de forêts ; il s’y trou-
ve auffi quelques puits d’eau falee > & quelques fontaines
médicinales. Les haies font bordées de poiriers
, dont on preffe le fruit pour en faireun excellent
ÿ p M Les rivières qui l’arrofent lui fourniffent
beaucoup de poiffon. En particulier la Saverne y
nourrit quantité de lamproies , qui fe plailent dans
les eaux limonneufes, telles que font celles de cette
riviere. L ’air répond au terroir : il eft fain & tempéré.
Outre Worcefter la capitale, il y a onze autres
bourgs ou villes à marché. Enfin les mufes ont fleuri
de bonne heure dans cette province.
Dès le xv. fiecle, Lïttleton (Thomas) fe fit une
grande réputation par fon livre des tenures, ôuvrage
dont le chevalier Edouard Coke fait le plus bel éloge.
L’archidiacre Nicholfôn , dans fon english hijlo-
rical l'ibrary. , part. I I l .p . i * London , ré p p , ob-
ferve que ce livre eft entre les mains de tous, ceux
qui fe deftinent à l’ étude, ou à la profelfion du droit
niunicipal d’Angleterre, & qu’il a été imprimé plus
fouvent qu’aucun autre livre de droit.. Quantité de
fes éditions font très-fautives ; & il faut s’en fervir
avec précaution, parce que les ridicules notes marginales
de quelques poffeffcurs ignorans des copies
I manufcrites , fe font gliffées dans le te x te , & qu’on
y cite fans rime ni raifon , des cas auxquels l’auteur
n’a jamais penfé . . . Un grand nombre d articles de
fon droit commun, font à préfent changes par des ac*
tes parlementaires, & d’autres ne font plus enufage.
Par exemple , tout ce qui regarde les dons en franke-
mariage, &c. ne fert qu’aux difputes, à fournir
quelques queftions fubtiles pour exercer les jeunes
gens dans les colleges, ou inns de cour. A l’égard de
quelques endroits qui paroiffent obfcurs à-cauie fi
la brièveté à laquelle la méthode' de l’auteur rpbli*
geoit, on peut les trouver plus amplement expliques
dans le journal theyear-book d’Edouard IV. ou lo*1
verra fouvent le fentimentdeLittleton fur divers cas
épineux, avec les raifons fur lefquelles il etoit app
u y é ; d’autres fujets ont été traites plus amplement
par Braélon & par Breton, que notre auteur a abrégés
en ce qu’il y a de principal. , ,
Habington (Guillaume), naquit dans le comte oe
Worcefter, en 16 0 5 , & mourut en 1654* Ses ouvrages
font des poéfies, fous le titre de cajîara, Londres
, 16 3 5 , in-8. & en profe, Yhijloire tf EdouardIV-
roi d'angle terre. Londres. 16 4 0 , en un petit in-jo •
6 ? * Njçholfon
Nicholfon. trouvé que l’auteur a donné une affez
belle ébauche du régné d’Edouard IV. & qu’il a fait
le portrait de ce prince dans un ftyle fleuri, d’unè
maniéré auffi rèflemblante qu’on pouvoit l’attendre
d’un homme fi fort éloigné par le tems, de l’original..
(Georges.), êveque de Bath & dé Wells ,
naquit dans le comté de Worcefter, en 1640 ,
mourut en 1 7 1 7 , à 87 ans. Ses ouvrages font remplis
d’érudition en tout genre; mais je n’en citerai que
deux, peu connus des étrangers , dont je donnerai,
par cette raifon , tin courte analyfe ; je veux parler
ffe fon traité du carême, & de les recherches fur les
anciennes mefures.
Son traité du carême parut à Londre en. 16 9 4 ,
in*8. L’auteur y prouve que dans le iv. fiecle, lorf-
que la religion chrétienne commença d’avoir un plus
grand -nombre d’écrivains , la quadragéjime , ainfi
qu’on parloit dans ce tems-ià , s’obfervoit affez généralement
par les chrétiens , pendant 40 jours. Si
nous remontons vers le milieu du iij. fiecle , nous y
trouverons déjà quelque détail de l’auftérité avec la»-
quelle les chrétiens obfervoient la femaine de la paf-
fion ; detail qui nous vient d’un dès plus grands hommes
de l’Eglife,qu’on avoit confultés fur l’heure qu’on
pouvoit finir le jeûne.
Cette grande auftérité de la femaineTainte, qui
ne le cédoit en rien à celte dont on a ufé dans la
fuite, donne tout lieu de penfer que les chrétiens
de ce tem^-là, n’ont pas laifle à la génération fuivante,
le foin d’y ajouter la dévotion de. femaines précédentes
; fur-tout, puifque nous trouvons qu’Orige-
n e , maître de D en ys , parle en termes exprès de la
.quadragéfime, comme confacrée au jeûne. Il eft vrai
que nous n’avons ce pafîage d’Origene que de la ver-
fion de Ruffin, qui n’etoit pas le tra duc-leur le plus
exacl ; mais il n’étoit pas le plus mauvais ; ainfi
il y a plus d’apparence qu’il a traduit ici fidellement,
que le contraire, n’y ayant aucune raifon particulière
de foupçonner de la falfification dans ce terme, plutôt
que dans un autre de la période , ni de s’étonner
qu’il foit parlé d’une chofe fi connue affez peu de tems
après.
Il paroît par le témoignage de Tertullien ( qu’on
peut mettre dans le fécond fiecle, auffi-bien que dans
le îroifieme), qu’au fentiment de l’Eglife de fon
tems, les jours de la mort de Jefus-Chrift, le vendredi
& le famedi-faint dévoient être confacrés au
jeûne, en vertu de l’autorité des apôtres; qu’on n’étoit
point obligé de jeûner d’autres jou rs,& comme
en vertu d’un précepte divin ; mais que cela étoit
laiffé à la diferétion des fîdeles , félon qu’ils le ju-
. geoient à-propos. Cette efpece d’incertitude ne lui
permettoit pas naturellement d’en dire davantage,
vu le fujet qu’il traitoit, ni de nous inftruire des différentes
coutumes des églifes fur cette partie arbitraire
du carême, quoique l’on puiffe receuillir d’ailleurs
, même de Tertullien , qu’on obfervoit dès ce
te ms-là un efpace plus confidérable,
Mais pour remonter plus haut, & nous approcher
davantage du fiecle des apôtres vers l’an 19 0 ,
après la mort de S. Jean Irénée , évêque vénérable ,
qui avoit converfé particulièrement avecPolycarpe,
comme celui-ci avec S. Jean & d’autres apôtres; Iré-
nee , dis-je , nous a inftruit , quoique par occafion
feulement, des pratiques différentes de fon tems ;
il nous apprend que les uns croyoient devoir jeûner
un jou r, les autres deux jours, ceux-ci plufieurs
jours , ceux-là quarante jours. ,
Les recherches du favant Hoôper fu r les anciennes
mefures des Athéniens, des Romains, & particulièrement
des Juifs ont été imprimées à Londres en 17 2 1 ,
•L’auteur déclare dans fa préface qu’ayant lu avec
foin fur cette matière deux traités curieux, qui pa-
Tome X V II.
rurent prefque en même-tems en Panùéé 16 8 4 ,
l’un du do£leu.r Cumberland , mort évêque de. Pe-
terborough > &£ l’autre du dofleur Edouard Bernard
imprimé d’abord avec le eommentàire du doèfeur Po-
coek furOfée,qu’ayant auffi examinélesdUfertations
de M. Gréa ves fur le pié 6c fur le denier romain louées
avec raifon par les deux auteurs dont on vient de
parler , il s’étoit attaché à rechercher plus exa&e-.
ment les mefures des hébreux ; & qu’ayant b/ui.iiu:;
les principes lursde M. Greaves’, ayant fuivi la méthode
de l’évêque Cumberland & profité des riches
matériaux raffemblés par le dodeur Bernard, il s’étoit
fait le fyftème fuivant.
Premièrement qu’ayant exàminé èn gén.éràl les
différentes mefures pour la longueur, là capacité, le
poids & îe rapport qu’elles ont les un es aux a titres, il a
fixé les mefures angloifes auxquelles il vouloit réduire
celles des juifs, afin de s’en faire de plus juftçs idées»
Enfuite , comme il fallpit chercher la eonnoilTancô
des mefures des juifs dans ce que nous en ont dit
des écrivains de divers tems Sç de divers p a y s, &
qu’il falloit réduire leurs différentes mefures à celles
a ’Angleterre, il a ete obligé d’examiner quelques-1*
unes des mefures modernes , mais fur-tout les anciennes
mefures des Athéniens & des Romains ; &
que muni 4e ces fecours * il a rapporté & comparé
enfemble ce que l’on a dit de plus vraiffeniblable
touchant les mefures-des juifs , & s’eft mis en état
dsen donner une connoiffance auffi claire & auffi certaine
qu’il eft poflxble. Ses recherches font donc di-
vifées en quatre parties.
Dans la première, il examine les mefures en aérai
, & particulièrement celles d’Angleterre, &c quelques
autres dont on fe fert de nos jours à Rome , ea
Efpagne, en Hollande & en Egypte. Dans la féconde
, il recherche lès. mefures d’Athènes à Caufe
des auteurs grecs qu’il faut confulter. Dans la troi-*
fieme, il examine les mefures anciennes des Romains
qui fuppofent la connoiffance de celles d’Athènes
, & dont l’intelligence eft néceffaire pour fe 1er-
vir avec fruit des auteurs latins. Dans la quatrième,
il s’agit des mefures des juifs. ,
Vient enfuite un appendix touchant les noms &
la valeur des monnoies angloifes & des mefures en
vaifleaux. Dans cet appendix, il dit que toutes les
anciennes mefures angloifes 4e cette efpece que
nous avons reçues des Saxons, venoient, félon toutes V
apparences, à ceux-ci des Sarrafins , auffi-bien que
la monnoie angloife. Il remarque que pour ce qui eft
des noms des vaifleaux connus en Efpagne & en Italie
, comme ceux de pipe , de botte, de barril 6>e.
il en chercheroit l’origine dans la Méditerranée, 6c ■ ' ' = ?
de-là chez les peuples orientaux, de qui venoient
les chofes contenues dans ces vaifleaux : car puif-
qu’il paroît clairement que tous les poids font phéniciens
d’origine , & que les mefures en Vaifleaux,
même de l’eau, étoient abfolument néceflaires aux
Phéniciens pour leur provifion dans ieurs vpyages
par terre , auffi-bien que par mer ; qu’entre les liquides
, le vin & l’huile étoient des produits de
leurs côtes, ( le mot vin non-feulement, mais les
noms fabuleux de Bacckus, de Scmélé, de Silent
avec fon âne dénotant cette origine ) , il eft aflez naturel
de penfer qiie les noms phéniciens des vaif-
féaux paflerent avec ce qu’ils contenoient dans les
îles de la Grece ; & que dans la fuite lorfque les Sarrafins
fe furent rendus maîtres de cette mer., ils adop-
terent d’abord les noms orientaux qu’ils trouvèrent,
& en donnèrent encore d’autres du même ordre ;
c’ eft ce qu’on peut conjeélurer par rapport à plufieurs
vaifleaux du levant, non-feulement de ceux
qui contiennent de l’eau, mais de ceux qui fervent
à naviger, car ils prennent fouvent leurs noms les
uns des autres. Ainfi il n’eft point du tout hors de
M M mm