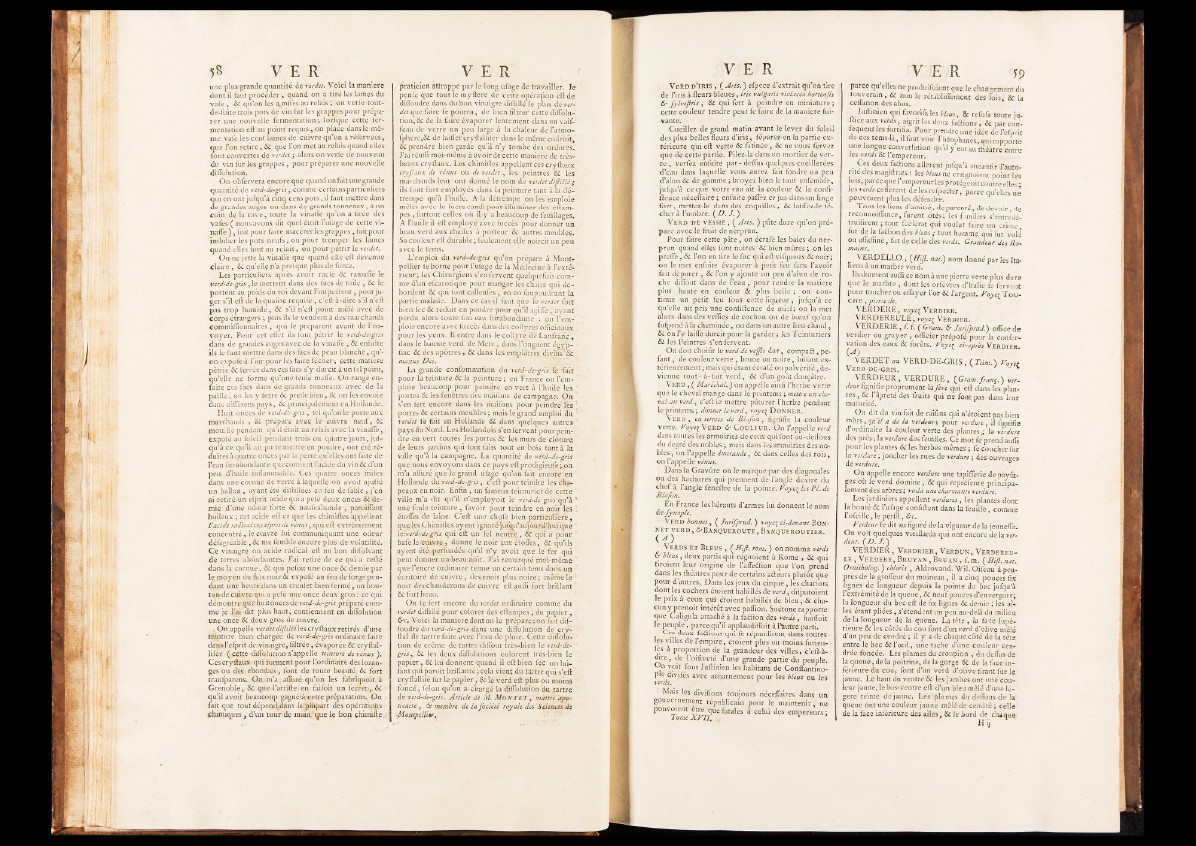
une plus grande quantité dt verdet. Voici la maniéré
dont il faut procéder , quand on a tiré les lames du
vafe , & qu’on les a^miles au relais ; on verle tout-
de-fuite trois pots de vin fur les grappes pour préparer
une nouvelle fermentation; lorfque cette fermentation
eft au point requis, on place dans le même
vafe les cent lames de cuivre qu’on a réfervées ,-
que l’on retire, & que l’on met au relais quand elles
font couvertes de verdit ; -alors on verle de nouveau
du vin fur les grappes, pour préparer une nouvelle
diffolution.
On obfervera encore que quand on fait une grande
quantité de verd-de-gris, comme certains particuliers
qui en ont jufqu’à cinq cens pots, il faut mettre dans
de grandes auges ou dans de grands tonneaux, à un
coin de la ca v e , toute la vinaffe qu’on a tirée des
vafes ( nous ayons dit quel étoit Tufage de cette vi-
naffe ) , foit pour faire macérer les grappes, foitpour
imbiber les pots neufs , ou pour tremper les lames
quand elles font au relais, ou pour pétrir le verdet.
On ne jette la vinaffe que quand elle eft devenue
claire , & qu’elle n’a prelque plus de force.
Les particuliers après avoir raclé & ramaffé le
verd-de-gris, le mettent dans des facs de toile , & le
portent au poids du roi devant l’infpe&eur, pour juger
s’il eft de la qualité requife , c ’eft-à-dire s’iln ’eft
pas trop humide, & s’il n’eft point mêlé avec de
corps étrangers ; puis ils le vendent à des marchands
commiffionnaires, qui le préparent avant de l’envo
yer. Pour cet effet ils font pétrir le verd-de-gris
dans de grandes auges avec de la vinaffe , &c enfuite
ils le font mettre dans des facs de peau blanche, qu’on
expofe à l ’air pour les faire fécher ; cette matière
pétrie & ferrée dans ces facs s’y durcit à un tel point,
qu’elle ne forme qu’ une feule maffe. On range en-
fuite ces facs dans de grands tonneaux avec de la
paille ; on les y ferre &c prelfe bien, & on les envoie
dans différenspays, & principalement en.Hollande.
Huit onces de verd-de-gris , tel qu’on le porte aux
marchands , &c préparé avec le cuivre neuf, &
mouillé pendant qu’il étoit au relais avec la vinaffe,
expofé au foleil pendant trois ou quatre jours, jufqu’à
ce qu’il ait pu fe mettre en poudre-* ont été réduites
à quatre onces par la perte qu’ elles ont faite de
l’eau furabondante que contient l’acide du vin &c d’un
peu d’huile inflammable. Ces quatre onces mifes
dans une cornue de verre à laquelle on avoit ajufté
un ballon , ayant été diftillées au feu de fable ,,j’en
ai retiré tin ei’prit acide qui a pefé deux onces & demie
d’une odeur forte & naufeabunde ,,paroiffant
huileux ; cet acide eft ce que les chimiftes appellent
l'acide radical ou efpritde venus, qui eft extrêmement
concentré,-le cuivre lui communiquant une odeur
défagréable ,& me femble encore plus de volatilité.
C e vinaigre ou acide radical eft un bon diffolvant
de terres abforbantes. J ’ai retiré de ce qui a refté .
dans la cornue, & qui pefoit une once & demie par
le, moyen du flux noir & expofé au feu de forge pendant
une heurè'dans un creufet bien fermé, un bouton
de çui-V'ïe/qui a pefé une once deux gros : ce qui
démonfre-que huitoncesde verd-de-gris préparé comme
je-Bai. dit plus haut, contiennent en diffolution
une once & deux gros de cuivre.
. On appelle verdet dijlillé les cryftaux retirés d’une
teinture bien chargée de verdrdçrgris ordinaire faite
dans-J’efprit' de. vinaigre* filtrée;, évaporée & cryftal-
lifée (cette diffolution s’appelle teinture devenus ) . .
Ces cryftaux- qui forment pour ^ordinaire des lozan-
ges ou des, rhombes , font de toute beauté & fort
tranfparens. On>m a ; affiné qu’on les fabrlquoit à
Grenoble, & que l’aftiftefen faifoit un fecrët»,.&c ’
qu’il avoit beaucoup gagnéfà/eette préparation. On >
fait que tout dépend^dans laiplnpart des opérât ipîis.»
»chimiques, d’un lourde main que le bon çhimifte j
praticien attrappe par le long ufage de travailler. Je
penfe que tout le myftere de cette opération eft de
diffoiidre dans du bon vinaigre diftillé le plus de verdet
que faire fe pourra, de bien filtrer cette diflolu-
■ tion, & de la faire évaporer lentement dans un vàif-
feau de verre un peu large à la chaleur d e l’atmo-
fphere,& de laiffercryftallifer dans le même endroit,
8c prendre bien garde qu’il n’y tombe des ordures.
J ’ai réufli moi-même à avoir de cette maniéré de très-
beaux cryftaux. Les chimiftes appellent ces cryftaux
cryjlaux de venus ou de verdet, les peintres &C les
marchands leur ont donné le nom de verdet dijlillé ;
ils font fort employés dans la'peinture tant à la détrempe
qu’à l’huile. A la défrèmpe on les emplçie
mêlés avec le lucre candi pour illuminer des eftam-
pes , furtout celles où il y a beaucoup de feuillages.
A l’huile il eft employé avec fuccès pour donner un
beau verd aux chaifes à porteur & autres meubles,.
Sa couleur eft durable ; feulement elle noircit un peu
avec le tems.
L ’emploi du verd-de-gris qu’on prépare à Montpellier
le borne pour l’ulage de la Médecine à l’extérieur;
les Chirurgiens s’ en fervent quelquefois comme
d’un efearotique pour manger les chairs qui débordent
& qui font calleufes, en en faupoudrant la
partie malade. Dans ce cas il faut que le verdet foit
bien fec & réduit en poudre pour qu’il agiffe, ayant
perdu alors toute fon eau furabondante , : ,pii l’emploie
encore avec fuccès dans des collyres officinaux.
pour les yeux. Il entre dans le collyre de Lanfrane , .
dans le baume verd de Metz , dans,l’onguent égyp- >
tiac & des apôtres, & dans les emplâtres divinsl8c .
manus Dei.
La grande confommation du verd-de-gris fe rait
pour là teinture &c la peinture’; en France on l’em- ’
ploie beaucoup pour peindre en vert à l’huile le s*
portes & les fenêtres des maifons de campagne. On ’
s’en fert encore dans les maifons pour peindre';les 1
portes & certains meubles ; mais le grand emploi du !
verdet fe fait en Hollande & dans quelques autres ’
pays du Nord. Les Hollandois s’en fervent pour pein- ’
dre en vert toutes les portes 8c les murs de clôture
de leurs jardins qui font faits tout en bois tant à la
ville qu’à la campagne. La quantité de verd-de-gris
que nous envoyons dans ce pays eft prodigieufe;,on
m’a affuré que le grand ufage qu’o n fait encore'en
Hollande du verd-de-gris, c’eft pour teindre les chapeaux
en noir. Enfin, un fameux teinturier de cette '
ville m’a dit-, qu’il n’ employoit le verd-de-gris'qu’k >
une feule teinture , favoir pour teindre en noir les :
étoffes de laine. C’eft une chofe bien particulière ,
quelles Chimiftes ayent ignoré jufqu’aujoùr.d’hui que ’
lé.verd-:de-gris qui eft un fel neutre, 8c qui a pour
bafe le-cuivre.-, donne le noir aux étoffes, 8c qu’ils •
ayent été-tperfiiadés qu’il n’y avoit que lé fer qui
peut donner., un-beau noir. J ’ai remarqué moi-même ’
que l’encre Ordinaire tenue un certain tems dans up
ecritoire de cuivre,- devenoit plus noire ; - meme le ’
noir des chauderons -de cuivre eft aufli fort brillant
& fort beau.
On fe fert encore du verrez ordinaire comme du
verdet diftillé pour colorer des'eftampes, du papier,
&c. Voici la maniéré dont on le prépare : on fait dif-
foudre du verd-de-gris dans une diffolution de cry-
ftal de tartre faite avec l’ eau de pluie. Cette diflblu- '
tion de crème de tartre diffout très-bien le verd-de-
gris , 8c les deux diffoliitions colorent très-bien le
papier, 8c lui donnent quand il eft bien fec un lui—
fant qui paroît brillanté ; cela vient du tartre qui s’eft
cryftallifé fur le papier, êc le verd eft plus ou moins
foncé, félon qu’on a chargé la diffolution du tartre
de verd-de-gris. Article de M. M o N T E T , ; mâttre 'àpe-
ticaire , & membre de La fociété royale des Sciences de
Montpellier t
VÉfeD d ’ i r i s , ( Arts. ) efpece d’ extrait qu’on tire
de l’iris à -fleurs b le u e s , iris vulgaris violacea hortenfis
6* fylvtfiris , 8c qui fe tt à peindre en m in ia tu re ;
cette couleur tendre peut fe faire de la maniéré fui-
vante*
Cueillez de grand matin avant le lever du foleil
des plus belles fleur); d’iris, féparez-en la partie extérieure
qui eft vefte & fatinée, & ne vous fervez
que de cette partie. Pilez-la dans un mortier de verre
, verféz enfuite par - deffus quelques cueillerées
d’eau dans laquelle vous aurez fait fondre un peu
d’alun 8c de gomme ; broyez bien le tout enfemble,
jufqù’à ce que votre eau'ait la couleur 8c la eonfi-
ftence néceffaire ; enfuite paflez ce jus dans un linge
fort, mettez-le dans des coquilles, 8c laiffez-Ie fécher
à Fombre. ( D . J . )
V e r d d e v e s s i e , ( Arts. ) pâte dure qu’on prép
a re av e c le fruit de nerprun.
Pour faire cette pâte, on écrafe les baies du nerprun
quand elles font noires 8c bien mûres ; on les
preffe, 8c l’on en tire le fuc qui eft vifqueux 8c noir;
on le met enfuite évaporer à petit feu fans l’avoir
•fait dépurer , 8c l’on y ajoute un peu d’alun de roche
diffout dans de l’eau, pour rendre la matière
plus haute en couleur & plus belle ; on continue
un petit feu fous cette liqueur, jufqu’à ce
qu’elle ait pris une confiftence de miel ; on la met
alors dans des vefîies de cochon ou de boeuf qu’on
fufpend à la cheminée, ou dans un autre lieu chaud ;
8c on l’y laifîe durcir pour la garder ; les Teinturiers
8c les Peintres s’en fervent.
On doit choifir le verd de vejße dur, compatt, pe-
fant, de couleur verte , brune ou noire, luifant extérieurement
; mais qui étant écrafé oupulvérifé, devienne
tout-à-fait verd, & d’un goût douçâtre.
V e r d , ( Maréchal. ) on appelle ainfi l ’herbe ve rte
q ue le cheval mange dans le printems ; mettre un c/:e-
val-au verd % c’ eft le mettre';pâturer l’herbe pendant
le p rintems; donner le verd, voye[ DONNER.
V e r d , en termes de B U fo n , fignifie la couleur
verte. VoyerfWe r d & C o u l e u r . On l’appelle verd
dans toutes les armoiries de ceux qui font au-deflous
du degré des nobles ; mais dans les armoiries des nobles
, on l’appelle émeraude, ÔC dans celles des rois,
©n l’appelle venus.
Dans la Gravüre on le marque par des diagonales
qu des hachures qui prennent de l’angle dextre du
chef à l’angle feneftre de la pointe. Voyez les P l.d e
Blafon. . . : • .
En France les hérauts d’armes lui donnent le nom
de fynople.
• V e r d bonnet, ( Jurifprud. ) voyei ci-devant Bon-
n e t v e r d , & B a n q u e r o u t e , B a n q u e r o u t ie r .
V e r d s e t -Bl e u s , ( Hiß. rom. ) on nomma verds
& bleus, deux partis qui régnoient à Rome , & qui
tiroient leur origine de l’affeétion que l’on prend
dans les théâtres pour de certains aéteurs plutôt que
pour d’autres. Dans les jeux du cirque, les chariots
dont les cochers etoient habillés de verd, difputoient
le prix à ceux qui étoient habillés de bleu, & chacun
y prenait intérêt avec paffion. Suétone rapporte
que Caligula'attaché à la faâion des verds, haïffbit
le peuple, parce qu’il applaudiffoit à loutre parti.
■ Ces deux faôions qui fe répandirent dans toutes
les villes de l’empire, étoient plus ou moins fiirieu-
fes à proportion de la grandeur des villes, c’eft-à-
dire , de l’oifiveté d’une grande partie du peuple.
Gn voit fous Juftinien les habitans de Conftantino-
pie divifés avec acharnement pour les bleus ou les
verds. ■ ■!
Mais les divifions toujours néceffaires dans un
gouvernement républicain pour le maintenir, ne
pouvoient être que fatales à celui des empereurs;
Tome X V U % , r >
ceflation des abus.
Juftinien qui favorifa les Wms, & refufa toute iu-
ftice aux verds, aigrit les deux faftions , & par cort-
lequent les fortifia. Pour prendre une idée del’efprit
de ces tems-là, ri faut voir Théophanes, qui rapporté
une longue converfatiort qu’il y eut au théâtre entre
les verds oc l empereur.
S e s deux foaions allèrent jufqu’à anéantir l’auto-
rrté des magiftrats : les Heu, ne craignoiént pdiht lés
lois,'pareè-qùe l’emperéurles protégéeitcOntrè elléS';
les «nér ceflérent delesrefpefter, parce qu’ elles rie
pouvoient plus les ticfcndre.
i , ternis les liens d’amitié, de parenté, dé devoir de
reconnoiflance, forent 6tés; les familles s’ entre’dé-
truiîirent ; tout fcêicrat qui voulut faire un crime
fut de la faction des bleus ; tout homme qui fut volé
ou affaùiné, fut de celle des n id s . Grandeur des Ra.
mains.
V ERD E L LO , ( Hijl. nat.) nom donné par les Italiens
àun marbre verd.
Ils donnent aufli ce hom à une pierre verte plus dure
que le marbre , dont les orfèvres d’Italie fe fervent
pour toucher ou effayer l’or & l’argent. Voyez T o u c
h e , pierre de.
V E R D E R E , voye^ V e r d i e r .
V E RD E R EÜ L E , voye^ Verdier;
V E R D E R IE , f. f. ( Gram. & Jurifprud.) office de
v e rd ie r ou g ru y e r ,■ o fficie r'p rép ofé po u r la confe r-
va tion des eaux & forets. V o y e £ c i-a p r è s V e r d i e r .
V E R D E T c« VERD-DE-GRIS , ( Teint.) Voyez
V e r d -d e -g r i s . v
V E R D E U R , V E R D U R E , {Gram, f rang.) Vir-
deur fignifie proprement la fève qui eft dans les plante
s , &c 1 aprete des fruits qui ne font pas dans leur
maturité. ’•
On dit du vin fait de raifins qui n’étoieiit pas bien
mûrs, qu’i l a de la verdeur ; pour verdure, il fignifie
d’ordinaire la couleur verte dés plantes (; la verdure
des près ; la verdure dés feuilles. Ce mot fe prend auflî
pour les plantes & les herbes mêmes ; fe^coucher fur
la verdure ; joncher les rues de verdure ; des ouvrages
de verdure.
On appelle encore verdure une tapifferie de payfa-
ges où lè verd domine, & qui repréfente principalement
des arbres ; voilà une charmante verdure.
Les jardiniers appellent^ verdures, les plantes dont
la bonté & l’ufage confiftent dans la feuille, comme
l’ofeille ,le perfil, &c.
Vtrdtur fe dit au figuré de la vigueur de la jeûnefle.
On voit quelques vieillards qui ont encore de la verdeur.
V E R D IE R , V e r d r i e r , V e r d u n , V e r d e r e u -
l e , V e r d e r e , B r u y a n , B ru an , f.m . { H i f t . n a t .
O r n ith o lo g . ) c h lo r is , Aldrovand. W il. Oifeau à-peu-
près de la grofîeur du moineau, il a cinq pouces fix
lignés de longueur depuis la pointe du bec jufqu’à
l’ extremitéde la queue, & neuf pouces d’envergure;
la longueur du bec eft de fix lignes & demie ; les ailes
étant pliées , s’étendent un peu au-delà du milieu
de la longueur de la queue. La tête , la face fupé-
rieure & les côtés du cou font d’un verd d’olive mêlé ■
d’un peu de cendré ; il y a de chaque côté de la tête
entre le bec & l’oe il , une taché d’une couleur cendrée
foncée.' Les plumes du croupion , du deffus de
la queue-, de la poitrine, de la gorge Sc de la face inférieure
du cou, font d’un verd d’olive tirant fur le
jaune. Le haut du ventre & lès jambes ont une couleur
jaune, lehàs-ventre eft d’un bleu mêlé d’une légère
teinte de jaune. Les plumes du deffous de la
queue ont une couleur jaune mêlé de cendré ; celle
de la face inférieure des ailes j & le bord de chaque
H ij