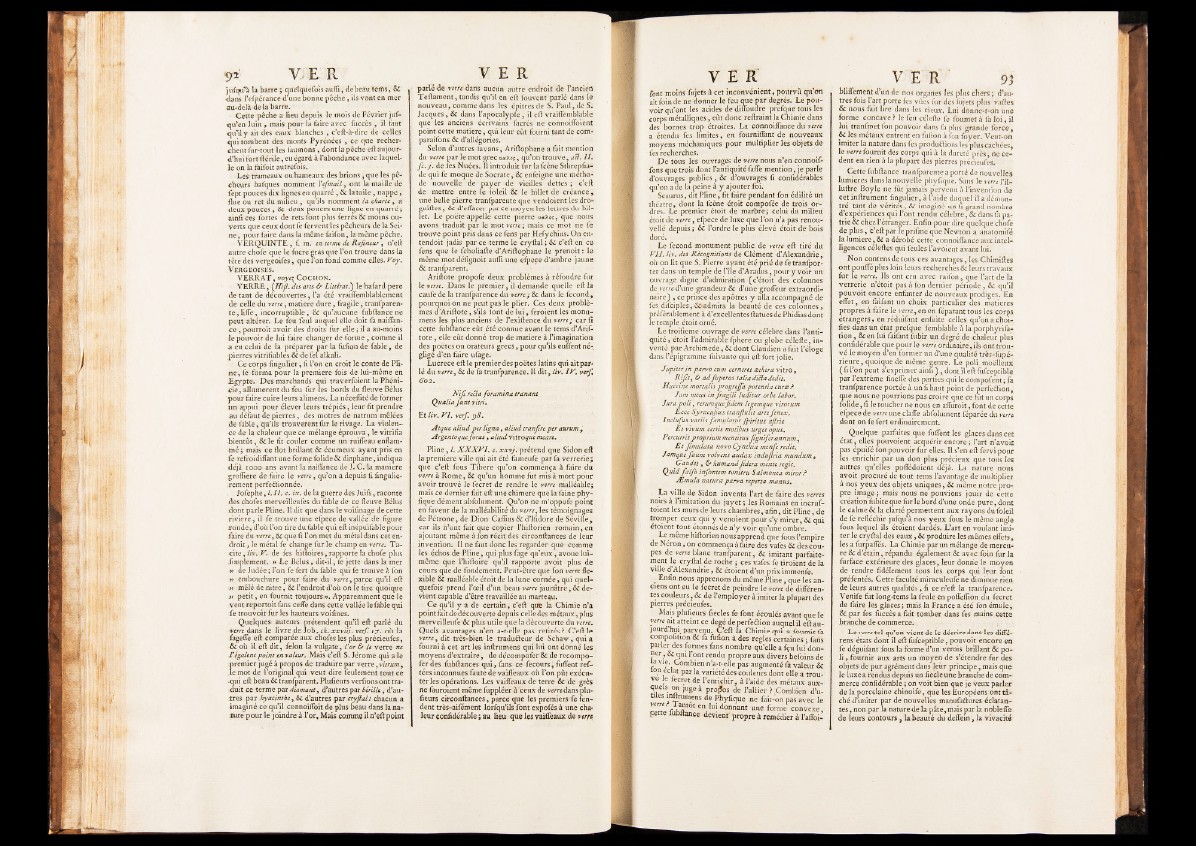
I
i
s i j |
y i V E E
jufcfu’à la barre ; quelquefois aufli, de beau'tems, &
clans l’efpérance d’une bonne pêche, ils vont en mer
au-delà de la barré.
Cette pêche a lieu depuis le mois de Février juf-
-qu’en Juin , mais pour la faire avec fuccès , il faut
qu’il y ait des eaux blanches , c’eft-à-dire de celles
qui tombent des monts Pyrénées , ce que recherchent
fur-tout les faumons , dont la pêche eft aujourd’hui
fort ftérile, eu égard à l’abondance avec laquelle
on la faifoit autrefois.
Les trameaux ou hameaux des brions ,que les pêcheurs
bafques nomment Yefmail, ont la maille de
fept pouces dix lignes en quarré, & la to ile , nappe,
flue ou ret du milieu, , qu’ils nomment la charte , a
deux pouces, &c deux pouces une ligne en quarré ;
ainfi ces fortes de rets lont plus ferres & moins ouverts
que ceux dont fe fervent les pêcheurs de la Seine
, pour faire dans la même faifon, la même pêche.
VERQ UIN TE , f. m. en terme de Raffneur, n’eft
autre chofe que le fucre gras que l’on trouve dans la
tête des vergeoifes, que l’on fond comme elles. Voy.
VE RG ECU s ES.
V E R R A T , voye{ Cochon.
V E R R E , (Hifl. des ans & Littéral.) le hafard pere
de tant de découvertes, l’a été vraiffemblablement
de celle du verre, matière dure, fragile, tranfparen-
îe ,l i f f e , incorruptible, & qu’aucune fubftance ne
peut altérer. Le feu feul auquel elle doit fa naiflàn-
c e , pourroit avoir des droits fur elle ; il a au-moins
le pouvoir de lui faire changer de forme, comme il
a eu celui de la préparer par la fufion de fable, de
pierres vitrifiables & de fel alkali.
Ce corps fingulier, fi l’on en croit le conte de Plin
e , fe forma pour la première fois de lui-même en
Egypte. Des marchands qui traverfoient la Phénic
ie , allumèrent du feu fur les bords du fleuve Bélus
pour faire cuire leurs alimeüs. La néceffité de former
un appui pour élever leurs trépiés, leur fit prendre
au défaut de p ierres, des mottes de natrum mêlées
de fable, qu’ils trouvèrent fur le rivage. La violence
de la chaleur que ce mélange éprouva, le vitrifia
Bientôt, & le fit couler comme un ruiffeau enflammé
; mais ce flot brillant & écumeux ayant pris en
fe refroidiffant une forme folide & diaphane, indiqua
déjà 1000 ans avant la naiffahce de J. C. la maniéré
.grofliere de faire le verre, qu’on a depuis fifingulie-
xement perfeftionnée.
Jofephe, l. I I . c. ix. de la guerre des Juifs, raconte
des chofes merveilleufes du fable de ce fleuve Bélus
.dont parle Pline. Il dit que dans le voifinage de cette
riviere, il fe trouve une efpece de vallée de figure
ronde, d’où l’on tire du fable qui eft inépuifable pour
faire du verre, & que fi l’on met du métal dans cet endroit,
le métal fe change fur le champ en verre. Tacite
, liv. V. de fes hiftoires, rapporte la chofe plus
fimplement. « L e Bélus, dit-il, fe jette dans la mer
» de Judée ; l’on fe fert du fable qui fe trouve à fon
» embouchure pour faire du verre, parce qu’il eft
■ » mêlé de nitre, & l’endroit d’où on le tire quoique
» petit, en fournit toujours». Apparemment que le
vent reportoit fans ceffe dans cette vallée le fable qui
fe trouvoit fur les hauteurs voifines.
Quelques auteurs prétendent qu’il eft parlé du
verre dans le livre de Jo b , ch.xxviij. verf. ry. où la
fageffe eft comparée aux chofes les plus précieufes,
& où il eft dit, félon la vulgate, l'or & Le verre ne
l'égalent point en valeur. Mais c’eft S. Jérome qui a le
premier jugé à propos de traduire par v e r re ,vitrum,
.le mot dé l’original qui veut dire feulement tout ce
-qui eft beau & tranfparent. Plufieurs verfions ont traduit
ce terme par diamant, d’autres par bérille, d’autres
par hyacinthe, & d’autres par cryftal: chacun a
imaginé ce qu’il connoifloit de plus beau dans la nature
pour le joindre à l’or. Mais comme iln ’eft point
V E R
parlé de verre dans aucun autre endroit de l’ànciërt
Teftament, tandis qu’il en eft fouvent parlé dans le
nouveau, comme dans les épitres de S. Paul, de S.
Jacques, & dans l’apocalypfe, il eft vraiffemblable
que les anciens écrivains facrés ne connoifloient
point cette matière, qui leur eut fourni tant de com-
paraifons & d’allégories.
Selon d’autres lavans, Ariftophane a fait mention
du verre par le mot grec o«Xoç, qu’on trouve, act. I L
f c . j . de les Nuées. Il introduit fur la fcène Sthrepfia-
de qui fe moque de Socrate, & enfeigne une méthode
nouvelle de payer de vieilles dettes ; c’eft
de mettre entre le foleil & le billet de créance ,
une belle pierre tranfparente que vendoient les dro-
guiftes, & d’effacer par ce moyen les lettres du billet.
Le poète appelle cette pierre vaxoc, que nous
avons traduit par le mot verre ; mais ce mot ne fe
trouve point pris dans ce fens par Hefychius. On en-
tèndoit jadis par ce terme le cryftal ; & c’eft en ce
fens que le fcholiafte d’Ariftophane le prenoit : le
même mot défigooit aulfi une efpece d’ambre jaune
& tranfparent.
Ariftote propofe deux problèmes à réfoudre fur
le verre. Dans le premier, il demande quelle eft la
caufe de la tranfparence du verre; & dans le fécond,
pourquoi on ne peut pas le plier. Ces deux problèmes
d’Ariftote, s’ils font de lu i, feroient les monu-
mens les plus anciens de l’exiftence du verre; car fi
cette fubftance eût été connue avant le tems d’Arif-
to te , elle eût donné trop de matière à l’imagination
des poètes ou orateurs grecs, pour qu’ils euffent né?
gligé d’en faire ufage.
Lucrèce eft le premier des poètes latins qui ait parlé
du verre, & de fa tranfparence. Il d it, liv. IV ’. verf,
ÔOZ.
N iff recta foramina trônant
Qualia Junt yitri.
Et liv. V I. verf. c)8.
Atque aliud per ligna, aliud tranfire per aurum ,
Argentoque foras , aliud vïtroque meare.
Pline, l. X X X V I . c. x x v j. prétend que Sidon eft
la première ville qui ait été fameufe par fa verrerie;;
que c’eft fous Tibere qu’on commença à faire du
verre à Rome, & qu’un homme fut mis à mort pour
avoir trouvé le fecret de rendre le verre malléable;
mais ce dernier fait eft une chimere que la faine phy-
fique dément abfolument. Qu’on ne m’oppofe point
en faveur de la malléabilité du verre, les témoignages
de Pétrone, de Dion Caflius & d’Ifidore de Séville ,
car ils n’ont fait que copier l’hiftorien romain, en
ajoutant même à ion récit des circonftances de leur
invention. Il ne faut donc les regarder que • comme
les échos de Pline, qui plus fage qu’eu x , avoue lui-
même que l’hiftoire qu’il rapporte avoit plus dé
cours que de fondement. Peut-être que fon verre flexible
& malléable étoitde la lune cornée, qui quelquefois
prend l’oeil d’un beau verre jaunâtre, & devient
capable d’être travaillée au martea.u.
Ce qu’il y a de certain, c’eft qitfe la Chimie n’a
point fait de découverte depuis celle des métaux , plus
merveilleufe*& plus utile que la découverte du verre.
Quels avantages n’en a-t-elle pas retirés ? C’eft le
verre, dit très-bien le traduâeur de Schaw, q uia
fourni à cet art les inftrumens qui lui ont donné les
moyens d’extraire, de décompofer &c de recompo-
fer des fubftances qui, fans ce fecours i fufl'ent ref-
tées inconnues faute de vaiffeaux où l’on pût exécuter
les opérations. Les vaiffeaux de terre & de grès
ne fauroient même fuppléer à ’ceux de verre dans plufieurs
circonftances, parce que les premiers Te fendent
très-aifément lorfqu’ils font expofés à une chaleur
confidérable ; au lieu que les vaiffeaux de verre
Ef 1
i
V E R
font moins fujets à cet inconvénient, pottrvù qu’on
ait foin de ne donner le feu mie par degrés. Le pouvoir
qu’ont les acides de diüoudre prefque tous les
corps métalliques, eût donc reftraint la Chimie dans
des bornes trop étroites. La connoiffance du verre
a étendu fes limites, en fourniffant de nouveaux
moyens méchaniques pour multiplier les objets de
fes recherches*1 -
De tous les ouvrages 4e verre nous n’çn connoif-
fons que trois dont l’antiquité faffe mention, je parle
d’ouvrages publics, & d’ouvrages fi confidérables
qu’on a de la peine à y ajouter foi.
Scaurus, dit Pline, fit faire pendant fon édilité un
théâtre, dont la fcène étoit compofée de trois ordres.
Le premier étoit de marbre ; celui du milieu
étoit de verre, efpece de luxe que l ’on n’a pas renou-
vellé depuis ; & l’ordre le plus élevé étoit de' bois
doré.
Le fécond monument public de verre eft tiré du
V II. liv. des Récognitions de Clément d’Alexandrie,
où on lit que S. Pierre ayant été prié de fe tranfpor-
ter dans un temple de ffle d’Aradus, pour y voir un
ouvrage digne d’admiration ( c ’étoit des colonnes
de verre d’une grandeur & d’une groffeur extraordinaire)
, ce prince des apôtres y alla accompagné de
fes difciples, &>admira la beauté de ces colonnes ,
préférablement à d’excellentes ftatues de Phidias dont
le temple étoit orné.
Le troifieme ouvrage de verre célébré dans l’antiquité
, étoit l’admirable fphere ou globe célefte, inventé
par Archimede, & dont Claudien a fait l’éloge
dans l’épigramme fuivante qui eft fort jolie.
Jupiter in parvo cum cerneret athera vitro ,
R ißt y & ad fuperos talia dicta dédit.
Huccine mortalis progreffa potentia cura ?
Jam meus in fragili Luditur orbe làbor.
Jura p o li, rerumque fidem legemque virorum
Ecce Syracufius tranfiulit arte fenex.
Inclufus variis famulatur fpiritus offris
E t vivum certis motibus urget opus.
Percurrit proprium mentitus fignifer annum,
E t fimulata novo Cynthia menfe redit.
Jamque fuum volvens audax induffria mundum ,
Gaudet, o* humandfidera mente regit.
Quid falfo infontem tonitru Salmonea miror ?
Æmula natura parva reperta manus.
noirs à 1 imitation du jayet ; les Romains en incruf
toient les murs de leurs chambres, afin, dit P line, d<
tromper ceux qui y venoient pour s’y mirer, & qu
etoient tout étonnés de n’y voir qu’une ombre.
Le meme hiftorien nous apprend que fous l’empin
de Néron, on commença à faire des vafes & des cou
pes de verre blanc tranfparent, & imitant parfaite
ment le cryftal de roche ; c es vafes fe tiroient de 1«
ville d’Alexandrie, & étoient d’un priximmenfe.
^ Enfin nous apprenons du même Pline, que les an
ciens ont eu le fecret de peindre le verre de différen
tes couleurs, & de l’employer à imiter la plupart de;
pierres précieufes.
Mais plufieurs fiecles fe font écoulés avant que 1(
verre ait atteint ce degé de perfeâion auquel il eft au
jourd’hui parvenu. C’eft la Chimie qui a fournis fi
compofition & fa fufion à des réglés certaines ; fan:
parler des formes fans nombre qu’elle a fçu lui donn
e r, & qui l’ont rendu propre aux divers befoins d<
ta vie. Combien n’a-t-elle pas augmenté fa valeur &
ion éclat par la variété des couleurs dont elle a trouv
e le fecret de l’enrichir, à l’aide des métaux aux-
quels on juge à propos de l’allier ? Combien d’u-
üles inftrumens de Phyfique ne fait-on pas avec le
verrf f . en lui donnant une forme convexe,
gette fubftance devient' propre à remédier à l’affoi-
V E R 9}
bhffemeht d’un de nos organes les plus chers ; d’au*
très fois l’art porte fes vues fur des fujets plus vaftes
& nous fait lire dans les cieux. Lui donne*t-on une
forme contave ? le feu célefte fe foumet à fa lo i , il
lui tranfmet fon pouvoir dans fa plus grande force ,
& les métaux entrent en fufion à fon foyer. Veut-on
imiter la nature dans fes produ&ions les plus cachées,
le verre fournit des corps qui à la dureté près , ne cèdent
en rien à la plupart des pierres précieufes.
Cette fubftance tranfparente a porté de nouvelles
lumières dans la nouvelle phyfique. Sans le verre l’il-
luftre Boyle ne fût jamais pervenu à l’invention de
cet infiniment fingulier , à l’aide duquel il a démontré
tant de vérités, & imaginé un fi grand nombre
d’expériences qui l’ont rendu célèbre, & dans fa patrie
& chez l’étranger. Enfin pour dire quelque chofe
de plus, c’eft par le prifme que Newton a anatomifé
la lumière, & a dérobé cette connoiffance aux intelligences
céleftes qui feules l’avoient avant lui.
Non contensdetous ces avantages, les Chimiftes
ont pouffé plus loin leurs recherches & leurs travaux
fur le verre. Ils ont cru avec raifon, que l’art de la
verrerie n’étoit pas à fon dernier période , & qu’il
pouvoit encore enfanter de npuveaux prodiges. En
effet, en faifant un choix particulier des matières
propres à faire le verre, en en féparant tous les corps
étrangers, en réduifant enfuite celles qu’on a cftoi-
fies dans un état prefque femblable à la porphyrifa-
tion , & en lui faifant fubir un degré de chaleur plus
confidérable que pour le verre ordinaire, ils ont trouv
é le moyen d’en former un d’une qualité très-fupé-
rieure, quoique de même genre. Le poli moëileux
( fi l’on peut s’exprimer ainh j , dont il eft fufceptible
par l’extrême fineffe des parties qui le compofent; fa
tranfparence portée à un fi haut point de perfection,
que nous ne pourrions pas croire que ce tût un corps
folide, fi le toucher ne nous en affuroit, font de cette
efpece de verre une claffe abfolument féparée du verre
dont on fe fert ordinairement.
Quelque parfaites que fulTent les glaces dans cet
état, elles pouvoient acquérir encore ; l’art n’avoit
pas épuifé fon pouvoir fur elles. Il s’en eft fervi pour
les enrichir par un don plus précieux que tous les
autres, qu’elles poffédoient déjà. La nature nous
avoit procuré de tout tems l’avantage de multiplier
à nos yeux des objets uniques, & même nôtre p ropre
image ; mais nous ne pouvions jouir de cette
création fubite que fur le bord d’une onde pure, dont
le calme & la clarté permettent aux rayons du foleil
de fe réfléchir jufqu’à nos yeux fous le même angle
fous lequel ils étoient dardés. L’art en voulant imiter
le cryftal des eaux, & produire les mêmes effets ,
les a furpaffés. La Chimie par un mélange de mercure
& d ’etain, répandu également & avec foin fur la
furface extérieure des glaces, leur donne le moyen
de rendre fidèlement tous les corps qui leur font
préfentés. Cette faculté miraculeufe ne diminue rien
de leurs autres qualités, fi ce n’eft la tranfparence.
Venife fut long-tems la feule en poffeflion du fecret
de faire les glaces; mais la France a été fon émule,
& par fes fuccès a fait tomber dans fes mains cette
branche de commerce. .
L e verre tel qu’on vient de le décrire dans les diffé-
rens états dont il eft fufceptible, pouvoit encore en
fe déguifant fous la forme d’un vernis brillant & poli
, fournir aux arts un moyen de s’ étendre fur des
objets de pur agrément dans leur principe, mais que
le luxe a rendus depuis un fièdeune branche de commerce
confidérable ; on voit bien que je veux parler
de la porcelaine chinoife, que les Européens, ont tâché
d’imiter par de nouvelles manufaéhires éclatantes
, non par la nature de la pâte, mais par la nobleffe
de leurs contours, U beauté du deffein, la vivacité