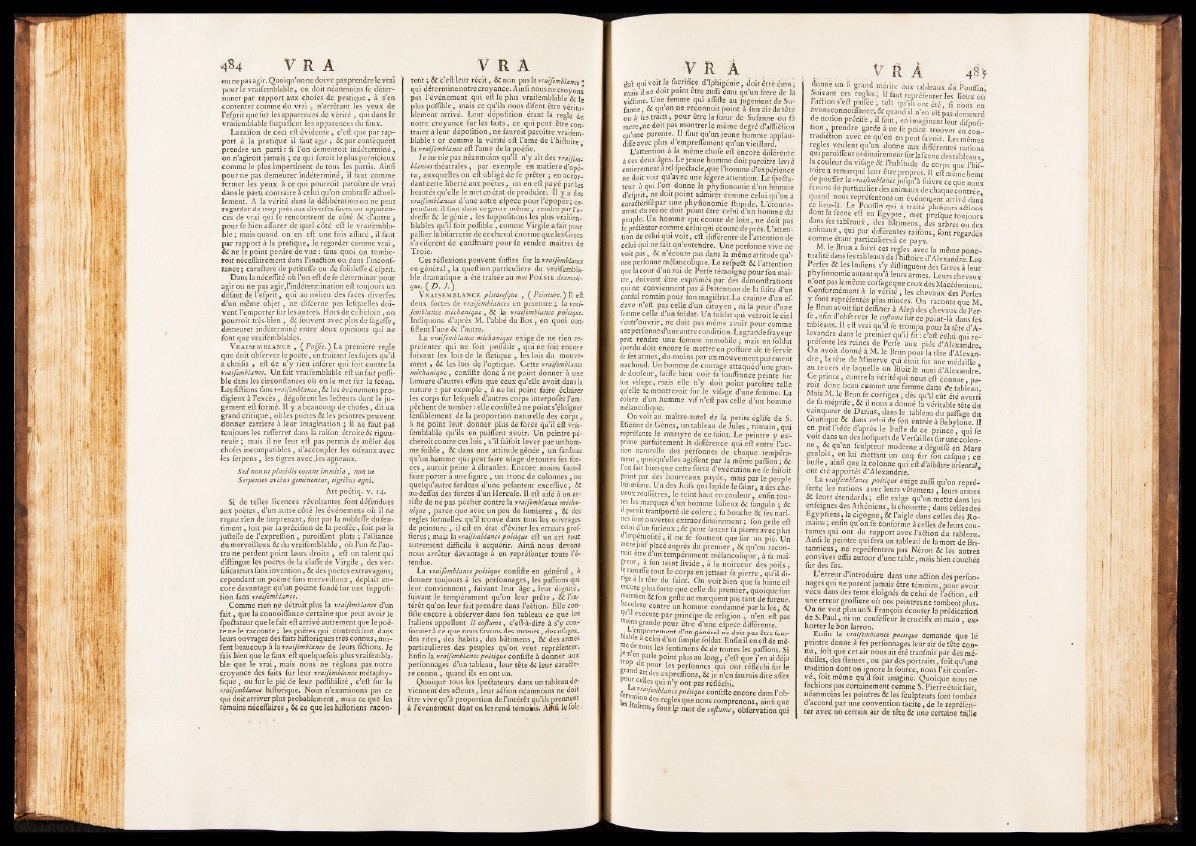
ou ne pas agir. Quoiqu’on ne doive pas prendre le vrai
pour le vraifemblable, oh doit néanmoins fe déterminer
par rapport aux ehofes de pratique, à s’en
contenter comme du vrai ^ n’arrêtant les yeux de
l’efprit que fut les apparences de vérité , qui dans le
vraifemblable furpaflent les apparences du faux.
Laraifon de ceci eft évidente , c’ eft que par rapport
à la pratique il faut agir , & par conféquent
prendre un parti : Il l’on demeuroit indéterminé ,
on n’agiroit jamais ; ce qui feroit le plus pernicieux
comme le plus impertinent de tous les partis. Ainfi
pour ne pas demeurer indéterminé, il faut comme
fermer les yeux à ce qui pourroît paroître de vrai
dans le parti contraire à celui qu’on embraffe actuellement.
A la vérité dans la délibération on ne peut
regarder de trop près aux diverfes faces ou apparentées
de vrai qui le rencontrent de côté & d’autre ,
pour fe bien affurer de quel côté eft le vraifemblable
; mais quand on en eft une fois afliiré, il faut
par rapport à la pratique -, le regarder comme v r a i,
& ne le point perdre de vue : fans quoi on tombe-
roit néceffairement dans l’inaCtion ou dans l’inconf-
tance ; caraCtere de petiteffe ou de foibleffe d’efprit.
Dans lanéceflité où l’on eft de fe déterminer pour
agir ou ne pas agir,l’indétermination eft toujours un
défaut de l’efprit, qui au milieu des faces diverfes
d’un même ob je t, ne difcerne pas lefquelles doivent
l ’emporter fur les autres. Hors de ce bëfoin ; on
pourroit très-bien , & fouvent avec plus de fageffe,
demeurer indéterminé entre deux opinions qui ne
font que vraifemblables.
Vraisemblance , ( Poéjîe.) La première réglé
que doit obferver le poète, en traitant les fujets qu’il
a choifis , eft de n’y rien inférer qui foit contre la
vraifemblance. Un fait vraifemblable eft un fait poflï-
ble dans les cireonftances où on le met fur la fcène.
Les fiftions fans vraifemblance, & les événemens prodigieux
à l’excès , dégoûtent les leCteurs dont le jugement
eft formé. 11 y a beaucoup de ehofes, dit un
grand critique, oùles poètes & les peintres peuvent
donner carrière à leur imagination ; il ne faut pas
toujours les refferref dans la raifon étroite & rigou-
reufe ; mais il ne leur eft pas permis de mêler des
ehofes incompatibles , d’accoupler les oifeaux avec
les ferpens , les tigres avec .les agneaux.
Sed non iu placidis coeant immitia, non ut
Serpentes avibus geminentur, tigribus agni,
Artpoétiq. v . 14.
Si de telles licences révoltantes font défendues
aux poètes, d’un autre côté les événemens où il ne
régné rien de furprenant, foit par la nobleffe dufen-
timent, loit par la précifion de la penfée, foit par la
jufteffe de l’expreflion , paroiffent plats ; l’alliance
du merveilleux & du vraifemblable, où l’un & l’autre
ne pefdent point leurs droits , eft un talent qui
diftingue les poètes de la claffe de Virgile , des ver-
fificateursfans invention, & des poètes extravagans;
cependant un poème fans m erveilleux, déplaît encore
davantage qu’un poème fondé fur une fuppofi-
tion fans vraifemblance.
Comme rien ne détruit plus la vraifemblance d’un
f a it , que la connoiffance certaine que peut avoir le
fpe&ateur que le fait eft arrivé autrement que le poète
ne le racconte ; les poètes qui contredifent dans
leurs ouvrages des faits hiftoriques très connus, nui-
fent beaucoup à la vraifemblance de leurs fictions. Je
fais bien que le faux eft quelquefois plus vraifemblable
que le v r a i, mais nous ne réglons pas notre
croyance des faits fur leur vraifemblance métaphy-
fique, ou fur le pié de leur poflibilité, c’eft fur la
vraifemblance hiftorique. Nous n’examinons pas ce
qui doit arriver plus probablement, mais ce que les
témoins néceffaires, & ce que les hiftoriens raconterit
; & c’eft leur récit, & non pas ^vraifemblance9
qui détermine notre croyance. Ainfi nous ne croyons
pas l’événement qui eft le plus vraifemblable & lé
plus poflible, mais ce qu’ ils nous difent être véritablement
arrivé. Leur dépofition étant la réglé de
notre croyance fur les faits , ce qui peut être contraire
a leur dépofition, ne fauroit paroître vraifem-
blable : or comme la vérité eft l’ame de l’hiftoire
la vraifemblance eft l’ame de la poéfie.
Je ne nie pas néanmoins qu’il n’y ait des Vraiftm.
blances théâtrales, par exemple en matière d’opér
a , auxquelles on eft obligé de fe prêter ; en accordant
cette liberté aux poètes , on en eft payé par les
beautés qu’elle le met eh état de produire. Il y a des
vraifemblances d’une autre efpece pouf l’épopée; cependant
il faut dans ce genre même, rendre par l’a-
dreffe & le génie , les fuppofitions les plus vraifemblables
qu’il foit poflible, comme Virgile a fait pour
pallier la bifarrerie de ce cheval énorme que les Grecs
s’aviferent de conftruire pour fe rendre maîtres de
Troie.
Ces réflexions peuvent fuffire fur la vraifemblance
en général, la queftion particulière du vraifemblable
dramatique a été traitée au mot Poésie dramatique.
( D . J . )
Vraisemblance, pittorefque , ( Peinture.') il eft
deux fortes de vraifemblances en peinture ; la vraifemblance
méchanique , & la vraifemblance poétique.
Indiquons d’après M. l’abbé du B o s , en quoi con-
fiftent l’une & l’autre.
La vraifemblance méchanique exige de ne rien re-:
préfenter qui ne foit poflible , qui ne foit encore
fuivant les lois de la ftatique , les lois du mouvement
, & les lois de l’optique. Cette vtaifemblance
méchanique, confifte donc a ne point donner à une:
lumière d’autres effets que ceux qu’elle avoit dans la
nature : par exemple , à ne lui point faire éclairer
les corps fur lefquels d’autres corps interpofés l’em-.
pêchent de tomber : elle confifte à ne point s’éloigner
lenfiblement de la proportion naturelle des corps
à ne point leur donner plus de force qu’il eft vraifemblable
qu’ils en puiffent avoir; Un peintre pé-
cheroitcontre ces lo is , s’ilfaifoit lever par unhom-
me foible, & dans une attitude gênée , un fardeau
qu’un homme qui peut faire ufage de toutes fes forces
, auroit peine à ébranler. Encore moins faut-il
faire porter à une figure , un tronc de colonnes , ou
quelqu’autre fardeau d’une pefanteur exceflive, ÔC
au-deffus des forces d’un Hercule. Il eft aifé à un ar-
tifte de ne pas pécher contre la vraifemblance méchanique
, parce que avec un peu de lumières , & des
réglés formelles qu’il trouve dans tous les ouvrages
de peinture , il eft en état d’éviter les erreurs grof-
fieres ; mais la vraifemblance poétique eft un art tout.
autrement difficile à acquérir. Ainfi nous devons
nous arrêter davantage a en repréfenter toute l’étendue.
La vraifemblance poétique confifte en général, a
donner toujours à fes perfonnages, les pallions qui
leur conviennent, fuivant leur â g e , leur dignité,
fuivant le tempérament qu’on leur prê te , & l’intérêt
qu’on leur fait prendre dans l’attion. Elle confifte
encore à obferver dans fon tableau ce que les
Italiens appellent i l coftume, c’eft-à-dire à s’y conformer
à ce que nous favons des moeurs, des ufages,
des rites, des habits, des bâtimens, & des armes
particulières des peuples qu’on veut repréfenter.
Enfin la vraifemblance poétique confifte à donner aux
perfonnages d’un tableau, leur tête & leur eârafte-,
re connu , quand ils en ont un.
Quoique tous les fpeélateurs dans un tableau deviennent
des aâeurs, leur aâion néanmoins ne doit
être vive qu’à proportion de l’intérêt qu’ils prennent
à l’événeiwent dont on les rend témoins, Aihfi le (oh
dal qui voit le facrifice d ’Iphigénie, doit être ému,
mais il ne doit point etre aufti ému qu’un frere de là
viftime. Une femme qui aflifte au jugement de Su-
fanne, & qu on ne recohnoit point à fon air de tête
ou à fes traits , pour etre la foeur de Sufanne ou fâ
mere,ne doit pas montrer le même degré d’affliftiort
qu’une parente. Il faut qu’un jeune homme applau*
diffe avec plus d’empreflement qu’un vieillard.
L’attention à la même chofe eft encore différente
à ces deüx âges. Le jeune hbmrne doit paroître livré
entièrement à tel fpeélacle,qiie l’homme d’expériencë
ne doit voir qu’avec une légère attention. Le fpefta-
teur à qui l’oii donne là phyfionomie d ’un hommë
d’efprit, ne doit point admirer comme celui qu’on à
caraûérifé par une phyfionomie ftupide. L ’étonnement
du roi ne doit point être celui d’un hommé du
peuple. Un hommé qui écoute de loin, ne doit pas
fe préfenter comme celui qüi écoute de près. L ’attend
tion de celui qui vo it, eft différente de l’attention dé
celui qui ne fait qü’ entehdre» Une perfonne vive né
voit pas, & n’écoute pas dans la même attitude qu’i
une perfonne mélancolique. Le refpeét l’attention
que la cour d’un roi de Pèrfe témoigne pour fon martre,
doivent être exprimés par des demonftrations
qui ne conviennent pas à Inattention de là fuite d’un
conful romain pour fon magiftr'at; La crainte d’un ef-
clave n’ eft pas celle d’un citoyen , ni là peur d’une
femme celle d’un foldat. Un foldat qui verroit le ciel
sentr ouvrir; ne doit pas même avoir peur comme
uneperfonne d’une autre condition. La grande fray éqr
peut rendre une femme immobile ; mais un foldat
éperdu doit encore fe mettre en pofture de fe fervir
de feS armes, du-moins par un mouvement purement
machinal. Un homme de courage attaqué d’une grande
douleur, laiffe bien voir fa fouffrance peinte fur
fon vifage, mais elle n’y doit point paroître telle
qu’elle fe montreroit fur le vifage d’une femme. La
colere d’un homme v i f n’eft pas celle d ’un hommé
mélancolique.
On voit au maîtré-âutel de la petite églife de Si
Etienne de Gènes, Un tableau de Ju le s, romain, qui
repréfente Je martyre de ce faint. Le peintre y exprime
parfaitement la différence qüi eft entre l’ac-i
tion naturelle des perfonnes de chaque tempérament
^quoiqu’elles agiffent par la même paflion ; &
l’on fait bien que cette forte d’exécution ne fe faifoit
point par des bourreaux payés, mais par le peuplé
lui-même. Un des Juifs qui lapide le faint , a des Cheveux
rouffâtres, le teint haut en couleur, enfin toutes
les marques d’un homme bilieux & fanguin ; &
il paroit tranfporté de colere ; fa bouche & fes narines
font ouvertes extraordinairement ; fon gefte eft
celui d’un furieux ; & pour lancer fa pierre avec plus
d împétuofité, il ne fe foutient quefiir un pié; Un
autrejuif placé auprès du premier, & qu’on reconnut
etre d’un tempérament mélancolique, à fa mai2
gteur, a fon teint livide , à la noirceur des poils ;
te ramafletout le corps en jettant fa p ierre, qu’il di-
ri§6 a la tete du faint. On voit bien que fa haine eft
encore plus forte que celle du premier, quoique fon
maintien & fon gefte ne marquent pas tant de fureur,
a colere contre un homme condamné parla lo i; &
Su} exécute par principe de religion , n’en eft pas
oins grande pour être d’une efpece différente,
i V.enJP°rtement d’un général ne doit pas être fem-
a ,e “ celui d’un fimple foldat. Enfin il en eft de mê-
ie n’ 6 Ü ü f ^es {entimens & de toutes les pallions. Si
tron6^ 31^6 P°^nt au l ° ng » c’eft que j’en ai déjà '
eranH U Pj° U^ *es Perlonnes. qui ont réfléchi fur le !
i l i aes expreflions, & je n’en faurois dire alfeZ
PO£r celles qui n’y ont pas réfléchi.
krvlt\ra^Am^ ancepoétl<l ue confiée encore dans l’ob-
les des/ egle sque no»« comprenons, ainfi que
iens> f ° us Jp mot de cofume, obfervâtiôn qùi
donne uh fi grand mérite aux tableaux du Pouflïnl
Suivant ces réglés; il faut repréfenter les lieux où
la é lio n se ft pàlfee; tels qd’ils ont été, fi ribüs en
avons connoiflance; & quahd il n’eh eft paé demeuré
de notion precife , il faut, eh imaginant leur difpofi-
t10" ’ Prendre garde à ne l point trouver en contradiction
avec ce qù’ori en peut faVoir. Les mêmes
réglés veillent qu’on donne aux différentes nations
qui parodient ordinairement fiirlàfcene des tableaux
la couleur du vifage & l’habitude de côrps que l’hif-
tw e a remarqué leur être propres, f l eft même beau
de pouffer la vraifemblance jufqù’à fuivre ce que nous
avon s de particulier des animaux de c&abtie contrée '
quand hotis repiefentons un événement arrivé dans
B h B m m m m m qui â tràité plufiêuré.aaionS
domla feeneeft en Eg yp te , met prefqué toujours
dans tes tableau*; des Bâtimëns, dés arbres ou des.
antmau*, qui jja r difFérentes ràifônsj ioiit regardés
CoiUme étant parficùliersâ êe paysi
M. k Brun a fuivi ces réglés avec la même ponc-
. tjtahte dans fes tàolesui de l’Hiftdite d’Àlexaiidre. Les
Perfes & les M e n s s’y ditlinguetit dés Grées â leur
phyfionomie aiitarit qu'à leurs àrriies. Leurs chevau*
n Ont pas lèmême corfâgeqüe céu* des Macédoniens!'
Gonformement à là vétité ; les chevàux des Perfes
y font repréfentés plus minées; On raconte que M.
le Brun avoitfaitdeflîner à Alep des chevaux de Per-
f e , àfin d’obferver le coflùme{\ur ce p6int-là dans fes
tableaux. H eft vrai qu’il fe trompa pour là tête d’A lexandre
dans le premier qu’ il fit i c’êft cëlui qui re-
prefente les reines de Pèrfe âux piés d’Alexahdre.'
On avdit donné à M. lé Brun pour la tête d’Alexandre,
la tete de Minerve qui éfoit fur Une médaille i
ail revers de laquelle on lifoit fe noni d’Alexandre’
Ce prince , Contre la vérité qui tiotis eft Connue, pa-
rbit donc beSiu comme une femme dans <fe tableau!
Mais M. le Brun fe corrigea ; dès H eût été averti
de la meprife, & il nous a donné la véritable tête du
vainqueur de Darius, dans le tableau du paffage du
Grahiqüé & dans celui dë fôn entrée à Babylone. Il
eii.prit 1 idée d’apres le bufte de ce princé, qui fe
voit dans un des bbfquets de Verfailles furüné colonne
, & qu’un fculpteur moderne a déguifé en Mars
gaulois, en lui ihettàht un coq fur Ion cafque ; ce
bufte, ainfi que la colonne qui eft d’albâtre Oriental,
Ont ete apportés d’Alexandrie;
La vraifemblance poétique exigé âiilîi qii’On repré-'
fente les nations avec leurs vêtemens , leürs armes
& leurs étendards ; elle exige qu’on mette dans les
enfeignes des Athéniens, là chouette; dans celles des
Egyptiens, la cigogne, & l’aigle dans celles des R o mains
; enfin qu’on fe conforme à celles de leurs coutumes
qui ont du rapport avec I’aéliort dii tableau»’
Ainfi le peintre qui fera Un tableau de lânidrt deBri-
tannicus ; ne repréfentera pas Nétort & les autres
convives âflïs autour d’unè table ; mais bien couchés
fur des lits.
L erreur d introduire dans une àélibn dès perfon-
nagès qui hepurent jamais être témoins,pour avoir
vécu dans des tems éloignés dé Celui de l’adibn, eft
une erreur grofliere où nos peintres rie tombent plusl
On rte Voit plUsuriS. François écouter là prédication
de S. Paul, ni un confeffeür le crucifix eri main , ex«
horter le bon larron.
Enfin la vraifemblance poétique demahde que le
peintre donne à fes perfonnages lëiir air de tête con»
rtu, foit que cet air nous ait été tranfmis par des médaillés,
des ftâtues, où par dès portraits, foit qu’une
tradition doftt oh ignore la Ibürce, nous l’ait confer-
v é , fdit même qu’il foit imaginé. Quoique rioùs né
fachionS pas cërtâineiftent comme S. Pierre étbitfait
néanmoins les peintres & les feulpteufs fon't tombés
d’accord par une convention tacite, de le repréfenter
avec un certain air de tête & une certaine taillé