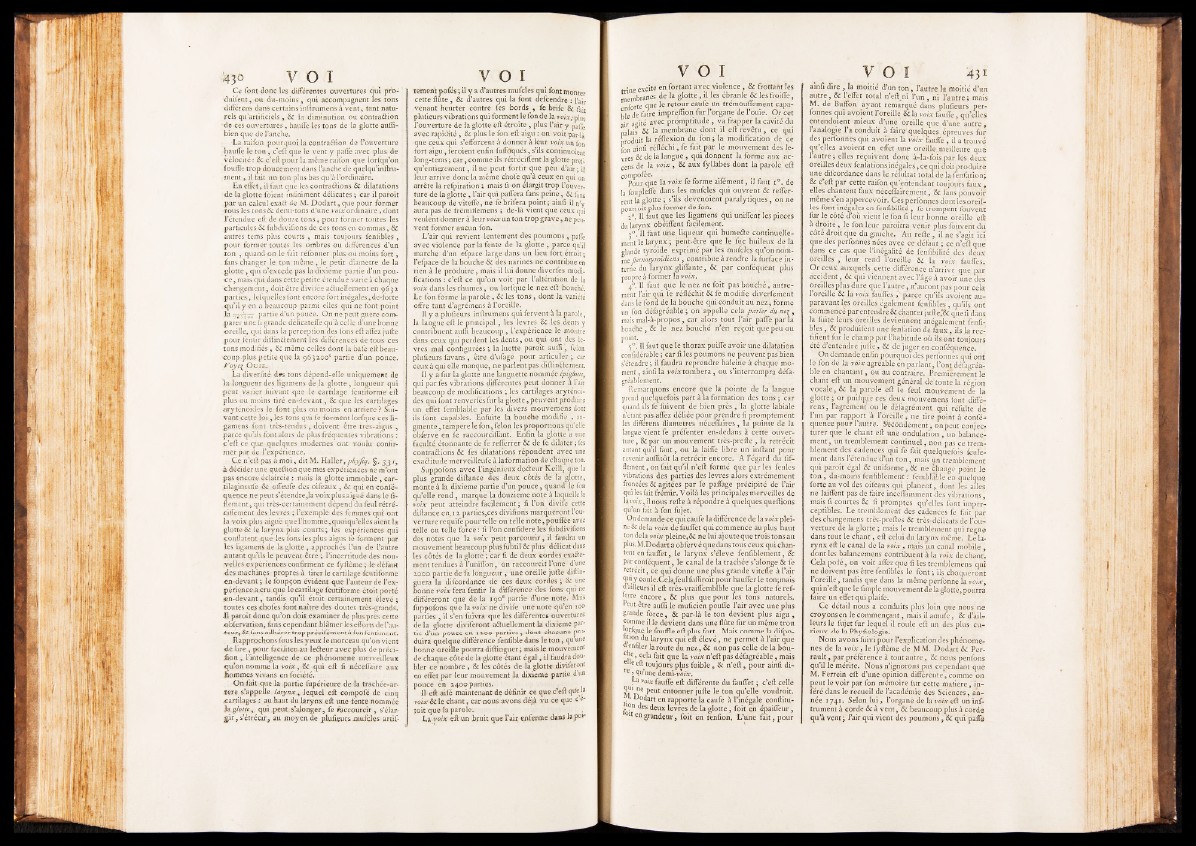
Ce font donc les différentes ouvertures qui ,pro-
■ duifent, ou du-moins , qui accompagnent les tons
différens dans certains inftrumens à vent, tant naturels
qu’artificiels , & la diminution ou contraftion
de ces ouvertures, hauffe les tons de la glotte auffi-
bien que de l ’anche.
La raifon pourquoi la contraction de l’ouverture
hauffe le to n , c’eft que le vent y pafle avec plus de
vélocité : & c’ en: pour la môme raifon que lorfqu’on
louffle trop doucement dans l’anche de quelqu’inftru-
ment, il fait un ton plus bas qu’à l’ordinaire.
En effet, il faut que les contractions & dilatations
de la glotte foient infiniment délicates ; car il paroît
.par un calcul exaét de M. Dodart, que pour former
tous les tons & demi-tons d’une voix ordinaire » dont
l ’étendue eff de douze tons, pour former toutes les
particules & fubdivifions de ces tons en commas, &
autres tems plus courts , mais toujours fenfibles,
pour former toutes les ombres ou différences d’un
ton , quand on le fait réfonner plus ou moins fo r t ,
. fans changer le ton-même , le petit diamètre de la
. glotte, qui n’excede pas la dixième partie d’un pou*
•ce , mais qui dans cette petite étendue .varie à chaque
changement, doit être divifée actuellement en 9632
parties, lefquelles font encore fort inégales, de-forte
. qu’il y en a beaucoup parmi elles qui ne font point
la partie d’un pouce. On ne peut guere comparer
une fi grande délicateffe qu’à celle d’un,e bonne
oreille, qui dans la perception des Ions eff affez jufte
.pour fenlir diftin&ement les différences de tous ces'
tons modifiés , & même celles dont la bafe eff beaucoup
plus petite que la 963200e partie d’un pouce.
Voye^ Ou ïe,
La diverfité des tons dépend-elle uniquement de
la- longueur des lïgamens de la glotte, longueur qui
peut varier fuivant que le cartilage feutiforme- eff
plus ou moins tiré en-devant, & que les cartilages
aryténoïdes le, font plus ou moins en arriéré ? Suivant
cette lo i , les tons qui fe forment lorfque ces li-
gamens font très-vendus , doivent être -très-aigus ,
parce qu’ils.font alors de plus.fréquentes vibrations :
ç ’eff ce que .quelques modernes ont voulu confirmer
par de rexpérience.
Ç.e n’eft pas à m oi, dit M. Haller, phyjîq. §. 3 3 /,
à décider une. queftion que mes expériences ne m’ont
pas encore éclaircie : mais la glotte immobile , car-
tilagineufe & offeufe des oifeaux, & qui en conséquence
ne peut s’étendre,la voix plus aiguë dans le fi-
flement, qui très-certainement dépend du feul rétré-
ciffement des levres ; l’exemple des femmes qui ont
•la v o ix plus aiguë que l’homme,quoiqu’elles aient la
glotte & le larynx plus courts; les expériences qui
confiaient .que les fons les plus aigus fe forment par
les iigamens -de la glotte , approchés l’un de l’autre
autant qu’ ils le peuvent être ; l ’incertitude des nouvelles
expériences confirment ce fyffème ; le défaut
■ des; machines, propres à tirer le cartilage feutiforme
en-devant ; le loupçon évident que l’auteur de l'expérience
a cru que le cartilage feutiforme étoït porté
îen-devant, tandis qu’il étoit- certainement élevé ;
toutes ces .chofes font naître des doutes très-grands.
I l paroît donc qu’on doit examiner de plus près cette
-obfervation, fans cependant blâmer les efforts de l’au-
-teur, &.fans-adhérer trop précifénient à fonfentiment.
Rapprochons.fous les.yeux le morceau qu’on vient
:de lire , pour faciliten.au leCteur avec plus de précision
j l’intelligence de ce phénomène merveilleux
qu.’on: nomme la v o ix , & qui eff fi néceffaire aux
hommes vivans en fociété. .
On fait que la partie fupérieure de la .trachée-ar-
-tere.sîappelle larynx.,. lequel eff compofé de cinq
cartilages ; au haut du larynx eff une-fente nommée
la glotçe, qui peut s^afonger., fe raccourcir , s’élarg
i r , s’étrécir, au moyen de plufieurs anufcles artiftement
pofés ; il y a d’autres mufcles qui font monter
cette flûte, & d’autres qui la font defeendre : Pair
venant heurter contre les bords , fe brife & fajt
plufieurs vibrations qui forment le fon de la voix - pllJS
l’ouverture de la glotte eff étroite , plus Pair y paffe
avec rapidité , & plus le fon eff aigu : on voit par-là
que ceux qui s’efforcent à donner à leur voix un fon
fort aigu, feroient enfin luffbqués, s’ils continuoient
long-tems ; c a r , comme ils rétréciffent la glotte pref.
qu’entiearement, il ne.peut fortir que peu d’air; il
leur arrive donc la même chofe cju’à ceux en qui on
arrête la refpiration ; mais fi on élargit trop l’ouverture
de la glotte, l’air qui paffera fans peine, & fans
beaucoup de vîteffe, ne fe brifera point; ainfi il n’y
aura pas de frémiffemens ; de-là vient que ceux qui
veulent donner à leur voix-un ton trop grave, ne peuvent
former aucun fon.
L ’air qui revient lentement des poumons , pafle
avec violence par la fente de la glotte , parce qu’il
marche d’un efpace large dans un lieu fort étroit ;
l’efpace de la bouche & des narines né contribue en
rien à le produire, mais il lui donne diverfes modifications
: c’eft ce qu’on voit par l’altération de la
voix dans les rhumes, ou lorfque le nez eff bouché.
Le fon forme la parole , & les tons, dont la variété
offre tant d’agrémens à l’oreille.
Il y a plufieurs inftrumens qui fervent à la parole,
la langue eff le principal, les levres & les dents y
contribuent aufli beaucoup, l’expérience le montre
dans ceux qui perdent les dents , o it qui ont des levres
mal configurées ; la luette paroît aufli félon
plufieurs favans , être d’ufage pour articuler ; car
ceux à qui elle manque, ne parlent pas diffinttement.
Il y â fur la glotte une languette nommée épiglotte,
qui par fes vibrations différentes peut donner à l’air
beaucoup de modifications ; les cartilages aryténoïdes
qui font renverfés fur la glotte, peuvent produire
un effet femblable par les divers mouvèmens dont
ils font capables. Enfuite la bouche modifie , augmente
, tempere le fon, félon les proportions qu’elle
obferve én fe raccqurciffant. Enfin la glotte a une
faculté, étonnante de fe refferrer & de fe dilater ; fes
contrarions & fes dilatations répondent avec une
exactitude merveilleufe à la formation de chaque ton.
Suppofons avec l’ingénieux doCteur Keill, que la
plus grande diftance des deux côtés de la glotte,
monte à la dixième partie d’un pouce, quand le fon
qu’elle rend , marque la douzième note à laquelle la
voix peut atteindre facilement ; fi l’on divife cette
diftance en,i 2 parties,ces divifions marqueront l’ouverture
requife pour telle ou telle note, pouffée avec
telle ou telle force : fi l’on confiderè lés fubdivifions
des notes que la voix peut parcourir, il faudra un
mouvement beaucoup plusfubtil & plus délicat dans
les côtés de la glotte ; car fi de deux cordes exactement
tendues à l’unïffon, on raccourcit Pimé d’une
2000 partie de fa longueur ; une oreille jufte diftin-
guera la difcordance de ces deux cordes ; & une
bonne voix fera fentir la différence des fons qui ne
différeront que de la 190e partie d’une noté. Mais
fuppofons que la voix ne divife une note qù’en 100
parties , il s’en fuivra que les différentes ouvertures
de la glotte diviferont actuellement la dixième partie
d’un pouce en 1200 parties, dont chacune pro>
duirà quelque différence fenfible dans le ton, qu’une
bonne oreille pourra diftinguer; mais le mouvement
de chaque côté de la glotte étant é g a l, il faudra doubler
ce nombre, & les côtés de la glotte diviferont
en effet par leur mouvement la dixième partie d’un
pouce én 2400 parties.
Il-eff aifé maintenant de définir ce que c’ eft qû®}3
voix & le chant, car nous avons déjà vu ce que c e-
foit que la parole.
La voix eff un bruit que l’air enferme dans lapoi-
. eXcite en fortant avec violence , & frottant les
embranes de la glotte, il les ébranle & les froiffe,
nforte que je retour caufe un trémouflement capable
de faire impreflfon fur l’organe de l’ouïe. Or cet
air agité avec promptitude , va.frapper la cavité du
nalais & ia membrane dont il eff revêtu, ce qui
oroduit la réflexion du fo n ; la modification de ce
fon ainfi réfléchi J'fe fait par le mouvement des levres
& de la langue, qui donnent la formé aux ac-
cens de la v o ix , & aux fyllabes dont la parole eff
compofee. iL), H H H a-;.;, ,
Pour que la voix fe forme aifement, il faut i ° . de
la foupleffe dans les mufcles qui ouvrent & reffer-
rent la glotte ; s’ils devénoient paralytiques, on ne
pourroit plus former dé fon.
i° . Il faut que les liganiens qui unifient les pieces
du larynx obeiffent facilement.
, ° . Il faiit une. liqueur qui humeCte continuellement
le larynx ; peut-être que le fuç huileux de là
glande tyroïde exprimé par les mufcles qu’on nomme
jlernotyroïdiens , contribue à rendre lafurface interne
du larynx gliffante, & par conséquent plus
propre àuformer la voix.
40. Il faut que le nez ne foit pas bouché,' autrement
l’air qui fe réfléchit & fe modifie diversement
dans lè fond de là bouche qui conduit au nez ; forme
un fon défàgréàble; on appelle cela parler du n e [,
mais mal-à-propos , car alors tout l ’air pafle par la
bouche j, & le nez bouché n’en reçoit que peu ou
point.' "
5°. Il faut que le thorax puiffe avoir une dilatation
confidérable ; car fi les poumons ne peuvent pas bien
s’étendre ; il faudra reprendre haleine à chaque moment
, ainfi la voix tombera, ou s’interrompra défagréablement.
Remarquons encore que la pointe de la langue
prend quelquefois part à la formation des tons ; car
quand ils fe fuivent de bien près , la glotte labiale
n’étant pas affez déliée pour prendre fi promptemènt
les différens diamètres nécéffaires, la pointe de la
langue vient fe préfenter en-rdédans à cetté ôüVer-
ture, & par un mouvement très-prefte , la rétrécit
autant qu’il faut, ou la laifle libre un inftant pour
revenir auflitôt la rétrécir encore. A l’égard du fif-
flement, on fait qu’il n’eft formé que par les feules
vibrations des parties des levres alors extrêmement
froncées & agitées par le paffage précipité de i’air
qui les fait frémir. Voilà les principales merveilles de
la voix, il nous refte à répondre à quelques queftions
qu’on fait à fon fujet.
On demande ce qui caufe la différence de la voix pleine
oc de la voix de faufiet qui commencé au plus haut
tort delà voix pleine,& ne lui ajoute que trois tons au
plus. M.Dodart a obfervé que dans tous ceux qui chantent
en fauffet, le larynx s’élève fenfiblement, &
par conféquent, le canal de la trachée s’alonge & fe
rétrécit, ce qui donne une plus grande viteffe à l’air
qui y coule.Celafeulfuffiroit pour hauffer le ton;mais
d’ailleurs il eff très-vraiflemblble que la glotte feref-
ferre encore, & plus que pour les tons naturels.
Peut-être aufli le muficien pouffe l’air avec une plus
grande force, & par-là le ton devient plus a igu ,
comme il le devient dans une flûte fur un même trou
jptfque le fouffle eff plus fort. Mais comme la difpo-
fition du larynx qui eff é le vé , ne permet à l’air que
d enfiler la route du nez, &c non pas celle de la bou-
Cae » cela fait que la voix n’eft pas défagréable, mais
e le eft toujours plus foible , & n’e ft, pour ainfi di-
re > qu’une demi-voix.
. Vo‘x faufle eft différente du fauffet ; c’eft celle
g “ “ « peut entonner jufte le ton qu’elle voudroit.
• Hodart en rapporte la caufe à l’inégale conftitu-
*?n des deux levres de la glotte, foit en épaiffeur,
0lt en grandeur, foit en tenfion, L ’une fa it, pour
ainfi dire , la moitié d’un ton, l’autre la moitié d’ un
autre, & 1 effet total n’eftjni l’un , ni l’autre; mais
M. de Buffon ayant remarqué dans plufieurs per-
fonnes qui avoient l’oreille & la voix fauffe, qu’elles
entendqient mieux d’üné oreille que d’une autre ,
1 analogie l’a conduit à faire'quelques épreuves fur
des perfonnes qui avoient lâ voix fauffe , il a trouvé
qu’elles avoient en effet une oreille meilleure qué
1 autre ; elles réçoiyent donc à-la-fois par les deux
oreilles deux fenfatïons inégales, ce qui doit produire
une difcordance dans le rélultat total de la fenfation;
& c-eft par cette raifon qu’entendant toujours faux ,
elles chantent faux rieceftairement, & fans pouvoir
meme s’en appercevoir. Ces.pérfonnes dont les oreilles
font inégalés en fenfibilite , fe trompent fouvent
fur le.coté d’ôû vient le fon fi leur bonne oreille eft
àÀrqitè , le fon leur paroîtra venir plus fouvent du
ÇÔré drpitque du gauche. Au re fte , il ne s’agit ici
que dès'perfonnes nées avec ce défaut ; ce n’ eft que
dans ce cas que 1 inégalité de fenfibilite des deux
oreilles , leur rend l ’oreille & la voix fauffes.
Or ceux auxquels cette différence n’arrive que par
accident, & qui viennent ay’ec l’âge à avoir une des
oreilles plus dure que l’autre, n’ auront pas'pour cela
l’oreille & la voix fauffes >p arc e qu’ils avoient auparavant
les oreilles, egalement fenfibles , qu’ils ont
commencé par entendre & chanter j u f t e , q ue fi dans
la fuite leurs oreilles deviennent inégalement fenfi-
bles, & prodüifent une fenfation de fau x , ils la rectifient
fur le champ par l’habitude où ils ont toujours
été d’entendr é jufte, & de juger en conféquence.
On demande enfin pourquoi des perfonnes qui ont
le fon de la voix agréable en parlant, l’ont défagréable
en chantant, ou au contraire. Premièrement le
chant eft un mouvement général de toute la région
vocale , & la parole eft le foui mouvement de la
glotte ; or puilque ces deux mouvemens font différens,
l’agrément ou le d.ëfagrément qui réfulte de
l ’un par rapport ‘à 'l ’ôrèille, ne. tire point à conféquence
pour l’autre. .Secondement, on peut conjecturer
que le chant eft une ondulation , un balancement,
un tremblement èontinuël, non pas ce tremblement
des cadences qui fe fait quelquefois feulement
dans l’étendue d’un to n , mais un tremblement
qui paroît égal & uniforme, & ne çjiange point le
ton , du-moins fenfiblement : femblable en quelque
forte au vol des oifeaux,qui planent , dont les ailes
ne laiffent pas de fairè inceflamment de.s vibrations 1
mais fi courtes & fi promptes qu’ elles font imperceptibles.
Le tremblement des cadences fe fait par
des changemens très-preftes & très-délicats de l’ouverture
de la glotte ; mais le tremblement qui régné
dans tout le chant, eft celui du larynx même. Le larynx
eft le canal dé la v o ix , mais un canal mobile ,
dont les balancemens contribuent à la voix de chant.
Cela p o fé , on voit affez que fi les tremblemens qui
ne doivent pas être fenfibles le font ; ils choqueront
l’oreille, tandis que dans la même perfonne la voix,
qui n’eft que le fimple mouvement de la glotte, pourra
faire un effet qui plaife.
Ce détail nous a conduits plus loin que nous, ne
croyons en le commençant, .mais il amufe, & d’ailleurs
le fujet fur lequel il roule eft un des plus curieux
de la Phyfiologie.
Nous avons fuivi pour l’explication des phénomènes
de la v o ix , le fyftème de M M. Dodart & Perrault
, par préférence à tout autre, & nous penfons
qu’il le mérite. Nous n’ignorons pas cependant que
M. Ferrein eft d’une opinion différente,' comme on
peut le voir par fon mémoire fur cette matière, inféré
dans le recueil de l’académie des Sciences, année
17 4 1 . Selon lu i, l’organè de la voix eft un inf-
trument à corde & à vent, & beaucoup plus à corde
qu’à vent ; l’air qui vient des poumons, & qui pafle