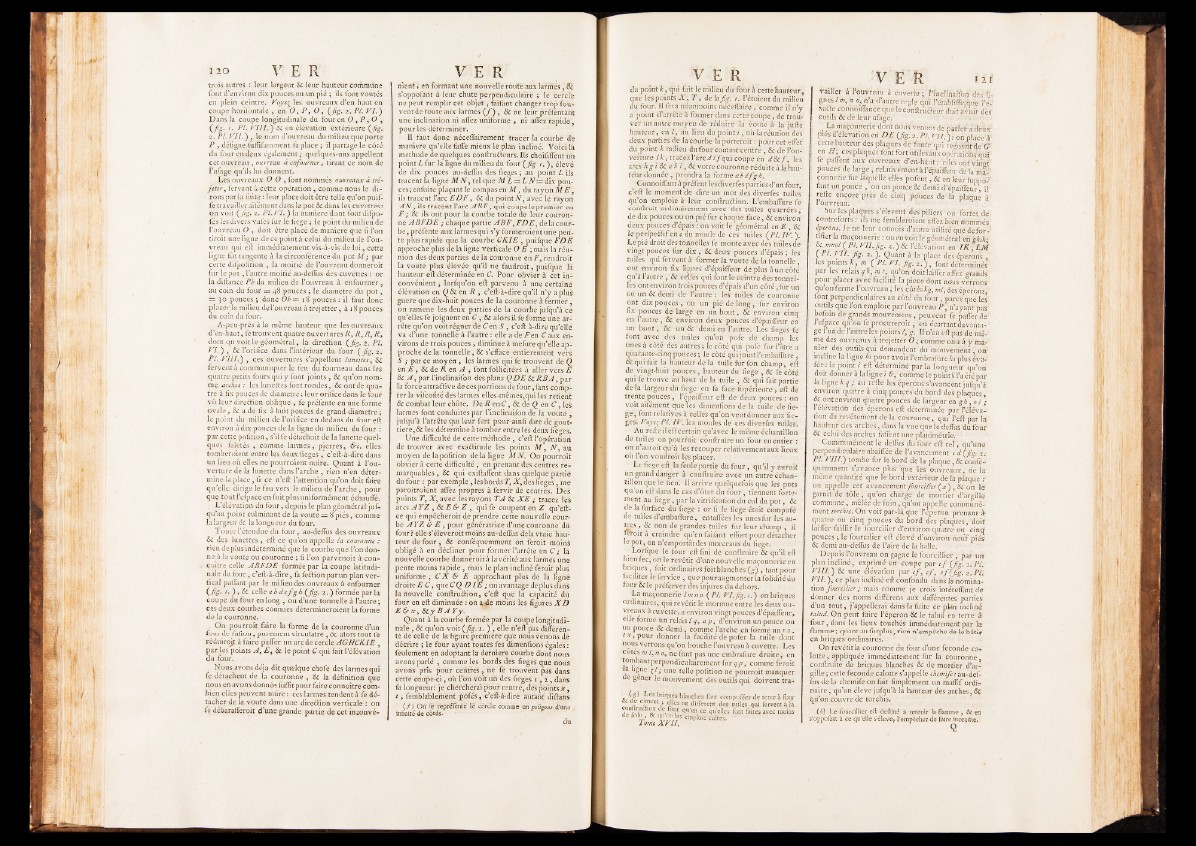
trois autres : leur largeur. & leur hauteur commune
font d’environ dix pouces ou un pie ; ils font voûtés
en plein ceintre. Voye^ les ouvreaux d’en haut en
coupe horifontale , en O , ? , O , {fig . 2. PI. V I . )
Dans la coupe longitudinale du four en O , P , 0 ,
{fig- i . P l . V II I . ) & en élévation extérieure (j%.
2. Z7. J7// . ) , le nom d’ouvreau du milieu que porte
P , défigne fuffifamment fa place ; il partage le côté
du four en deux également ; quelques-uns appellent
cet ouvreau , ouvreau à enfourner, tirant ce nom de
Pufage qu’ils lui donnent.
Les ouvreaux 0 0 , font nommés ouvreaux à tré-
jeter, fervant à cette opération , comme nous le dirons
par la fuite : leur place doit être telle qu’on puif-
fe travailler aifément dans le pot & dans les cuvettes :
on voit ( fig. 2. PI. V I, ) la maniéré dont font dil'po-
fés les divers vafes fur le fiege ; le point du milieu de
l ’ouvreau O , doit être placé de maniéré que fi l’on
tiroit une ligne de ce point à celui du milieu de l’ouvreau
qui eft immédiatement vis-à-vis de lu i, cette
ligne fut tangente à la circonférence du pot M ; par
cette difpofition , la moitié de l’ouvreau donneroit
fur le pot , l’autre moitié au-deffus des cuvettes : or
la diftance Pb du milieu de l’ouvreau à enfourner ,
au coin du four = 48 pouces ; le diamètre du p o t ,
= 30 pouces ; donc Ob = 18 pouces : il faut donc
placer le milieu de l’ouvreau à trejetter, à 18 pouces
du coin du four.
A-peu-près à la même hauteur que les ouvrèaux
d.’en-haut, fe trouvent quatre ouvertures R , R i R , R ,
dont on voit le géométral, la dire&ion { fig. 2 . PL
V I .) , & l’orifice dans l’intérieur du four ( fig. 2.
PL V II I .) , ces ouvertures s’appellent lunettes, &
fervent à communiquer le feu du fourneau dans les
quatre petits fours qui y font joints , & qu’on nomme
arches : les lunettes font rondes, & ont de quatre
à fix pouces de diamètre; leur orifice dans le four
vu leur dire&ion oblique , fe préfente en une forme
o v a le , & a de fix à huit pouces de grand diamètre ;
le point du milieu de l’orifice en dedans du four eft
environ à dix pouces de la ligne du milieu du four :
par cette pofition, s’il le détachoit de la lunette quelques
faietés , comme larmes , pierres, &c. elles
tomberoient entre les deux fieges ,* c’eft-à-dire dans
un lieu oii elles ne pourroient nuire. Quant à l’ouverture
de la lunette dans l’arche , rien n’ en détermine
la p lace, fi ce n’eft l’attention qu’on doit faire
qu’elle dirige le feu vers le milieu de l’arche , pour
que tout l’eipace en foit plus uniformément échauffé.
L ’élévation du four, depuis le plan géométral juf?
qu’au point culminant de la voûte = 8 p iés, comme
la largeur &: la longueur du four.
Toute l’étendue du four, au-deffus des ouvreaux
& des lunettes , eft ce qu’on appelle la couronne :
rien de plus indéterminé que la courbe que l’ondon-
ne^à la voûte ou couronne ; fi l’on parvenoit à con-
coître celle A B F D É formée par la coupe latitu dira
is du four, c’eft-à-dire, fa feftion par un plan vertical
paffant par le milieu des ouvreaux à enfourner
(.fig- '• ) > & cellt a b d e f g h {fig. 2. ) formée parla
coupe du four en long , ou d’une tonnelle à l’autre;
ces deux courbes connues détermineroient la forme
de la couronne.
On pourroit faire la forme de la couronne d’un
four de fufion, purement circulaire , & alors tout fe
réduiront à faire paffer un arc de cercle A G H C K IE ,
par les points A , Zs, & Je point C qui fait l’éfévation
du four.
4 Nous,avons déjà dit quelque chofe des larmes qui
le détachent de la couronne , & la définition quô
nous en avons donnée iùffit pour faire connoîtrë combien
elles peuvent nuire : ces larmes tendent à fe détacher
de la voûte dans une direélion verticale : on
fe debarafferoit d ’une grande partie-de cet inconvénient
, en formant une nouvelle rôiitfe aux laftfiës, Bt
s’oppoftmt à leur chute perpendiculaire ; lé ber clé
ne peut remplir cét o b je t, faifant changer trop fou-
vent de toute aux larmes ( ƒ ) , & ne leur prëféntah’t
une inclination ni afl'ez uniforme , ni affez'rapide,
pour les déterminer.
Il faut donc néceffairemênt tracer la courbé dé
maniéré qu’elle faffe mieux lé plan incliné. Voici là
méthode de quelques conftrufteurs. Ils choififfent uh
point L fur la ligne du milieu du four ( fig. 1. ) , élevé
de dix pouces au-deffus des fieges ; au point L ils
tracent la ligné M N , tel que M L — L N = dix pouces;
enfuite plaçant le coiripasen M , du rayon M È 9
ils tracent l’arc E D F , & du point N , avec lé rayon
A N , ils tracent l’arc A B F , qui coupe le premier en
F ; te ils ont pour la courbe totale de leur couronne
A B F D E ; chaque partie A B F , F D E , de là courbe
, préfênte aux larmes qui s’y formeroientune pente
plus rapide que la courbe C K IE , puifque F D È
approche plus de la ligne verticale O E ; mais la réunion
dès dèux parties dé la couronné en F , rendroit
la voûte plus élevée qu’il ne fâudroit, puifquè là
hauteur eft déterminée en C. Pour obvier à cét in1
eonvénient ; lorfqu’on eft parvenu à une certaine
élévation en Q & en R , c’eft-à-dire qu’il n’y a plûS
guere que dix-huit pouces de la couronne à fermer,
on ramene les deux parties de la courbe jufqu’à cè
qu’elles fe joignent en C , & alors il fe forme une arrêté
qu’on voit régner de C eh S ., c’eft à-dire qü’éll'ê
va d’une tonnelle à l’autre : elle a de Z7 en C aux environs
de trois pouces, diminue à mefure qu’elle approche
de la tonnelle, & s’efface entièrement vérâ
5 ; par ce moyen , les larmes' qui fe trouvent dé Q
en E , & de R en A , font follicitées à allér vers E
6 A , par l’inclinaifon des plans Q D E & R B A , par
la force attraétive de ces portions de foitr, fans corfip-
terla vifeofité des larmes elles-mêmés,qui les rétiërit
& combat leur chiite. De R e n C , & de Q en C , foi
larmes font conduites par l’inclinaifon de la vOiité ,
jufqu’à l’arrête qui leur fort pour-ainfi dire dé gouttière,
& les détermine à tomber entre les deux fië^esi
Une difficulté de cette méthode , c’ eft l’opération
de trouver avec exaftitude lès points M , N , aù
moyen de la pofition de là ligne M N . Ori pourroii
obvier à cette difficulté ; en prenant dés centres remarquables
, & qui exiftaffent dans quelque partie
du four : par exèftipie , lés bords T, X , des fieges, me
paroitroient allez propres à fervir de centrés. Des
points T , X , avec les rayons T A & X E ; tracez lès
arcs A Y Z j S c E & Z , qui fe coupent en Z qu’ëft-
ce qui empêcheroit de prendre cette nouvelle courbe
AYZ, & E j pour génératrice d’une couronne dû
four ? elle s’éleveroit moins au-defliiS dèla vraie hauteur
de four j & conféquemmertt on feroit moins
obligé à en décliner pour former l’arrête en C ; la
nouvelle courbé donneroit à la vérité atix: larmes une
pente moins rapide, mais le plan incliné féfoit plus
uniforme ; € X & E approchant plus dé là ligné
droite E C , que CQ D I E ; un avantagé déplus dans
la nouvelle conftru&ion, c’eft que la capacité du
four en eft diminuée : on a tçle rnoihS leS figuïes X î )
Ê & x , & ƒ B A Y y .
Quant à la courbe formée par lâ coupe îongitudi-
nalé , & qu’ori voit {fig. 2. ) , elle n’éft pas différén-
tè de celle de la figure prémièrè que nôiis venons de
dé Cf ire ; le four ayant toutes fes dimèhfiônS égalés :
feulement en adoptant la derniere courbé dont nous
avons parlé , comme les bords des fiêgéS què nous
avons pris pour céiitfës, né fe trouvent pas dans
cétté coupe-ci, oîi l’on voit un des fiégè$ 1 , i , dans
fà longueur: je cHërchefài pour centré, dés points x ,
t ; fëhiblablemént pofé s, c’eff-à-dirè à'utânf diftahs
•_ {fi) ÔA fe réprëfènté le cercle comme un poligonc d’une .
infinité de côtés.
du
V E R
dit point k , qui fait le milieu du finira cetteliauteur,
que les points X , T * de la fig: t . l’étoient du milieu
du four. Il fera neanmoins nécèffaife ; ' comme il n’y
a point d’afretè à former dans cette coupe, de trouver
un autre moyen de réduire la voûté à la jitfte
hauteur, en / , au lieu du point i , oîi la réunion dés
deux parties de la côurbe la porterait : pour cet effet
du point k milieu du four comme cèrttfe , & de l’ouverture
Lk i tracez l’arc^Z / ƒ qui coupe en d&c f , les
arcs h g i & a b i .7 &c Votre couronne réduite à la hait-
te'ur donnée:, prendra la forme a b d f g k .
Connoiffant à préfent les diverfes parties d’un four,
c’eft le moment de dire un mot des diverfes tuiles'
qu’on emploie à leur conftru&ion. L ’embaflûre fe
conftruit ordinairement avec des tuiles quarrées ;
de dix pouces ou un pié fur chaque face , & environ!
deux pbuces d’épais : on voit le géométral en E , &
le perfpeétif en é du moule de ces tuiles ( PI. IV. ).
Le pié droit des tonnelles fe monte avec des tuiles de
vingt pouces fur dix , Ôt deux pouces d’épais ; les
tuiles qui fervent à former la voûte de la tonnelle,
ont environ fix lignes d’épaiffeur de plus à un-côté
qu’à l’autre , & celles qui font le ceintre des tonnelles
ont environ trois; pouces d’épais d’un côté, fur un
où un & demi de l ’autre : les tuiles de couronne
ont dix pouces, OU un pié de long, fur environ
fix poucës de large én un bout, & environ cinq
en l’autre, & environ deux pouces d’épaiffeur en .
un bout, ôc un & demi en l’autre. Les fiegès fe
font avec des tuiles qu’on pofe de champ les
unes à côté dés autres ; le côté qui pofe fur l’a.tre a
quarante-cinq pouces; le côté qui joint l’ embaffure*
6cqui fait la hauteur de la tuile fur fon.champ, eft
dé. vingt-huit pouces, hauteur du fiege , & le côté
qui fe trouve au haut de la tuile , & qui fait partie
de la largeur du fiege en fa face fupérieure , eft de
trente pouces , I’épaiffeur eft de deux pouces : on
voit aifément què le s dimenfions de la tuile de fieu
g e , font relatives à celles qu’on veut donner aitx fieges.
Voye{ PL IV. les moules de ces diverfes tuiles«
Au refte il eft certain qu’avec le même échantillon
de tuiles on poùfrôit conftruire un four en entier : '
on n’auroit qu’à les recouper relativement aiix lieux
où l’on vOudroit les placer.
Le fiege eft la feule partie du four i qu’il y auroit
un grand danger à conftruire avec un autre échantillon
que le lien! Il arrive quelquefois que les pots
qu on eft dans le cas d’ôtei‘ du fo u r , tiennent fortement
au fiege , par la vitrification du cul du p o t, &
de la furface du fiege : or fi le fiege étoit compôfé
de tuiles d’embaffure, entaffées les unes fur les au-
ttes 3 Bc non de grandes tuiles fur leur champ , il
feroit à craindre qu’en faifant effort pOiir détacher
le pot , on n’emportât des morceaux du fiege.
Lùrfque le four eft fini de conftruire & qu’il eft
bien fec, on le revêtit d’une nouvelle maçonnerie en
briques , foit ordinaires foit blanches {g) , tant pouf
faciliter le fervice , que pour augmenter lafoliditédu
four & le préferver des injures du dehors.
La maçonnerie Imno { PI. VI. fig. 1. ) en briques
ordinaires, qui revêtit le mormue entre les deux ou*
vreaux à cuvette> a environ vingt pouces d’épaifleur,
elle formé un relais l q, a p , d’environ un pouce ou
un pouce & demi, comme l’arche en forme un r s ,
t x , pour donner la facilité de pofer la tuile dont
nous verrons qu’on bouche l’ouvreau à cuvette. Les
cotes / « / , n 0 , ne font pas une embrafure droite, en
tombant perpendiculairement fur q p , comme feroit
la ligne ^ / ; une telle pofition ne pourroit manquer
de gener le mouvement des outils qui doivent tra-*
c 'J p .^es bii^ues blanches font compofées de terre à four
n C *es ne different des miles qui fervent à la
‘ e, foi/r pu'en cè qu’elles font faites avec moins
de foin , Ôt qu on les emploie cuites.
Tome X V I I ,
V E R m
Vailler à l’ouWeàù S cuvette; l ’in cM a iW t e lignes
lm ,h o; n’a’d’autre réglé qui l’établifle;àue l’e-''
Safle connoiflance que le coriAruSeiir doit a«bir des
outils & de leur ufagé.
• . f-3 maç'onnerië dont ridiis venons de parlé f a défi r
^iés d’clévatio'n en D E Çfig-i, PI. f i l . ) : e h phceH
, <«te naittdur des plaques de fonte'qiii rednènfde G
j ces plaqués font fort üïiies'/i'tix oqératjoits qui '
! “ paffent aux ouvreaux d’endi3iit i elles ont1vingt
! Pouccs * large ; relativement à l’epaiffeur dé'la ma-'
l Çonnerte fur laquelle elles pofént ; & eh leur ftipp'3/
fuit unpouce , ou lui pouce & demi d'épaifTeur,
| réfté encore près de cinq pouces de là piaque
I ouvréaii: v
Sur les plaques s ’ëlevent des piliers-'ôu fortes dé-
contreforts : ifs me fembleroient afl’ez bien rtomtfiés:
; éperons: Je né leur connôis d’autre Utilité que d è fo r J
tifier la maçOnnerie : onen vôit ie géométraièh ghiki
; Sç mnol { PI. V II. fig . 2 . ) & l’élévation en I K , LM
( PI. V I I . fig . 2 . ) . Quafit à la1 ;place des éperons ,
les points k , m { PI. VI. fig. i . ) , -font déterminés
par les relais q k ,mr , qu’on doit laiffer affez grands
pour placer avec facilité la pièce dont nous verrons
qu’on ferme l’ouvreau ; les côtés%, ml, des éperons,
font perpendiculaires au côté' du four, parce que les
outils que l’on emploie par l’oiivreau P , n’ayant pas
befoin dé grands mouvemens, peuvent fe paffer cle'
l’efpàce qù’on fe procureroit, ien écaftant davantage
l’uh de l’aûtre les points l, g. Il n’en eft pas dé même
des ouvreaux à trejetter O; comme ona à ÿ manier
des outils qui demandent du mouvement on
incline la ligne hi pour avoir l’embrafure /zi pluS éva-1
; fée.: le p o^t i eft déterminé par la'longueur qu’on-
doit donner à là ligne i &, comme le point* l’a été par
la ligne * q ; au refte les éperons's’avancent jufqu’à
ènviron quàtre à cinq pouces’du bord des'plaques,
& ont environ quatre pouces: de largeur en g h , o l
l’élévatioh des éperons eft. déterminée par l’élévation
dit revêtement de la couronne,. qui l’eft par lâ
hauteur' des arches, dans la vue que le deffus du four
& celui des arches faffent une planimétrxe.
Communément le deffus du four eft t e l , qu’une
perpendiculaire abaiffée de l’ avancement c d (/g. 2 .-
Pl. V III.) tombe fur leborcl de la plaque, & confié
quemment s’avance plusv que les ouvreaux, de là
même quantité que le bord -extérieur de la plaque f
on appelle cet avancement fourcilier {a ) , & on le"
garnit de tô le , .qu’on chargé de mortier d’argillé
commune, mêlée de fo in , qu’on appelle communément
torchis: On voit par-là que l’éperon prenant à-
quatre ou cinq pouces du bord des plaques-, doit’
laiffer faillir le fourcilier d’environ quatre oit cinq'
pouces ; le fourcilier eft élevé d’anyiron neuf pies
& demi au-deffus de l’aire de la halle.
Depuis l’ouvreau on gagne le fourcillier , par -un-
plan incliné, exprimé èri coupe par e f {fig. 2. PI,'
V I I I .) & une élévatiçn par e f , e f , e f t f g . 2 . PL
V i l . ) , ce plan incline eft confondu dans lâhomina-
tiori fourcilier ; mais comme je crois intéreffant de
donner des noms différens aux différentes parties
d’un tout, j’appellerai dans la fuite ce plan incliné
talud. On peut faire l’éperon &: le talud en terre à
•four, dans les lieux touchés immédiatement par la
flamme ; quant au furplus , rien n’empêche de le bâtir
en briques ordinaires.
On revêtit la couronne du four d’une fécondé calotte
, appliquée immédiatement fur la couronne,
conftruite de briques blanches & de mortier d’ar-
gille ; cette fécondé calotte s’appelle chemife : au-def-
lusde la chemife on fait Amplement un maffif ordinaire
, qu’ ori éleve jufqii’à la hauteur des arches, ôfi
qu’on couvre de torchis,-
(A) Le fourcillier eft deftihé à retenir la flamme , & en
s’oppofant à ce qu’elle s’élève, l’empêcher de faire incendie,