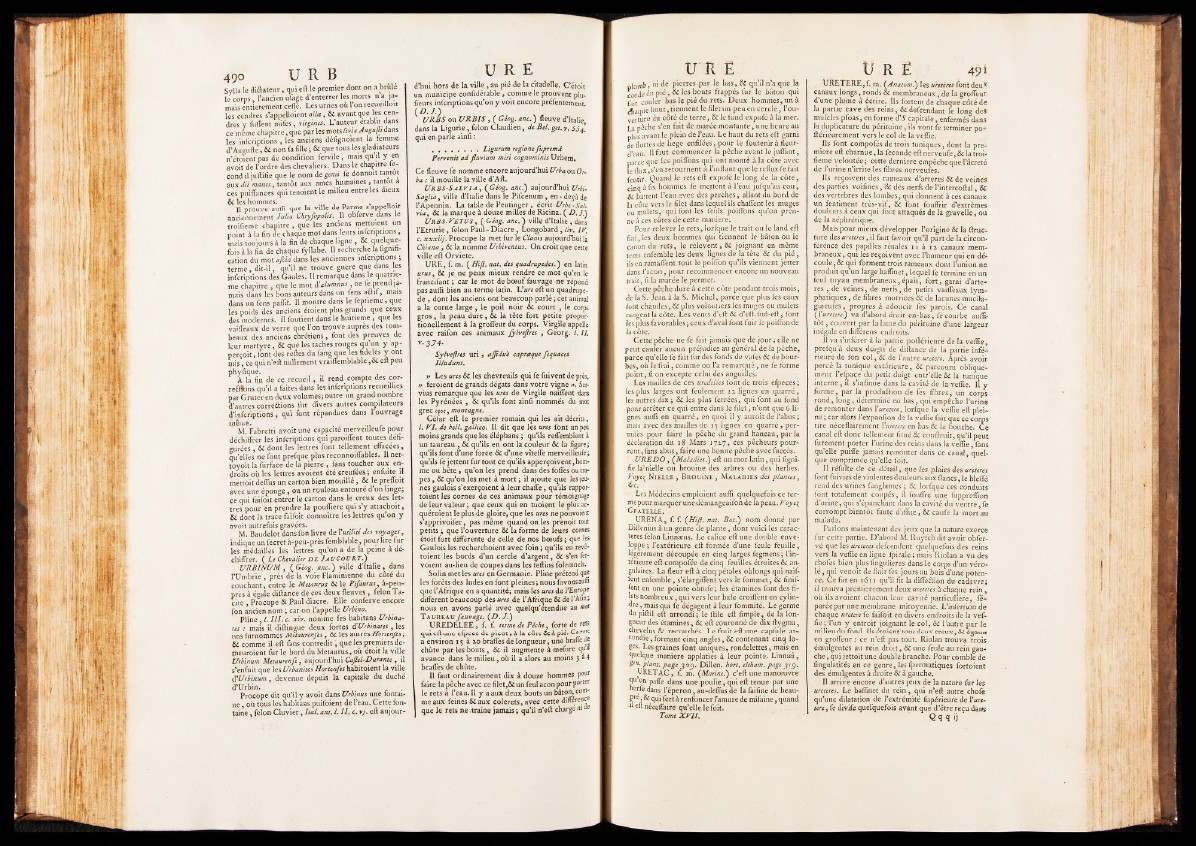
Sylla le diâateur, qui eft le premier dont on a brûle
le corps, l’ancien ufage d’enterrer les morts n a jamais
entièrement ceffé. Les urnes où l’on recueilloit
les cendres s’appelloient o lla , 6c avant que les cendres
y fuffent mifes , virgines. L’auteur établit dans
ce meme chapitre, que par les mots m m Augufh dans
les inferiptions , les anciens défignoient la femme
d'Augufte, 6c non fa fille ; 6c que tous les gladiateurs
n’étoient pas de condition fervile, mais qu’il y en
avoit de l’ordre des chevaliers. Dans le chapitre le-
cond il juftifie que le nom de gémi fe donnoit tantôt
aux dit mants, tantôt aux âmes humaines , tantôt à
cçs puiffances qui tenoient le milieu entre les dieux
& les hommes. _ » h
Il prouve aufli que la ville de Parme s appelloit
anciennement Julia Chryfopolis. Il obferve dans le
troifieme chapitre , que les anciens mettoient un
point à la fin de chaque mot dans leurs inferiptions,
mais toujours à la fin de chaque ligne , & quelquefois
à la fin de chaque fyllabe. Il recherche la lignification
du mot afeia dans les anciennes inferiptions ,
terme, dit-il, qu’il ne trouve guere que dans les
inferiptions des Gaules. Il remarque dans le quatrième
chapitre , qtie le mot d'alumnus , ne fe prend jamais
dans les bons auteurs dans un fens a ftif, mais
dans un fens paflif. Il montre dans le feptieme > que
les poids,des anciens étoientplus grands que ceux
des modernes. Il foutient dans le huitième, que les
vaifléaux de verre que l’on trouve auprès des tombeaux
des anciens chrétiens, font des preuves de
leur martyre, 6c que les taches rouges qu’on y ap-
perçoit, font des reftes du fang que les fideles y ont
mis, ce qui n’eft nullement vraiffemblable ,6c ell peu
phyfique. . . . ,
A la fin de ce recueil, il rend compte des cor-
reftfons qu’il a faites dans les inferiptions recueillies
par Gruter en deux volumes; outre un grand nombre
d’autres corrections fur divers autres compilateurs
d’inferiptions, qui font répandues dans l’ouvrage
| | | j| | Fabretti avoit une capacité merveilleufe pour
déchiffrer les inferiptions qui paroiffent toutes défigurées
, 6c dont les lettres font tellement effacées,
qu’elles ne font prefque plus reconnoiffables. Il net-
toyoit la furface de la pierre , fans toucher aux endroits
oîi les lettres avoient été creufées; enfuite il
mettoit deflus un carton bien mouillé, 6c 1<e preffoit
avec une éponge, ou un rouleau entouré d’un linge;
ce qui faifoit entrer le carton dans le creux des lettres
pour en prendre la poufliere qui s’y attachoit,
& dont la trace faifoit connoître les lettres qu’on y
avoit autrefois gravées. ;
M. Baudelot dans fon livre de Xutilité des voyages,
indique un fecret à-peu-près femblable, pour lire fur
les médailles les lettres qu’on a de la peine à déchiffrer.
( Le Chevalier d e J a u c o u r t .')
U R B IN UM , ( Géog. anc. ) ville d’ Italie, dans
l’Umbrie , près dé la voie Flaminienne du côte du
couchant, entre le Metaurus & l e Pifaurus, à-peu-
près à égale diftance de ces deux fleuves, félon Tacite
, Procope & Paul diacre. Elle conferve enepre
fon ancien nom ; car on l’appelle Urbino.
Pline, /. I I I . c. xiv. nomme fes habitans Urbina
tes : mais il diftingue deux fortes à'Ur binâtes , les
uns furnommés Metaurenfes, 6c les autres Hortenfes:
6c comme il eft fans contredit, que les premiers de
meuroient fur le bord du Metaurus, où étoit la ville
Urbinum Metaurenft, aujourd’hui Caflel-Durante , il
s’enfuit que les Urbanités Hortenfes habitoient la ville
ftUrbinum, devenue depuis la capitale du duché
d’Urbin.
Procope dit qu’ il y avoit dans Urbinus une fontaine
, où tous les habitaas puifoient de l’eau. Cette fontaine
, félon C luvier, Ital. ant. L. I I , c, vj. eft aujour-
..’hui hors de la v ille , au pié de la citadelle. C’étoit
un municipe confidérable , comme le prouvent plu-
fieurs inferiptions qu’on y voit encore préfentement.
D . J . )
U R B S ou U R B I S , ( Géog. anc. ) fleuve d’Italie,
dans la Ligurie, félon Claudien, de Bel. get. v. 55^.
qui en parle ainft :
..........................Ligurum regione fupremâ
Pervenit ad fluvium miri cognominis U'rbem,
Ce fleuve fe nomme encore aujourd’hui Urb a ou Or-
ba : il mouille la ville d’Aft.
U r b s - S a L v IA , ( G é o g . anc.") aujourd’hui U r b i
S a g l i a , ville d’ Italie dans le Pifcenum, en - deçà de
l’Apennin. La table de Peutinger, écrit U r b e - Salv
i a , 6 c la marque à douze milles de Ricina. ( D. J . )
U r b s -V e t u s , ( Géog. anc. ) ville d’Italie , dans
l’Etrurie, félon P au l-D ia c re , Longobard , liv. U',
c. x x x iij. Procope la met fur le Clanis aujourd’hui la
Chiana, & la nomme Urbiventus. On croit que cette
ville eft Orviete.
U R E , f. m. ( Hiß. nat. des quadrupèdes. ) en latin
urus, 6c je. ne peux mieux rendre ce mot qu’en le
francifant ; car le mot de boeuf fauvage ne répond
pas aufli bien au terme latin. Uure eft un quadrupède
, dont les anciens ont beaucoup parlé ; cet animal
a la corne large. le poil noir 6c court , le corps
g ro s , la peau dure, 6c la tête.fort petite propor-
tionelleipent à la grofleur du corps. Virgile appelle
avec raifon ces animaux fylveßres , Georg. I. II.
y- 3J4-
Sylveßres uri , afjiduï capraque fequaces
Illudunt,
» Les ures 6c les chevreuils qui fe fuivent de près,
» feroient de grands dégâts dans votre vigne ». Ser*
vius remarque que les ures de Virgile naiflent dans
les Pyrénées , 6c qu’ils font ainft nommés du mot
grec opes, montagne.
Céfar eft le premier romain qui les ait décrits,
/. V I. de bell, gallico. Il dit que les ures font un peu
moins grands que les éléphans ; qu’ils reffemblent à
un taureau , 6c qu’ils en ont la couleur & la figure ;
qu’ils font d’une force 6c d’une vîtefle merveilleufe ;
qu’ils fe jettent fur tout ce qu’ils apperçoivent, homme
ou bête , qu’on les prend dans des folles outra-
p e s , 6c qu'on les met à mort ; il ajoute que les jeunes
gaulois s’ exerçoient à leur chafle, qu’ils rappor-
toient les cornes de ces animaux pour témoignage
de leur valeur ; que ceux qui en tuoient le plus acquéraient
le plus de gloire, que les ures nepouvoient
s’apprivoifer, pas même quand on les prenoit tout
petits ; que l’ouverture 6c la forme de leurs cornes
étoit fort différente de celle de nos boeufs ; que les
Gaulois les recherchoient avec foin ; qu’ils en révéraient
les bords d’un cercle d’argent, 6c s’en fer-
voient au-lieu de coupes dans les feftins folemnels.
Solin met les ures en Germanie. Pline prétend que
les forêts des Indes en font pleines ; nous favonsaufli
que l’Afrique en a quantité; mais les ures de l’Europe
different beaucoup des ures de l’Afrique 6c de l ’Afie ;
nous en avons parlé avec quelqu’etendue au tnot
T aureau fauvage. (D . J . )
U R ED E L É E , f. f. terme de Pêche, forte de rets
qui eft une efpece de picot, à la côte 6c à pié. Ce rets
a environ 1 5 à zo brafles de longueur, une braffe de
chute par les bouts, 6c il augmente à mefure q»“
avance dans le milieu, où il a alors au moins 3 à 4
brafles de chûte.
Il faut ordinairement dix à douze hommes p®ur
faire la pêche avec ce filet,& un feul aconpour porter
le rets à l’eau. Il y a aux deux bouts un bâton, comme
aux feines 6c aux colerets, avec cette différence
que le rets ne .traîne jamais ; qu’il n’eft charge ni d®
olomb, ni de pierres par le bas, 6c qu’il n’a que la
corde du p ié , 6c les bouts frappés fur le bâton qui
fait couler bas le piédurets^ Deux hommes, un à
éfiaque bout, tiennent le filet un peu en cercle, l’ouverture
du côté de terre, 6c le fond expofé à la men
La pêche s’en fait de marée montante, une heure au
plus avant le plein de l’eau. Le haut du rets eft garni
de flottes de liege enfilées, pour le foutenir à fleur-
d’eau. Il faut commencer la pêche avant le juflànt,
parce que les poiflons qui ont monté à la côte avec
le flux s’en retournent à l’inftant que le reflux fe fait
fentir. Quand le rets eft expofé le long de la côte,
cinq àfix hommes fe mettent à l’eau jufqu’au cou,
& battent l’eau avec des perches, allant du bord de
la côte vers le filet dans lequel ils chaflent les muges
ou mulets, qui font les feuls poiflons qu’on prenne
à ces côtes de cette maniéré.
Pour relever le rets, lorfque le trait ou le land eft
fini, les deux hommes qui tiennent le bâton ou le
canon du rets, le rèlevent, 6c joignant en même
teins enfemble les deux lignes de la tête 6c du p ié ,
ils en ramaflent tout le poiffon qu’ils viennent jetter
dans l’acon, pour recommencer encore un nouveau
trait, fi la marée le permet.
Cette pêche dure à cette côte pendant trois mois,
de la S. Jean à la S. Michel, parce que plus les eaux
font chaudes, & plus volontiers les muges ou mulets
rangent la côte. Les vents d’eft 6c d’eft-fud-eft, font
les plus favorables ; ceux d’aval font fuir le poiffon de
la côte.
Cette pêche ne fe fait jamais que de jour ; elle ne
peut caufer aucun préjudice au général de la pêche,
parce qu’elle fe fait fur des fonds de vafes 6c de bourbes,
où le fra i, comme ôn l’a remarqué, ne fe forme
point, fi on excepte celui des anguilles.
Les mailles de ces uredelées font de trois efpeces ;
les plus larges ont feulement 12 lignes en quarré,
les autres dix ; 6c les plus ferrées, qui font au fond
pour arrêter ce qui entre dans le filet, n’ont que 6 lignes
aufli en quarré , en quoi il y aurait de l’abus ;
mais avec des mailles de 15 lignes en quarré, per-
mifes pour faire la pêche du grand haneau, parla
déclaration du 18 Mars 17 2 7 , ces pêcheurs pourront
, fans abus, faire une bonne pêche avec fuccès.
U R E D O , {Maladies.) eft un mot latin, qui figni-
fie l#nielle ou brouïne des arbres ou des herbes.
Voyt7 Nie l l e , Brouïne, Maladies des plantes,
&c.
• Les Médecins emploient aufli quelquefois ce terme
pour marquer une démangeaifon de la peau. Voye[
Gratelle.
URENA, f. f. {Hift. nat. Bot.) nom donné par
Dillenius à un genre de plante, dont voici les caractères
félon Linnæus. Le calice eft une double enve-
loppe ; l’extérieure eft formée d’une feule feuille,
légèrement découpée en cinq larges fegmens ; l’in-
terieure eft compofée de cinq feuilles étroites 6c angulaires.
La fleur eft à cinq pétales oblongs qui naif-
fent enfemble, s’élargiffent.vers le fommet, 6c finif-
■ fent en une pointe obtufe ; les étamines font des filets
nombreux, qui vers leur bafe croiflent en cylindre
, mais qui fe dégagent à leur fommité. Le germe
du piftil eft arrondi ; le ftile eft fimple, de la longueur
des étamines, & eft couronné de dix ftygma,
chevelus & recourbés. Le fruit eft une capfule arrondie
, formant cinq angles, 6c contenant cinq loges.
Les graines font uniques, rondelettes, mais en
quelque maniéré applaries à leur pointe. Linnæi,
gin. plant, page 325). Dillen. hort. eltham. page 3 1g .
E R E T A C , f. m. {Marine.) c’eft une manoeuvre
qu on paffe dans une poulie, qui eft tenue par une
herfe dans l’éperon, au-deflus de la faifine de beau-
Pre > & qui fert à renfoncer l’amure de mifaine, quand
ù eft néceffaire qu’elle le foit.
Tome X V I I ,
U R E T E R E ,fi m. {Anatôm.) les uretères font deux
canaux longs, ronds 6c membraneux, de la grofleur
d une plume à écrire. Ils fortent de chaque côté de
la partie cave des reins, 6c defeendant le long des
niufcles pfoas, en forme d’S capitale, enfermés dans
la duplicature du péritoine fils vont fe terminer po-
ftérieurement vers le col de la veflie.
Ils font compofés de trois tuniques, dont la pre^
miere eft charnue, la fécondé eft nerveufe, 6c la troi-
fiemè veloutée; cette derniere empêche que l’âcreté
de l’urine n’irrite les fibres nerveules.
Ils reçoivent des rameaux d’arteres & de veines
des parties voifines dés nerfs de l’intercoftal, &
des vertebres des lombes j qui donnent à ces canaux
un fentiment tres-vif, & font fouffrir d’extrêmes
douleurs à ceux qui font attaqués de là gravelle ; ou
de la néphrétique.
Mais pour mieux développer l’origine 6c la ftruc-
ture des ureteres 9 il faut favoir qu’il part de la circonférence
des papilles rénales 1 1 à 12 canaux membraneux
, qui les reçoivent avec l’humeur qui en dé*
coule, 6c qui forment trois rameaux dont l’Union ne
produit qu’un large baflînet, lequel fe termine en un
feul tuyau membraneux, épais, fort, garni d’arteres
, de veines, de nerfs, de petits vaifleaux lymphatiques
, de fibres motrices 6c de lacunes mucüa-
gineufes, propres à adoucir fes parois. Ce canal
( l'uretere) va d’abord droit en-bas, fe courbe auflï-
to t , couvert par la lame du péritoine d’une largeur
inégale en différens endroits.
11 va s’inférer à la partie poftérieuré de la veflie,
prefqu’à deux doigts de diftance de la partie inférieure
de fon co l, & de l’autre uretere. Après avoir
percé la tunique extérieure, & parcouru obliquement
l’efpace du petit doigt entr’e lle& la tunique
interne , il s’infinue dans la cavité de la veflie. Il y
forme, par la produ&ion de fes fibres, un corps
rond, long, détermine en b as, qui empêche l’urine
de remonter dans Xuretere, lorfque la veflie eft pleine
; car alors l’expanfion de la veflie fait que ce corps
tire néceffairement Xuretere en bas & le bouche. Ce
canal eft donc tellement fitué $c conftruit, qu’il peut
furement porter l’urine des reins dans la veflie, fans
qu’elle puiffe jamais remonter dans ce canal, quelque
comprimée qu’elle foit.
Il réfulte de ce dérail, que les plaies des ureteres
font fui vies de violentes douleurs aux flancs, le blefle
rend des urines fanglantes ; & lorfqye ces conduits
font totalement coupés, il fouffre une fupprefiion
d’urine, qui s’épanchant dans la cavité du ventre, fe
corrompt bientôt faute d’iflue, 6c caufe la mort au
malade.
Parlons maintenant des jeux que la nature exerce
fur cette partie. D ’abord M. Ruÿfch dit avoir obfer-
vé que les ureteres defeendent quelquefois des reins
vers' la veflie en ligne fpirale ; mais Riolan a vu des
chofes bien plus fingulierès dans le corps d’un véro-
-lé, qui vénoit de finir fes jours au bois d’une potence.
Ce fut en 16 1 1 qu’il fit la diffeâion du cadavre;
il trouva premièrement deux ureteres à chaque rein ,
où ils avoient chacun leur cavité particulière, fé-
paréè par une membrane mitoyenne. L ’infertion de
chaque uretere fe faifoit en divers endroits de la vef-
fie ;T u n y entrait joignant le col, & l ’autre par le
milieu du fond. Ils étoient'tous deux creux j & égaux
en grofleur : ce n’eft pas tout. Riolan trouva trois
émulgentes au rein droit, 6c une feule au rein gauche
, qui jettoit une double branche. Pour comble de
fingulatités en ce genre, les fpermatiques fortoient
des émulgentes à droite & à gauche.
. Il arrive encore d’autres jeux de la nature fur les
ureteres. Le baflinet du re in, qui n’eft autre chofe
qu’une dilatation de l’extrémité fupérieure de Xuretere
, fe divife quelquefois avant que d’être reçu daris
Q q q ÿ