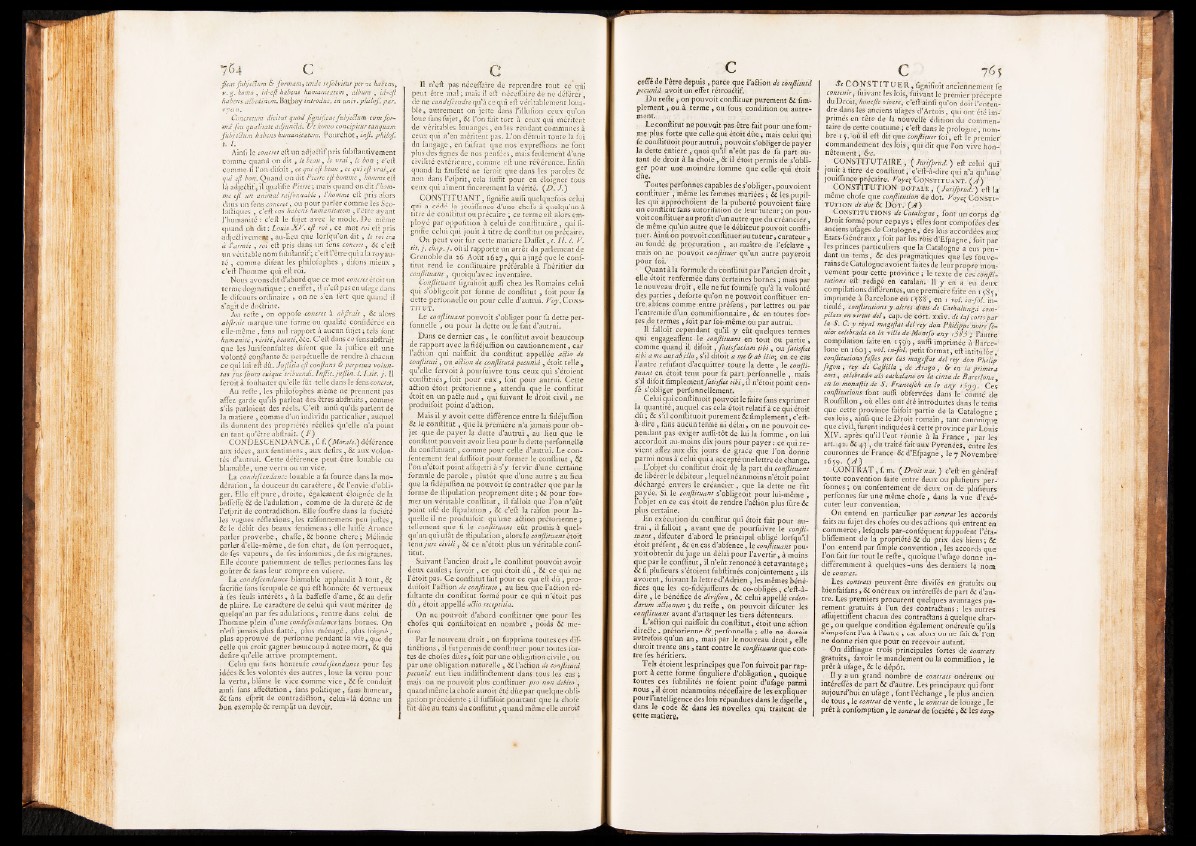
7^4 C
Jicat fxibjèciüm & formam,unde refolvuür per to habens,
v. g. homo , id-eft habens hurnanitatern, album -, id-eft
habens albiiiàdn. Baçbay introduc. in univ. philof. par.
«yoo.
Concrttum dicitu 'r qubd fignifiçat fubjeclum arm forma
feu qualitate adjuncld. Ut homo concipitur tanquam
fubjeclum habens kumanitatem. Pourchot, infî. philof.
l> f.A
infi le concret eft un ad je â if pris fubftantivement
comme quand on d it , le beau, le vra i, U bon ; e’eft
comme.fi l’on difoit, ce qui ejl beau , ce qui ejl vrai, ce
qui e(l bon. Quand on dit Pierre efl homme , homme eft
là adje&if,il qualifie Pierre ; mais quand oridit l’homme
efl un animal raifonnable , U homme eft pris alors
dans un fens contrée-, ou pour parler comme les Sco-
lalîiques , c’eft ens habens hurnanitatern -, l’être ayant
rhumânité ï c’ eft le lu jet avec le mode. De même
quand oh dit : Louis X V . ejl roi , ce mot roi eft pris
adjectivement, au-lieu que lorlqu’on dit , le roi ira
à F armée , roi eft pris dans un fens concret, & c’eft
un véritable nom fubftantif; c’eft l’être qui a la royauté
, comme difent les philofophes , difons mieux,
c ’eft l’homme qui eft roi.
Nous avons dit d’abord que ce mot concret étoit un
terme dogmatique ; en effet, il n’eft pas en ufage dans
le difeours ordinaire , on ne s’en fert que quand il
s’ agit de doCtrine.
Au re fte , on oppofe concret à ab(Irait , & alors
abflrait marque une forme ou qualité confidérée en
elle-même , fans nul rapport à aucun fujet ; tels font
humanité, vérité, beauté, & c . C ’eft dans ce fensabftrait
que les Jurifconfultes difent que la juftice eft une
volonté confiante & perpétuelle de rendre à chacun
ce qui lui eu dû. Jujlitia efl confions & perpétua volun-
las ju s fuum cuique tribuendi. Injlit. juflin. I. I.tit. j . Il
feroit à fouhaiter qu’elle fût telle dans le fens concret.
Au refte, les philofophes même ne prennent pas
affez garde qu’ils parlent des êtres abftraits , comme
s’ils parloient des réels. C’eft ainfi qu’ ils parlent de
la matière , comme d’un individu particulier, auquel
ils donnent des propriétés réelles qu’elle n’a point
en tant qu’être abftrait. ( F )
CO ND ESCEN D AN CE, f. f. (Morale.) déférence
aux idées, aux fentimens, aux defirs, 6c aux volontés
d’autrui. Cette déférence peut-être louable ou
blâmable, une vertu ou un vice.
La condefeendance louable a fa fource dans la modération
, la douceur du caraélere, 6c l’envie d’obliger.
Elle eft pure, droite, également éloignée de la
baffeffe 6c de l’adulation, comme de la dureté 6c de
l ’efprit de contradiction. Elle fouffre dans la l'ociété
les vagues réflexions, les raifonnemens peu juftes,
6c le débit des beaux fentimens ; elle laiffe A ronce
parler proverbe, chaffe, & bonne chere ; Mélinde
parler d’ elle-même, de fon chat, de fon perroquet,
de fes vapeurs, de fes infomnies, de fes migraines.
Elle écoute patiemment de telles perfonnes fans les
goûter 6c fans leur rompre en vifiere.
La condefcendance blâmable applaudit à tout, 6c
lacrifie fans fcrupule ce qui eft honnête 6c vertueux
à fes feuls intérêts, à la baffeffe d’ame, & au defir
de plaire. Le caradere de celui qui veut mériter de
quelqu’un par fes adulations, rentre dans celui de
l’homme plein d’une condefcendance fans bornes. On
n’eft jamais plus flatté, plus ménagé, plus foigné,
plus approuvé de perfonne pendant la v ie , que de
celle qui croit gagner beaucoup à notre mort, 6c qui
defire qu’elle arrive promptement.
Celui qui fans honteufe condefcendance pour les
idées & les volontés des autres, loue la vertu pour
la vertu, blâme le vice comme v ic e , & fe conduit
ainfi fans affe&ation , fans politique, fans humeur,
& fan s efprit de contradi&ion, celui-là donne un
bon exemple 6c remplit un devoir.
C
Il n’eft pas néceffaire de reprendre tout ce qüi
peut être mal ; mais il eft néceffaire de ne déférer,
de ne condefctndre qu’à ce qui eft véritablement louab
le , autrement on jette dans l’ illufion ceux qu’on
loue fans fujet, & l’on fait tort à ceux qui méritent
de véritables louanges, en les rendant communes à
ceux qui n’ en méritent pas. L’on détruit toute la foi
du langage, en faifant que nos expreflions ne font
plus des lignes de nos penfées, mais feulement d’une
civilité extérieure, comme eft une révérence. Enfin
quand la fauffeté ne feroit que dans les paroles &
non dans l’efprit, cela fuffit pour en éloigner tous
ceu i qui aiment lincerement la vérité. (D . J . )
CO NST ITU AN T , lignifie aulîi quelquefois celui
qui a cédé la jouiffance d’une chofe à quelqu’un à
titre de conftitut ou précaire ; ce terme eft alors employé
par oppofition à celui de conrtituairè , qui lignine
Celui qui jouit à titre de éonftitut ou précaire»
On peut voir fur cette matière Daffet, t. I I . I. V.
tit. j . chàp. j . ou il rapporte un arrêt du parlement de
Grenoble du z6 Août 1 6 i y , qui a juge que le conf-
titut rend le conftituaire préférable à l’héritier du
cûnjlituant,. quoiqu’avec inventaire.
Conftituant lignifioit a,uffi chez les R oma ins celui
qui s’ obligeoit pa r forme de conftitut , fo it pour fa
dette perlonnelle Ou p our celle d’ autrui. Voy. C o ns -
titut.
Le cbnjlituant pouvoit s’obliger pour fa dette per-
fonnelle , ou pour la dette ou le fait d’autrui.
Dans ce dernier ca s, le conftitut avoit beaucoup
de rapport avec la fidéjulîion ou cautionnement, car
l’adion qui naiffoit au conftitut appellée actio de
conftitud , ou action de confiitutâ pecuniâ , étoit telle ,
qu’elle fervoit à pourfuivre tous ceux qui s’étoient
conftitués, foit pour e u x , foit pour autrui. Cette
adion étoit prétorienne , attendu que le conftitut
étoit en un p ade nud , qui fuivant le dfoit c iv il, ne
produifoit point d’adion.
Mais il y avoit cette différence entre la fidéjulîion
&C le conftitut, que la première n’a jamais pour objet
que de payer la -dette d’autrui, au lieu que le
conftitut pouvoit avoir lieu pour la dette perfonnelle
du conftituant, comme pour celle d’autrui. Le con-
fentement feul fuffilbit pour former le conftitut, &
l’on n’étoit point affujetti à s’y fervir d?une certaine
formule de parole , plutôt que d’une autre ; au lieu
que la fidéjulîion ne pouvoit fe contrader que par la
forme de liipulation proprement dite ; 6c pour former
un véritable conftitut, il fallait que l ’on n’eût
point ufé de ftipulation , 6c c’eft la raifon pour laquelle
il ne produifoit qu’une adion prétorienne ;
tellement que fi le conftituant eût promis à quelqu’un
qui uiât de ftipulation, alors le conftituant étoit
tenu jure c iy ili, 6c ce n’é toit plus un véritable conftitut.
Suivant l’ancien droit, le conftitut pouvoit avoir
deux caufes ; favoir , ce qui étoit dû , & ce qui ne
l’étoit pas. Ce conftitut fait pour ce qui eft d û , produifoit
l’ adion de conjiituto, au lieu que l’adion ré-
fultante du conftitut formé pour ce qui n’étoit pas
du , étoit appelle actio receptitia.
On ne pouvoit d’abord conftituer que pour les
chofes qui confiftoient en nombre , poids 6c me-
fure.
Par le nouveau droit, on fupprima toutes ces dif-
tindions, il fut permis de conftituer pour toutes fortes
de chofes dûes, foit par une obligation civ ile , ou
par une obligation naturelle , 6c l’adion de conjlitutdi
pecuniâ eut lieu indiftindement dans tous les cas ;
mais on ne pouvoit plus conftituer pro non debito ,
quand même la chofe auroit été dûe par quelque obligation
précédente ; il fuffifoit pourtant que la chofe
rut due au tems du conftitut, quand même elle auroit
cefle de l’être depuis , parce que Fâdion de conflitutâ
pecuniâ. .avoit un effet rétroactif.
D u refte s on pouvoit conftituer purement & Amplement
©uàterme , ou Tous condition ou autrement.
.
Le conftitut ne pouvoit pas être fait pour une fomr
mç plùs forte que celle qui étoit dûe | mais celui qui
fe çonftituoit pour autrui, pouvoit s’obliger de payer
la dette entieré ,- quoi qu’il n’ eût pas de fa part autant
de droit à.la chofe , & il étoit permis de.s’oblir-
ger pour une-moindre fommé que. celle , qui étoit
dûe.
Toutes perfonnes capables de s’obliger, pouvoient
conftitüèr , mêirié les femmes mariées ; 6c les pupilles
qui approchaient de la puberté poüvoient faire
un conftitut faiis autorifation de leur tuteur; on pourvoit
conftituer aü profit d’un antre que du créancier,
de mêrne qu’un autre que: le débiteur pouyoit conftituer.
Ainfi on ppiiypit conftituer au tuteur, curateur ^
au fonde de ;procuration , aii maître de l’efclave
mais on ne pouvoit conftituer qu’un autre payeroit
pour foi.
■ Quant à la formuledueônftitut par l’ancien droit,
elle étoit renfermée dans‘certaines bornes ; mais par
le nouveau-droit, elle ne fut foiiHïifè qu’à' la vôïonté
des parties ,-,defprte qu’on ne pouvoit conftituer entre,
abfeps commp entre préfèns/, par lettres ou par
rentremife d’uncpînmiflîpnnaire, 6c en toutes for-?
tes tde termes , loft par foi-même.où par autrui.
Il falloif cependant qu’il.:y çût quelques termes
qui engageaffent- le conftituant en tout ou partie j.
comme quapd il difoit i fàtisfaciam tib i, ou fatisfiet
tibi a me aut abillo , s’il difoit a me & ab illo; en ce cas
l’autre refufant d’acquitter toute la dette , le confti-
tuant t n étoit tenu pour fa part perfonnelle ,.mais
s ’il difoit fimplen^ent fatisfiet tibi fû n’étoit point cen-
fé s’obliger perfonnellement. :
Celui qui çonftituoit pquvojt le faire fans exprimer
h quantité, auquql cas cela étoit relatif à ce qui étoit
dû ; 6c s’il çonftituoit purement & Amplement, c’eft-
à -dire, fans aucun terme ni délai, on ne pouvoit cependant
pas exiger aufli-tôt de lui la fomme, on lui
accprdoit aû-mp;iris dix jours pour payer : çe qui rer
vient affez aux dix jours de grâce que l ’on donne
parmi nous à celui qui a accepté une lettre de change.
L’objet du conftitut étoit de la part du conftituant
.de libérer le débiteur, lequel néanmoins n’étoit point
déchargé envers le créancier, que la dette ne fut
payée. Si, le conftituant s’obligeoit pour lui-même ,
l’objet en ce cas étoit de rendre l’a&ion plus fure &
plus certaine.
. En exécution du conftitut qui étoit fait pour aut
ru i, il fallpit , avant que de pourfuivre le confli-
tuant, difeuter d’abord le principal obligé lorfqu’il
étoit p réfent, & en cas d’abfence, le conftituant pouyoit
obtenir du juge un délai pour l’avertir, à moins
que par le conftitut, il n’eût renoncé à cet avantage ;
oc fi plufieurs s’étoient fubftitués conjointement, ils
avoient, fuivant la lettre d’Adrien , les mêmes bénéfices
que les co-fidéjuffeurs 6c co-obligés, c’eft-à-
dire , le bénéfice de divifion, & celui appellé ceden-
darum actionum ; du refte , on pouvoit difeuter les
confiituans avant d’attaquer les tiers détenteurs.
L ’aétion qui naiffoit du conftitut, étoit une aftion
direéle , prétorienne & perfonnelle ; elle ne duroit
autrefois qu’un an , mais par le nouveau droit, elle
duroit trente ans , tant contre le c o n ftitu a n t que contre
fes héritiers.
Tels étoient les principes que l’on fuivoit par rapport
à cette forme finguliere d’obligation , quoique
toutes ces fubtilités ne foient point d’ufage parmi
nous , il étoit néanmoins néceffaire de les expliquer
pour l’intelligence des lois répandues dans le digefte,
dans le code & dans les novelles qui traitent de
^ette matière.
^ C O N S T I T U E R , fignifioit anciennement fe
contenir,;fuivant les lois, fuivant le premier précepte
du T>ro\t;honefte vivere, c ’eft ainfi qu’on doit l’enten-
dre dans-les anciens iifages d’Artois, qui ont été imprimés
en tête de la nôûvêllç édition dit commentaire
d»cette coutume ; c’eft dans le prologue, nombre
i ÿ .’oii'il eft dit que confliçuer fo i, eft le premier'
commandement des lois , qui dit que1 l’on vive hon-'
nêtementy'6'r.
CONST-ITUTAIRE , (‘ Jurifprud. ) eft célui qui
jouit à titre dé conftitut H e’ëft-à-dire qui n’a qu’une"
jouiffance précaire. ^ o^ G on st itu an t . ( J ) "-
CONSTITUTION dotale , ( Ju rifp rÙ :) ^ . la-
même chofe que conflitüiiôn dé dot. CONSTITUTION
dè-d'oi 6c D o t . 1 (A )
Constitutions dé Catalogne, font un corps de'
Droit formé pour ce pays f elles fonr compoféës dés'
anciens ûfagéS de'Catalogne,' dés lois accôrdeeS aux
Etats-Générauxfoit par les rbis d’E fpagne,' foit par
les princes particuliers que la Catalogne’ a eus pendant
un tems, 6c des pragmatiques que les foitvé-
rains de Catalogne avôiènt faites de leur,propre'‘mouvement
pour cette province ; le texte de désrc\friftï-
tutions eft;rédigé en eatëlah; Il y énf d. ëu deux'
compilations différentes, une première Faite en 1 5.85,
imprimée à Bareelonë en3 en / tçfé inffit.'ïn*
titulé',-- conflhutiàns y dlt/és-drets de Cathdiüngâ 'dbm-i
pilais en virtui del, cap/d'e 'edrt. xxiv. de lafcottspar
la S. Ci y rèyal mageflàt del rey don Phiiippffiotrfife-
nior celebrada en la ville-dé-Mdntfo any ï ‘586'VTautre
compilation faite en rfc/9 / aliffi imprimée â Barce-:
lone en 1603 -, vol. iri-foL petit format , eft'ifitîfûlêé I
conflitutions fieftes per las magefiat del rey don P/ielip
fegon, rey. de Cafiilla , de Arago, 6* en la' frimera
oort, celebrada dis cathàlans en là cinta de Barcelbna
en lo monaftit de S . Francefch en lo ahy /5c) 0 . ' Ceç'
canftibutianf. font auffi obfërvées dans le comté de
Roufîillon, où elles prit été introduites dans le tems
que cette'province faifoit1 partie de la Catalogne ;
cés lo is, ainfi-que le Droit romain, tant canonique
que c ivil, furent indiquées à cette province par Louis
X IV . après-qu’il l’eut réunie à la France , par les
art. 141J &4<3 , du traité Tait-aiix Pyrehéëâ; entre lès.
couronnes de France- & d’Efpàgne, le 7 Novembre-
1659. ( A ) - • . - Z . .
•CO N TRA T, f. m. ( Droit xnat. ) c’eft en général
toute convention faite entre deux ou plufieurs per-
fonnes ; ou confentéttient de deux ou de. plüfiéurs
perfonnes fur une même chofe, dans la vue d’exé-
ciiter leur convention; •'
On entend en particulier par contrat les accords
faits au fujet des chofes ou des a£Hons qui entrent en
commerce , lefquels par-conféquent fuppofent l’éta-
bliffement de la propriété 6c du prix des biens; 6c
l’on entend par fimple convention , les accords que
l’on fait fur tout le refte, quoique l’ufage donne indifféremment
à quelques-uns des derniers le nom
de contrat.
Les contrats peuvent être divifés en gratuits ou
bienfaifans, & onéreux ou intéreffés de part 6c d’autre.
Les premiers procurent quelques avantages purement
gratuits à l’un des contra&ans : les autres
affujettiffent chacun des contraâans à quelque charg
e , ou quelque condition également onéreufe qu’ils
s’impofent l’un à l’autre ; car alors on ne fait 6c l’on
ne donne rien que pour en recevoir autant^
On diftingue trois principales fortes de contrats
gratuits, favoir le mandement ou la commiflion, le
prêt à ufage, & le dépôt»
Il y a un grand nombre de contrats onéreux ou
intéreffés de part 6c d’autre. Les principaux qui font
aujourd’hui en ufage , font l’échange, le plus ancien
de tous, le contrat de vente, le contrat de louage , le
prêt à confomption, le contrat de fociété, & les con?