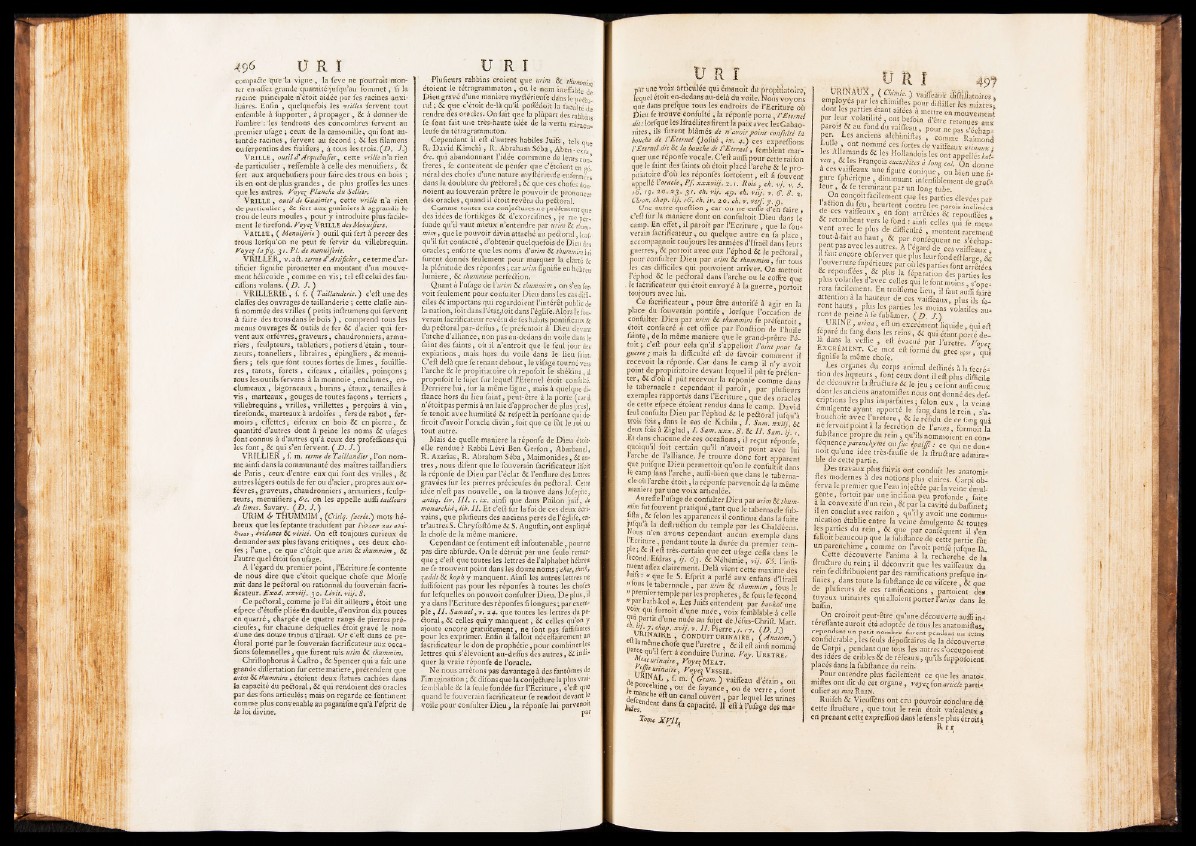
496 U R ï
compare ïjire la vign e, la feve ne p'ouîToit monter
en-affez grande quantité jufciu’au fommet, ‘fi la
racine •principale'n’étoit aidée par fes racines auxiliaires.
Enfin , quelquefois les vrilles fervent tout
ensemble à fupporter, à propager , & à donner de
Fombre: 'les tendrons des concombres fervent au
.premier ufage ; ceux de la camomille, qui font mitant
de racines, fervent au fécond ; & ie s filamens
©u ferpentins des fraifîers, à tous les trois. (JD. J !)
Vrille, outild*Arquehifier, cette vrille n’a rien
-de particulier , reffemble à celle des menuifiers, •&
fert aux arquebufiers pour faire des trous en bois ;
ils en ont déplus grandes, de plus groffes les unes
que les autres. V-oyti Planche du Sellier;
Vr il l e , outil de Guainier, cette 'vfille n’a rien
de particulier, & fert aux guainiers à' aggrandir le
trou de leurs moules , pour y introduite plus facilement
le tirefond. Voyei Vrille des Menuifiers.
VRILLEE, ( Menuiferie ) outil qui fert à percer des
trous lorfqu’on ne peut fe fervir du villebrequin.
Voye\ la-fig, 3 1 . PI. de menuiferie.
V R IL LE R , v .a ft . terme d Artificier, ce terme d’artificier
fignifie pirouetter en montant d’un mouvement
hélicoïde , comme en vis ; tel eft celui des fauchions
volans. ( D . J . )
V R IL LER IE , f, f. ( Taillanderie. ) c’eftunedes
claffes des ouvrages de taillanderie ; cette claffe ain-
fi nommée des vrilles ( petits inftrumens qui fervent
à faire des trous dans le bois ) , comprend tous les
menus ouvrages & outils de fer & d’acier qui fervent
aux orfèvres, graveurs, chaudronniers, armuriers
, fculpteurs, tabletiers, potiers d’étain , tourneurs,
tonneliers, libraires, épingliers , & menuifiers
; tels que font toutes fortes de limes, fouillie-
res , tarots, forets , c ifeaux, cifailles, poinçons;
tous les outils fervans à la monnoie , enclumes, en-
clumeaux , bigorneaux, burins, étaux, tenailles à
vis , marteaux, gouges de toutes façons , terriers ,
villebrequins, vr illes, vrillettes , perçoirs à v in ,
tirefonds, marteaux à ardoifes , fers de rab ot, fermoirs
, effettes, cifeaux en bois & en pierre, &
quantité d’autres dont à peine les noms & ufages
font connus à d’autres qu’à ceux des profefiions qui
les font, & qui s’en fervent. ( D . J . j
V R IL LIER , f. m. terme de Taillandier, l’on nomme
ainfi dans la communauté des maîtres taillandiers
•de Paris, ceux d’entre eux qui font des vrille s, &
autres légers outils de fer ou d’acier, propres aux orfèvres
, graveurs, chaudronniers , armuriers, fculpteurs,
menuifiers, &c. cfn les appelle auffitailleurs
.de limes. Savary. ( D . J . )
URIM £ THUMMIM , (Critiq. facrée.) mots hébreux
que les feptante traduifent par S'nXctnv xai ax»-
S uclv , évidence & vérité. On eft toujours curieux de
demander aux plus favans critiques, ces deux cho-
fes ; l’une , ce que c ’étoit que urim & thummim, &
l’autre quel étoit fon ufage.
A l ’égard du premier point,l’Ecriture fe contente
de nous dire que c’étoit quelque chofe que Moïfe
mit dans le peûoral ou rationnai du fouverain facri-,
ficateur. Exod. x xv iij. 30 . Lévit, viij. 8.
Ce peéforal, comme je l’ai dit ailleurs, étoit une
efpece d’étoffe pliéeün double, d’environ dix pouces
en quarré, chargée de quatre rangs de pierres pré-
©ieufes, fur chacune defquelles étoit gravé le nom
d’une des douze tribus d’Ifraël. Or c’eft dans ce perforai
porté par le fouverain facrifîcateur aux occasions
folemnelles , que furent mis urim & thummim.
Chriftophorus à Caftro, & Spencer qui a fait une
grande differtation fur cette matière, prétendent que
urim & thummim, étoient deux ftatues cachées dans
la capacité du pefforal, & qui rendoient des oracles
par des fons articulés; mais on regarde ce fentiment
comme plus convenable au paganifme qu’à l’efprit de
la loi divine.
U R I
nufietirs rabbins croient que 'urim S i 'ttittmu,}»
étoient le tétragrammaton , -oit le nom ineffable d
Dieu gravé d’une maniéré myftérienfe dtfns lë ne&0,
rai ; & que c’étoit de-là qu’il poffédoit la facilité de
rendre des oracles. On fait que la plupart des rabbins
fe font fait une très-haute idée de la vertu xniracu-*
leufe du tétragrammaton.
Cependant il eft d’autres habiles Ju ifs , tels qt,e
R. David Kimchi > R. Abraham Séba, Aben - ezra
&c. qui abandonnant l’idée commune de leurs confrères
, fe contentent de penfer que c’ étoient en général
des chofes d’une nature myftérieufe enfennces
dans.la doublure du petforal ; tk. que ces chofes don-
noient au fouverain prêtre le pouvoir de prononcer
des oracles, quand il étoit revêtu du pefforal.
Comme toutes ces conje&ures ne préferttent que
des idées de fortiléges & d’exorcifmes, je me per-
fuade qu’il vaut mieux n’entendre par urim & thum*
mim, que le pouvoir divin attaché au peéforal, lorfo
qu’il fut confacré, d’obtenir quelquefois de Dieu des
oracles; enforte que les noms d’urim & thummim lui
furent donnés feulement pour marquer la clarté &
la plénitude des réponfes ; car urim fignifie en hébreu
lumière, & thunimimperfection*
Quant à l ’ufage de Yurim & thummim, on s’en fer-
voit feulement pour confuïter Dieu dans les cas difficiles
& importans qui regardoient l’intérêt public de
la nation, foit dans l’état,ibit dans l’églife. Alors le fou»
verain facrifîcateur revêtu de fes habits pontificaux &
du peéforal par-defius, fe préfentoit à Dieu devant
l’arche d’alliance, non pas au-dedans du voile dans le
faint des faints, où il n’entroit que le feul jour des
expiations, mais hors du voile dans le lieu faint.
C’eft delà que fe tenant debout, le vifage tourné vers
l’arche & le propitiatoire où repofoit le shékina, il
propofoit le iùjet fur lequel l ’Eternel étoit confulté.
Derrière lu i, fur la même ligne, mais à.quelque di-
ftance hors du lieu faint, peut-être à la porté (car il
n’étoit pas permis à un laïc d’approcher de plus près),
fe tenoit avec humilité & refpeûla perfonne qui de*
firoit d’avoir l’oracle d ivin , loit que ce fut le roi ou
tout autre.
Mais de quelle maniéré la réponfe de D ieu étpit*
elle rendue ? Rabbi Lévi Ben Gerfon, Abarbanel,
R. Azarias, R. Abraham Séba, Maimonides, & autres
, nous difent que le fouverain facrifîcateur lifoil
la réponfe de Dieu par l’éclat & l’enflure des lettres
gravées fur les pierres précieufes du peâoral. Cette
idée n’eft pas nouvelle, on la trouve dans Jofephe,
antiq. liv. I I I . c. ix. ainfi que dans PHilon juif, dt
monarchiâ, lib. I I . Et c’eft fur la foi de ces deux écrivains
, que plufieurs des anciens peres de l’églife, en-
tr’autres S. Chryfoftôme & S. Auguftin, ont expliqué
la chofe de la même maniéré.
Cependant ce fentiment eft infoutenable, pouf ne
pas dire abfurde. On le détruit par une feule- remarque
; c’eft que toutes les lettres de l’alphabet hébreu
ne fe trouvent point dans les douze noms ; cket, theth,
[addt &c koph y manquent. Ainfi les autres lettres ne
fuflifoient pas pour les réponfes à toutes les chofeS
fur lefquelles on pOuvoit confuïter Dieu. D e plus, il
y a dans l’Ecriture des réponfes fi longues ; par exemple
, I I . Samuel, v. 24. que toutes les lettres du pe-
éforal, & celles qui y manquent, &c celles qu’on y
ajoute encore gratuitement, ne font pas fuffifantes
pour les exprimer. Enfin il falloit néceflairement au
facrifîcateur le don de prophétie, pour combiner les
lettres qui s’élevoient au-deflùs des autres, & indiquer
la vraie réponfe de l’oracle.
Ne nous arrêtons pas davantage à des fantômes de
l’imagination ; & difons que la conjecture la plus vrai-
femblable & la feule fondée fur l’Ecriture, c’eft qi,e
quand le fouverain facrifîcateur fe rendoit devant le
-voile pour confuïter D ieu , la réponfe lui parvenoit
par
U R ï
par ünè Voix articulée qui értianoit <îü propitiatoire'
lequel étoit en-dedans au-delà du voile» Nous voyons
que dans preftque tous les endroits de l’Ecriture où
Pieu fe trouve Confulté , la réponfe porte ,VEternel
dit: lorfque les IlrâéÜtes firent la paix avec les Gabao-
jnites, ÜS furent blâmés de n ’avoir point confulté là
bouche de VEternel ( jo fu é , ix . 4.) ces expreffionS
VEternel dit & la bouche de VEternel, femblent marquer
une réponfe vocale. C’eft auffi pour cette raifon
que le faint des faints où étoit placé l’arche & le propitiatoire
d’où les réponfes fortoient, eft fi fouvent
appellé Y oracle, Pf. x xx v iij. 'È 1. R o is , ch. v/\ v. S.
tS. rp. 2 0 .2 3 . 3 t. ch. vij. 4c). eh, viij. v. S. S-. 2»
Citron, chap. iij, iG. ck, iv, 2 0 . ch, v. vérf. y . t).
Une autre queftion , car on ne ceffe d’en faire ,
c’eft fur la maniéré dont on confultoit Dieu dans le
camp. En effet, il paroît par l’Ecriture , que le fouverain
facrifîcateur > ou quelque autre en fa place,
accompagnoit toujours les armées d’Ifraël dans leurs
guerres * & portoit avec eux l’éphod & le peétoral,
pour confuïter Dieu par urim & thummim, fur tous
les cas difficiles qui pouvoient arriver. On mettoit
l’éphod & le peétoral dans l’arche ou le coffre que
. le facrifîcateur qui étoit envoyé à la guerre > portoit
toujours avec liiL
Ce facrifîcateur, pour être autorifé à agir en ia
place du fouverain pontife, lorfque l’occafion de
confuïter Dieu par urim & thummim fe préfentoit
étoit confacré à cet office par l’onétion de l’huile
fainte, de la même maniéré que le grand-prêtre l’é-
toit ; c’eft pour cela qu’il s’appelloit Point pour la
guerre ; mais la difficulté eft de faVoir comment il
recevoit la réponfe. Car dans le camp il n’y a voit
point de propitiatoire devant lequel il pût fe préfen-
ter, & d’où il pût recevoir la réponfe comme dans
lè tabernacle : cependant il paroît, par plufieurs
exemples rapportés dans l’Ecriture, que des Oracles
de cette efpece étoient rendus dans le camp» David
feul confulta D ieu par l’éphod & le peétoral jufqu’à
trois fo is, dans le cas de Kehila , I . Sam. x xiij &
deux fois à Ziglad, I . Sam. x x x . 8. & I L Sam. ij.
•Et dans chacune de ces occafions, il reçut réponfe '
quoiqu’il foit certain qu’il n’avoit point avec lui
l’arche de ralliance. Je trouve donc fort apparent
que puifque Dieu permettoit qu’on le confultât dans
îê camp fans l’arche, auffi-bien que dans le taberna^
cle où l’arche étoit, la réponfe parvenoit de la même
maniéré par une vo ix articulée»
Au refle l’ufage de confuïter Dieu par Urim Uthum- mm B B Pratiqu<Mant que le tabernacle fub-
Itlta, & félon les apparences il continua dans la fuite
jMquà la deftraflion du temple par les Chaldéens,
Nous n’en avons cependant aucun exemple dans
‘ tenture, pendant toute la durée du premier tem-
■ , ' I e? très-“ rt»in que cet ufage ceffa dans le
tecotld, Eldras , ij. 6 3 . & Néhémie, vij. CS. l'inft-
nuent allez clairement, Delà vient cette maxime des
Juifs: « que le S, Ëfprit a parlé aux enfans d’ifrael
"lotis le tabernacle , par Urim thummim , fous le
» ptemier temple par fes prophètes, & fpus le fécond
iparbath-kol», Les Juifs entendent par bat^kol une
voix qui fortoit d’une nuée , Voix femblable à celle
qui partit d’une nuée au fuiet de Jéfus-Chrift. Matt,
‘B B j f l H ! H v- 11- Pierre (D . j \
URINà IRe , c o n d u it u r in a ib é , ( A n jo u ,.)
en ta même chofe que l’uretre , & il eft ainfi nommé
P | | qu u fert à conduire l’urine. Voy. Ur e t r e ,
bina ire , Voye{ Mé a t .
■ M K Vessie.
depore.A1- ’ ■ “ / 1 lram‘ ) vàifléàu d^tain , oit
fe màiirE ainn ’ ° ” de, fay altei > 0“ v e r re ; dont
defcenU j Un Sana^ ouvert, par lequel les urines
hdes. ent ^anS caPat^ ‘ U eft à l’ufage des ma-
tomt X r ü %
tî R I 49^
ÜRiNÀÜX , ( ÛiiŸnU. ) vaifleaiix diftîilatoirèS ,
employés par les ch.mtftes pour diftifter les mixtes,
don les par tes étant aifées à mettre en mouvement
par leur volatilité, ont bëfoin d’être retenues aux
paroiS & au fond du vaiflëaü , pour ne pas s’échap-
Dd'fe ^-es anciens alchimiftes | l01]lnj ; R aimo^
r Ali’ H B B fortes de vaiffisauit urinnux ;
les Allemands & les Hollandois les ont appellés kt>â
T J FranÎO« d long col. ^ donné
à ces vaiffeaux une figure Honlque, ou bien une fi.
gure Iphertque * diminuant infenfiblement de eraA
leur , & fe terminant p.ar un long tube 6
On conçoit facilement que fes parties élevées paf
1 afltort du feu j heurtent contre les parois inclinées
de ces vaiffeaux, en font arrêtées & repouffées ,
& retombent Vers le fond : ainfi celles qui fe meu*
vent avec le plus de difficulté . .montent rarement
tout-à-fait au haut, & par.^nféquent ne s’échani
peut pas avec les autres, A l’égard de des vaiffeaux ,
il faut encore ohfervet que plus leurfond éft large &
louverture fupeneprç par oit fes parties font arrêtées
& repouflees, & plus la feparation des parties les
plus volatiles d avec celles qui 1e font moins ; s’ope,
fera factlement, Eli troifieme lied, il faut aiiffi faifê
attention à la hauteur de ces vaiffeaux j plus ils fe-*
root hauts j plus les parties les moins volatiles au.
font de peiné à'fe fublimer. ( D . J . )
URINE , urind, eft un excrément liquidé, qui eft
fepare du fang dans léç-reins , & qui étant porté delà
dans la veffie , eft évacué par l ’uretre. Fayer
E x c r ém e n t , Ce mot éft formé du grec s««, > qtft
lignihe la meme chofe, n
, Les. organes du corps animal deftinés à la fecrc.
tien des liqueurs ; font; ceux dont il eft plus difficile
de découvrir laftmaure & le jeu ; cefont aufficeux
dont les anciens anatomiftes nous ont donné des defe
c t io n s les plus imparfaites ; felon eux * la veiné
emulgenté ayant apporté le fang dans le rein » s’a-
bouchoit avec l’ uretere, & le réfidii de ce fang qui
nefervoitpoidtàlafecrétiOn de Yitrini, formoit la
liibftance propre du rein » qu’ils nommoient en con-
lequenc zpartnchymi où fu t éf ai(jt ! ce qui ne don»
noit qu une idee très-fauffe de la ftruSure admira,
ble dé cette partie.
Des travaux plus füivis Ont conduit lés anatomiftes
modernes à des notions plus claires. Carpi ob-
ferva le premier que l ’eau inje&ée par la veiiie émüh
gente, fortoit par une ineifion peu profonde , faite
à la convexité d’un rein, & par la Cavité dubaffmet;
il en conclut avec raifon j qu’il y a voit une commua
nication établie entre la veiné émulgente & toutes
les parties du re in, & que par conféquent il s’en
falloit beaucoup que la fiibftance de cette partie fût
un parenchime , comme on l’avoit penfé jufque là»
^ Cette découverte l’anima à la recherche de laî
ftruélure du rein; il découvrit que les vaiffeaüx du
rein fe diftribuoient par des ramifications prefque in->
finies , dans toute la fubftance de ce vifeere, & que
de plufieurs de ces ramifications , paftoient des
tuyaux urinaires qui alloient porter l’urine dans lé
baffin.
^ On croiroit peut-être' qu’une découverte au/Û in-«
tereffante auroit été adoptée dè tous les anatomiftes*
cependant un petit nombre furent pendant un feras
confidérable, les feuls dépofitâires de la découverte
de C a rp i, pendant que tous les autres s’occupoîeut
des idées de cribles & de réfeaux-, qu’ils fuppoibienÉ,
placés dans la fubftance du rein.
Pour entendre plus faciléfrient ce que les ânatoi
miftes ont dit de cet organe, voye^ fon article parti-«
culier au mot Rein.
Ruifch & Vieunêns ônt cru pouvoir conçluré d è
cette ftruâure , que tout le rein étoit vafculëitx $
eii prenant eette expreffion danS'Ie fenslé pïits' efrffil j
R t ft