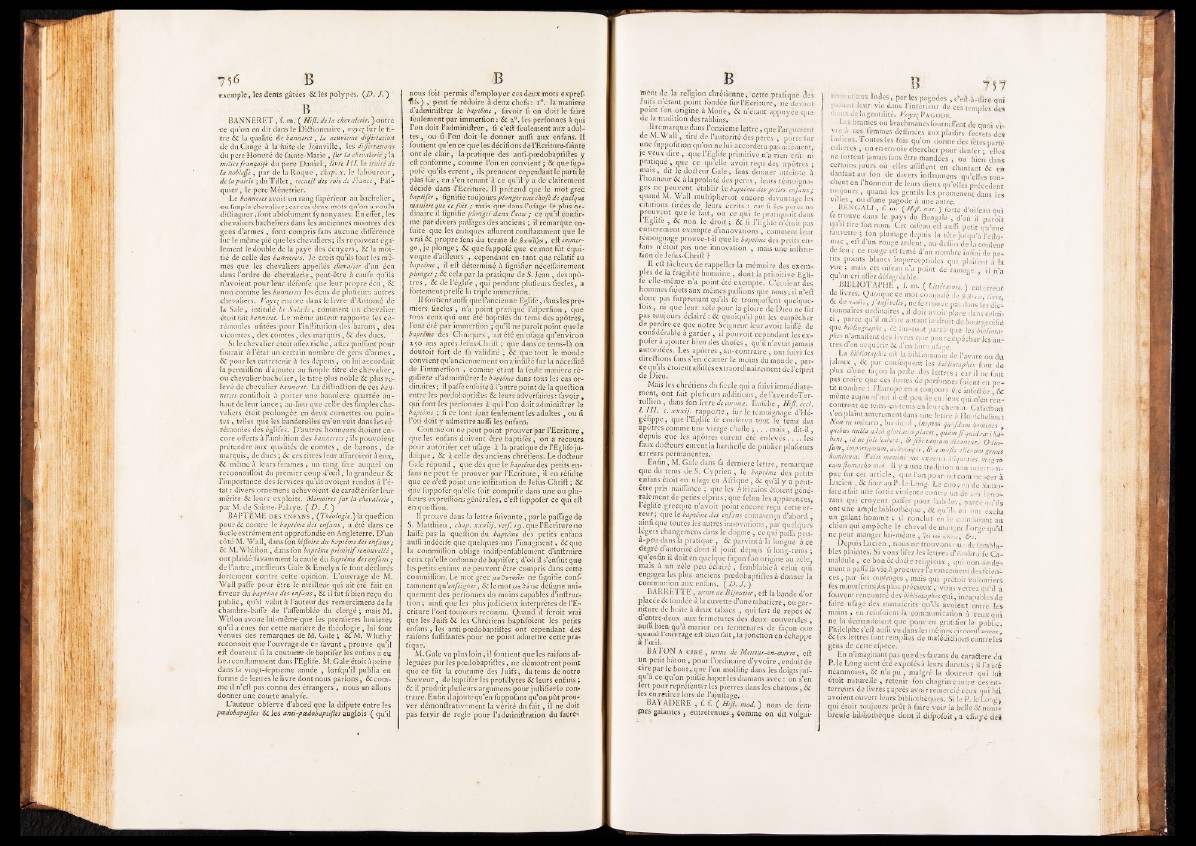
exemple, les dents gâtées & lés polypes. (JD. RH
B
BANNERET , t m. ( Hifl. de la chevalerie-. ) outré
c e qu’on en dit dans le DiÔionnaire, voye^ fur le titre
6c la qualité de banneret, la neuvième dij/crtatio'n
■ de du Cange à la fuite de Joinville, les differtations
du pere Honoré de fainte-Marie ,fu r la chevaleriéj'là
milice françoife du pere Daniel, livre I I I . lé tfhitéde
la nobleffe , par de la Roque , chap. x. le laboureur,
de la pairie ; duTille t, recueil des rois de France, Pàf-
qu ier, le pere Ménetrier.
Le banneret avoit un rang fupérieur au bachelier,
ou fimple chevalier ; car ces deux mots qu’on a voulu
diftingueryfont abfolument fynonymes. En effet, les
chevaliers bacheliers dans les anciennes montres des
gens d’armes font compris fans aucune différence
lur le même pié que les chevaliers ; ils reçoivent également
le double de la paye dès écuyers, & la moitié
de celle des bannerets. Je crois qu’ils font les mêmes
que les chevaliers appelles 'chevalier d’un écu
dans l’ordre de chevalerie, peut-être à caufe qu’ils
n’avoient pour leur défenfe'que leur propre écu , &!
non comme les bannerets les ccus;de plufiéurs autres
chevaliers. F'oye^ encore dans le livre d’Antomé de
la Sa le , intitulé là Salade, comment un chevalier
étoit fait banneret. Le même aütéiir rapporte les cérémonies
ufitées pour l’ infti union des baroris, des
vicomtes, des comtes, des marqü'is, & des ducs. '
Si le chevalier étoit affez riche, a fiez puiffant pouf
fournir à l’état un certain nombre de gens d’armes ,
& pour les entretenir à les dépens, oh lui accordoit
la permiflion d’ajouter au limple titre de che'valier,
ou chevalier bachelier, le titre plus noble & plus relevé
de chevalier banneret. La diftinftion de ces ban-
nercts coniifloit à porter une bannière quarréè <(ti-
haut de leur lance ; au-lieiv que celle des nmples chevaliers
étoit prolongée en deux cornettes’ou pointes
, telles que les banderolles qu’ on voit dans les cérémonies
des églifes. D’autres honneurs étoiétit encore
offerts à l’ambition des bannerets ; ils pouvoiént
prétendre aux qualités de comtes,, de barons, de
marquis, de ducs ; & ces titres leur affuroient à eux,
& même à leurs femmes , un rang fixe auquel on
reconnoiffoit du premier coup d’oe il, la grandeur &
l’importance des fervices qu’ ils avoient rendus à l’état
: divers ornemens achevoient de caraftérifer leur
mérite & leurs' exploits. Mémoires fu r la chevalerie ,
par M. de Sainte- Palaye. ( D . J . )
BAPTÊME des en fa n s , (Théologie.) la queftion
pour & contre le baptême des enfans, a été dans ce
fiecle extrêmement approfondie eh Angleterre. D ’un
côté M. Wall, dans fon hifloire du baptême des enfans ;
5c M. Whifton , dans fon baptême primitif renouvellé,
ont plaidé favamment la caufe du baptême des enfans ;
de l’autre , meilleurs Gale &Emelyn fe font déclarés
fortement contre cette opinion. L ’ouvrage de M.
"Wall paffe pour être le meilleur qui ait été fait en
faveur du baptême des enfans, & il fut fi bien re.çu du
public, qu’il valut à l ’auteur des remercimensdela
chambre-balfe de l’alfemblée du clergé ; mais M.
Wifton avoue lui-même que les premières lumières
qu’il a eues fur cette matière de théologie , lui font
venues des remarques de M. Gale ; & M, Whitby
rcconnoit que l’ouvrage de ce favant, prouve qu’ il
eft douteux fi la coutume de baptifer les enfans a eu
heu conftamment dans l’Eglife. M. Gale étoit à peine
dans fa vingt-feptieme année , lorfqu’il publia en
forme de lettres le livre dont nous parlons, & comme
il n’eft pas connu des étrangers , nous an allons
donner une courte analyfe.
L’auteur obferve "d’abord que la difpute entre les
pcedobaptijles ÔC les anti-pcedobaptijles anglois ( qu’il
nous foit permis d’employer ces deux mots expréf-
l ê ' l ,' peut fe réduire à deux chefs : i°;- la maniéré
d’adminiftrer le baptême ,■ favoir fi on doit le fairé
feulement par immerfion : & z°. les perfonnes à qui
l’on doit Padminiftrer', fi c’ëft feulement aux adul-î
te s , ' ou'fi Ton doit le donner aufîi aux èhfahs. Il
fouîient qu’en ce que les décifiônsdè l’Ecritlire-fainte
ont de clair, la pratique des anti-poedobaptiftes y
eft conforme, comme l’on en convient ; & qûefupi
pofé qu’ils errent, ils prennent cependant le parti lé
plus’ fu r , en s’en tenantà ce qu’il y a de clairement
décidé dans l’Ecriture. Il prétend que'le mot grec
baptifer, lignifie toujours plonger une ckofe de quelque
maniereque ce foit ; mdis que dans l’ufâge l e plus ordinaire
il plonger dans l'eau ; ce qU’il confirme
par divers paflagès dés anciens ; il remarque en-
fuite que les critiques affurent conftamment'que le
vrai &c propre fçns du terme de fix.'dlfèui, eft immer-
go , je plonge ; & quç fuppofé, que ce,mot fut équivoque
d’ailleurs,, cependant en tant que rélatif au
baptême , il eft: déterminé, à lignifier neceffairement
plonger ; •& cela par la pratique de S. Je a n , des apôtres
, &c de I’ég life , qui pendant plufiéurs fiecles., a
fortement preffé la triple immerfion.
Il foutientauflï que l’ancienne Eglife , dans les premiers
fiecles , n’a point pratiqué l’afperfion, que
tous ceux qui ont été bâpnfés au tems des apôtres,
l’ont été par immerfion ; qu’il 'ne paroît point que le
baptême des •Cliniques , ait été en üfage qu’ environ
15 0 ans après Jefus-Chrift ;■ que dans ce tems-là on
doutoit fort de fâ Validité', &C 'que tout le monde
convient qu’anciennément on a ihlifté fur la néceffifé
de l’immerfion , comme étant la feule manière régulière1
d’adrniniftrèr \e baptême dans tous les cas ordinaires;
il paffe enfiiiteàu autre point de la queftion
entre lés poédobaptiftes & leurs adverfaifes : favoir ,
qui font les perfonnes à qui Ton doit adminiftrer le
baptême ; fi ce font font feulement les adultes , ou fi
l’on doit y admettre aufîi les enfans.
Comme on ne peut point prouver par l’E criture,
que les enfans doivent être baptifés , on a recours,
pour aiitprifer !cet ufage à la pratique de l’Eglife judaïque
, & à celle des anciens chrétiens. Le dofteur
Gale réporid , que dès que le baptême des petits enfans
ne peut fe prouver par l’Ecriture, il en réfulte
que ce n’eft point une inftitutidn de Jefus-Chrift: ; &
que fuppofer qu’elle foit cômprife dans une ou plu-
fieurs exprefllons générales, c’èftfuppofer ce qui eft:
en queftion.
II prouve dans la lettre fuivante, parle paflage dé
S. Matthieu , chap. xxv iij. verf. ig . que l’Ecriture 11e
lai fie pas la queftion du baptême des petits enfans
aufîi indécife que quelques-uns l’imaginent, & q u e
la commiflion oblige indilpenfablement d’inftruire
ceux qu’elle ordonne de baptifer ; d’oii il s’enfuit que
les petits enfans ne peuvent être compris dans cette
commiflion. Le mot grec ne lignifie confi
tara ment qu’enfdgner, & le mot ^aS-araç défigne uniquement
des perfonnes du moins capables d’inftruc-
tion ; ainfi que les plus judicieux interprètes de l’Ecriture
l’ont toujours reconnu. Quand il feroit vrai
que les Juifs & les Chrétiens baptifoient les petits
enfans, les anti-poedobaptiftes ont cependant des
raifons fuffifantës pour ne point admettre cette pratique.
M. Gale va plus loin, il foutient que les raifons alléguées
par les pcedobaptiftes, ne démontrent point
que ce fût la coutume des Ju ifs , dutems de notre
Sauveur, de baptifer les profélytes & leurs enfans ;
&: il produit plufiéurs argumens pour juftifïerle contraire.
Enfin il ajouté qu’en fuppofant qu’on pût prouver
démonftrativement la vérité du f a it , il ne doit
pas fervir de réglé pour Tadminiftration du façte^
imènt cîe la religion èhrêtieniie, cette pratiqué <Jes \
Juifs n étant point fondée fur l’Ecriture, ne devant J
point fon origine à Moïfe* & n’étant appuyée que I
de la tradition des rabbins»
II remarque dans l’onzieme lettre > que l’argument I
de M. W a ll, tiré de l’autorité cjles peres , porte liir
une fuppofition qu’on ne lui accordera pas aifément,
je veux dire , que l’Eglife primitive n’a rien crû ni
pratiqué , que ce qu’elle avoit reçu des apôtres ;
mais, dit le doûeur Gale» fans donner atteinte à
l’honneur &c à la probité des peres, leurs témoignages
ne peuvent établir le baptême des petits enfans ;
quand M. Wall multiplieroit encore davantage les
citations tirées de leurs écrits : car fi les peres ne
prouvent que le fa it, ou ce qui fe pratiquoit dans
l Eglife , &c non le droit ; &c fi l’Eglife n’étoit pas
entièrement exempte d’innovations , comment leur
témoignage prouve-t-il que le baptême des petits enfans
n’étoit pas une innovation , mais une inftitu*
tion de Jefus-Chrift ?
Il eft fâcheux de rappeller îa mémoire des exemples
de la fragilité humaine , dont la primitive Eglife
elle-même n’a point été exempte. C’étoient des
hommesfujetsaux mêmes pallions que nous; il n’eft
donc pas furprenant qu’ils fe trompaflent quelquefois
» ni que leur zèle pour la gloire de Dieu ne fut
pas toujours éclairé : & quoiqu’il pût les empêcher
de perdre ce que notre Seigneur leur avoit laiffé de
confidérable à garder , il pouvoit cependant les ex-
pofer à ajouter bien des chofes , qu’il n’avoit jamais
autorifées. Les apôtres , an-contraire » ont fuivi fes
directions fans s’en.ecarter le moins du monde, parce
qu’ ils étoient afliftés extraordinairement de l’efprit
de Dieu»
Mais les chrétiens du fiecle qui a fuivi immédiate^
ment, ont fait plufiéurs additions, de l’aveu deTer-
tullien , dans fon livre de coroim. Eufèbe , Hiß. eccl,
l . I I l . c. x xx ij. rapporte, fur le témoignage d’Hé-
gefippé, que l’Eglife fe Coriferva tout le tems des
apôtres comme une vierge chafte ; » .. mais, dit-il,
depuis que les apôtres eurent été enlevés. . . . les
faux doCteurs eurent la hardiefle de publier plufiéurs
erreurs permanentes.
Enfin, M.Gale dans fa derniere lettre, remarque
que du tems de S. Cyprien , le baptême des petits
enfans étoit en ufage en Afrique , &c qu’il y a peut-
être pris naiflanee ; que les Africains étoient généralement
de petits efprits ; que félon les apparences,
•l’églife grecque n’avoit point encore reçu cette erreur;
que lé baptême des enfans commença d^abord ,
ainfi que toutes les autres innovations, par quelques |
légers changemëns dans le dogme , ce qui pafla peu- i
à-peu dans la pratique , & parvint à la longue à ce
degré d’autorité dont il jouit depuis fi long-tems';
qu’enfin il doit en quelque façon fon origine au zèle,
mais à uti zèle peu éclairé , femblable à celui qui
engagea les plus anciens poedobaptiftes à donner la :
communion aux enfans. ( D . J . ) •
B A R R E T T E , terme de Bijoutier, eft la bande d’or
placée & fondée à la cuvette d’une tabatière, ou garniture
de boîte à deux tabacs , qui fert de repos &C )
d’entre-deux aux fermetures des deux* couvercles ,
aufli bien qu’à marier ces fermetures de façon que i
quand l’ouvrage eft bien fait, la jondion en échappe '
à l’oeil.
BATON A c ir é , terme de Metteür-en-oeuvre, eft
un petit bâton ; pour l’ordinaire d’y vo ire , enduit de
cire parle bout, que l’on mollifig dans les doigts juf-
qu’à ce qu’on puifle haper les diamans avec : on s’en ,
fert pour repréfenter les pierres dans les chatons , & i
les en retirer lors de Tâjuftage.
B A YADERE , fi fi ( H ß . -tfiod. ) nom de fern- .
jnes galantes , entretenues , Comme on dit Vulgai*
ment aux W e S » par les pagodes , cVfU-dlrë qui
panent leur vie dans l’intérieur de ces temples des
(lieux deJagentihte. I^oye^ Pa gode.
Los brames ou brachmancsfournifleht de quoi vr-
v r e à ces femmes deffinées auxplaififs fecrets des
indiens, Toutes les fois qu’on donne dès fêtés particulières
, on en envoie chercher pour danfer ; elles
ne lortent jamais fans être mandées > Ou bien dans
certains jours où elles aflïftent en chantant & eft
danfant au fon de divers inftrumens qu’elles toii*
chent en l’honneur de leurs dieux qu’elles précèdent
toujours, quand lés gentils les promènent dans les
v ille s , ou d’une pagode à une autre,
B EN G A L I, û m, {Hiß. me. ) forte d’oifeaü qui
le trouve dans le pays du Bengale , d’où il paroît
qtul tire ion nom. Get oifeau eft a u ® petit qü’uné
fauvette ; fon plumage depuis la tête jufqu’à l’efto*
mac j eft d’un rouge ardent, au-deffus de la eoùleüf
de feu ; ce rouge eft iemé d’un nombre infini de peints
points blancs imperceptibles qui plaifent à ià
vue ; mais cet oifeau n’a point de ramage il n’i
qu’un cri allezdéfagréable.
BIELIOTAPHE , f, m, ( Littérature. ) enterretif
de livres. Quoique ce mot compofé de livre,
lit de rai?», j ’tnfeydis, ne fe trouve pas dans lès die’
ttonnatres ordinaires, il doit avoirplace dans celui.
Cl, parce qu’il mérite autant le droit de bourgeoifiè
que bibliographe, & lur-tout parce que les bMioitu-
phes n’amaffent des livres que pourempêcher les au»
très d en acquérir &c d’en faire ufage.
I La MUi»upkit eft la bibliomanie de l’aVârê ôu dit
jaloux , & par conféquent les bibliotaphes îo nf de
plus d’une façon la pelle des lettres ; car il ne faut
pas croire que ces fortes de perfonnes foient en p e .
tit nombre : l’Europe en a toujours cié infedlée &
même aujourd’hui il eft peu de curieux qiti n’èn fen»
contrent de teins-en-tems en leur chemin. Gafàuboii
s’en plaint amerement dans une lettre à Hoefcheliusi
Non tu imitaris, lui dit-ib, iüeptos tjuoßam hommes ~
quibus nulle adeo gloriatio platei , quiwiß quid ran ha-
bent , id ut fo li habere , &ß b i tcmturridic'aniur. Odio-
fum importùmum, , * a mufis ulictm'mgtmi
homlnum, Taies menùni me exoeriri àliquoties mn<rnO
cumftoriiacho theo. Il y a une tradition non interrompue
fur cet article, que l’on pourro:tcom nencer à
Lucien , & finir au P. le Long. Le citoyen de Samo-*
fate a fait une fortie violente ecfntre un de ces iano-
rans qui croyent paffer pour habiles, parce qu’ils
ont une ample bibliothèque , & qu’ils en ont exclu
un galant homme ; il conclut en le'comparant au
chien qui empêche le cheval de manger lor« e qu’il
ne peut manger lui-même , %i vov °
Depuis Lucien , nous ne trouvons q iu de femhla-
bles plaintes. Si vous lifez les lettres d’Ambroife Ca-
maldule, ce bon & dofte religieux, qui lïôn-fëiile-
ment a pafle fa vie^à procurer l’avancement des feien*-
ces , par fes qu/rages , mais qui prétoit volontiers
fes manuferitsj jLs plus précieux vous verrez qu’il â
fouvent rencontré des bibliotaphes qui, incapables dô
faire ufage des manuferits qu’ils avoient entre -les
mains , en refufoient la communication à ceux qui
ne là dëmandoient que pour en gratifier le public»
Philelphe s’eft aufii vu dans les mêmes cirêonftances*
& fe s lettres font remplies de malédi&ions contre les
gens de cette efpece.
En n’imaginant pas quedesfavans du cara&ere dit
P. le Long aient été expofésà leurs duretés ; il l’a été
néanmoins, & n’a pu , malgré la douceur qui" liii
étoit naturelle , retenir fon chagrin contre ees eii-
terreurs de livres ; après avoir remercié ceux qui lui
avoient ou vert leurs bibliothèques. Si le P. le Long*
qui étoit toujours prêt à faire voir la belle & nom*
breufe bibliothèque dont il difpofoit, a eftuyé dèâ