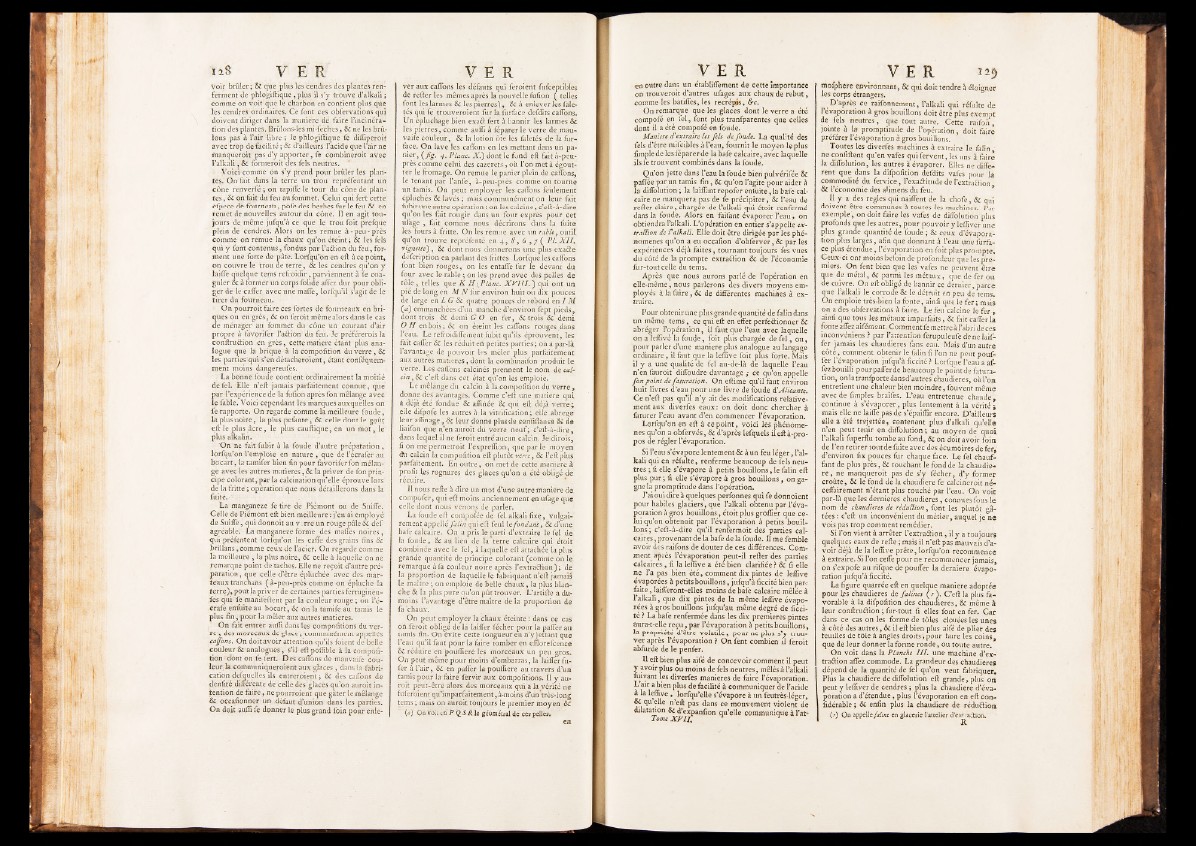
Voir brûler; & que plus les cendres des plantes renferment
de phl'o'giftique , plus il s’y trouve d’ alkali ;
comme on voit1 que le charbon en contient plus que
les cendres ordinaires. Ce font ces obfervations qui
doivent diriger dans la maniéré dé faire l’incinefa-
tion des plantes. Brûlons-les mi-feches, 8c ne les brûlons
pas à l’air libre ; le phlogiftique fe diffipexoit
avec trop de facilité ; 8c d’ailleurs l’acide que l’air ne
ùianqueroit pas d’y apporter, fe combineroit avec
l’a lk a li, & formeroit des Tels neutres. *
Voici comme ôn s’y prend pouf brûlér lès plantés.
On'fait dans la terré un trou repréfentant un
cône renverfé ; on tapiffe le tour du cône de plantes
, & on fait du feu au fommet. Celui qui fert cette
éfpece de fourneau, pôfe des herbes fur le feu 8c en
remet de nouvelles autour du cône. Il en agit toujours
de même jufqu’à ce que le trou foit prefque
plein de cendrési Alors on les remue à-p eu-p rè s
Comme on remue la chaux qu’on éteint ; & les fels
qui y font contenus, fondus par l’aftion du feu, forment
une forte de pâte. Lorfqu’on en eft à ce point,
on couvre le trou de terre, & les cendres qu’on y
taiffe quelque tems refroidir, parviennent à fe coaguler
8c à former un corps folide allez dur pour obliger
dé lé caffer avec une maffe, lorfqu’il s’agit de le
tirer du fourneau.
- On pourroit faire Ces fortes de fourneaux ért briques
ou en grès, 8c on feroit même alors dans le cas
de ménager- au fommet du cône un courant d’air
propre à favorifer faction du feu. J e préférerois la
conftruétion en grès, cette matière étant plus analogue
que la brique à la compofition du v e r re , &
les parties qui s’en détacheroient, étant conféquem-
ment moins dangereufes.
La bonné;foude contient ordinairement la moitié
de fel. Elle n’eft jamais parfaitement connue, que
par l’expérience de la fufion après fon mélange avec
le fable. Voici cependant les marques auxquelles on
fe rapporte. On regarde comme la meilleure foude,
la plus noire, la plus pefante celle dont le goût
eft le plus â cre , le plus cauftique, en un mot, le
plus alkalin.
On ne faitfubir à la foude d’autre préparation,
lorfqu’on l’emploie en nature, que de l’écrafer au
bôcart', la tamifer bien fin pour favorifer fon mélange
avec lés autres matières, & la priver de fon principe
colorant, par la calcination qu’elle éprouve lors
de la fritte ; opération que nous déraillerons dans la
fuite. •
La manganeze fe tire de Piémont ou de Suifle.
Celle de Piémont eft bien meilleure : j’en ai employé
de Suifle, qui donnoit au v .rréun rouge pâle & def
agréable. La manganeze forme des maffes noires,
qui préfentent -lorfqu’on les cafte des grains fins 8c
brillans, comme ceux de l’acier. On regarde comme
la meilleure , la plus noire, & celle à laquelle on ne
remarqué point de taches. Elle ne reçoit d’autre pré*
jjàration , quë celle d’être épluchéé avec des marteaux
tranchahs ( à-peu-près comme oh épluche la
terre), pour la priver de certaines parties ferrugineuses
qui Te manifeftent par la couleur rouge; on l’é-
Crafe enfuite au bocart , & on la tamife au tamis le
plus fin, pour la mêler aux autres matières.
On fait entrer aufli dans les compofitions du verre
, des morceaux déglacé * communément appellés
caffons. On doitavoir attention qu’ils foient de belle
couleur & analogues, s’il eft poflibie à la compôfi-
tion d’ont on fe-lert. O es caffons de mauvaife couleur
la cqmmuniqueroiént aux glaces, dans, la-fabrication
defquelles ils entreroient ; 8c des caffons de
denfité différente de celle des glaces qu’on auroit intention
de faire, ne pourvoient que gâter le mélange
& occasionner un défaut , d’union dans les parties.
On doit aufli fe donner le plus grand foin pour enlever
aux caffons les défauts qui feroient fufceptibles
dé relier les mêmes après la nouvelle fufion ( telles
font les larmes 8c les pierres), & à enlever les fole-
tés qui fe trouveroient fur la Surface defdits caffons.
Un épluchage bien exaélfert à bannir les larmes 8c
les pierres, comme aufli à féparer le verre de mau-
vàifie couleur, 8c la lotion ôte les faletés de la fur-
face. On lave les caffons en les mettant dans uii panier,
( fig. 4. Plane; X .) dont le fond eft fait à-peu-
pres comme celui dès cazerets, où l’on met à égoutter
le fromage. On remue le panier plein de caffons,
le tenant par l’anfe, à-peu-près comme on tourne
un tamis. On peut employer les caffons feulement
épluchés & laVés ; mais communément on leur fait
fubir une autre opération : on les calcine, c’eft-à-dire
qu’on les fait rougir dans un four exprès pour cet
ufage , fait comme nous décrirons dans la fuite
les fours à fritte. On les remue avec un râble, outil
qu’on trouve repréfenté.en 4 , <?, 6 , y ( PL X Î I .
v ig n e tte ) , 8c dont nous donnerons une plus exafte
defeription en parlant des frittes Lorfque les caffons
font bien rouges, on les entaffe lur le devant du
four avec le rable ; on les prend avec des pelles de
tô le , telles que K H'fPlanc. X V I I I . ) qui ont un
pie de long en Ai N fur environ huit ou dix pouces
de large en L G 8c quatre pouces de rebord en IM
(a) emmanchées d’un manche d’environ fept pieds,
dont trois 8c demi G O en fe r, & trois 8c demi
O H en bois ; 8c on éteint les caffons rouges dans
l’eau. Le refroidiffement fubit qu’ils éprouvent, les
fait caffer &c les réduit en petites parties ; on a par-là
l’avantage, de pouvoir les mêler plus parfaitement
aux autrès matières, dont la combinaifon produit le
Verte. Les caffons calcinés prennent le nom de cal-
cin , 8c c’eft dans cet état qu’on les emploie.
Le mélange du calcin à la compofition du verre >
donne des avantages. Comme c’eft une matière qui
â déjà été fondlie 8c.affinée & qui eft déjà v e r re ;
elle difpofe les autres à la vitrification; elle abrégé
leur affinage, 8c leur donne plus de confiftancë & de
liaifon que n’en auroit du verre neuf; c’eft-à-dire,
dans lequel il ne feroit entré aucun calcin. Je dirois,
fi on me permettait l’expreflxon, que par le moyen
du calcin la compofition eft plutôt verre, 8c fe ft plus
parfaitement. En outre, On met de cette maniéré à
profit les rognures des glaces qu’on a été obligé de
recuire.
Il nous refte à dire un mot d’une autre manière de
compofer, qui eft moins anciennement en ufage que
celle dont nous venons de parler.
La foude eft conîpofée de' fel.alkali fix e , vulgairement
appellefa lin qui ëft feul 1 è f o n d a n t > 8c d’une
bafe Calcaire. On a pris, le parti d’extraire le fel de
là fonde, 8c ait lieu dé la terre calcaire qui étoit
combinée avec le fe l, à laqûelle eft attachée la plus
grande quantité de principe colorant (comme oh le
remarque à fa couleur noire après l’extraction); de
la proportion de laquelle le fabriquant n’eft jamais
le maître ; on emploie de belle chaux, la plus blanche
& la plus pure qu’on pût trouver. L’artifte a du-
moins l’avantage d’être maître dé la proportion de
fa chaux.
On peut employer la chaux éteinte : dans ce cas
oh feroit obligé de là laiffer fécher pour la paffer au
tamis fin. On évite cette longueur en n’y jettant que
l’eait qu’il faut pour la faire tomber en efflorefcence
8c réduire en poiiffieré les morceaux un peu gros.
On peut même pour ihoiris d’embarrâs, la laiffer fu-
fer à l’a ir , 8c en paffer la poufliere au travers d’un
tamis pour la foiré Servir aux compofitions. Il y âu-
roit peut-êtrë alors des morceaüx qui a la vérité ne
fuferbient qu’imparfaitement, à-moins d’ un très-long
tems ; mais on auroit toujours le premier moyen 8c
" ( « ) On Voit, t h P Q S R le géométral de ces pelles.
en
en outre dans un établiffement de cette importance
on trouveroit d’autres ufages aux chaux de rebut,
comme les batiffes, les recrépis, &c.
On remarque que les glaces dont le verre a été
compofé en fe l, font plus tranfparentes que celles
dont il a été compofé en foude.
Maniéré £ extraire les fels de foude. La qualité des
fels d’être mifcibles à l’eau, fournit le moyen le plus
{impie de les féparer de la bafe calcaire, avec laquelle
ils fe trouvent combinés dans la foude.
Qu’on jette dans l’eau la foude bien pulvérifée 8c
pafl.ee par un tamis fin, & qu’on l’agite pour aider à
îa diffolution ; la laiffant repofer enfuite, la bafe calcaire
ne manquera pas de fe précipiter, & l’eau de
relier claire, chargée de l’alkali qui étoit renfermé
dans la foude. Alors en faifant évaporer l’eau, on
obtiendra l’alkali. L ’opération en entier s’appelle extraction
de Valkali. Elle doit être dirigée par les phénomènes
qu’on a eu occafîon d’obferver, & par les
expériences déjà faites, tournant toujours Ses vues
du côté de la prompte extraction & de l’économie
fur-tout celle du tems.
Après que nous aurons parlé de l’opération en
elle-même, nous parlerons des divers moyens employés
à la fa ire , & de différentes machines à extraire*
Pour obtenir une plus grande quantité de falin dans
un même tems, ce qui eft en effet perfectionner &
abréger l’opération, il faut que l’eau avec laquelle
on a leflivé la foude, foit plus chargée de f e l , ou ,
pour parler d’une maniéré plus analogue au langage
ordinaire, il faut que la leffive foit plus forte. Mais
il y a une qualité de fel au-de-là de laquelle l’eau
n’en fauroit diffoudre davantage ; ce qu’on appelle
fon point de faturation. On eftime qu’il faut environ
huit livres d’eau pour une livre de foude d’Alicante.
Ce n’ eft pas qu’il n’y ait des modifications relativement
aux diverfes eaux : ôn doit donc chercher à
faturer l’eàu avant d’en commencer l’évaporation.
Lorfqu’on en eft à ce point, voici les phénomènes
qu’on a obfervés, 8c d’après lefquels il eft à-propos
de régler l’évaporation.
Si l’eau s’évapore lentement & à un feu léger, l’al-
kali qui en réfulte, renferme beaucoup de fels neutres
; fi elle s’évapore à petits bouillons, le falin eft
plus p ur; fi elle s’évapore à gros bouillons, on gagne
la promptitude dans l’opération.
J ’ai oui dire à quelques perfonnes qui fe donnoient
pour habiles glaciers, que l’alkali obtenu par l’évaporation
à gros bouillons, étoit plus greffier que celui
qu’on obtenoit par l’évaporation à petits bouillon
s ; c’ eft-à-dire qu’il renfermoit des parties calcaires
, provenant de la bafe de la foude. Il me femble
avoir des raifons de douter de ces différences. Comment
après l’évaporation peut-il refter des parties
calcaires , fi la leflive a été bien clarifiée ? & fi elle
ne l’a pas bien été, comment dix pintes de leffive
évaporées à petits bouillons, jufqu’à ficcité bien par*
faite, laifferont-elles moins de bafe calcaire mêlée à
l’a lkali, que dix pintes de la même leffive évaporées
à gros bouillons jufqu’au même degré de ficcité
? La bafe renfermée dans les dix premières pintes
aura-t-elle reçu, par l’évaporation à petits bouillons,
la propriété d’être volatile, pour ne plus s’y trouv
e r après l’évaporation ? On fent combien il feroit
abfurde de le penfer.
Il eft bien plus aifé de concevoir comment il peut
y avoir plus ou moins de fels neutres, mêlés à l’alkali
fuivant les diverfes maniérés de faire l’évaporation.
L air a bien plus de facilité à communiquer de l’acide
à la leflive , | lorfqu’elle s’évapore à un feutrès-léger,
& qu elle n’eft pas dans ce mouvement violent de
dilatation & d’expanfion qu’elle communique à Pat*
Tome X P I I . n
molphere environnant, & qui doit tendre à éloigner
les corps étrangers.
D ’après ce raifonnement, l’alkali qui réfulte de
1 évaporation à gros bouillons doit être plus exempt
de fels neutres, que tout autre. Cette rai fo n ,
jointe à là promptitude de l’opération, doit faire
préférer l’évaporation à.gros bouillons.
Toutes les diverfes machines à extraire le falin '
ne confillent qu’ en vafes qui fervent, les uns à faire
la diffolution, les autres à évaporer. Elles ne different
que dans la difpofition defdits vafes pour la
commodité du fervice, i’exa&itude de l’extra dion
8c l’économie des aUmens du feu.
Il y a^des réglés qui naiffent de la chofe, 8c qui
doivent être communes à toutes les machines. Par
exemple, on doit foire les vafes de diffolution plus
profonds que les autres, pour pouvoir y lefliver une
plus grande quantité de foude ; & c,eux d’évaporation
plus larges, afin que donnant à l’eau une furfa-
ce plus étendue, l’évaporation en foit plus prompte.
Ceux-ci ont moins befoin de profondeur que les premiers.
On fent bien que les vafes ne peuvent être
que de métal, 8c parmi les métaux, que de fer ou
de cuivre. On eft obligé de bannir ce dernier, parce
que l’alkali le corrode 8c le détruit en peu de tems.
On emploie très-bien la fonte, ainfi que le fer ; mais
on a des obfervations à foire. Le feu calcine le fer ,
ainfi que tous les métaux imparfaits, 8c foit caffer la
fonte affez aifément. Comment fe mettre à l’abri de ces
inconvéniens ? par l’attention fcrupuleufedenelaif-
fer jamais les chaudières fans eau. Mais d’un autre
côte , comment obtenir le falin fi l’on ne peut pouffer
l’évaporation jufqu’à ficcité ? Lorfque l ’eau a affez
bouilli pourpafferde beaucoup le point de fotura-
tion, on la tranfporte dans d’autres chaudières, où l’on
entretient une chaleur bien moindre, fouvent même
avec de fimples braifes. L’eau entretenue chaude,
continue à s’évaporer, plus lentement à la vérité ;
mais elle ne laiffe pas de s’épaiflir encore. D ’ailleurs
elle a été trejettée, contenant plus d’alkali qu’elle
n’en peut tenir en diffolution ; au moyen de quoi
l’alkali fuperflu tombe au fond, 8c on doit avoir foin
de l ’en retirer tour de fuite avec des écumoires de fer,'
d’environ fix pouces fur chaque face. Le fel chauffant
de plus près, & touchant le fond de la chaudièr
e , ne manqueroit pas de s’y fécher, d’y former
croûte, & le fond de la chaudière fe calcineroit né-
ceffairement n’étant plus touché par l’eau. On voit
par-là que les dernieres chaudières, connues fous le
nom de chaudières de réduction, font les plutôt gâtées
: c’eft un inconvénient du métier, auquel je ne
vois pas trop comment remédier.
Si l’on vient à arrêter i’extraélion, il y a toujours
quelques eaux de refte ; mais il n’eft pas mauvais d’avoir
déjà de la leffive prête, lorfqu’on recommence
à extraire. Si l’on ceffe pour ne recommencer jamais,
on s’expofe au rifque de pouffer la derniere évaporation
jufqu’à ficcité.
La figure quarrée eft en quelque maniéré adoptée
pour fos chaudières de falines ( r ). C’eft la plus favorable
à la difpofition des chaudières, & même à
leur conftrudion ; fur-tout fi elles font en fer. Car
dans ce cas on les forme de tôles clouées les unes
à côté des autres, & il eft bien plus aifé de plier des
feuilles de tôle à angles droits’, pour faire les coins,
que de leur donner Ta forme ronde, ou toute autre.
On voit dans la Planche I I I . une machine d’ex-
traâion affez commode. La grandeur des chaudières
dépend de la quantité de fel qu’on veut fabriquer.
Plus la chaudière de diffolution eft grande, plus on
peut y leffiver de cendres ; plus la chaudière d’évaporation
a d’étendue, plus l’évaporation en eft con-
lidérable ; 8c enfin plus la chaudière de réduélion
(r) On appelle faltne en glacerie l'attelier d’éxn adion.