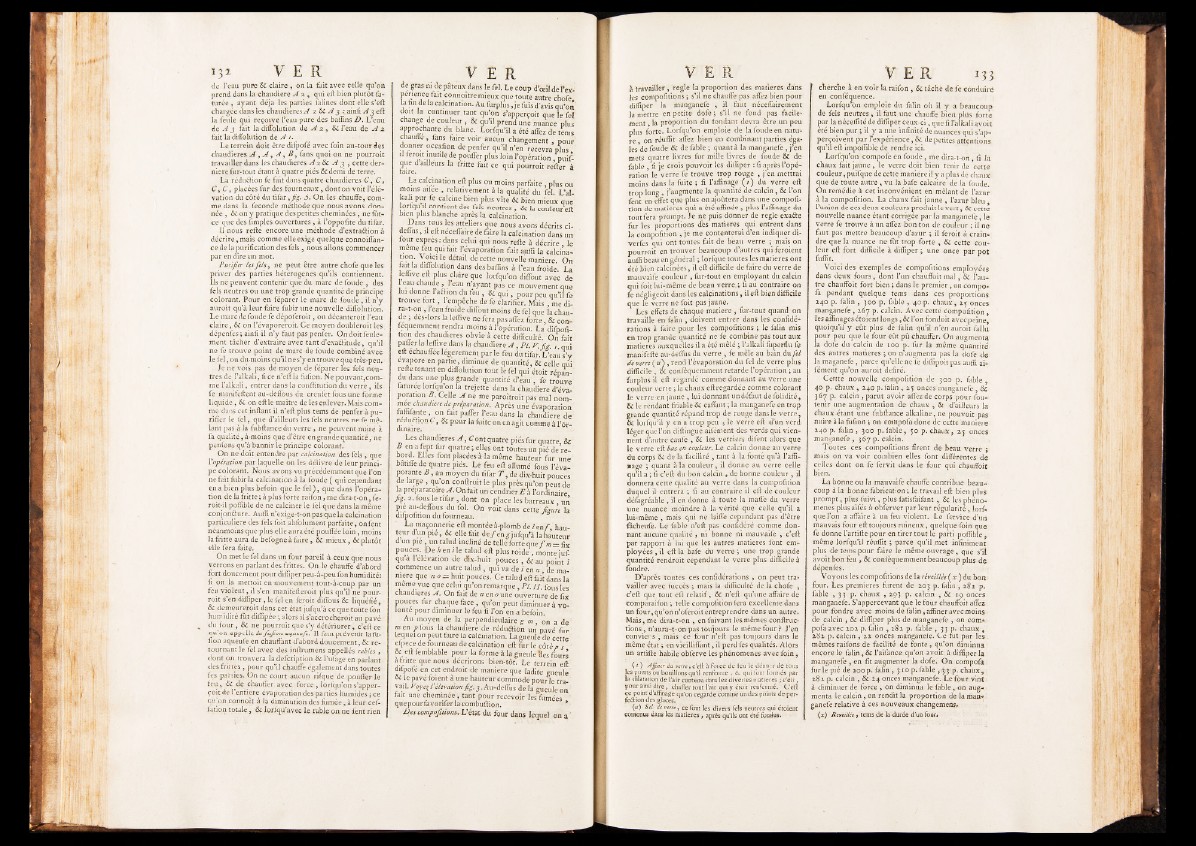
de l’eau pitre 6c claire , on la fait avec celle qufo’ft
prend dans la-chaudière A 2 , qui èft bien plutôt fa-
turée , ayant déjà les parties falines dont elle s’eft
chargée dans les chaudières^ 2 6c A 3 ainfi A % eft
la feule qui reçoive l’eau pure des baffins D . L ’eau
de A 3 fait la diffolution de A 2 , 6c l’eau de A z
fait la diffolution de A 1.
Le terrein doit être difpofé avec foin au-tour des
chaudières A , A , A , B , fans quoi on ne pourroit
travailler dans les chaudières A 2 6 c A 3 + cette dernière
fur-tout étant à quatre piés &demi de terre.
L a réduction fe fait dans quatre chaudières C , £?,
C , C , placées fur des fourneaux, dont on voit l’élévation
du côté du tifar, fig. à. On les chauffe, comme
dans la fécondé méthode que nous avons donnée
, & on y pratique des petites cheminées, ne fut-
ce que des fimples ouvertures, à l’oppofite du tifar.
Il nous refte encore une méthode d’extrattion à
décrire, mais comme elle exige quelque connoiflan*
ce de la purification des fe ls, nous allons commencer
par en dire un mot.
Purifier les f i l s , ne peut être autre chofe que les
priver des parties hétérogènes qu’ils contiennent.
Ils ne peuvent contenir que du marc de foude , des
fcls neutres ou une trop grande quantité de principe
colorant. Pour en féparer le marc de fonde , il n’y
auroit qu’à leur faire fubir une nouvelle diffolution.
Le marc de foude fe dépoferoit, on décanteroit l ’eau
claire, & on l’évaporeroit. Ce moyen doubleroit les
dépenfes ; ainfi il n’y faut pas penfer. On doit feulement
tâcher d’extraire avec tant d’exa&itude, qu’il
ne fe trouve point de marc de foude combiné avec
le fe l, ou du-moins qu’il ne s’y en trouve que très-peu.
Je ne Vois pas de moyen de féparer les fels neutres
de l’alkali, fi ce n’eft la fufîon. Ne pouvant,comme
l’alkali, entrer dans la conftitution du v e r re , ils
fe manifeftent au-deffous du creufet fous une forme
liquide , & on eftle maître de les enlever. Mais comme
dans cet inftant il n’eft plus tems de penfer à purifier
le fe l, que d’ailleurs les fels neutres ne fe mêlant
pas à la fubftance du verre , ne peuvent nuire à
fa qualité, à-moins que d’être en grande quantité,'ne
penfons qu’à bannir le principe colorant. ’=.
On ne doit entendre par calcination des fe ls, que
Yopération par laquelle on les délivre de leur principe
colorant. Nous avoh$ vu précédemment que l’on
ne fait fubir la calcination à la foude ( qui cependant
en a bien plus befoin que le fel ) , que dans l’opération
de la fritte ; à plus forte raifon, me dira-t-on, fe-
rpit-il poffible de ne calciner le fel que dans la même
conjoncture. A uffi n’exige-t-on pas que la calcination
particulière des fels foit abfolument parfaite, onfent
néanmoins que plus elle aura été pouffée loin, moins
la fritte aura de befogne à faire, 6c mieux, 6c plutôt
elle fera faite.
On met le fel dans un four pareil à ceux que nous
verrons en parlant des frittes. On le chauffe d’abord
fort doucement pour diftiperpeu-à-peufon humidité:
fi on la mettoit enmouvement tout-à-coup par un
feu violent, il s’en manifofferoit plus qu’il ne pourroit
s’en diffiper, le fel en féroit diffous & liquéfié,
& demeureroit dans cet état jufqu’à ce que toute fon
humidité fut dilîipée ; alors il s’accrocheroit au pavé
du fou r, & ne pourroit que s’y détériorer, c’eft ce
ou’on appelle la fujîon aqueufe. Il faut prévenir lafu-'
fion aqueufe en chauffant d’abord doucement, & retournant
le fel avec des inftrumens appellés râbles ,
dont on trouvera la defcription 6c l’ufage en.parlant
des frittés , pour qu’il chauffe également dans toutes
les parties. On ne court aucun rifque de pouffer le
feu , & de chauffer avec force , lorfqu’on s’apper-
Çojt de l’entiere évaporation des parties humides ; ce
qu on connoît à la diminution des fumée, à leur cef-
lation totale, 6c lorfqu’avec le rable on ne fent rien
dé gras ni de pateiuc dans le fel. L e coup d’oeil de l’e.v-
perience fait connoître mieux que toute autre chofe
la fin de la calcination. Au furplus, je fuis d’avis qu’on
doit la continuer tant qu’on s’apperçoit que le fel
change de couleur * & qu’il prend une nuance plus
approchante du blanc. Lorfqu’il a été affez de tems
chauffe, fans faire voir aucun changement ; pour’
donner occafion de penfer qu’il n’en recevra plus .
“ B H H g g P?uffer plus loin l’opération , puif-
fairc ai elus a fritte fait ce qui pourroit relier à
Là calcination efl plus Ou moins parfaite plus bu
moins ailée , relativement à la qualité du fel. L ’al-
kah pur fe calcine bien plus vite & bien mieux que
lorfqu il contient des fels neutres , & la couleur efl
bien plus blanche après là calcination.
j Dans|touS;les atteliers que.nous avons décrits cidefTus,
il efl neceffairè de faire la çalcination ’Iàns un
tour exprès : dans celui qui nous refie à décrire le
meme feu qui fait l’évaporation fait auffi la calcina*
tion Vmcile détail de cette nouvelle maniéré. On
faitla diffolution dans ,des bafEns à l’ eau froide. La
lcfiivc cft plus claire que lorfqu’cr. diîfout avec de
1 eau chaude , l’eau n’ayant pas ce mouvement que
lui donne 1 aftion du feu , & q u i, pour peu qu’il fe
trouve fo r t , l’empêche de fe clarifier. Mais , me dira
t-on , ’eau froide diffout moins de fel que la chau-’
de ; des-lors la lefîive ne fera pas affez forte & con-
iequemment rendra moins à l’opération. La difpofi-
tion des chaudières obvie à cette difficulté. On fait
paffer la leflive dans la chaudière A , PL. K fig. /.qui
efl échauffée légèrement par le feu dn tifar. L ’eau s’v
évapore en partie, diminue de quantité, & celle qui
refie tenant en diffolution tour le fel qui étoit répandu
dans une plus *rande|feiantité d-’Æ ; fe trouve
iaturee lorfqu’on la trejette dans ia chaudière d’éva*
poration B . S elle A né me parpîtrbit pas mai nommeexhaudierc
de préparation. Après une évaporation
iuffitante, on fait paffer l’eau dans la chaudière de
réduction C , oc pour la fuite on en agit comme à fo r -
dinaire.
Les chaudières A , Ç ont quatre piés fur quatre &:
B en a fept fur quatre ; elles ont toutes un pié de re-
?Ar. i , es *ont placées à la même hauteur fur une
banffe de quatre piés. Le feu eft allumé fous l’évaporante
B , au moyen du tifar T \de dix-huit pouces
de large , qu’on conftruit le plus près qu’on peut de
la préparatoire A . On fait un cendrier E à l’ordinaire
fig : 2. fous le tifar , dont on place les barreaux, un
pie au-deffous du fol. On voit dans cette figure la
difpofition du fourneau.
La maçonnerie eft montée à-plomb de / en ƒ hau-
teur d’un p ié , & elle fa itd e / en gr jufqu’à' la hauteur
d un pie , un talud incline de telle forte q u e /m = fix
pouces. D eA e n ile talud efl plus roide , monte juf-
q u à 1 élévation de dix-huit pouces , &. appoint i
commence un autre talud , 'qui va de ï en n , de nia- ’
niere que » » = huit pouces. Ce talud efl fait dans la
même vue que celui qu’on remarque, PL I I . fous les
chaudières A. On fait de n en o une ouverture de iix
pouces fur chaque fa c e , qu’on peut diminuer à volonté
pour diminuer le feu fi l’on en a befoin.
Au moyen de la perpendiculaire *g m , on a de
men p fous la chaudière de réduaion un pavé fur
Lequel on peut faire la calcination. Laguèule de cette
efpece de fourneau de calcination eft fur le côté/» s
& eft femblable pour k forme à la gueule le s fours
à fritte que nous décrirons bien-tôt. Le terrein eft
difpofé en cet endroit de manière que ladite gueule
& lepavéfoient à une hauteur commode pour le travail.
delà giieuleon
fait une cheminée y tant pour recevoir les fumées '
que pour favorifer la combuftion.
£>es-compofuions.-Vhat du four dans lequel on a '
à travailler, réglé la proportion des matières dans
les compofitions ^ s’il ne chauffe pas affez bien pour
diflîper la manganefe , il faut néceffairement
la mettre en petite dofe ; s’ il ne fond pas faeile-
#ient la proportion du fondant devra être un peu
plus forte. Lorfqu’on emploie de la foude en natu-
te on réuffit affez bien en Combinant parties égales
de fonde 5c de fable ; quant à la manganefe, j’en
fiiets quatre livres fur mille livres de ioude & de
fable , fi je crois pouvoir les difliper : fi après l’opé»-
ration le verre fe trouve trop rouge , j’en mettrai
moins dans la fuite ; fi l’affinage ( * ) du verre eft
trop long , j’augmente la quantité de calcin , 6c l’on
fent en effet que plus on ajoûtera dans une compofh-
tion de matières qui a été affinée , plus l’affinage du
tout fera- prompt. J e ne puis donner de réglé exatte
fur les proportions des matières qui entrent dans
la compofition , je me contenterai d’en indiquer di-
verfes qui ont toutes fait de bèau verre ; mais on
pourroit en trouver beaucoup d’autres qui feroient
auffi beau en général ; lorfque toutes les matières ont
été bien calcinées, il eft difficile de faire du verre de
mauvaife couleur , fur-tout en employant du calcin
qui foit lui-même de beau verre.; u au contraire on
fe négligeoit dans les calcinations, il eft bien difficile
que le verre ne foit pas jaune.
Les effets de chaque matière , fur-tout quand on
travaille en faim , doivent entrer dans les cônfidé-
rations à faire pour les compofitions ; le falin mis
en trop grande quantité ne fe combine pas tout aux
matières auxquelles il a été mêlé ; l’alkali fuperflu fe
manifefte au-deffus du verre , fe mêle au bain du fe l
Je verre ( « ) , rend l’évaporation du fel de verre plus
difficile , 6c conféquemment retarde l’opération ; au
furplus il eft regardé comme donnant au verre une
couleur verte ; la chaux eft regardée comme colorant
le verre ;en jaune , lui donnant un défaut de folidité,
& le rendant friable & caffant ; la manganefe en trop
grande quantité répand trop de rouge dans le ve r re ,
& lorfqu’il y en a trop peu , le verre eft d’un verd
léger que l’on diftingue aifémerit des verds qui viennent
d’autre caufe , & les verriers dilent alors que
le verre eft bas en couleur. Le calcin donne au verre
du corps 6c de la faciliré , tant à la fonte qu’à l’affinage
; quant à la couleur, il donne au verre celle
qu’il a ; fi c’ eft du bon calcin , de bonne couleur , il
donnera cette qualité au verre dans la compofition
duquel il entrera ; fi au contraire il eft de couleur
défagréablé, il en donne à toute la maffe du verre
une nuancé moindre à la vérité que celle qu’il a
Jui-même , mais qui ne laiffe cependant pas d’être
facheufe. Le fable n’ eft pas confidéré comme donnant
aucune qualité, ni bonne ni mauvaife , c’eft
par rapport à lui que les autres matières font employées
, il èft la bafe du verre ; une trop grande
quantité rendroit cependant le verre plus difficile à
fondre.
D’après toutes ces confîdérations , on peut tra*
Vailler avec fuccès ; mais la difficulté de la chofe ,
c’eft que. tout eft relatif, & n’eft qu’une affaire de
comparaifon ; telle compofition fera excellente dans
un four,qu’onn’oferoitentreprendre dans un autre.
Mais, me dira-t.-on , en fuivant les.mêmes conftruc-
tions, n’aura-t-on pas toujours le même four ? j ’en
conviens , mais ce four n’eft pas toujours dans le
même état ; en vièilliffant, il perd fes qualités. Alors
un artifte habile obferve les phénomènes avec foin,
( t ) Affiner du verre, c’eft à force dé feu le d é n u cr de tous
les points pu bouillons qu’il renferme , &. qui font formés par
la dilatation de l'air contenu dans les diveries matières ; c’é lt,
pour ainfi dire, chaffer tout l'air qui y étoit renfermé. C ’eft
ce point d’affinage qu’on regarde comme un des points de per*
fedion des glaces.
(u) Selrdè verre, ce font les divers fels neutres qui étoient
contenus dans les matières > après qu’ils ont été fondus*
chèrche à en voir la raifon , & tâché de fe conduire
en conféquence.
Lorfqu ôn emploie du falin oîi il y a beaucoup
de fels neutres * il faut une chauffe, bien plüs forte
par la néceffité de diffiper ceux-ci, que fi l’alkali avoit
été bien pur ; il y a une infinité de nuances qui s ’ap-
perçoivent par l’expérience, 6c de petites attentions
qu’il eft impoffible de rendre ici.
Lorfqu’on compofe én foude, me dira-t-on fi là
chaux fait jaune, le verre doit bien tenir de cetté
couleur, puifque de cette manière il y a plus de chaux
que de toüte autre , Vu la bafe calcaire de la foude.
On remédie à cet inconvénient en mêlant de l’azur
à la compofition. La chaux fait jaune , l’azuf bleu i
l’uniori de ces deux couleurs produit le v e r t, & cette
nouvelle nuance étant corrigée par la manganefe, le
Verre fe trouve à un affez bon ton de couleur ; il ne
faut pas mettre beaucoup d’azur ; il feroit à craindre
que la nuance ne fût trop forte , 6c cette couleur
eft fort difficile à diffiper ; une once par pot
fuffit.
Voici des exemples de compofitions employées
dans deux fours, dont l’un chauffoit mal, 6c l’autre
chauffoit fort bien ; dans le premier, on compo-
fa pendant Quelque tems dans ces proportions
14 0 p. falin , 300 p. fable , 40 p. chaux, zç onces
manganefe, 267 p. calcin. Avec cette compofition,
les affinages étoient longs, & l’on fondoit avec peine*
quoiqu’il y eût plus de falin qu’ik n ’en auroit fallu
pour peu que le four eût pû chauffer. On augmenta
la dofe du calcin de 100 p* fur la même quantité
des autres matières ; on n’augmenta pas ia dofe dô
la maganefe, parce qu’elle ne fe diffipoit pas auffi ai-
fément qu’on auroit defiré. .
Ceftte nouvelle compofition de 300 p. fable ,
40 p. chaux , 240 p. falin , 25 onces manganefe , 6c
3 67 p. calcin , parut avoir affez de corps pour fou-
tenir une augmentation de chaux , & d’ailleurs la
chaux -étant une fubftance alkaline, ne pouvoit pas
nuire à la fufion ; on compofa donc de cette maniéré
240 p. falin , 300 p. fable, 50 p. chaux, 25 onces
manganefe, 367 p. calcin.
Toutes ces compofitions firent de beau verre ;
mais on va voir combien elles font différentes de
celles dont on fe fervit dans le four qui chauffoit
bien.
La bonne ou la mâuvaifè chauffe contribue beaucoup
à la'bonne fabrication; le travail eft bien plus
prompt, plus fuiv i, plus fatisfaifant , & les phénomènes
plus aifés à obferver par leur régularité , lorfque
l’on a affaire à un feu violent. Le fervice d’un
mauvais four eft toujours ruineux, quelque foin que
fe donne rartiftèipOur en tirer tout le parti poffible *
même lorfqu’il réuffit ; parce qu’il rmet infiniment
plus de tems pour faire le même ouvrage , que s’il
avoit bon fou , & conféquemment beaucoup plus de
dépenfes.
Voyons les compofitions de la réveillée ( x ) du bon
four. Les premières furent de 203 p. falin, 282 p.
fable , 33 p. chaux , 293 p. calcin , 6c 19 onces
manganefe. S’appercevant que le four chauffoit affez
pour fondre avec moins de falin j affinerav.ee moins
de calcin j 6c diffiper plus de manganefe -, on com*
pofa avec 202 p. falin , 282 p* .fable * 33 p. chaux .
282 p. calcin j 2 2 onces manganefe. Ce fut par les .
mêmes râifons de facilité de fonte j qu’on diminua
encore le falin, & l’aifance qu’on avoit. à difliper la
manganefe , en fit augmenter la dofe. On .compofa
furie pié de 200p. falin , 3 10 p*fable ^ y -p . chaiix*
282 p. calcin , & 24 onces manganefe. Le four.vint
à diminuer de force , on diminua le fable, on aug-*I
menta le calcin, on rendit la proportion de la manganefe
relative à ces nouveaux changemens*
(x) Réveillée. ; tems de la durée d’un four«