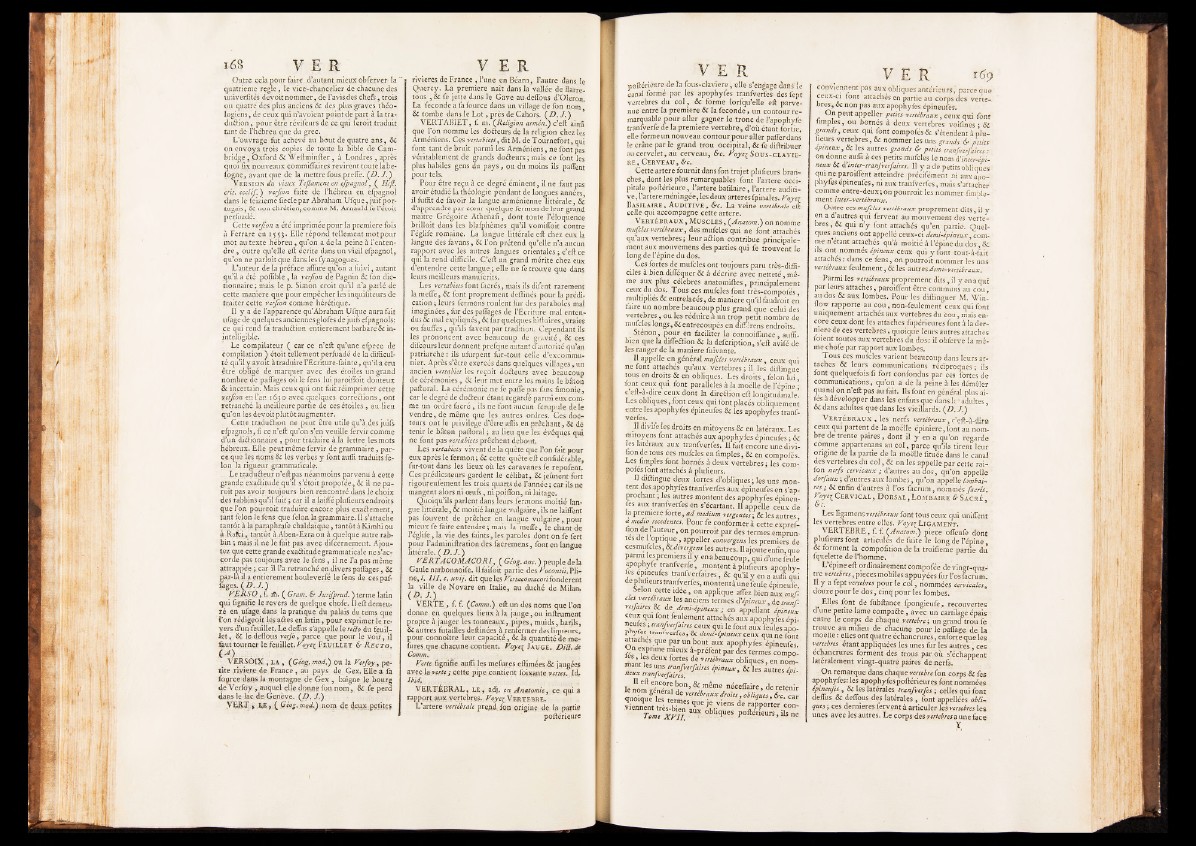
Outre cela pour faire .d’autant mieux obferver- la "
quatrième regle, le vice-chaiicelier de chacune des
univerfités devoit nommer, de 1’avis.des chefs, trois
ou quatre des plus anciens & des plus graves, théologiens,
de ceux qui n’avoient point de part à la trad
it io n , pour être révifeurs dé ce qui ieroit traduit
tant de l’hébreu que du grec.
L ’ouvrage fut achevé au bout de quatre ans, &
on envoya, trois copies de toute la bible de Cambridge
, Oxford & W eftminfter, à Londres, après
quoi fix, nouveaux commiflaires revirent toute la be-
iogne., avant que de la mettre fousprefle. (Z ? ./ .)
V e r s io n du vieux Te dament en efpagnol, ( Hiß.
çrit. eccléf ) verßon faite de l’hébreu en efpagnol
dans le feizieme fiecle par Abraham U fque, ju if portugais,
& non chrétien, comme M. ArnaulcLf’e l’étoit
perfuaflé.
Cette verßon a été imprimée pour la première fois
à Ferrare en 1553- Elle répond tellement mot pour
mot au texte hébreu, qu’on a de la peine à l’entendre
, outre qu’ elle eft écrite dans un v ieil efpagnol,
qu’on ne parloit que dans les fynagogues.
L ’auteur de la préface affure qu’on a fui v i , autant
qu’il a été poflïble , la verßon de Pagnin & fon dictionnaire;
mais le p. Simon croit qu’il n’a parlé de
cette maniéré que pour empêcher les inquifiteurs de
traiter cette verßon comme hérétique.
Il y a de l’apparence qu’Abraham Ufque aura fait
ufagede quelques anciennes.glofes de juifs efpagnols:
ce qui rend fa traduction entièrement barbare & inintelligible.
Le compilateur f car ce n’efl qu’une efpece de
compilation ) étoit tellement perfuadé de la difficulté
qu’il y avoit à traduire l’Ecriture-fainte, qu’il a cru
être obligé de marquer avec des étoiles un grand
nombre de paflages qîi le fens lui paroifîoit douteux
& incertain. Mais ceux qui ont fait réimprimer cette
verßon en l’an 1,630 avec quelques, corrections , ont
retranché la meilleure partie de ces étoiles , au lieu |
qu’on les devoit plutôt augmenter.
Cette traduétipn ne peut être utile qu’ à des juifs
efpagnols, fi ce n’efl qu’on s’en veuille fervir comme
d’un dictionnaire , pour traduire à la lettre les mots
hébreux. Elle peut même fervir de grammaire, parce
qqq.les noms & les verbes y font auffi traduits félon
la rigueur grammaticale.
Le tradu&eur.n’eftpas néanmoins parvenu à cette
grande; exactitude qu’il s'étoit propofée, & il ne pa-
roît pas avoir toujours bien rencontré dans le choix
des rabbins qu’ il fuit ; car il a laifle plufieurs,endroits
que l’on pourroit traduire encore plus exactement,
tant félon le fens que félon la grammaire. Il s’attache
tantôt à la paraphrafe chaldaïque, tantôt àKimhipu
à Rafei, tantôt à, Aben-Ezra ou à quelque autre rabbin
; mais il ne le fait pas avec difeernement. Ajoutez
que cette grande exactitude grammaticale nes’ac^
çorde pas toujours avec le fens, il ne l’a pas même
^ttrappée ; car il l’a retranché en divers paflages, &
par-là il a entierement bouleverfé le fens de cespaf-
fages. ( D . J . )
V E R S O , 1. ift. ( Gram. & Jurifprud. ) terme latin
qui fignifie le revers de quelque chofe. Il eft demeuré
en ufage dans la pratique du palais du tems que
l’on rédigçqit les aCtes en latin , pour exprimer le revers
d’un feuillet. Le deflus s’appelle le recloàw feuille
t , & le-deflpus vcffo, parce que pour le v o ir , il
feut,tourner le feuillet. Port? F e u i l l e t & R e c t o , ü :. VERSOIX , LA , ( Géog.mod,) ou la Verfoy, petite
r iv k r e d e France, au pays de Gex. Elle a fa
fo^rce dans la montagne de’ G e x , baigne le'bourg
de Verfoy , auquel elle donne fon nom , & fe perd
rivières, de France , l’une en Béarn, l’autre dans le
Quercy. La première naît dans la vallée de Barre-
tons , & fe jette dans le Gave au-deflbus d’Ôleron.
La fécondé a fa fource dans un village de fon nom
& tombe dans le L o t , près de Cahors. (D . J . )
V E R T A B IE T , f. m. (Religion arment) c’efl ainfi
que l’on nomme les doCteurs de la religion chez les
Arméniens. Ces vertabiets, dit M. de Tournefort, qui
font tant de bruit parmi les Arméniens, ne font pas
véritablement de grands do&eurs ; mais ce font les,
plus habiles gens du pays , ou du moins ils pafîent
pour tels.
Pour être reçu à ce degré éminent, il ne faut pas
avoir étudié la théologie pendant de longues années,
il fuffit de favoir la langue arménienne littérale, &
d’apprendre par coeur quelque fermon de leur grand
maître Grégoire Athenafi, ' dont toute l’éloquence
brillojt dans les. blafphèmes, qu’il vomiflbit contre
l’églife romaine. La langue littérale eft chez eux la
langue des fa vans, & i ’on prétend qu’elle n’a aucun
rapport avec les autres langues orientales ; e’e,ft ce
qui la rend difficile. C’eft un grand mérite chez eux
d’entendre cette langue ; elle- ne fe trouve que dans
leurs meilleurs manuferits.
Les vertabicts font feçrés, mais ils difent rarement
la m éfié, & font proprement deftinés pour la prédication
; leurs fermons roulent fur des paraboles, mal
imaginées, fur des paflages de 1’Ecriture mal entendus
& mal e x p l iq u é s fu r quelques hiftoires,.vraies
ou faillies , qu’ils favent par tradition. Cependant.ils
les prononcent avec beaucoup de gravité, & ces
difeours leur donnent prefque autant d’autorité qu’au
patriarche : ils ufurpent fur-tout celle d’excommunier.
Après s’être exercés dans quelques villages ,.un
ancien vertabiet les reçoit doreurs avec beaucoup
de cérémonies, & leur met entre les mains le bâton
paftoral. La cérémonie ne fe pafle pas fans fimonie,
car le degré de do&eur étant regardé parmi eux comme
un ordre fa cré , ils ne font aucun fcrupule de le
vendre, de même que les autres ordres. Ces,docr
teurs ont le privilège d’être afiis en prêchant, &.de
tenir le bâton paftoral ; au lieu que les évêques qui
ne font pas verta.biets prêchent debout.
Les vertabiets vivent de la quête que l’on fait pour
eux après le fermon; & cette quête eft considérable,
fur-tout dans les lieux oh les caravanes fe repofent.
Ces prédicateurs gardent le célibat, & jeûnent fort
rigoureufement les trois quarts de l’année ; car ils ne
mangent alors ni oeufs, ni.ppiflon, ni laitage.
Quoiqu’ils parlent dan? leurs fermons moitié langue
littérale, & moitié langue vulgaire, ils ne laiflent
pas fouvent de prêcher, en langue vulgaire, pour
mieux fe faire entendre; mais la meflé, le chant de
l’églife, la vie des feints, les.paroles dont on fe fert
pour l’adminiftration des facremens, font en langue
littérale. ( D . J . )
V E R T A CO M A COR I , ( Géog. anc. ) peuple delà
Gaule narbonnoife. llfaifoit partie des Vocontii. Pline,
l. I I I . c. xvij. dit que les Veriacomacorifonàerent
la ville de Novare en Italie, au duché de Milan.
V E R T E , f. f. (\Comm.) eft un des noms que l’on
donne en quelques lieux à la jauge, ou inftrument
propre à jauger les tonneaux, pipes, muids, barils,
& autres futailles deftinées à renfermer des liqueurs,
pour connoître leur capacité, & la quantité de me-
fures que chaçunq contient. Voye^ J a u g e . Dicl.dt
Comm,
V ’.rte fignifie auffi les mefures eftimées & jaugées
avec la verte ; cette pipe contient foixante vertes, Id.
Ib id ,..'
V E R T É B R A L , l e , adj. en Anatomie, ce qqi a
rapport aux vertebres. Voye^V e r t e b r e .
L ’artere vertébrale prend, fpp. origine de la partie
poftérieure
poftérieure de la fous-claviere, elle s’engage dans ïe
canal formé par les apophyfes tranfverfes des fèpt
vertebres du c o l , & forme lorfqu’elle eft parvenue
entre la première & la fécondé, un contour remarquable
pour aller gagner le tronc de l’apophyfe
traniverfe de la première vertebre, d’oîi étant fortie,
elle forme un nouveau contour pour aller pafler dans
le crâne par le grand trou occipital, & fe diftribuer
au cervelet, au cerveau, &c. Voye^ S o u s - c l a v i e -
re , C e r v e a u , & c.
Cette artere fournit dans fon trajet plufieurs branches,
dont les plus remarquables font l’ârtere occipitale
poftérieure, l’artere bafilaire, l’artere auditive
, l’artere méningée, les deux arteres fpinales. Voye{
B a s i l a i r e , A u d i t i v e , & c. La veine vertébrale eft
celle qui accompagne cette artere.
V e r t é b r a u x , Mu s c l e s , (Anatom.) on nomme
mufcUs vertébraux, des mufcles qui ne font attachés
qu’aux vertebres ; leur a&ion contribue principalement
aux mouvemens des parties qui fe trouvent le
long de l’épine du dos.
Ces fortes de mufcles ont toujours paru très-difficiles
à bien diflequer & à décrire avec netteté, même
aux plus célébrés anatomiftes, principalement
ceux du dos. Tous ces mufcles font très-compofés,
multiplies & entrelacés, de maniéré qu’il faudroit en
faire un nombre beaucoup plus grand que celui des
vertebres, ou les réduire à un trop petit nombre de
mufcles longs, & entrecoupés en diffirens endroits.
Sténon, pour en faciliter la connoiflance, aufli-
bien que la difleftion & la defeription, s’eft avifé de
les ranger de la maniéré fuivante.
Il appelle en généra\ mu fc le s v e r t é b r a u x , ceux qui
ne font attachés qu’aux vertebres; il les diftingue
tous en droits & en obliques. Les droits, félon lui,
font ceux qui font parallèles à la moëlle de l’épine ;
c’eft-à-dire ceux dont la direâion eft longitudinale.
Les obliques, font ceux qui font placés obliquement
entre les apophyfes épineufes & les apophyf es tranfverfes,.
II divife les droits en mitoyens & en latéraux. Les
mitoyens font attaches aux apophyfes épineufes ; &
les latéraux aux tranfverfes. Il fait encore une divi-
fion.de tous ces mufcles.en fimples, & en compofés.
Les fimples font bornes .à deux vertebres ; les com-
pofes font attachés à plufieurs.
Il diftingue deux lortes d’obliques ; les uns mo
tent des apophyfes tranfverfes aux épiqeufes en s’a
prochant ;le s autres montent des apophyfes épine
tes aux tranfverfes en s’écartant. Il appelle ceux (
la premièr e forte , ad medium verger.les ; & les autre
a rnedio ncedentes. Pour fe conformer à cette.expre
lion de fauteur, on pourrait par des termes-empru
tés de 1 optique , appeller convergens les premiers <
ces mufcles, & divergeas les autres. Il ajoute enfin, qi
parmtlespremiersily en a beaucoup, qui d’une feu
apophyfe tranfverfe, montent à plufieurs apoph'
tes épineufes tranfverfaires, & qu’il y en a auffi
° e Plyfieurstranfverfes, montent à une feule épineul
Selon cette idee, on applique affez b ie n a u x™
Cltivçrubraux iesanciens termes à’ijrinenx, de trar,
vafaires Sc i e demi-épineux ; en appellant érrinei
ceux qui font feulement attachés aux apophyfes,éD
neufes ; tranfvtrfiires ceux qui le font aux feules apc
phyfes tranfverfes; & demi-épineux ceux qui ne foi
attaches que par un bout aux apophyfes épineufe
n exprime mieux à-préfent par des termes comp,
les les deux fortes de vertébraux obliques, en non
! s " ns W B m & les autres & n e u x tran jve rJ,aires. ' r
1 . n i™ H ^ 0n>& mème néeeffaire, de reten
auoim,féinéra de vmibraux droits, obliques, &c. ci
.Viennent mS êèÈÊÈÈb de rapporter co.
Terne X F U . au? . oU.15 ',es pofteneurs, ils r
conviennent pas aux obliques antérieurs, parce que
ceux-ci font attachés en partie au corps des verte-,
bres, & non pas aux apophyfes épineufes.
On peut appeller petits vertébraux, ceux qui font
fimples, ou bornes à deux vertebres voifines ; &
grands, ceux qui font compofés & s’étendent à plu-
iieurs vertebres, & nommer les uns grands & petits
epmeux, & les autres grands & petits tranfverfaires :
on donne aufli à ces petits mufcles le nom d’inter-épineux
& tinter-tranfverfaires. Il y a de petits obliques
qui ne paroiflent atteindre précifément ni aux apophyfes
épineufes, ni aux tranfverfes, mais s’attacher
comme entre-deux;on pourroit les pommer fimple- 1
ment inter-vertébraux.
Outre ces mufcles vertébraux proprement dits-, il y
en a d autres qui fervent au mouvement des verte-
bres, & qui n’y font attachés qu’en partie., Quel-
qu es anciens ont appellé ceux-ci demi-épineux, comme
n’etant attachés qu’à moitié à l ’épine du dos, &
ils ont nommés épineux ceux qui y font toiit-à-fait
attachés : dans ce fens, on pourroit nommer les uns
vertébraux feulement, & les autres demi-vertébraux.
Parmi les vertébraux proprement dits, il y en a qui
par leurs attaches, paroiflent être communs au cou,
au dos & aux lombes. Pour les diftinguer M. Win-
flow rapporte au cou, non-feulement ceux qui font
uniquement attaches aux vertebres du cou, mais encore
ceux dont les attaches fupérieures font à la dernière
de ces vertebres, quoique leurs autres attaches
foient toutes aux vertebres du dos : il obferve la même
chofe par rapport aux lombes.
Tous ces mufcles varient beaucoup dans leurs attaches
& leurs communications réciproques ; ils
font quelquefois fi fort confondus par ces fortes de
communications, qu’on a de la peine à les démêler
quand on n’eft pas au fait. Ils font en général plus ai-
fés à développer dans les enfans que dans le - adultes ,
& dans adultes que dans les vieillards. (Z). J . )
V e r t é b r a u x , les nerfs vertébraux, c’eft-à-dire
ceux qui partent de la moëlle épiniere,font au nombre
de trente paires , dont il y en a qu’on regarde
c0.m.me appartenons au co l, parce qu’ils tirent leur
origine de la partie de la moëlle fituée dans le canal
des vertebres du co l, & on les appelle par cette rai-
fon nerfs cervicaux ; d’autres au dos, qu’on appelle
dorfaux ; d’autres aux lombes, qu’on appelle lombaires
; & enfin d’autres à l’os facrum, nommés facrés.
^ o y e ^ C e r v ic a l , D o r s a l , L o m b a ir e & S a c r é ,
Les V ig zm Q n sv e r t'é b ra u x font tous ceux qui unifient
les vertebres entre elles. V o y e ç L ig a m e n t .
V E R T E B R E , f. f. (Anatom.} piece ofleufe dont
plufieurs font articulés de fuite le long de l’épine
& forment la compofition de la troifieme partie du
fquelette de l’homme.
L ’épine eft ordinairement compofée de vingt-quatre
vertebres, pièces mobiles appuyées fur l’os facrum.
Il y a fept vertebres pour le c o l, nommées cervicales,
douze pour le dos, cinq pour les lombes! '
Elles font de fubftance Ipongieufe, recouvertes
d une petite lame compaéle, avec un cartilage épais
entre le corps de chaque vertebre ; un grand trou fe
trouve au milieu de chacune pour le paflage de la
moëlle : elles ont quatre échancrures, enforte que les
vertebres étant appliquéés les unes fur les autres, ces
échancrures forment des trous par oîi s’échappent
latéralement vingt-quatre paires de nerfs.
On remarque dans chaque vertebre fon corps & fes
apophyfes: les apophyfes p.oftérieures font nommées
épineufes , & les latérales tranfverfes ; celles qui font
deflus & deflous des latérales , font appellées obliques
; ces dernieres fervent à articuler les vertebres les
unes avec les autres. Le corps des vertebres a une face
Y